Musée des familles,
juin et juillet 1842
ÉTUDES LITTÉRAIRES
Eugène Sue
Eugène Sue (1804-1857) atteint en 1842 un sommet de son œuvre : cette année-là commence la longue publication – elle s'étendra sur plus d'un an – des feuilletons des Mystères de Paris. Mais dans l'article qu'on va lire, c'est surtout à la première carrière de l'écrivain que s'intéresse Gautier. En effet, ce texte de 1842 est la reprise d'une étude publiée en 1836 dans la Chronique de Paris, la revue de Balzac. Sue était alors connu et apprécié pour ses romans maritimes à succès, et il avait entrepris une ambitieuse Histoire de la marine française (1835-1837, 5 vol.), occasion pour Gautier de régler ses comptes avec le genre maritime en général. En 1842, il ajouta une conclusion sur l'évolution de la carrière de Sue après 1836.
I
Un pauvre critique terrestre se trouve dans un cruel embarras quand il lui faut s'occuper d'un littérateur océanique comme M. Eugène Sue. Avant de pouvoir lire ses œuvres couramment, il est obligé d'apprendre par cœur le dictionnaire de marine et de se loger dans la tête le vocabulaire le plus formidable qui se puisse imaginer.
D'honnêtes écrivains de l'intérieur des terres sont parfaitement incapables de distinguer la proue de la poupe d'un vaisseau. Il en est même qui font, avec la plus bourgeoise sécurité, naviguer leurs poétiques embarcations, la quille tournée du côté du ciel ; car l'on ne sait guère en France de marine que ce que l'on apprend à l'Opéra-Comique et au Vaudeville : cela se borne à bâbord et à tribord, plus quelques jurons nautiques réservés depuis un temps immémorial à l'oncle marin, brutal et millionnaire. Il n'y a rien d'étonnant à cela ; la marine n'a jamais été en France un sujet de préoccupation nationale comme en Angleterre et en Amérique ; sans doute notre marine est belle et grande, comme tout ce qui appartient à la France, mais la véritable force et la véritable gloire du pays ne sont pas là. Le roman militaire, si de pareilles catégories étaient acceptables dans l'art, serait assurément plus possible en France que le roman maritime.
Pour moi, j'avoue, dans toute l'humilité de mon âme, que je suis aussi ignorant à l'endroit des choses aquatiques qu'un rédacteur du Journal de la marine197, et je ne suis pas en état le moins du monde de chicaner M. Eugène Sue sur aucun point de la manœuvre. Je conviens, et je ne pense pas que personne me méprise pour cela, que j'avais vécu jusqu'à présent sans soupçonner ce que pouvait être une itague198 de palan.
Si M. Eugène Sue déploie les bonnettes199 hors de propos, s'il fait prendre un ris intempestivement, s'il place le tapecu200 et le foc où ils ne doivent pas être, s'il entortille maladroitement de braves cordages qui sont incapables de réclamer dans les journaux, que puis-je faire à cela ? Je n'ai pas la science qu'il faut pour stigmatiser convenablement de semblables énormités ; mais j'aime à croire que M. Eugène Sue a trop de conscience pour tromper d'innocents lecteurs et de plus innocents critiques. Dans une matière qu'il traite avec un acharnement spécial, il faut s'en remettre à son exactitude et à son honnêteté là-dessus, à peu près comme pour des dissertations d'érudits, hérissées de passages chaldéens, syriaques, hébreux ou chinois, qu'on est forcé de trouver exacts sur parole. Quel est le feuilletoniste qui peut dire s'il y a des contresens ou non dans les traductions de M. Stanislas Julien201 ?
Ce qui est accessible à toute critique, c'est le style, le drame, l'intention philosophique, la donnée et le genre des ouvrages de M. Sue.
Je ne crois pas qu'il puisse y avoir une littérature proprement dite maritime ; c'est une spécialité beaucoup trop étroite, quoiqu'elle ait, au premier aspect, un faux air de largeur et d'immensité. La mer peut fournir quatre ou cinq beaux chapitres dans un roman, ou quelque belle tirade dans un poème ; mais c'est tout. Le cadre des événements est misérablement restreint : c'est l'arrivée et le départ, le combat, la tempête, le naufrage ; vous ne pouvez sortir de là. Retournez tant que vous voudrez ces trois ou quatre situations, vous n'arriverez à rien qui ne soit prévu. Un roman résulte plutôt du choc des passions que du choc des éléments. Dans le roman maritime l'élément écrase l'homme. Qu'est-ce que le plus charmant héros du monde, Lovelace202 ou don Juan lui-même, sur un bâtiment doublé et chevillé en cuivre, à mille lieues de la terre, entre la double immensité du ciel et de l'eau ? L'Elvire de M. de Lamartine aurait mauvaise grâce à poisser ses mains diaphanes au goudron des agrès. La gondole du golfe de Baya203 est suffisamment maritime pour une héroïne. Le drame n'est, du reste, praticable qu'avec les passagers. Quel drame voulez-vous qu'on fasse avec des marins, avec un peuple sans femmes ! Quand vous les aurez montrés dans l'ivresse et dans le combat, tout sera dit. Un romancier nautique, avec son apparence vagabonde et la liberté d'aller de Brest à Masulipatnam204, ou plus loin, est en effet forcé à une unité de lieu beaucoup plus rigoureuse que le poète classique le plus strictement cadenassé. Un vaisseau a cent vingt pieds de long par trente ou quarante de large, et l'écume a beau filer à droite et à gauche, les silhouettes bleues et lointaines des côtes se dessiner en courant sur le bord de l'horizon, l'endroit où se passe la scène n'en est pas moins toujours le même, et la décoration aussi inamovible que le salon nankin des vaudevilles de M. Scribe205 : que l'on soit à fond de cale, à la cambuse, à l'entrepont, aux batteries ou sur le tillac, c'est toujours un vaisseau.
Il est vrai que l'auteur peut mettre ses personnages à terre ; mais que voulez-vous que fassent des gens qui débarquent, si ce n'est d'aller au cabaret ou dans quelque endroit équivalent ? On ne fait pas connaissance avec le monde en cinq ou six jours, et une action n'a pas le temps de se nouer et de se dénouer dans un si court espace. Ou si, pour parer à cet inconvénient, l'auteur laisse ses personnages sur le terrain ordinaire de toute action dramatique, ce n'est plus un roman maritime, c'est un roman aussi terrestre que le premier venu. Le pauvre vaisseau qui est là dans le port ne demande qu'à partir, il bondit d'impatience comme un cheval qu'on tient en bride, et, en vérité, c'est péché que de faire perdre une si bonne brise à ces braves matelots, sous prétexte que le héros n'a pas encore eu le temps d'attendrir sa divinité et de pousser son aventure à bout. Cette pointe obligée de mât qui perce toujours au-dessus de l'action produit l'effet le plus désagréable et le plus impatientant.
À part ces impossibilités naturelles au genre, je ne pense pas que les habitudes excentriques et particulières d'une profession puissent suffire à défrayer une branche de romans. Où cela s'arrêterait-il ? M. Eugène Sue fait des romans dont les personnages sont nécessairement des marins. Demain, un autre s'arrogera le monopole des romans en diligence ; l'intérieur, la rotonde, l'impériale, remplaceront la dunette, l'entrepont et le hunier ; à la place du facétieux cambusier racontant l'histoire du voltigeur hollandais ou des trois cochons, vous aurez M. J. Prudhomme206, ou un commis voyageur parlant de ses aventures. Les ports seront des auberges, et au lieu de sombrer on versera. Ce roman est aussi faisable que l'autre. Ni l'art ni le roman ne sont là, mais bien dans le développement des passions éternelles de l'homme.
Quant au mérite de l'idée première, elle n'appartient pas à M. Eugène Sue. Elle revient de droit à M. Fenimore Cooper, quoique Smollett207 eût déjà tracé dans ses romans des caractères de marins. Le Pilote, Le Corsaire rouge sont et, demeureront, je pense, les chefs-d'œuvre du genre. Cooper l'Américain, né sur un sol vierge et à peine défriché, excelle à peindre la lutte de l'homme avec la nature ; il y a une admirable placidité de lignes dans les horizons de ses tableaux dont le charme est inexprimable, et un austère parfum de plantes sauvages s'exhale de tous les feuillets de ses livres. Les plus beaux romans de Cooper sont composés avec des éléments d'une simplicité extrême. C'est habituellement une poursuite à travers une savane ou une forêt vierge, une intelligence surmontant des obstacles matériels ; la barbarie qui cède avec regret et pied à pied ses larges solitudes à la civilisation. Les personnages n'apparaissent que comme des points blancs ou rouges sur le fond d'outremer des lointains, ou sur le vert sombre et dur des ébéniers centenaires. Cependant, malgré leur petitesse relative, par leur énergie et leur résolution, ils dominent cette gigantesque nature, et c'est là la source de l'intérêt sublime et profond qui s'attache au Dernier des Mohicans, à La Prairie208. L'orgueil humain est intimement flatté de cette victoire, et s'en réjouit par esprit de corps. Cette disposition rendait Fenimore Cooper plus propre que tout autre à réussir dans le roman maritime. Son pinceau, sobre de teintes, rend avec une justesse admirable ces effets de ciel et d'eau où quelques petits filaments noirs se dessinant à l'horizon plus minces et plus frêles que des fils d'araignées, annoncent seuls la présence de l'homme. L'idée qui éclate à chaque page est celle exprimée par le proverbe breton : « Ma barque est si petite et la mer est si grande ! » De là vient tout l'intérêt. Le style tumultueux et brillanté de M. Eugène Sue est bien loin d'atteindre à l'émotion que produit cette tranquillité de couleur et cette sévérité de touche presque puritaine.
M. Eugène Sue, comme il le dit lui-même, a tenté de mettre en relief des prototypes : dans Kernok le pirate, dans Le Gitano le contrebandier, dans Atar-Gull le négrier, dans La Salamandre le marin militaire209.
Avec toute la complaisance imaginable, et malgré l'amour un peu platonique parfois que M. Eugène Sue professe pour la vérité vraie, il est difficile d'admettre le Gitano comme le type exact du contrebandier réel ; ce marin équestre, avec son petit cheval Ikar, me semble avoir de bien singulières allures. Il sent diablement son Conrad et son Giaour210, et j'ai peine à allier son lyrisme effréné à son commerce frauduleux de soieries ; il est vrai que la scène est en Espagne, et, s'il faut en croire nos romanciers, l'Espagne est un pays privilégié du ciel, où l'on se poignarde continuellement ; et où la plus mince fille rendrait des points pour la férocité à la plus sauvage tigresse ; ce brigand très lettré déclame contre la société et fait de superbes raisonnements. Il a bien quelques légères peccadilles à se reprocher ; mais qu'est-ce que cela ? Une douzaine de meurtres tout au plus, à peu près autant de sacrilèges ; il a conspiré je ne sais combien de fois. Vous conviendrez que la société se montre bien insociable en repoussant un pareil homme de son sein. Notre poétique contrebandier se laisse maladroitement surprendre et finit par subir le supplice du garrot en place publique. Là-dessus, un certain Fasillo, qui remplit l'office de Kaled auprès de ce Lara211, indigné du supplice de son vertueux maître, jure une haine mortelle à l'espèce humaine, s'en va à Tanger, charge sa tartane212 de marchandises pestiférées et l'échoue devant Cadix, où elle est pillée par la populace. Une affreuse épidémie se déclare ; vingt-cinq ou trente mille personnes meurent de la contagion.
Assurément, ce n'est pas nous qui inquiéterons un estimable romancier pour quelques douzaines de meurtres de plus ou de moins. Nous savons la difficulté de tenir éveillé le public d'aujourd'hui, ce vieux sultan usé et cacochyme ; nous ne voulons pas réduire un auteur au pâturage d'épinards et aux moutons poudrés à blanc de l'idylle Pompadour ; nous permettrons volontiers à M. Eugène Sue des choses que l'on n'eût certainement points passées à M. le chevalier de Florian, d'innocente mémoire213. Cependant, il conviendra lui-même qu'il abuse légèrement de la tuerie, et, sans être précisément de l'opinion de Candide, et sans voir tout en beau, il nous permettra de croire que les hommes même les plus scélérats ne sont pas aussi scélérats qu'il nous les représente. – Le capitaine Kernok, pour récréer son équipage, met le feu à un vaisseau qu'il a capturé, et fait griller dedans trois ou quatre douzaines d'Espagnols dûment ficelés et garrottés : ceci me paraît exorbitant. Kernok, il est vrai, est pirate, et les pirates se permettent des choses qui feraient saintement horripiler notre conscience bourgeoise. Néanmoins, sans exiger d'eux une innocence de jeune pensionnaire, j'aime à croire qu'ils ne se livrent pas aussi facétieusement à des atrocités gratuites. Je veux bien encore passer à Kernok, attendu que c'est un homme un peu violent et dont l'éducation a été visiblement négligée, sa plaisanterie hasardée des trois douzaines d'Espagnols rôtis tout vifs. Mais que le capitaine Brulart214, qui a été comte et homme du monde, fasse jeter un pauvre diable à la mer sur une cage à poulets, avec deux négresses mortes, et commette à tort et à travers une multitude d'assassinats, le tout parce que sa femme l'a trompé, je soutiendrai, dussé-je passer aux yeux de M. Eugène Sue et du monde entier pour l'optimiste de Collin d'Harleville215, que c'est une misanthropie au moins exagérée, et que si tout homme mystifié se livrait à de pareils massacres, le monde serait dépeuplé depuis bien longtemps.
La vengeance est le mobile de tous les héros de M. Eugène Sue ; néanmoins, les héros de M. Sue dépassent dans leurs vengeances toutes les proportions humaines.
Je sais vivre comme un autre, j'ai de l'indulgence, et personne à coup sûr ne m'accusera d'être prude et petite maîtresse. Mais les hommes pâles de M. Sue ne s'arrêtent pas à de pareilles simplicités et ne s'amusent pas aux bagatelles de la porte216. Ils sont si prodigieusement excessifs, que je ne puis m'empêcher de me hérisser un peu, et de réclamer en faveur de l'humanité dont je ne suis cependant pas éperdument épris.
Le nègre Atar-Gull, avec ses grosses lèvres bouffies et ses grands yeux blancs, est aussi faux dans son genre que le berger Némorin217 avec sa culotte vert pomme et sa houlette garnie de roses pompons. C'est l'exagération inverse, voilà tout. Encore la haine d'Atar-Gull est-elle à la rigueur explicable ; mais Szaffie218 ! mais le capitaine Brulart ! mais la duchesse d'Alméida219 ! M. Szaffie, non moins féroce sous des airs doucereux que ses anthropophages prédécesseurs, imite trop visiblement les héros de l'école satanique !
Si toutes ces ogreries étaient représentées comme des légendes et avec le frisson de terreur superstitieuse qui saisit le lecteur dans Han d'Islande ou dans Melmoth220, et non pas comme des reproductions exactes d'une vérité absolue, je les admettrais sans sourciller, et j'aurais examiné tout d'abord la valeur de l'exécution poétique. Car, de ce que l'on s'égorge avec un acharnement incroyable dans les romans de M. Sue, je n'inférerai pas, comme beaucoup de critiques bénévoles, que M. Eugène Sue s'est reflété dans ses personnages, et que c'est un homme systématiquement sanguinaire ; je lui accorde de plus toutes les vertus sociales et domestiques.
Dans les romans de M. Sue il y a deux styles bien distincts, le style parlé et le style écrit ; l'un bon et l'autre inégal ; l'un chaud, vif, libre, naturel ; l'autre parfois tendu jusqu'à rompre. Les figures secondaires, les dialogues des matelots, et tous les endroits auxquels M. Sue n'a pas l'air d'attacher d'importance, sont exécutés dans la seconde manière. Dans ces passages, la vérité même du fond commande impérieusement la vérité de forme. Les descriptions, les marines proprement dites, les mers, ressemblent à celles de Gudin221 ; ce sont des mers de convention, beaucoup trop coquettement échevelées avec des vagues qui ont l'air de feldspath ou de cristaux irisés, une écume d'ouate et des navires d'un ton beaucoup trop bitumineux.
Maintenant passons à l'éloge.
II
Nous avons été bien sévère, comme on doit l'être envers tout artiste d'un talent supérieur. M. Eugène Sue peint parfaitement surtout lorsqu'il ne veut pas peindre ; il a du talent par les côtés où il ne croit pas en avoir. Il possède à un degré assez haut le sentiment comique ; s'il voulait tourner cette puissance vers le théâtre, il y réussirait, je n'en doute pas. Le marquis de Longetour222 est une vraie création, c'est un type. Ce brave débitant de tabac, forcé par sa femme acariâtre et ambitieuse d'accepter le commandement d'une frégate, et ne sachant comment s'y prendre, est plaisamment présenté : il est dommage qu'à la fin ce portrait dégénère en caricature. Cette peinture ne manque pas de profondeur et résume assez bien les premières années de la Restauration : beaucoup d'autres physionomies sont fermement indiquées. Maître Buyk, Daniel le philosophe et son chien, le lieutenant Thomas, le docteur Gédéon, le mousse Grain-de-Sel, le maître canonnier Kergouet, ont le piquant et la finesse des pochades de Charlet. Ils vivent bien, ne se ressemblent pas, et font rire. Il n'y a guère que les héros et les personnages importants qui soient ennuyeux chez M. Eugène Sue, défaut qui lui est commun avec bien d'autres romanciers, et que Walter Scott lui-même n'a pas toujours évité.
Outre cette haute qualité, M. Eugène Sue en possède encore une autre non moins importante : il a de la vie ; une vie un peu turbulente et un peu fouettée, mais enfin c'est de la vie, et n'en a pas qui veut. Ces deux choses suffisent pour le séparer du commun des faiseurs de romans. Ses œuvres maritimes ont eu du succès et ont encore des imitateurs.
M. Eugène Sue, ennuyé de demander à l'invention le type des Brulart, des Szaffye, et de tous ces mannequins démoniaques dont il fait tirer les fils par une fatalité aveugle, ennuyé aussi de s'entendre accuser d'un pessimisme systématique, s'est jeté du roman dans l'histoire.
Mais au lieu d'échapper à cette obsession d'idées sombres et sanglantes, il trouva au contraire dans ses nouvelles études de quoi corroborer sa conviction première, c'est-à-dire que le crime n'était pas toujours puni et la vertu récompensée aussi régulièrement que dans les mélodrames du beau temps de la Gaîté, aux jours où florissait le patriarcal M. Marty223, découverte tout à fait neuve et du plus grand intérêt. M. Eugène Sue, et ceci démontre une âme belle et généreuse, s'indigne outre mesure de ce que les faibles soient écrasés par les forts, que la corruption effrontée et cynique l'emporte sur la vertu simple et modeste ; mais ce n'est pas d'hier qu'est écrite la fable du loup et de l'agneau, et il y a fort longtemps déjà que Caïn a tué Abel. Qu'y faire ? il n'est à cela qu'un seul remède : la rémunération, après la mort, du bien ou du mal, dans l'enfer ou dans le paradis. La moralité de la comédie humaine ne se joue pas dans le monde, et le quatrain sentencieux n'est pas toujours gravé au bas de l'apologue.
M. Eugène Sue était plus que tout autre à même de faire une bonne histoire de la marine, et par ses connaissances spéciales, et par ses relations avec de hauts personnages, qui ont mis complaisamment à sa disposition des matériaux de la plus grande importance, entièrement inédits ; matériaux si complets, qu'ils rendent pour ainsi dire le travail de M. Eugène Sue inutile, et qu'il eût suffi de les transcrire et de les coordonner.
« Que puis-je écrire, comme il le dit lui-même, qui vaille les naïfs récits de Jean Bart sur ses combats ? Où trouvera-t-on plus d'éclat et d'éblouissant esprit que dans ces lettres si gaies, si brillantes, confidences moqueuses de M. le marquis de Grancey et de M. le chevalier de Valbelle, à propos de chaque action où leurs vaisseaux venaient d'assister ? Qu'y a-t-il de plus noble que ces Mémoires de M. le vice-amiral comte d'Estrées224, pages toutes empreintes du grand langage du XVIIe siècle ?
« Aussi est-ce avec une singulière émotion que je touchais et que je lisais ces feuilles manuscrites jaunies par tant d'années, en songeant que tout cela avait été écrit à bord, après le combat, à l'odeur de la poudre brûlée ; là, sur un canon renversé et fumant encore ; ici, sur un tronçon de mât criblé par la mitraille ; et, je l'avoue, j'éprouvai quelque chose de saisissant lorsque après avoir déplié cette admirable lettre du chevalier Desardent, un des héros et l'une des victimes du combat de Solbay225, je remarquai au bas de celle feuille épaisse et dorée sur les tranches, une large tache de ce généreux sang qui venait de couler si noblement.
« Et que dire encore de ces précieux bulletins adressés par le duc d'York à Charles II, son frère, et de ces relations du prince Rupert, et de ces mémoires de Colbert de Terron et d'Imfreville, remplis de tant de faits et d'inappréciables détails sur la législation et la construction maritime de cette époque226 ? »
Walter Scott est mort ; Dieu lui fasse grâce, mais il a introduit dans le monde et mis à la mode le plus détestable genre de composition qu'il soit possible d'inventer. Le nom seul a quelque chose de difforme et de monstrueux qui fait voir de quel accoutrement antipathique il est né ; le roman historique, c'est-à-dire la vérité fausse ou le mensonge vrai.
Cette plante vénéneuse, qui ne porte que des fruits creux et des fleurs sans parfum, pousse sur les ruines des littératures ; elle est d'aussi mauvais présage que l'ortie et la ciguë au bas d'un mur ; car on ne la voit jeter à droite et à gauche ses rameaux d'un vert pâle et maladif que dans les temps de décadence et aux endroits malsains. Cela prouve tout simplement qu'un siècle est dénué de jugement et d'invention, incapable d'écrire l'histoire et le roman : deux choses aussi ennemies ne peuvent se rechercher et se lier ensemble qu'à la dernière extrémité.
C'est une imagination aussi heureuse que celle des vers prosaïques et de la prose poétique. Sommes-nous donc en effet tombés à ce point de frivolité et d'insouciance que nous soyons hors d'état de comprendre et d'admirer un ouvrage fait sérieusement et consciencieusement ? Ne sommes-nous donc bons qu'à écouter des contes bleus ou rouges ? et ne regardons-nous que les livres où il y a des images ? Avons-nous en effet le goût si horriblement blasé et faussé que nous ne prenions goût et ne soyons sensibles qu'aux vins mêlés d'alcool et aux épices les plus irritantes ?
Animer et colorer, telle a été l'intention de M. Eugène Sue ; faire ressortir le côté pittoresque de l'histoire, c'est-à-dire donner aux détails caractéristiques une importance si grande que le trait primitif disparaît presque complètement : procédé réprouvé de tous les grands maîtres, et qui n'est en vogue que depuis quelques années.
L'auteur a choisi la vie de Jean Bart pour le début de son ouvrage. Jean Bart, né en 1650, mort en 1702, a pris part à toutes les grandes actions maritimes sur l'Océan, et sa biographie est un cadre naturel où les figures de Tourville, de Grancey, de Forbin, d'Estrées et de Duquesne227 trouvent place chacune à leur tour et se dessinent à leur plan.
Le vocabulaire maritime de cette époque ne diffère pas assez complètement de celui en usage de nos jours pour être tout à fait inintelligible ; cependant il contient assez de mots inaccoutumés pour pouvoir servir de transition au langage nautique du XVIe siècle, qui est entièrement autre, ainsi qu'on peut le voir par l'admirable scène de la tempête de Rabelais dans Pantagruel228. Cette considération a engagé M. Eugène Sue à commencer par la fin au lieu de commencer par le commencement ; je ne sais pas jusqu'à quel point il est commode d'entreprendre une maison par le toit et de l'achever par la cave. Cela le regarde. Cependant de cette manière on voit les résultats avant de voir les causes, et la suite logique des faits est singulièrement intervertie. Mais ces considérations devaient céder à cet inconvénient majeur de la plus ténébreuse inintelligibilité. En effet, si le vocabulaire actuel est compréhensible pour si peu de personnes, que sera-ce donc quand à la science d'un officier de marine il faudra joindre la science d'un archaïste spécial ?
Est-ce une histoire ou un roman historié que M. Eugène Sue a voulu faire ? Le premier chapitre du livre a plutôt l'air d'un début de roman, comme La Salamandre ou Atar-Gull, que d'une histoire sérieuse, ou même d'une chronique familière ; on y voit une mise en scène tout à fait mélodramatique et inutile de l'intérêt que les bourgeois de Dunkerque portaient à maître Cornille Bart, le père de Jean ; des descriptions à n'en plus finir de costumes et de meubles, comme dans le roman le plus minutieusement détaillé de l'école de Walter Scott ; le tout entremêlé de récits héroïques sur les prouesses du Renard de la mer, et de quolibets interminables du vieux matelot Haran Sauret, type grimaçant et grotesque, qui serait beaucoup mieux placé dans l'entrepont de la Sylphide229. Le reste du volume est rempli par l'inventaire des curiosités du cabinet de Lyonne230 et de Colbert, des facéties de Cavoye231, des procès-verbaux et des mémoires qui n'ont pas la moindre liaison avec le reste du texte, et c'est à peine si la figure du grand roi, qui devrait dominer tout l'ouvrage, apparaît une seule fois, sous un aspect frivole, caressant les chiennes épagneules, et respirant des parfums comme une petite maîtresse vaporeuse, au risque de donner la migraine à son ministre.
M. Eugène Sue promet, dans sa préface, de dévoiler les véritables causes de la guerre, inconnues jusqu'ici, et de faire toucher au doigt les motifs, mesquins en apparence, qui ont eu de si grands résultats. Il donnera peut-être plus tard les explications qu'il tient en réserve ; mais, quoique j'aie lu les volumes fort attentivement, il m'a été impossible d'y voir autre chose que des tripotages diplomatiques qui prouvent que la clef d'or de M. Viennet ouvrait en ce temps-là autant de consciences qu'aujourd'hui232, et que les gouvernants qui comptent sur la corruption humaine comptent rarement sans leur hôte.
Ce qui manque surtout à cette composition, c'est l'ordre et la clarté ; les pages ont très souvent un rez-de-chaussée d'annotations si considérables que les étages de lignes supérieures sont réduits à une proportion beaucoup trop restreinte, et que le texte réel n'a l'air que de la glose des notes. Tous ces détails rejetés au bas des feuilles ou à la fin du volume devraient être harmonieusement fondus dans le récit ; car des documents entassés pêle-mêle ne sont pas plus une histoire qu'un tas de moellons n'est un palais : avec des moellons et des documents on peut faire un palais ou une histoire, à cette condition toutefois d'être historien ou architecte : M. Sue est peut-être bon architecte.
Sans approuver complètement les gens qui font de l'histoire à vol d'oiseau et contemplent les siècles du haut des pyramides, je ne suis pas non plus partisan de ces infatigables déterreurs de chartes et de mémoires, de ces hyènes scientifiques qui vont exhumant du tombeau des archives les squelettes poudreux des personnages les plus insignifiants. Je pense que le procès-verbal n'est pas du domaine de l'histoire, et que l'on doit se contenter d'en extraire le sens général des événements.
M. Eugène Sue, avec un laisser-aller qui n'est pas sans quelque fatuité littéraire, dit en finissant son introduction que son travail n'a été qu'un travail de longue patience et d'oisiveté, un de ces labeurs indolents où l'imagination s'engourdit, une de ces occupations presque mécaniques qu'on est si heureux de se créer pour échapper à la lourde monotonie des heures, ou à l'impuissante irritation de la pensée. Il me semble qu'une histoire complète de la marine française ne doit pas être un de ces labeurs indolents où l'imagination s'engourdit, et que ce ne serait pas trop de toute la puissance d'esprit d'un homme bien éveillé pour en venir à bout.
Et, continuant ses modestes dépréciations, il ajoute que c'est une œuvre, en un mot, toute ressemblante à celle de ces artistes florentins qui copiaient en mosaïque les admirables pages de l'école italienne ; à force de petits morceaux de pierre de toutes couleurs, de toutes nuances, ils finissaient par fondre et harmoniser des teintes qui, vues de loin, reproduisaient assez naïvement l'aspect du tableau.
Une mosaïque bien exécutée a son prix, quoique nous préférions une toile touchée au pinceau. Malheureusement M. Eugène Sue n'est pas un artiste florentin. Il a bien rassemblé des milliers de petites pierres de différentes couleurs, mais il a oublié de les mettre en place, ou il les a disposées dans un linéament vicieux et incorrect, qui ne reproduit pas l'aspect du tableau original.
Cependant, avec tous ses défauts, l'Histoire de la marine, curieuse dans ses détails, a le mérite d'ouvrir la voie. Attacher le grelot233 est en toute chose une action périlleuse, et l'on ne peut que louer M. Eugène Sue d'avoir essayé de porter la lumière dans ce côté si peu exploré de nos annales. Une révision sévère, une fonte plus homogène des matériaux dans le texte, pourraient rendre l'Histoire de la marine un livre vraiment utile et remarquable.
Dans ces dernières années, M. Eugène Sue quitte l'océan, les vaisseaux et les marins pour les salons, le grand monde et le night-life de Paris : Arthur a été le premier roman de cette nouvelle série, qui promet d'être nombreuse, ou du moins fort volumineuse, car depuis le succès des Mémoires du diable, de Frédéric Soulié, les romans ne se permettent guère d'avoir moins de quatre ou six tomes in-8° : Clarisse Harlowe et Le Grand Cyrus vont bientôt être dépassés234. Arthur se fait remarquer par une analyse extrêmement vraie et très fine d'un caractère odieux mais malheureusement trop fréquent, celui d'un jeune homme élevé par un père misanthrope, qui lui donne à vingt ans toutes les défiances soupçonneuses d'un vieillard. Ainsi mis sur ses gardes, Arthur ne voit dans l'amitié, l'amour et le dévouement le plus sublime que des attaques indirectes à sa position ou à sa fortune ; il cherche et trouve à tout des motifs honteux et bas dont il s'autorise pour rendre malheureux et briser les cœurs qui se trouvent sur son passage. Ce portrait est tracé de main de maître ; et La Rochefoucauld, cet implacable analyste de l'égoïsme humain, n'a pas un scalpel plus tranchant et plus aigu.
L'Art de plaire235 a eu le triple succès du journal, du livre et du théâtre.
Quant à Mathilde, sa vogue même nous dispense d'en parler : depuis longtemps aucune publication n'avait obtenu une telle faveur. Le pessimisme de M. Eugène Sue a cette fois admis quelques anges pour contraste aux démons en gants blancs et en bottes vernies qu'il fait agir. Mathilde possède assez de vertus pour contrebalancer les vices de Lugarto. Chose inouïe ! Mathilde, qui n'a pas moins de six volumes et qui a paru d'abord par feuilletons dans La Presse, a tenu pendant six mois la curiosité parisienne en éveil.
Les Mystères de Paris n'ont point valu moins de succès au Journal des débats.
M. Eugène Sue, qui pourrait disputer à M. de Balzac le titre du plus fécond de nos romanciers, s'il modérait un peu sa plume toujours au galop, pourrait obtenir, dans la littérature, une place plus haute que celle qu'il occupe. Son succès près du public ne serait pas plus grand, car il n'a rien à désirer de ce côté-là ; mais il gagnerait aussi le suffrage de tous ceux qui ne lisent pas seulement par curiosité, et qui regrettent que les qualités d'imagination et d'observation qui n'ont jamais fait défaut à M. Eugène Sue, ne soient pas enchâssées dans un style plus pur, plus ciselé, plus littéraire enfin. L'approbation des artistes n'est pas moins nécessaire à un écrivain que celle du public.
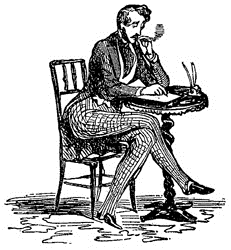
197 On ne sait pourquoi Gautier ironise sur ce fort sérieux « recueil mensuel de sciences et d'histoire » fondé en 1833, et qui selon son titre complet traitait « de la marine, des colonies, des consulats et des voyages ».
198 Mot féminin désignant notamment, en effet, le cordage qui passe sur une poulie pour soulever une charge avec un palan.
199 Petites voiles complémentaires hissées pour accélérer la marche du bateau.
200 Ou tapecul, petit mât arrière de certains voiliers.
201 Fameux orientaliste (1799-1873), professeur de chinois au Collège de France depuis 1832.
202 Séducteur plus cynique que « charmant » du roman de Richardson Clarisse Harlowe (1747-1748).
203 C'est-à-dire la baie de Naples, du nom de Baïes, ancienne ville romaine. « Le golfe de Baya » est la pièce XXI des Méditations de Lamartine.
204 Aujourd'hui Bandar, port de la côte orientale de l'Inde, pays où se déroule une grande partie de l'action d'un des romans maritimes de Sue, La Vigie de Koat-Ven (1834).
205 Dans son feuilleton de théâtre, Gautier se moque à répétition du « salon nankin » et du « salon pistache » du Gymnase, à l'en croire les deux seuls décors de ce théâtre (où sont jouées les œuvres de Scribe).
206 Héros du « Voyage en diligence » de Monnier (voir l'article p. 31).
207 Tobias Smollett (1721-1771), écrivain écossais, utilisa dans ses romans d'aventures les souvenirs de sa première carrière de chirurgien de la marine. L'Américain Fenimore Cooper (1789-1851) est aujourd'hui surtout célèbre comme peintre des Indiens, mais de son vivant ses romans de mer étaient fort appréciés, notamment les deux cités ici, Le Pilote (1824) et Le Corsaire rouge (1828).
208 Deuxième et troisième des cinq romans du « cycle indien » de Cooper (1826 et 1827).
209 Gautier cite les récits maritimes qui firent la première vogue de Sue : les nouvelles « Kernok le pirate » et « El Gitano » composent le volume Plik et Plok (1831) ; Atar-Gull (1831) et La Salamandre (1832) sont deux romans violents et hauts en couleur.
210 Deux héros de grands poèmes romantiques de Byron (Le Corsaire, 1814 ; Le Giaour, 1813).
211 Nouvelle allusion au Corsaire : Lara est le nom sous lequel se cache Conrad ; Kaled est son page.
212 Bateau à voile triangulaire utilisé en Méditerranée.
213 Gautier se moque souvent de cet auteur d'aimables fables et de pastorales (1755-1794), à qui l'on doit la célèbre chanson « Plaisir d'amour ».
214 Féroce corsaire, dans Atar-Gull.
215 Jean-François Collin d'Harleville (1755-1806), auteur de la comédie moralisante L'Optimiste (1788).
216 Aux préliminaires.
217 Personnage d'Estelle, œuvre de Florian (voir p. 124, note 1).
218 Personnage de La Salamandre.
219 Plus exactement Alméda, personnage de La Vigie de Koat-Ven.
220 Han d'Islande, premier roman publié de Hugo (1823), appartient à la même veine noire et frénétique que Melmoth l'homme errant (1820), roman terrifiant de l'Irlandais Charles Maturin (1782-1824).
221 Théodore Gudin (1802-1880), peintre de marines réputé en son temps, mais peu apprécié de Gautier.
222 C'est le capitaine incompétent, dans La Salamandre. Tous les personnages cités ensuite se trouvent aussi dans ce roman.
223 Jean-Baptiste Marty (1779-1863), acteur très populaire, joua le mélodrame à la Gaîté de 1802 à 1835.
224 De la famille des comtes de Grancey sont issus deux maréchaux, Jacques (1603-1680) et Léonor (1655-1725), mais ils combattirent sur terre ; le marquis évoqué ici doit être le fils du premier. Jean-Baptiste de Valbelle (1627-1681), chef d'escadre réputé pour son acharnement contre les Anglais, et Jean d'Estrées (1624-1707), nommé vice-amiral en 1669, sont plus aisément repérables.
225 Combat naval entre Hollandais, Français et Anglais, près de La Haye (7 juin 1672).
226 Gautier cite un passage de l'introduction de Sue (éd. de 1845, t. I, p. IX-X). Duc d'York : titre porté par le futur Jacques II jusqu'à ce qu'il succède à son frère Charles II en 1685 ; il fut grand amiral d'Angleterre de 1660 à 1673. Robert, dit le prince Rupert (1619-1682) : amiral anglais, neveu du roi Charles Ier, maître de la marine anglaise sous Charles II. Louis d'Imfreville (?-1708), commissaire général de la marine de Louis XIV, eut à travailler avec le grand ministre Colbert, à qui la marine doit son essor à cette époque.
227 Anne de Tourville (1642-1701), vice-amiral et maréchal de France, Grancey (voir p. 128, note 2), Claude de Forbin (1656-1733), compagnon d'armes de Jean Bart, et Abraham Duquesne (1610-1688) illustrèrent tous le règne de Louis XIV par leurs qualités de marins et de guerriers.
228 C'est bien Pantagruel qui subit cette tempête, mais l'épisode se trouve dans Le Quart Livre (chap. XVIII).
229 Nom du bateau dans La Vigie de Koat-Ven.
230 Sans doute le diplomate Hugues de Lionne (1611-1671), un des grands ministres de Louis XIV.
231 Louis Ogier, marquis de Cavoye (1639-1716), aide de camp de Louis XIV et courtisan très en vue.
232 Allusion non éclaircie à Jean-Pons-Guillaume Viennet (1777-1868), satiriste et littérateur proclassique.
233 Être le premier à se risquer (La Fontaine, « Conseil tenu par les rats », Fables, II, 2).
234 Clarisse Harlowe (voir p. 119, note 2) parut en sept volumes ; Artamène ou le Grand Cyrus, roman précieux de Madeleine et Georges de Scudéry, en dix (1649-1653). Le roman de Soulié Les Mémoires du diable est, lui, récent : six volumes en 1837-1838. Arthur, de Sue, date aussi de 1838 mais ne compte que deux volumes ; en revanche, Mathilde, mémoires d'une jeune femme, paru en 1841, en a six.
235 Aucune œuvre de Sue (et aucune pièce de théâtre du temps) ne porte pour titre L'Art de plaire ; peut-être s'agit-il d'un sous-titre, mais je ne vois pas à quel texte pense Gautier.