Préface
de Stanley Hoffmann

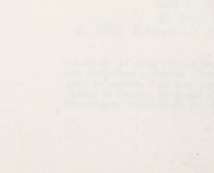
Voici un livre qui fera, je pense, parler non seulement de lui et de son auteur, mais surtout de son sujet : le régime de Vichy. Sans doute avons-nous, depuis vingt-cinq ans, été submergés de libelles, de mémoires, de plaidoyers, de témoignages et d'études partielles. Mais combien de tentatives sérieuses de dresser un bilan d'ensemble avons-nous pu lire ? Dix ans après la fin de la guerre d'Algérie, on peut discuter — passionnément sans doute, mais à fond — de cette page sanglante et tragique de l'histoire contemporaine. Vingt-huit ans après l'effondrement du régime du maréchal, le débat sur Vichy reste embarrassé : on a du mal à dépasser le cadre des vitupérations antagonistes, à s'élever au-dessus des propos qu'échangent, figés depuis plus d'un quart de siècle, procureurs et avocats dans les salles des cours de justice. Un colloque organisé, il y a un peu plus de deux ans, par la Fondation nationale des Sciences politiques, et les réactions provoquées par le film de Marcel Ophüls, le Chagrin et la Pitié (sans parler du film lui-même), ont montré qu'il n'était pas facile de traiter de ces quatre années terribles sans reproduire les divisions , les accusations, les suspicions qui les avaient marquées. Immanquablement, le débat tourne au psychodrame. Mais si, aujourd'hui, ceux qui ont vécu ces années-là restent trop profondément marqués par elles pour faire preuve de l'équité que réclame l'Histoire, ceux qui demain y parviendront peut-être ne paieront-ils pas cette sérénité d'un prix trop élevé ? Sauront-ils encore retrouver l'atmosphère,' le ton, le climat, inoubliables pour ceux qui y furent plongés, mais presque inconcevables pour ceux qui n'ont connu que les périodes moins exceptionnelles de l'après-guerre ?
La France de Vichy
Le livre de Robert Paxton est doublement précieux. D'abord, parce qu'il a été écrit par un jeune historien américain totalement dénué de préjugés. Il n'a pas vécu en France les événements qu'il analyse ici ; son premier livre, une étude approfondie de l'armée de Varmistice 1 , témoignait d'une objectivité parfaite, d'une documentation impeccable et d'un esprit aigu : rien n'était laissé dans l'ombre et l'éloignement de l'auteur — dans le temps et l'espace — ri entraînait ni sécheresse ni perte du sens de la réalité telle que l'avaient ressentie et vécue les contemporains. Sur un sujet qui remue encore trop profondément les Français, il est bon qu'un miroir leur soit tendu par un auteur étranger ; mais il est important que le Français — parfois chauvin quand il s'agit d'études sur la France — ne puisse récuser cet audacieux. M. Paxton est un spécialiste de l'histoire de la France moderne et contemporaine qu'il enseigne à Columbia University ; il a fait de longues recherches en France ; son travail est fondé sur des sources irréfutables. Il a eu la curiosité (que n'ont pas montrée la plupart des spécialistes français) d'aller consulter les archives allemandes et américaines — non publiées mais accessibles aux chercheurs — et il y a trouvé d'amples traces des interventions et des propos de Vichy. Scrupuleusement, il indique les documents dont il s'est servi. On ne pourra lui reprocher ni parti pris initial, ni ignorance de son sujet, ni légèreté dans la recherche. Autrement dit, c'est sur le fond qu'il faudra le discuter.
Justement, c'est le fond qui est le plus remarquable. Car cet observateur à la fois averti et non engagé, acéré et tempéré, dresse un bilan sinistre et soutient une thèse dévastatrice. Certes, son propos a des limites. L'histoire qu'il nous livre est, sur certains points, moins détaillée que celle de Robert Aron. Il s'agit d'une synthèse : Paxton va à l’essentiel. C'est avant tout de la politique suivie par les dirigeants de Vichy, et de la classe politique vichyste, qu'il est question. Paxton ne s'intéresse guère au collaboration-nisme parisien et ne s'attaque pas vraiment aux problèmes que posent l'étude de l'opinion publique, ou celle des actes et des effets
R. O. Paxton, Parades and Politics at Vichy (Princeton University Press, 1966).
Préface
11
du régime dans tel ou tel département. Il montre quelles furent les élites qui participèrent aux jeux, poisons et délices de l’Êtat français, et quels groupes sociaux bénéficièrent ou souffrirent de ses œuvres, mais il n’analyse pas l’ampleur et l’évolution des sympathies et des appuis sur lesquels le régime pouvait compter dans les diverses catégories sociales. Dans le cadre même de son étude, certains éléments ne sont pas nouveaux. Paxton n’est pas le premier à souligner les contradictions internes du régime, la multiplicité des tendances rivales. Mais mieux que personne, il montre que Vichy représentait moins le triomphe suranné des contre-révolutionnaires que la résurgence d’un libéralisme conservateur et antidémocrate — la droite orléaniste étudiée par René Rémond — qui accepte bien la Révolution française, mais seulement jusqu’en 1791. Paxton n’est pas le premier à affirmer que Vichy fut la revanche des minorités et des notables, mais mieux que personne il montre la prépondérance des experts, des technocrates, des hauts fonctionnaires sur les idéologues. Il n’est pas le premier à indiquer la continuité entre Vichy et l’après-guerre sur bien des points, mais mieux que personne il montre celle des grands corps de l’État et des hommes d’affaires.
Sur deux points capitaux , l’apport de Paxton est révolutionnaire. D’abord, la thèse : il n’y a eu ni double jeu, ni passivité (ni a fortiori, demi-résistance) d’un Vichy attentiste ; il y a eu une constante et illusoire politique de collaboration, une offre maintes fois renouvelée au vainqueur nazi : en échange d’une reconnaissance par l’Allemagne de l’autonomie politique de Vichy et d’un assouplissement de l’armistice, la France s’associerait pleinement à l’« ordre nouveau » et jouerait le rôle d’un brillant second —- partenaire impérial et naval de la puissance dominante. C’est Hitler qui n’a pas voulu de la collaboration ainsi proposée et quémandée ; nous le savions déjà grâce aux travaux d’Eberhard Jackel 2 . Ce que nous ne savions pas, c’est l’ampleur et la ténacité des efforts et des offres de Vichy. Paxton les révèle, preuves en main. Il montre ainsi le fatal engrenage : moins les Allemands mordaient à l’hame-
La France de Vichy
çon, plus Vichy y dans Vespoir de concessions allemandes, anticipait en quelque sorte et collaborait quand même — et faisait ainsi doublement le travail des Allemands, dispensés d’avoir à se charger eux-mêmes de la besogne, ou bien trouvant le terrain tout préparé pour eux, là où ils décidaient de s’en charger après tout.
Bien sûr, les défenseurs de Vichy contesteront la thèse. Diront-ils que toutes ces promesses et requêtes trouvées dans les archives allemandes prouvent seulement que, s’adressant à l’occupant tout-puissant, les autorités de l’Êtat français, pour obtenir quelque chose au comptant, étaient bien obligées de faire des promesses à terme, mais sans intention de les tenir ? Hélas, Paxton non seulement montre qu’à chaque fois, et toujours en vain, Vichy procédait à un commencement de livraison, faisant ainsi crédit aux nazis, mais surtout il explique que, parlant aux diplomates américains à Vichy, Pétain tenait le même langage qu’aux Allemands : la collaboration était voulue, l’ordre nouveau accepté. Les critiques de Paxton diront-ils alors que les offres de service étaient peut-être et maladroites et sincères, mais nullement criminelles, puisqu’il y avait tout lieu, en juin 40, de croire à la victoire allemande, et bien des raisons, deux ans plus tard, de redouter celle de l’URSS ? La raison d’Êtat n’exigerait-elle pas que des gouvernants avisés agissent de façon à donner à la France les meilleures cartes possibles dans la perspective d’une Europe sauvée du bolchevisme mais dominée par l’Allemagne ? Mais, pour justifier cette politique-là, il faut tout simplement faire abstraction du contexte. Vichy, ce n’était pas la Prusse après Tilsit. Hitler n’était pas Napoléon... Les rebuffades répétées du Führer montraient bien quel cas il faisait de la France écrasée ; et là ou la Prusse battue s’était engagée dans la voie de la modernisation et des réformes pour la revanche, Vichy oscillait entre l’utopie réactionnaire et la rationalisation industrielle au service de l’occupant. Pour chercher malgré tout à faire prévaloir sa politique, il aurait fallu, à Vichy, une froide volonté de chantage et une capacité de marchandage, dont Paxton souligne précisément l’absence : avant novembre 1942, Vichy ne pouvait menacer Hitler avec les armes qui restaient au régime — la flotte et l’Afrique du Nord — parce que l’usage de ces armes (c’est-à-dire la reprise
Préface
13
de la guerre par la France) était justement ce que Vichy voulait à tout prix éviter. Après novembre 1942, Vichy n'avait plus rien, sauf, hélas, sa volonté de durer, qui servait les desseins des Allemands. L'histoire des rapports entre Vichy et les nazis est un parfait répertoire d’antidiplomatie. La politique des offres de collaboration ne reposait pas seulement sur une hypothèse fausse (la victoire allemande ou l’hégémonie de l'Allemagne sur le continent après une paix de compromis) et sur des espérances absurdes (Pétain médiateur, ou la France capable d'arracher une vraie « souveraineté interne » au prix d'un alignement sur la politique extérieure du Reich). Elle acceptait, en fait, de vendre l'âme du pays, de sacrifier ses idéaux, en échange de concessions matérielles douteuses et révocables. Pour que ce pari eût un sens , il aurait fallu une autre Allemagne. Face à l'Allemagne hitlérienne, il n'y avait pas moyen de rassembler les Français derrière une telle gageure. Les chantres du retour au réel en furent réduits aux exhortations et aux imprécations : si seulement Hitler voulait bien... si seulement les Français n'écoutaient point les Alliés, les gaullistes et les communistes et les nostalgiques de la liberté... si seulement l'alliance des Anglo-Saxons et des Russes éclatait... L'Allemagne étant ce qu'elle était, les Français étant ce qu'ils étaient, une politique qui présupposait la bonne volonté éclairée de l’une et l'unanimité aveugle des autres était le comble de l'irréel. Si, tout au long de la guerre, il y eut malgré tout un bout d'épée français dans la grande Alliance, ce ne fut certes pas du fait de Vichy...
Pour justifier cette politique-là, il faut aussi faire abstraction des résultats. Et c'est là que le bilan dressé par Paxton est particulièrement accablant. Si l'épée de la France, du fait de Vichy, resta bien courte, le « bouclier » de Vichy fut plutôt une haire, ou la tunique de Nessus. Un régime fondé sur la hantise de l'ordre, décidé à sauver la France de la guerre afin d'empêcher le chaos et la subversion, aboutit à la guerre civile. Un régime dont les défenseurs affirment qu'il a épargné à la France les horreurs de la « polonisa-tion », n'a finalement ni assuré à la nation un niveau de vie ou d'inflation meilleur que celui des autres États occupés d'Europe occidentale (le vrai cadre de référence, comme le souligne Paxton),
La France de Vichy
ni évité en 1943 des déportations d’ouvriers pires que celles — justement — qui sévissaient en Pologne ; et si dans la sinistre comptabilité de la « solution finale », la France ne fait pas trop mauvaise figure, ce n’est pas à cause de Vichy ; comme le dit Paxton, c’est quelquefois malgré Vichy.
La thèse est-elle excessive, le bilan trop noir ? Le seul reproche qu’on pourra peut-être adresser valablement à Paxton, c’est d’avoir donné de Vichy une explication trop cohérente. Tout ce qu’il dit est juste, mais derrière les grandes lignes qu’il dégage si bien, combien de velléités, de coups de barre, de changements de cap (ou de chemise), de contradictions non seulement entre groupes et services, mais dans le for intérieur même de chacun des principaux acteurs ! Derrière les idées générales et les grands desseins, combien de petites mesures, au coup par coup et au jour le jour. Mais si c’est un reproche à Paxton, c’est aussi un reproche supplémentaire à Vichy... La direction des grandes lignes et la logique des grands desseins furent bien celles qu’il décrit. Si Vichy ne fut point tout aussi sinistre qu’il le donne à penser, ce n’est pas tant à cause de bonnes volontés ou de dévouements qu’il néglige, que du fait d’impuissances, d’incohérences, d’inconséquences qui parfois brisèrent les lignes et noyèrent les desseins.
Pour l’essentiel, il sera difficile de réfuter la conclusion de l’auteur : voulant sauver l’État, Vichy a failli perdre la nation et l’État. La grandeur de la résistance, c’est d’avoir sauvé l’honneur de la nation. La grandeur du général de Gaulle — dont le réalisme à long terme fut justement l’inverse de l’irréalisme et de l’incohérence de Vichy — c’est d’avoir su désobéir à l’État du maréchal pour sauvegarder l’avenir de la nation et pour reconstituer un État. Si le bilan dressé par Paxton ressemble à un règlement de comptes, ce n’est pas la faute d’un historien scrupuleux : c’est celle de la vérité.
Prologue : été 1940
Nous avons perdu en quelques jours toute sécurité et sommes sur une pente épouvantable et irrésistible. Rien de ce que Von peut craindre n’est chimérique et l’on peut absolument tout craindre, tout imaginer.
Paul Valéry, 18 juin 1940.
Quiconque a vécu la débâcle de mai-juin 1940 ne s’est jamais tout à fait remis du choc. Les Français, persuadés qu’ils étaient de jouer un rôle particulier dans le monde, ont été sérieusement traumatisés par les six semaines qui ont consommé leur défaite. Atterrés par son effondrement, les alliés de la France se sont pris à douter qu’elle puisse encore s’opposer à l’expansion du nazisme. Même Hitler, que le général Ludwig Beck, chef de l’état-major, avait mis en garde en 1938 en lui assurant que l’armée française était « encore la plus forte d’Europe 1 », s’est trouvé pris de court, après la danse du triomphe qui fut tant photographiée lors de la signature de l’armistice à Rethondes, le 25 juin. Personne n’avait imaginé que les armées allemandes pouvaient atteindre les Pyrénées en six semaines ; la commotion en fut d’autant plus grave.
Ce livre ne traite pas, après bien d’autres, des causes de la chute de la France, mais de ce que les Français décidèrent de faire ensuite, deux questions difficiles certes à séparer. Ce qui s’imposait, tout d’abord ou presque, c’était de trouver un responsable à la défaite. Les Français de la Libération ont accusé les Français de Vichy d’avoir souhaité la victoire allemande et d’y avoir aidé pour favoriser leurs projets réactionnaires. Les Vichyssois ont accusé le Front populaire, « monstrueuse alliance du communisme moscou-taire, du radicalisme maçonnique et de la finance juive », d’avoir « précipité la France dans une guerre idéologique, après l’avoir
1. Wolfgang Forster, Ein General kàmpft gegen den Krieg (Munich, 1949), 84, 86, 92. Un éditorial du New York Times exprime une opinion analogue le 7 mai 1938.
La France de Vichy
affaiblie 2 ». Pour la gauche, la défaite s’incarnait dans des officiers profascistes fuyant vers l’arrière dans des voitures de l’armée, et des politiciens également profascistes allant de l’avant pour s’emparer du gouvernement. Pour la droite, elle s’identifiait à la funeste panique des 55 e et 71 e divisions d’infanterie qui laissèrent, le 13 mai, les panzers allemands franchir la Meuse près de Sedan, pensant que les troupes stationnées à Paris étaient truffées de communistes. Punir les coupables — ces deux séries de coupables — était en bonne partie ce que les Français voulaient faire « après », en 1940, puis en 1944-46.
Attribuer la défaite, puis le régime de Vichy, à la trahison ou à une cabale ne mène plus guère à rien. En ce qui concerne la défaite, les études les plus convaincantes effectuées des deux côtés montrent clairement qu’elle s’explique par des facteurs militaires classiques : les troupes étaient étirées en lignes trop minces le long de la Meuse, face aux Ardennes, où se porta le gros de l’attaque ennemie, et les communications trop lentes ont empêché les Français de savoir où s’exerçait la poussée la plus forte ; en outre, la stratégie statique adoptée voulait que les excellents blindés français et l’artillerie fussent disséminés sur une ligne de défense, au lieu d’être engagés pour contenir la percée allemande ; enfin, le moral de l’armée fléchissait. Ces soldats, tristes avatars des « poilus de la Grande Guerre » étaient le sous-produit indirect de la société et de ses politiciens, bien sûr, mais les causes directes de la défaite, qu’il s’agisse de politique ou de conjuration — trahison, cinquième colonne, matériel insuffisant ou médiocre, refus de combattre des communistes ou des fascistes —, ne sont que des épiphénomènes et point n’est besoin en tout cas d’y recourir pour expliquer l’issue des combats 3 .
2. Jean Berthelot, discours aux cheminots, 21 août 1941, Ministère public d Berthelot, 140.
3. Dans l’étude sur les campagnes allemandes qui fait autorité, Fall Gelb (Wies-baden, 1947), Hans-Adolf Jacobsen montre combien le plan allemand était risqué et les chefs nerveux. Il ressort de l’étude française la plus convaincante, 1940 : La guerre des occasions perdues, du colonel A. Goutard (Paris, 1955), qu’une autre Marne était beaucoup plus plausible qu’on ne le croit en général. Le dernier en date des ouvrages indiquant le grand nombre et l’excellente qualité des blindés français est dû à R.H.S. Stolfi, « Equipment for Victory in France in 1940 », History, vol. 55, n<> 183 (février 1970), 1-20. Les vieux clichés sur l’infériorité du matériel français ne restent valables que pour un secteur, vital il est vrai, l’aviation ; encore faut-il retenir que les Stukas, vulnérables, ont joué un rôle de moins en moins important et que les nouveaux appareils alliés sont arrivés en ligne à la fin. La France était plus vulnérable en 1940 qu’en 1914, mais la défaite n’était absolument pas inéluctable.
Prologue: été 1940
17
Le nouveau régime n’était pas davantage issu d’une cabale. J’essaierai de montrer qu’il a bénéficié de l’appui des masses et du concours de l’élite. Son programme s’inspirait moins des modèles allemand et italien qu’il ne dérivait de conflits intérieurs envenimés de longue date. Il est facile évidemment de prouver que certains Français ont émargé aux fonds secrets de P Allemagne et de l’Italie à la fin des années 30 : des journalistes impécunieux tels Frédéric le Grix, des chefs de ligues comme Jacques Doriot, des tueurs à gages comme ce Jean Filliol qui, avec ses acolytes, assassina les frères Rosselli en 1937 pour le compte de Mussolini. Il y avait des profascistes notoires, par exemple les jeunes romanciers Robert Brasillach et Pierre Drieu la Rochelle. Mais ce ne sont pas eux qui ont pris les décisions en 1940. Il était certes spectaculaire et commode tout à la fois de voir dans le nouveau régime une cabale étrangère 4 ; cependant, vingt années d’archives de l’Axe n’ont guère apporté d’arguments à l’appui de la thèse d’une conspiration. Même le procureur général, lors du procès de Pétain en 1945, est passé du chef d’accusation initial, « complot fomenté depuis longtemps contre la République », à une inculpation plus anodine, à savoir qu’il n’a rien fait « pour empêcher qu’on spécule autour de son nom, à la fin des années 30 5 ». Pendant cette période, il y avait en Grande-Bretagne des éléments analogues et, si la bataille d’Angleterre s’était terminée comme la campagne de Flandre en 1940, il est certain qu’une histoire de la chute de l’Angleterre ferait elle aussi la part belle à la conspiration. Pour comprendre les décisions de 1940 il est indispensable de connaître le contexte de la III e République, et avant tout les facteurs sociaux, économiques et politiques qui ont eu plus d’importance qu’une poignée de romanciers aigris et d’agents de l’étranger.
J’ai choisi de commencer par la défaite militaire, fait accompli en métropole. Le dernier gouvernement de la III e République est formé, dans le respect de la Constitution, mais non dans le calme, à Bordeaux, pendant la nuit du 16 au 17 juin, aux alentours de minuit, afin qu’il demande aux Allemands ce que seraient les conditions de paix. Les formes républicaines sont observées, mais une fois ce seuil franchi, tout baigne dans une lumière nouvelle. Paul Reynaud, président du Conseil sortant, propose le maréchal Pétain
4. La littérature a trouvé dans la cinquième colonne une veine apparemment inépuisable. Elle va de Pétain et la Cinquième Colonne, Albert Bayet (Paris, 1944), à la Cinquième Colonne, Max Gallo (Paris, 1970).
La France de Vichy
pour lui succéder, et se déclare prêt à partir comme ambassadeur aux États-Unis. Le président de la République, Albert Lebrun, charge le maréchal Pétain de former le ministère et le nouveau gouvernement, dans sa composition, est un exemple patent d’union nationale sous la III e République. Il va des conservateurs aux socialistes, la SFIO étant officiellement représentée par Albert Rivière et André-Louis Février. Seuls en sont exclus ceux qui sont irréductiblement opposés à un armistice. La formation du gouvernement Pétain, le 17 juin, est une étape évidente vers la fin de la guerre, mais une étape à peine perceptible vers la fin de la légalité républicaine. C’est par de petits bonds de ce genre, et non par la conspiration, qu’une bonne partie des Français et de l’élite de la population est amenée à participer à un monde politique nouveau et inattendu.
Cela dit, la défaite est un état d’esprit. Jusqu’au dernier moment, et plus tard encore, certains membres du cabinet Reynaud s’ingénient à trouver le moyen de continuer la lutte. Les troupes britanniques et françaises, évacuées de Dunkerque au début de juin, ont été débarquées à nouveau pour défendre un « réduit breton », mais quand le général Alan Brooke arrive à Rennes le 13 juin pour inspecter les forces anglaises passées sous commandement français, les Allemands ont déjà traversé la Seine entre Paris et la mer ; lts plans sont submergés sous le torrent des événements.
Le projet de continuer la guerre en Afrique du Nord est beaucoup plus prometteur. Sur ce sol qui est partie intégrante de la terre de France, les hommes brûlent de se battre, comme le dit le général Noguès dans un télégramme adressé le 18 juin au commandant en chef, le général Weygand. Ils comptent sur le puissant appui d’une marine intacte, des nouveaux chasseurs Dewoitine D 520 qui viennent de sortir, des avions et du matériel déjà expédiés par les États-Unis et de tout ce qui pourrait être envoyé de la métropole vers cet immense Dunkerque méditerranéen. Même avec l’aide de l’Espagne et de l’Italie, et bien que l’Afrique du Nord soit une base logistique médiocre, la marine allemande, mal équipée pour des opérations amphibies, pourrait difficilement transporter une armée par mer où elle s’opposerait aux flottes britannique et française 6 .
6. André Truchet, dans l'Armistice de 1940 et /’Afrique du Nord (Paris, 1953), montre très en détail comment on pouvait poursuivre la lutte en Afrique du Nord. A la fin de sa vie, le général Weygand a dit que c'était une entreprise suicidaire. Voir à ce sujet En lisant les mémoires du général de Gaulle (Paris, 1955), 91. Les télégrammes de Noguès figurent dans Ministère public c! général Noguès, 26.
Prologue: été 1940
19
Le transfert commence en fait. Même après que Pétain a été désigné comme président du Conseil pour sonder les Allemands sur les conditions de paix, le cabinet décide, le 19 juin, qu’une partie du gouvernement et les deux Assemblées partiront pour le Maroc, car Bordeaux risque d’être envahi avant que les négociations puissent commencer. Le climat change alors et l’on se met à parler d’« émigrés ». Une dernière poignée d’irréductibles — vingt-neuf députés et un sénateur — s’embarquent en fin de compte à Bordeaux, le 21 juin, sur le Massilia, un bateau affrété pour la circonstance. L’escadre française est à Mers el-Kébir, en Algérie, et près de mille pilotes partent avec leurs avions au cours des derniers jours.
L’armistice n’était donc pas la seule solution, ce qui donnait des cauchemars à Hitler. Une armée française faisant la guerre en Afrique du Nord aurait obligé l’Axe à disperser dangereusement son effort militaire, pendant l’été 1940, et contrebalancé l’avantage d’une occupation totale du continent, que Hitler d’ailleurs n’envisageait pas sans inconvénients. Si ses propositions d’armistice, dit-il à Mussolini le 17 juin, étaient clémentes, c’était pour prévenir « le cas où le gouvernement français pourrait les rejeter, s’enfuir à Londres afin d’y poursuivre la guerre, sans parler de la pénible responsabilité que les puissances occupantes devraient assumer, notamment dans le domaine administratif 7 ».
Cette gêne fut épargnée à Hitler. On n’eut pas à écarter des solutions de rechange ; elles devinrent impensables. Le gouvernement Reynaud n’eut jamais à choisir formellement entre l’armistice et un combat au finish. Les faucons eurent probablement peur de provoquer un vote. Tout le monde se rallia à la proposition soumise le 16 juin par Camille Chautemps, vice-président du Conseil, à savoir de chercher à connaître les conditions allemandes pour avoir plus de renseignements ; c’était en fait décider de ne rien décider. Le cœur n’y était pas et il aurait fallu à Reynaud ou à tout autre qu’il fût touché par une inspiration miraculeuse ou qu’il se sentît acculé, pour mener la lutte jusqu’au bout. En l’absence de décision nette, les priorités les plus profondes ont joué, qui rendaient cette lutte inconcevable. Elles ont formé l’atmosphère dans laquelle le nouveau régime pouvait germer.
7. Documents on German Foreign Policy ( DGFP ), série D, IX, n<> 479, 608. L’ambassadeur allemand à Madrid avait également informé Berlin que le gouvernement français projetait de passer en Afrique du Nord.
La France de Vichy
Quel roi, s’il va faire la guerre à un autre roi, ne s’assied tout d’abord pour délibérer s’il peut, avec dix mille hommes, faire face à un ennemi qui vient à lui avec vingt mille ? S’il ne le peut, tandis que celui-ci est encore loin, il lui envoie un ambassadeur pour négocier la paix.
Luc 14, 31-32
(Évangile pour le dimanche 23 juin 1940) 8 .
On ne peut vraiment pas se méprendre sur la joie et le soulagement qui déferlent, emportant l’angoisse, quand le maréchal Pétain annonce à la radio, le 17 juin un peu après midi, que le gouvernement formé la nuit précédente va demander l’armistice : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat. » Sans attendre les négociations, soldats et civils font tout simplement la paix eux-mêmes. Le général Erwin Rommel, regagnant l’Allemagne en toute hâte ce jour-là, sans rencontrer pratiquement de résistance, trouve des soldats français debout au bord de la route, pensant que l’armistice a pris immédiatement effet (les négociateurs ne quittent pas Bordeaux avant le 20 juin et l’armistice entre en vigueur le 25). Ceux qui veulent continuer la lutte paraissent brusquement menacer les espoirs de survie frais éclos. Quand toutes les villes de plus de 20 000 habitants sont déclarées « ouvertes », le 18 juin, pour éviter des destructions inutiles, les agglomérations de moindre importance, maire en tête, emboîtent le pas sans hésiter. Les soldats et les civils de la Mort dans Vâme (le roman de Sartre) qui s’efforcent d’arracher Mathieu à sa résistance désespérée ont eu beaucoup d’émules réels. A Vier-zon, les habitants tuent un officier de chars qui essaie de tenir les ponts sur le Cher. Le colonel Charly, qui, le 20 juin, ordonne à ses troupes encerclées près de la ligne Maginot de faire une percée, est tué par ses hommes qui s’écrient : « Il va tous nous faire massacrer 9 .» Quant aux personnalités qui étaient contre l’armis-
8. Robert Brasillach, Journal d’un homme occupé dans LJne génération dans l’orage (Plon, 1968) , 350.
9. L’affaire de Vierzon est rapportée par le général André Beaufre dans le Drame de quarante (Paris, 1965), 265. Voir aussi William L. Shirer, la Chute de
Prologue : été 1940
21
tice, Reynaud (à supposer qu’il s’y soit jamais opposé) eut alors un accident de voiture ; Georges Mandel était au Maroc pour essayer de prendre contact avec les Anglais. Charles de Gaulle note avec amertume dans ses Mémoires « qu’aucun homme public n’éleva la voix pour condamner l’armistice™». Ces souvenirs pénibles valent d’être rappelés uniquement pour souligner que l’armistice ne fut pas le complot d’une minorité.
Il est facile, évidemment, d’envisager bien des années après, dans une étude théorique ne présentant aucun risque, la solution héroïque d’une résistance jusqu’à la mort. Ceux qui en auraient fait les frais avaient eu le poil roussi par le Blitzkrieg et ne voulaient plus aller au feu. D’ailleurs, lutter jusqu’au bout ne semblait avoir aucun sens stratégiquement. On pouvait aisément penser que les forces allemandes, qui avaient écrasé l’orgueilleuse armée française, ne se laisseraient sans doute pas arrêter par les Britanniques, qui avaient beaucoup moins participé aux combats en 1940 qu’ils ne l’avaient fait en 1914. La plupart des dirigeants français étaient persuadés que la conférence de la paix était une question de semaines ou de mois H, quoi que fassent les débris de l’armée. Les Allemands avaient redécouvert la guerre de mouvement qu’ils avaient tant cherchée en 14-18 et la lutte était terminée. Les Français, joignant l’acte à la parole, montraient qu’ils attendaient une paix proche. Après tout, le gouvernement Pétain avait demandé ce que seraient les conditions de la paix, et non pas de l’armistice, dans le message que Paul Baudouin, ministre des Affaires étrangères, avait fait transmettre, le 16 juin peu après minuit, par Lequerica, ambassadeur d’Espagne 12 . Un simple armistice venait en second dans ses
la 111e République (Paris, 1970), 906-907. La commission parlementaire d’enquête sur les années de guerre et d’avant-guerre a étudié un certain nombre de ces affaires : Événements survenus en France de 1933 à 1945 II, 384-404. The Rommel Papers (B.H. Liddell Hart, New York, 1953), 69-73.
10. Charles de Gaulle, Mémoires I, l'Appel (Plon), 73.
11. Foreign Relations of the United States {F RU S), 1940, II, passim, et notamment le télégramme du 1er juillet 1940 dans lequel William C. Buîlitt indique que divers dirigeants français prédisent un effondrement rapide de l’Angleterre, 462 sq.
12. Les dénégations formulées par Paul Baudouin après la guerre sont infirmées par les textes de l’époque. Voir colonel A. Goutard, « Comment et pourquoi l’armistice a-t-il été ‘ accordé ’ par les Allemands », Revue de Paris, vol. 67 (octobre 1960), ainsi que les lettres de Baudouin et Goutard dans les deux numéros suivants. On peut trouver le texte de la question posée par Baudouin et transmise à Berlin par Madrid, dans les archives du ministère allemand des Affaires étrangères, Büro des Staatssekretars, « Beziehungen zwischen Frankreich und Deutsch-land », vol. 2 (T-120/121/119600).
La France de Vichy
préférences, mais ne changeait rien à la conférence de la paix qu’il prévoyait pour le courant de l’été et où la France obtiendrait de meilleures conditions que si elle combattait jusqu’au bout. Pétain devait d’ailleurs dire à Hitler, le 24 octobre, qu’il espérait que la paix « serait favorable à ceux qui avaient essayé de prendre un nouveau départ 13 ». La législation française montre à l’évidence qu’on s’attendait à un armistice de courte durée et à une paix proche : par exemple, les retraites allouées aux officiers qui ne pouvaient servir dans une petite armée d’armistice temporaire, ne devaient leur être versées que pendant trois mois. Wladimir d’Ormes-son, ambassadeur de France au Vatican, essayait d’intéresser la papauté à un plan de paix reposant sur un bloc catholique latin englobant la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. De leur côté les fonctionnaires de la Wilhelmstrasse travaillaient à un traité de paix franco-allemand fort différent 14 . Bien qu’on ait prétendu après la guerre que l’armistice devait être un bref répit précédant une reprise des hostilités 15 , tous les indices de l’époque montrent que l’ensemble du pays tenait pour acquises deux données stratégiques : la guerre était finie et l’Allemagne l’avait gagnée.
Se battre jusqu’au bout n’était pas seulement dérisoire militairement ; c’était, pis encore, un suicide social. Les Français étaient tout d’abord partis pour la guerre en septembre 1939 sans enthousiasme aucun. Depuis que la menace allemande avait pris nettement forme pour la première fois avec la dénonciation, en mars 1935, du traité de Versailles qui limitait les armements, puis avec la remilitarisation de la Rhénanie, en mars 1936, la possibilité d’une guerre contre Hitler suscitait des réactions mitigées. A certains, le remède éventuel semblait pire que le mal. Un grand nombre de conservateurs, que Charles Micaud appelle les « nationalistes résignés 16 », crovaient qu’une guerre contre l’Allemagne ne pourrait profiter qu’à Staline, en abattant son pire ennemi à l’ouest et en minant les structures sociales européennes. Après la vague de grèves de mai-
13. DGFP, série D, XI, n° 227, 385 sq. Camille Chautemps dit à Bullitt le 1er juillet que Pétain, Laval et Weygand estiment que la France obtiendra des conditions de paix plus favorables si elle établit un régime semi-dictatorial, FRUS, 1940, II, 468.
14. Ministère de la Guerre, Bulletin officiel (1940), 1100, 1112. Actes et Documents du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre mondiale (Cité du Vatican, 1967), IV, 97 ; Büro des Staatssekretàrs, « Friedensverhandlungen mit Frankreich » (T-120/365, 368, 378).
15. Par exemple : Général Weygand, Mémoires III, Rappelé au service (Paris, 1957).
16. Charles A. Micaud, The French Right and Nazi Germany 1933-39 (Durham, N.C., 1943), 97-99.
Prologue: été 1940
23
juin 1936 et la victoire électorale du Front populaire, la peur d’une révolution communiste en France tourna à l’hystérie ; combattre Hitler, c’était, semble-t-il, faire « une guerre où les intérêts de la France ne sont pas en jeu, mais uniquement ceux du communisme international 17 ». Les « nationalistes résignés » avaient l’appoint de deux groupes marginaux ayant peu de chose en commun : quelques pronazis déclarés (un très petit noyau d’ailleurs, n’appartenant pas à la droite traditionnelle) et certains pacifistes de gauche qui n’avaient pas suivi Blum et Thorez lorsqu’ils étaient passés de l’antimilitarisme à l’antinazisme armé. D’autres encore redoutaient la guerre, non par idéologie, mais en raison des armes récentes et du dynamisme effrayant de la nouvelle Allemagne. La guerre, à leurs yeux, c’était les gaz asphyxiants et les villes bombardées. Paris serait pire que Guernica.
En outre, tout Français ayant plus de trente ans se souvenait du gaspillage aveugle de jeunes vies en 14-18, qui avait fait de la France un pays de vieillards et d’infirmes. Cette dure réalité, que rappelait chaque jour la présence d’anciens combattants dans la rue, prit une acuité particulière en 1935, début de ces « années creuses » annoncées par les démographes ; l’effectif du contingent fléchit alors de moitié, tant les garçons nés entre 1914 et 1918 étaient peu nombreux. Encore un bain de sang et resterait-il même une France ? Céline ne fit qu’exprimer plus brutalement le sentiment de bien d’autres. Il prédisait vingt-cinq millions de victimes et la « fin de la race » :
« Nous disparaîtrons corps et âme de ce territoire comme les Gaulois, ces fols héros, nos grands dubonnards aïeux en futilité, les pires cocus du christianisme. Ils nous ont pas laissé vingt mots de leur propre langue. De nous, si le mot ‘ merde ’ subsiste, ça sera bien joli 18 . »
C’est pourquoi la France ne déclara la guerre à l’Allemagne, le 3 septembre 1939, que quelques heures après les Anglais. Deux généraux, Condé et Prételat, votèrent contre au Conseil supérieur de la guerre ; une bonne partie de la population civile accueillit la nouvelle avec tristesse. La guerre ne fut déclarée qu’après des jours et des jours de négociations pénibles ; pendant tout ce temps, Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, et ses partisans s’accro-
17. Voir « L’armée et la politique », L'Action française, 25 août 1936. La référence m’a été indiquée par M. Lawrence Abrams.
18. Louis-Ferdinand Céline, L'École des cadavres (Paris, 1938), 78-79. P.-É. Flandin, au cours de la campagne qu’il mena en septembre 1938 contre la guerre pour la Tchécoslovaquie, annonça qu’elle ferait un million de morts.
La France de Vichy
chèrent passionnément à l’espoir d’un nouveau Munich obtenu grâce aux bons offices de Mussolini. On continua à se demander, non sans hargne, si la guerre avait vraiment été nécessaire
Il est certain que si Hitler avait été vaincu quand ses blindés déferlèrent, au mépris du danger, sur le nord de la France, ces doutes auraient été aussi rapidement dissipés qu’ils le furent en Grande-Bretagne. Mais avec l’écrasement de la France, ils remontèrent de plus belle à la surface, accompagnés d’un vindicatif : « Je vous l’avais bien dit. » L’ancienne peur que la guerre de Staline n’ouvrît la voie à la révolution devenait une réalité concrète terrifiante. La société française commençait à s’effilocher.
Dans le nord et l’est du pays, la moitié de la population devint nomade : « Toute la Belgique et l’Artois sont sur les routes », écrivait Paul Valéry qui, vers le 20 juin, quitta Paris pour Dinard avant l’arrivée des Allemands. « L’expression du désordre vivant, poignant. Tous les véhicules possibles, et les charrettes bourrées d’enfants blonds dans la paille. On ne sait, ils ne savent où ils vont 20 . » L’image qui reste surtout de cet enfer de juin, ce sont peut-être les millions de réfugiés, Belges et Français, militaires et civils, qui obstruaient les routes aux derniers jours, mitraillés par l’aviation italienne, épuisés par leur mutuel désespoir. Ces grappes humaines agglutinées pour survivre en étaient à la guerre de tous contre tous dont parle Hobbes. Lorsqu’il décrit, dans la Mort dans l’âme, Sarah et son enfant rudoyés et floués par le chauffeur de taxi tombé en panne sèche sur la route embouteillée, Sartre n’invente rien. En Normandie, Évreux se dispersa devant l’envahisseur ; sur ses 20 000 habitants, il n’en restait que 172 le 11 juin ; on en comptait 218 une semaine plus tard et pas plus de 6 800 le 30. Même le 15 juillet, presque trois semaines après l’armistice, la population n’atteignait que la moitié de ce qu’elle était avant l’exode. C’est là un exemple entre bien d’autres, à ceci près que les réfugiés d’Alsace-Lorraine et de la zone interdite limitrophe n’ont pas eu le droit de regagner leur foyer 21 .
19. L’ouvrage de A.J.P. Taylor sur les Origines de la Seconde Guerre mondiale (Londres, 1961) a été la première tentative d’après-guerre d’expliquer scientifiquement une attitude populaire bien plus largement répandue en France depuis 1940 que ce ne fut jamais le cas en Angleterre ou aux États-LTnis.
20. Paul Valéry, Cahiers XXIII (Paris, 1960), 307.
21. Pour Évreux, voir Marcel Baudot, l’Opinion publique sous l’occupation (Paris, 1960), qui, en dépit de son titre, est consacré à un seul département, l’Eure. Jean Vidalenc, dans l’Exode de mai-juin 1940 (Paris, 1947), estime à dix millions le nombre total des réfugiés.
Prologue : été 1940
25
Certains fonctionnaires restèrent à leur poste pendant que la marée allemande déferlait ; d’autres partirent en exode. René Bousquet- secrétaire général de la préfecture de la Marne à Reims, note que tout son bureau s’est « replié » fin juin à Albi, — encore un exemple parmi bien d’autres. Les services publics essentiels étaient paralysés 22 .
Dès que le gouvernement eut quitté la capitale, le 10 juin, la rumeur se répandit d’un Paris soviétique. Personne ne sait aujourd’hui si l’aide de camp qui fit irruption le 13 juin au Conseil de cabinet pour avertir le général Weygand, commandant en chef des forces françaises, que les communistes s’étaient emparés du pouvoir, se faisait l’écho d’un « bobard dirigé » ou d’une rumeur exacte. Il est bien évident que le désir d’éviter l’avènement des communistes à Paris a beaucoup pesé dans Tardent plaidoyer de Weygand en faveur de l’armistice 23 .
Mais ce n’était pas seulement des officiers qui redoutaient une répétition de 1871. « Éviterons-nous la révolution ? » écrivait le père Teilhard de Chardin le 18 juin. « Tout est possible après un tel choc. »
L’entrée des Allemands à Paris le 14 juin n’était nullement rassurante à cet égard. Après tout, Hitler et Staline étaient alliés, et il y avait parmi les autorités d’occupation des idéologues nationaux-socialistes comme le Dr. Friedrich Grimm, qui ne désespéraient pas de séduire le parti communiste français en mettant en avant leurs ennemis communs : prêtres, juifs et grands bourgeois 24 . Le futur ambassadeur d’Allemagne lui-même, Otto Abetz, semble avoir encouragé ces contacts. En fait, les bruits qui couraient à Paris sur les bonnes relations des nazis et des communistes faisaient autant scandale à Berlin qu’à Vichy, et le Parti ne réussit pas en fin de compte à faire reparaître l'Humanité, ni à reprendre sa propagande neutraliste de la fin 1939. Mais il fallut attendre juin 1941 pour que Vichy cessât vraiment de croire à une étrange collusion
22. Ministère public d Bousquet.
23. P.C.F. Bankwitz, « Maxime Weygand and the Fall of France », Journal of Modem History 31, 3 (septembre 1959) ; William Bullitt, ambassadeur des États-Unis, prévoyait lui aussi une montée du communisme à Paris. Voir Gordon Wright, « Ambassador Bullitt and the Fall of France », World Politics 10, 1 (octobre 1957), 63-90.
24. Mémorandum du Dr. Friedrich Grimm, 19 juin 1940 (Centre de documentation juive contemporaine [CDJC], Paris, document LXXV, 253).
soviéto-nazie à Paris, qui n’allait pas sans lui inspirer un vague malaise 25 .
Ce fut vers le maréchal Pétain, « le chef qui nous a sauvés de l’abîme 26 », que monta une fervente gratitude. A dire vrai, c’est plutôt un recul instinctif devant le chaos qui rendit tout bonnement impensable une guerre au finish. L’arme dernière d’un peuple dont l’armée conventionnelle s’est désintégrée est le chaos. Se battre de l’étranger, ce serait non seulement subir les souffrances d’une occupation de tout le territoire métropolitain (et tous les Français avaient été nourris d’histoires sur les atrocités allemandes en Belgique pendant la Première Guerre mondiale) ; ce serait aussi accepter les représailles exercées contre les Français de France pour des actes commis par des Français d’outre-mer. Cela signifiait la guérilla sur le continent, les troubles sciemment provoqués, des comités de vigilance remplaçant une administration établie, une politique délibérée de rendre l’occupation plus coûteuse pour chacun. Choisir cette solution aurait été dur pour un peuple n’ayant pas souffert ; c’était inconcevable pour un peuple ayant connu deux guerres en moins de vingt-cinq ans, hanté par le spectre de la révolution qui se profilait derrière chaque crise : 1871, 1917, 1936.
Pour utiliser le chaos comme arme dernière, un peuple doit avoir été dépouillé du bien-être de la propriété et du réconfort de la routine, assez irrévocablement pour y avoir renoncé, mais non pas jusqu’à en être devenu passif. Quand l’aviation américaine étudia l’efficacité du bombardement des populations civiles pendant la Seconde Guerre mondiale, elle constata qu’une fois la ville réduite à l’état de ruines, la productivité d’Hambourg augmenta. Les frivolités superflues qui gaspillaient de la main-d’œuvre avaient disparu dans les flammes. La France, au contraire, avait été assommée, démoralisée, sans devenir Spartiate pour autant, par la guerre la plus rapide et la moins destructrice qu’elle avait subie au XX e siècle. Ses villes n’avaient pas été bombardées systématiquement, comme Londres était sur le point de l’être ; on n’avait pas vu des régions entières
25. Pour Abetz, voir le mémorandum du Dr. Best, 17 août 1940 (CDJC, document LXXV-152) ; Halder dans son Journal des 10, 11, 15 et 26 août 1940 signale non sans inquiétude les tractations qu’aurait, paraît-il, engagées Abetz avec les communistes. Des sources hostiles au Parti accordent une très large place aux efforts qu’il déploya pendant l’été 1940 pour reprendre ses activités. Pour le comote rendu le plus complet, voir Physiologie du parti communiste français, A. Rossi (Paris, 1948), 395-410.
26. L’expression est de Jean Berthelot, dans un discours de mai 1941, Ministère public d Jean Berthelot.
Prologue : été 1940
27
devenir des déserts, comme en 1914-18. Ainsi qu’un officier allemand le faisait remarquer avec complaisance à Jacques Benoist-Méchin en juillet 1940, « l’offensive foudroyante a tué la guerre dans l’œuf 27 ». Tels les habitants d’une maison secouée par un tremblement de terre, les Français entreprirent de sauver leurs affaires des décombres et d’en éloigner les voleurs.
Ceux qui ont conclu l’armistice ont très explicitement indiqué qu’ils redoutaient des troubles si les hostilités continuaient. Le chaos devait être évité, et non pas utilisé comme la dernière arme contre Hitler. Si nous partons outre-mer, dit le maréchal Pétain au Conseil de cabinet réuni à Cangé le 13 juin (il était encore ministre sans portefeuille dans le gouvernement Reynaud), nous risquons qu’un gouvernement émigré ne soit pas reconnu. Et comment combler le vide en France ?
« Priver la France de ses défenseurs naturels dans une période de désarroi général, c’est la livrer à l’ennemi, c’est tuer l’âme de la France, c’est, par conséquent, rendre impossible sa renaissance. Le renouveau français, il faut l’attendre bien plus de l’âme de notre pays, que nous préserverons en restant sur place, plutôt que d’une reconquête de notre territoire par des canons alliés, dans des conditions et dans un délai difficiles à prévoir 28 . »
Les « défenseurs naturels » de la société française étaient, pour le maréchal Pétain, l’armature administrative qui, du ministre, « descendait de proche en proche » jusqu’au maire de village, en passant par le préfet, étayée par la police et l’armée. Tous ces hommes mettaient leur point d’honneur à servir le pays. Le nouveau régime était le successeur légal de l’ancien, et il y avait à faire. En outre, selon une conception hobbeso-napoléonienne profondément ancrée dans la fonction publique française, l’État n’est pas seulement l’instrument de la volonté du peuple souverain, ni un arbitre ; c’est un bien en soi, porteur de valeurs supérieures à la somme des individus qui le composent. Il faut continuer à le faire fonctionner. Quelles horreurs menaceraient les Français en cas d’éclipse de l’État ? « J’ai servi loyalement » fut une excuse fréquemment invoquée par les fonctionnaires de Vichy lors des procès d’après-guerre, mais elle donnait un son tellement faux à leurs arguments qu’elle traduisait de toute évidence fidèlement les priorités qui avaient joué en 1940.
27. U.S. Strategie Bombing Survey, cité par J.K. Galbraith dans The Affluent Society (Mentor, New York, 1963), 131-133. Jacques Benoist-Méchin, La Moisson de quarante (Paris, 1941), 67.
28. Général Émile Laure, Pétain (Paris, 1941), 432.
La France de Vichy
Lorsqu’il passa en jugement, René Bousquet, préfet de la Marne en 1940, puis chef de la police sous Laval, défendit les efforts qu’il fit pour reconstituer l’armature de la France pendant l’été 1940. Il ne parla pas de politique ; en bon fonctionnaire, il refusa d’admettre que l’administration est le support d’une politique. Soulignant qu’il n’était pas « héroïque de fuir », il fit valoir qu’il fallait travailler avec les Allemands pour rétablir l’ordre nécessaire à la survie du pays. C’est avec une fierté évidente qu’il déclara avoir « rétabli les fonctions normales » du département, dès le 17 juillet. Pierre Angéli, préfet du Finistère en 1940, avant de devenir préfet régional de Lyon, fit l’éloge du loyalisme des préfets de 1940, dont aucun ne démissionna. Ils ont compris, dit-il, dans sa dernière déclaration au tribunal de Lyon en novembre 1944, que les préfets ont en quelque sorte charge d’âmes. La « fierté du corps préfectoral » fut d’avoir constamment sauvegardé les éléments essentiels de la souveraineté nationale et allégé les rigueurs physiques de l’occupation 29 . Yves Bouthillier, un inspecteur des Finances que Paul Reynaud appela à son cabinet en mai 1940, et qui fut le ministre des Finances de Pétain les deux premières années, évoque brièvement le cas des fonctionnaires dans ses souvenirs parus après la guerre : « L’activité ordonnée en présence de l’occupant [était] le meilleur exemple de civisme 39 . »
Le sens de la fonction publique fut renforcé par une soif générale du normal, pendant l’été 1940. Bon nombre de ceux qui allaient être plus tard des opposants déclarés au régime de Vichy en étaient alors encore à trier ce qui pouvait être sauvé du naufrage de leur existence. Simone de Beauvoir par exemple, raconte de façon saisissante dans quel état d’hébétude elle est revenue à Paris en juillet. Hile n’eut le sentiment de maîtriser à nouveau sa vie qu’après avoir repris son poste de professeur dans un lycée.
« Pendant ces trois semaines, je n’étais nulle part ; il y avait de grands événements collectifs avec une angoisse physiologique particulière ; je voudrais redevenir une personne avec un passé et un avenir. Peut-être à Paris j’y réussirai. Si je peux toucher mon traitement, je resterai ici longtemps 31 . »
29. Haute Cour de justice, Ministère public d Bousquet, 38-58. Cour de justice de Lyon, Ministère public d Angéli, 100.
30. Yves Bouthillier, Le Drame de Vichy II (Paris, 1950), et Les Finances sous la contrainte, 245-247.
31. Simone de Beauvoir, La Force de Vâge (Paris, I960), 459-72.
Prologue : été 1940
29
Jean Guéhenno, qui voue le régime aux gémonies, trouve un réconfort à enseigner dans un lycée parisien, jusqu’à ce qu’il soit muté et « dégradé » en septembre 1943 par le ministre de l’Éducation nationale, Abel Bonnard 32.
Des réfugiés regagnent leur foyer ou cherchent asile ailleurs Des familles essaient de reprendre contact. Deux millions environ de prisonniers de guerre attendent impatiemment dans des camps en France d’être libérés. D’innombrables demandes d’emploi sont envoyées au maréchal Pétain. Alarmés par le niveau du chômage, des fonctionnaires travaillent à une reprise de l’économie. Des hommes d’affaires s’adressent à l’armée allemande pour obtenir des contrats. Gaston Bruneton, par exemple, se rend à l’état-major à Paris, en juillet, et obtient une avance pour le revêtement d’aéroports destinés à la Luftwaffe 33. Te Temps et le Figaro prennent des dispositions temporaires pour se faire imprimer à Lyon et à Clermont-Ferrand, tandis que VAction française utilise les presses du Courrier du Centre à Limoges.
Le gouvernement lui-même se démène pour quitter sa résidence provisoire et regagner Paris. Il n’a jamais envisagé de rester en permanence à Vichy, cette ville d’eaux déjà méridionale. Après avoir pris les armées ennemies de vitesse, des châteaux de la Loire jusqu’à Bordeaux, il a dû déménager encore. L’avant-garde allemande est le 18 juin aux portes de la ville, qui est bombardée le 20. A la signature de l’armistice, Bordeaux est en zone occupée. Il faut trouver une meilleure capitale provisoire. Aucune des grandes villes du Sud ne convient. Marseille et Perpignan, par exemple, offrent de trop grandes tentations à l’émigration. D’autres sont des fiefs de la III e République : Lyon est depuis 1905 sous la coupe de son maire, Édouard Herriot, chef du parti radical, comme Toulouse appartient à la dynastie des Sarraut. Clermont-Ferrand est entre les mains de Pierre Laval, propriétaire d’un journal et de la station de radio. Vichy est un choix négatif : le plus grand nombre de chambres d’hôtel dans le centre de la France et pas de suzerain politique. C’est donc dans cette ville de cure pour bourgeois hépa-
32. Jean Guéhenno, Journal des années noires (Paris, 1947), 21 septembre 1943.
33. Voir le rapport de police du 23 août 1940 (document de Nuremberg NG-5418) ; pour Bruneton, un homme d’affaires parmi bien d’autres, mais qui passa en jugement après la guerre pour être devenu commissaire de la Main-d’œuvre française en Allemagne, voir Haute Gour de justice, Ministère public d Bruneton, 4.
tiques que ministres, députés et sénateurs s’installent quand l’armistice entre en vigueur, le 25 juin.
L’administration réquisitionne les hôtels, entasse des classeurs dans des salles de bains et des vestiaires, remplace les lits par des bureaux. On ne se préoccupe pas de faire installer le chauffage central, puisqu’on doit être de retour à Paris avant le froid. La convention d’armistice le prévoit (article 3) et, de toute façon, cette convention doit bientôt déboucher sur les négociations de la paix. On dit le 14 juillet aux représentants américains qui ont suivi le chef de l’État à Vichy, que le gouvernement regagnera Paris aux autours du 20 34 ; il brûle d’envie, tout autant que la population, de se réinstaller dans une routine bien établie.
Il y a donc une espèce d’accord tacite entre Hitler qui espère un armistice économique, et les Français qui sont impatients de retrouver une existence bien réglée. L’armistice repose sur cet intérêt partagé. La « collaboration » (le mot et son contenu) apparaît déjà dans la convention. Aux termes de l’article 3, le gouvernement français aide les autorités du Reich à exercer tous les « droits de la puissance occupante » dans la zone nord. En particulier, il « invitera toutes les autorités et tous les services administratifs à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d’une manière correcte ». Le mot fatidique est dit. Collaboration, terme banal pour travail en commun, va devenir synonyme de haute trahison après quatre années d’occupation.
^ar besoin d’une vie normale prenant les formes les plus élémentaires — besoin de retrouver son foyer et son emploi — bien des Français se sont engagés sur la voie d’une complicité quotidienne qui les conduit peu à peu jusqu’à prêter un concours actif à des mesures que personne n’aurait imaginées en 1940. Distribuer le courrier, réparer les ponts, faire la classe, loger les réfugiés — tout ce qui ramène la tranquillité et l’ordre dans le pays répond au marché tacitement conclu avec les Allemands : la France sortira de la guerre intacte socialement et tournera son énergie vers l’intérieur.
34. U.S. Department of State Serial File 851.01/82. Le chauffage fut installé en toute hâte à la fin octobre. Voir ibid., 740.0011 Eur. War 1939/552.
Prologue : été 1940
31
Le mois de juin 1940 a marqué dans Vhistoire de notre pays une crise devant laquelle chacun aujourd’hui doit se reclasser...
Mais cette nécessité dune révolution totale, nous étions à peu près les seuls à l’affirmer en 1932...
Elle n était pas pour nous une opinion parmi d’autres, elle était le sens et la vocation de nos vingt-cinq ans.
Emmanuel Mounier, novembre 1940 œ .
Au reste, Vichy sera plus qu’un atelier de réparations. Le plaidoyer éloquent d’Yves Bouthillier en faveur de la politique de présence pendant l’été 1940, des services rendus par l’administrateur conscient de son devoir devant les besoins les plus criants d’un peuple malheureux, va à l’encontre de ce qu’il dit à Otto Abetz en septembre. Quand, après avoir traversé pour la première fois la ligne de démarcation, il rencontre à Paris l’ambassadeur d’Allemagne, il lui parle avec passion d’« un ordre économique et social nouveau 36 ». Vichy n’est pas un petit pansement ; c’est de la grande chirurgie. La France est le seul des pays occidentaux occupés à ne pas se contenter d’administrer ; elle fait une révolution intérieure de ses institutions et de ses valeurs morales.
Il est en effet impensable de remettre simplement les choses en l’état. En perdant la guerre, la III e République a perdu sa légitimité. Aucun régime moderne n’a survécu en France à une défaite militaire, et même l’Ancien Régime fut mortellement blessé par les revers de la guerre de Sept ans. Depuis la guerre totale, chaque homme se reproche la défaite. Le reproche est anormalement amer en 1940 — beaucoup plus amer que ne le fut en 1870 l’acrimonie provoquée par la capitulation du second Empire devant la Prusse. Car le Français n’a cessé de douter de lui depuis la fin du XIX e siècle, et s’est vu frustré depuis vingt ans des fruits de la victoire de 1918. Les atteintes morales et psychiques sont plus sensibles que les blessures physiques, pendant l’été 1940.
35. Esprit, 8e année, no 94 (novembre 1940).
36. Der Vertreter des Auswàrtiges Amts beim Oberbefehlshaber des Heeres, « Frankreich ». Mémorandum d’Abetz, « Aufzeichnungen über politische Bespre-chungen in der Zeit vom 6. bis 15. September 1940 ». (T-120/364/206021 sq).
La France de Vichy
La France avait été le royaume le plus puissant et le plus peuplé de l’Occident sous Louis XIV, le plus vaste pays d’Europe sous Napoléon I er / une des grandes puissances sous Napoléon III et Clemenceau, et maintenant ? Il était facile d’attribuer son déclin à une décadence sociale et morale, car c’étaient les recensements de 1891 et 1896 qui avaient pour la première fois mis en évidence son faible taux de natalité, alors qu’ailleurs, en Allemagne notamment, il augmentait rapidement. On n’avait cessé de s’inquiéter de ce taux de natalité, un des indices de la vitalité du pays, depuis qu’avaient paru, en 1897, le Roman de Vénergie nationale de Barrés et, en 1902, VÉnergie nationale de Gabriel Hanotaux. Avec une fascination morbide, les Français de 1940 retournent les pierres de leur champ national, et regardent les choses rampantes, réelles ou imaginaires, qui grouillent dessous.
Dans ce climat d’autoflagellation, le mythe d’une promenade militaire allemande à travers un pays sans défense prend solidement corps ; les soldats ennemis n’ont-ils pas été stupéfaits devant le délabrement des fermes françaises ? « On dirait que la vie s’est arrêtée chez nous depuis un demi-siècle 37 . » On répudie donc la III e République par soif de quelque chose de différent.
« Trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop peu d’alliés. » Par cette formule lapidaire qu’il emploie dans son discours du 20 juin pour expliauer la défaite, Pétain passe adroitement de la politique étrangère et de la doctrine militaire à la décadence sociale. Un grand nombre de Français lui emboîtent le pas. Il était à prévit que la droite antiparlementaire, qui identifiait depuis longtemps la politique électorale à la déchéance du pays, crierait vengeance avec Charles Maurras dont la Seule France paraît en 1941 ou avec Henri Massis qui publie Les idées restent la même année II n’est pas étonnant non plus que de jeunes révoltés aient exulté devant le naufrage de la vieille bourgeoisie lassée et lassante dont ils se moquent depuis l’université. Dans les deux romans les plus virulents publiés sous l’occupation, les Décombres et les Beaux Draps, Rebatet et Céline s’attellent avec une joie féroce à une destruction qui est le prolongement de la haine du bourgeois animant la jeune droite des années 30. Ce qui est étonnant, en revanche, c’est qu’ils soient allègrement rejoints par des gens qui s’étaient tenus fort loin de l’extrême-droite. Même après que la tendance antisémite du régime est devenue évidente, Daniel Halévy, que préoccupait depuis longtemps la disparition des sociétés rurales organiques remplacées
37. Jacques Benoist-Méchin, op. cit., 105.
Prologue : été 1940
33
par des masses urbaines sans visage, salue le retour aux vérités que le nouveau régime retrouve sous « les cendres et les débris de la défaite 38 ». Paul Valéry, qui va bientôt perdre son poste de directeur du Centre universitaire de Nice, écrit fin juin, dans ses Cahiers : « La guerre fut perdue pendant la paix. » André Gide, qui est en train de relire la Débâcle, le roman de Zola sur la guerre franco-prussienne, note le 26 juin dans son Journal qu’on va vers la fin de la « décomposition de la France », de la « liberté excessive », du « triste règne de l’indulgence » : « Tout mon amour pour la France ne pouvait faire que je ne fusse sensible à l’état de délabrement de notre pays 39. » François Mauriac, dans le Figaro, serre la bride à ceux qui osent parler d’espoir à un tel moment. La France doit reconnaître qu’elle est « au fond d’un abîme d’humiliation 40 ».
Chacun explique à sa manière la pourriture. Certains s’arrêtent à des signes superficiels : le jazz, l’alcool, la vie nocturne de Paris, les jupes courtes, la dépravation de la jeunesse, le contrôle des naissances. On accuse même le plaisir d’avoir amolli la nation : « esprit de facilité », « culte du bien-être ». Des intellectuels ont tourné en dérision des institutions sacrées : Léon Blum, qui a ridiculisé le mariage dans une œuvre de jeunesse ; Jean Cocteau dont les Parents terribles ont miné l’autorité du père. Et surtout, Gide a autorisé chacun à assouvir ses désirs avec ses « actes gratuits 41 ». On comprend donc la violence du choc de 1940, quand on voit le créateur de Lafcadio, chez qui il y avait toujours eu conflit entre une attirance pour les esprits libres et une austérité puritaine solidement enracinée, écrire lui aussi que la liberté avait été poussée trop loin :
« Indulgence. Indulgences... Cette sorte de rigueur puritaine par quoi les protestants, ces gêneurs, se sont rendus souvent haïssables, ces scrupules de conscience, cette intransigeante honnêteté, cette ponctualité sans scrupule, c’est ce dont nous avons le plus manqué. Mollesse, abandon, relâchement dans la grâce et l’aisance, autant d’aimables qualités qui devaient nous conduire, les yeux bandés, à la défaite 42 . »
Comble de l’ironie, c’est précisément ce qui faisait de la France
38. Daniel Halévy, « Le réformateur inconnu », Le Temps, 18 août 1940. Voir aussi Alain Silvera, Daniel Halévy and his Times (Ithaca, N.Y., 1966), 204-206.
39. Valéry, op. cit., 386, 505 ; André Gide, Journal (La Pleiade).
40. Le Figaro, 19 juin et 15 juillet 1940.
4L René Gillouin, « Responsabilité des écrivains », Journal de Genève, no 33 (7-8 février 1942), s’en prend à ces trois hommes de lettres.
42. Gide, op. cit., 25 juillet 1940.
La France de Vichy
un pays charmant où s’épanouissait la création artistique, qui l’a si mal préparée aux temps durs d’aujourd’hui. Paul Valéry note fin juin : « L’abus de fort bonnes choses a fait le malheur de la France. Parmi elles, la bonté de sa terre, la liberté des esprits, l’insoumission des individus — tout ce qui dégénère en facilité, en négligence, en improvisation... Nous sommes victimes de ce que nous sommes et la France, singulièrement de ses avantages 43 . »
Des critiques allant plus loin rejettent la faute essentielle sur l’ensemble des valeurs morales modernes. Comme ces historiens du national-socialisme qui en cherchaient les racines dans Luther et Tacite, d’aucuns estiment que la débâcle de 1940 met en évidence les mauvais tournants pris au début même de l’ère moderne. Les écrivains maurrassiens accusent le « régime des palabres », l’individualisme débridé hérité de Descartes et Rousseau, qui a démantelé la hiérarchie et l’autorité en 1789 pour les remplacer par un parlementarisme flasque. Oubliant Valmy, Jemmapes, la Marne et Verdun, ils disent que le régime postrévolutionnaire était trop invertébré et trop indulgent envers l’étroit intérêt individuel pour être jamais capable d’engendrer la grandeur. Il a été importé des pays anglo-saxons, comme tout ce qui s’est attaqué à la majesté de la France. Ils se réjouissent de « la fin de la France babillarde 44 ».
Les jeunes catholiques de gauche gravitant autour d’Emmanuel Mounier situent, dès 1932, le mauvais tournant à la Renaissance qui « a manqué la renaissance personnaliste et négligé la renaissance communautaire. Contre l’individualisme, nous avons à reprendre la première. Mais nous n’y arriverons qu’avec le secours de la seconde ». Pour ces critiques de la société moderne, 1940 est un « jugement de l’Histoire » porté non pas seulement sur la III e République, qui ne mérite même pas le mépris, mais sur la conception globale d’un monde libéral capitaliste et individualiste 45 .
Pendant l’été 1940, on ne sait pas encore exactement ce que sera le gouvernement nouveau ni ce que seront les institutions nouvelles
43. Valéry, op. cit., 384, 421.
44. Charles Maurras, La Seule France (Paris, 1941) ; Henri Massis, Les idées restent (Paris, 1941) ; Jacques Benoist-Méchin, op. cit., 50, 175, recherche des « contrepoisons » à Descartes et Rousseau. La dernière phrase est de Jacques Chardonne, dans Chronique privée de l’an 1940 (Paris, 1940), 90. René Gillouin et Maurras, après Le Play, soutenaient l’un et l’autre que les valeurs de la Révolution française étaient anglo-saxonnes.
45. Emmanuel Mounier, « D’une France à l’autre », Esprit, 8 e année (novembre 1940), 1-10. On cite également des extraits du premier éditorial d 'Esprit, intitulé « Refaire la renaissance » (1932).
Prologue: été 1940
35
qu’il va créer, mais on est certain que les vieilles lunes ont à jamais disparu. A l’époque, juin 1940 apparaît comme une cassure nette : « Il n’y a plus de France au sens où l’on l’entendait hier 46 », écrit Valéry dans ses Cahiers.
On pouvait penser — tel avait été l’éclat des dernières manifestations électorales — qu’il y avait en France , en 1936 , trente-huit millions de républicains. Que sont-ils devenus ?
Jean Guéhenno, 1942 47 .
Nous pouvons voir maintenant combien on eut tort après la guerre de penser qu en s’immolant sur l’autel de Vichy, les 9 et 10 juillet, la lll e République s’était laissée manœuvrer par Pierre Laval. Il était commoae de tout taire peser sur ses épaules tombantes, surtout après qu’il eut été fusillé dans la cour de la prison de Fresnes, le 15 octobre 1945. Dans les souvenirs et mémoires parus apres la guerre sur les premiers jours de Vichy, Laval est partout : cajolant, promettant, brandissant la menace d’un Weygand et d’un de Lattre de Tassigny (dont la division attendait a Clermont-Ferrand), prêts à baiayer l’Assemblée si elle n’accomplit pas sa tâche, 1 avertissant que l’Angleterre conclura une paix séparée aux dépens de la France si celle-ci ne se hâte pas, etc... Comme il était commode d’avoir un paria sur qui rejeter tous les votes boiteux de ces deux journées ! Laval était le bouc émissaire idéal, avec ce penchant incoercible pour l’intrigue qu’on lui attribuait, l’incarnation du mal en 1944, un mort qui ne pouvait pas crier « tu quo-que ». « Pierre le Noir », le seul politicien dont le nom pouvait se lire de droite à gauche ou de gauche à droite, un envoyé des dieux pour les caricaturistes, avec son visage rond, au teint basané, son éternelle cigarette et sa cravate blanche.
La légende d’une conspiration de Laval fourmille anormalement d’incohérences. En voulant avilir l’homme, elle en fait un sorcier de la politique. On s’est servi de l’habileté qu’on lui prêtait dans des pièces transformées en tabagies, pour se disculper d’avoir dit ceci ou cela. Cette légende procède aussi de courants contradictoires. Les vieux conservateurs détestent Laval qui incarne à lui
46. Valéry, op. cit., 429.
47. Guéhenno, op. cit., 25 juillet 1942.
La France de Vichy
seul la chicane de la III e République ; la gauche hait en lui l’homme qui a tourné casaque. Si on le considère avec moins de passion, Laval était beaucoup moins grand que sa légende. Ce n’était ni le cajoleur irrésistible, ni le renégat sans scrupules. Aucune de ses incursions hardies dans la grande politique ne fut couronnée de succès : ni avec Brüning ou Hoover en 1931, ni avec Mussolini ou Staline en 1935, ni avec Hitler après 1940. En outre, il est difficile d’assimiler à un vulgaire opportuniste le Laval opiniâtre qui fut pacifiste pendant la Première Guerre mondiale, vota contre le traité de Versailles, s’opposa à la guerre en 1939 et à Vichy fut neutraliste jusqu’au bout, longtemps après que les ambitieux plus ordinaires eurent glissé vers l’un des deux camps 48 .
Fils d’un aubergiste-boucher-facteur de Châteldon, gros village des collines de l’Auvergne, Pierre Laval gravit les échelons que la III e République offrait à un provincial pauvre et ambitieux. Après de brillantes études, il enseigne quelque temps la biologie et reçoit une bourse pour aller faire des études de Droit à Paris. Inscrit au barreau parisien, il se fait rapidement un nom en obtenant l’acquittement d’un ouvrier accusé d’activités anarchistes. Il devient spécialiste des conflits du travail et avocat de la CGT. C’est comme socialiste qu’en mai 1914 il est élu député à Aubervilliers, dans la banlieue parisienne.
Laval ne sera cependant jamais un doctrinaire. L’autorité qu’il acquiert à Aubervilliers tient beaucoup plus à sa bonhomie et aux services qu’il rend à ses électeurs, qu’à sa pureté idéologique. Il appartient à l’aile pacifiste modérée de la SFIO (tendance Jean Longuet) et fait sensation en juin 1917 quand il accuse le gouvernement d’avoir employé les troupes annamites contre les manifestations pacifistes, mais il se sent fortement attiré par le pouvoir. Il entend l’appel pour la première fois à la fin de 1917, quand Clemenceau cherche un socialiste pour compléter son cabinet ; il ne semble pas cependant que le « Tigre » ait sérieusement songé à Laval. Ses liens avec la gauche se distendent encore quand il perd son siège de député aux élections de 1919.
Il le retrouve en 1924, avec la mairie d’Aubervilliers, après avoir mis en échec le parti communiste, puissant dans la commune. Cette campagne est le point de départ d’une bataille à couteaux tirés avec les communistes, qui va dominer la carrière politique de Laval. Il
48. La meilleure étude sur Laval en quelque langue que ce soit est jusqu’ici celle de Geoffrey Warner, Pierre Laval and the Eclipse of France (Londres, 1968).
Prologue : été 1940
37
siège alors comme indépendant. Aucun scrupule socialiste ne l’éloignant plus du pouvoir, il devient ministre des Travaux publics en 1925 dans le gouvernement Painlevé (il a 31 ans). Il sera onze fois ministre et quatre fois président du Conseil au cours des dix années suivantes.
Laval est maintenant devenu un grand personnage de la III e République. La combinaison du barreau et de la politique étant lucrative, il se taille un petit empire dans la presse et la radio aux alentours de Lyon et Clermont-Ferrand. Geoffrey Warner nous rappelle que Laval fut « l’un des politiciens français les plus riches de l’entre-deux-guerres 49 ». Avec l’acquisition du château décrépit de Châteldon, il devient le premier citoyen de sa bourgade natale. Laval a toujours affirmé qu’il avait bâti sa fortune en achetant à crédit des entreprises marginales qu’il vendait avec bénéfice après les avoir bien gérées, et en vivant très simplement. L’enquête menée en 1944, à l’occasion de son procès, n’a pas pu prouver la corruption dont l’accusait la rumeur publique. Quoi qu’il en soit, Laval se lie à un autre monde, par ses affaires et ses relations personnelles. Quand il se présente au Sénat en 1927, il s’oppose au cartel des gauches. On ne peut cependant comprendre Laval si l’on ne se rappelle qu’il a gardé intacte son assise politique dans la classe ouvrière d’Aubervilliers ; il l’entretient par ses manières plébéiennes et l’aide efficace qu’il apporte à ses électeurs. Un homme sans parti, pragmatique, flirtant avec la gauche et avec la droite, faisant tout reposer sur des contacts personnels, voilà Laval.
Quand il accède au sommet, au début des années 30, il se trouve confronté à des crises pour lesquelles il est mal préparé : l’effondrement financier mondial et la montée du fascisme. Laval est président du Conseil pendant toute l’année 1931 et ministre des Affaires étrangères dans les gouvernements qui se succèdent d’octobre 1934 au début de 1936 ; de juin 1935 à février 1936, il garde son portefeuille quand il redevient président du Conseil. Politiquement, il comble le vide laissé par Poincaré, Tardieu et Briand. De Briand, qui fut son ministre des Affaires étrangères en 1931, il garde le langage de la réconciliation franco-allemande qui lui est déjà familier. Cependant, sa majorité conservatrice — celle de Poincaré et de Tardieu — lui interdit des concessions substantielles. Personnellement, Laval apporte à la politique étrangère et aux affaires financières la suprême confiance en soi d’un homme qui s’est fait lui-même, un mépris pour les rites prudents, sentant le grand
49. Geoffrey Warner, op. cit., 21.
La France de Vichy
bourgeois, des diplomates de carrière et des banquiers internationaux, la technique de l’expression brutale et le plaisir toujours renouvelé de démêler les embrouilles, ce qui lui a si bien réussi à Châteldon et à Aubervilliers. Ce mélange politique et personnel est désastreux. Laval se précipite dans des affaires délicates avec une brutalité venant de l’inexpérience. Les négociations qu’il mène avec le chancelier Brüning et le président Hoover ne parviennent ni à endiguer la crise financière, ni à détendre les relations franco-allemandes. En 1935, il a l’air de prêter la main à Mussolini en Abyssinie, mais il n’est pas capable d’éviter l’orage qui éclate ensuite en France et en Angleterre, et il arrive à mécontenter tout le monde. On ne sait d’ailleurs toujours pas ce qu’il a dit au Duce. Après avoir négocié avec Staline un accord de sécurité mutuelle, il ne tente pas de le faire ratifier par le Parlement. Les élections du Front populaire l’envoient dans le désert. Il reste presque silencieux pendant quatre ans. Le ressentiment qu’il manifeste en 1940 contre les parlementaires élus aux cris de « Pendez Laval » ajoute, comme il le dit en août au Dr. Friedrich Grimm, un ingrédient à sa mixture politique. Le Parlement « m’a vomi », aurait-il dit le 25 juin 1940, si l’on en croit Paul Baudouin. « Maintenant je vais le vomir 50 . » Quand le gouvernement Pétain, ayant signé l’armistice et attendant l’ouverture imminente de la conférence de la paix, décide de convoquer l’Assemblée nationale pour lui faire abroger la constitution de 1875 et donner au maréchal pouvoir d’en rédiger une autre, Laval semble très désireux d’apporter son aide. Il n’a pas été pris dans le cabinet du 17 juin parce que trop représentatif de la « République des camarades » (comme dit Weygand à l’époque) ou parce que trop antianglais (comme dit Weygand après la guerre) 51 . S’il envisage de traiter avec la Chambre et le Sénat, un gouvernement conduit par des non-parlementaires doit toutefois compter un des grands ténors de la III e République. Or, ils se font rares cet été-là. L’eussent-ils voulu, il n’est pas question de prendre 'les derniers présidents du Conseil, parce qu’ils sont ou bien trop à gauche (Léon Blum) ou bien trop compromis dans la défaite (Daladier, Reynaud). Chez les conservateurs, Poincaré est mort, Tardieu devenu « l’ermite de Menton » et Caillaux, partisan notoire de la réconciliation franco-allemande, trop vieux pour jouer
50. T-120/2624/D525934-37 ; P. Baudouin, Neuf mois au gouvernement (Paris, 1948), 219.
51. Pour le souci qu’avait Weygand d’exclure tout parlementaire du gouvernement de 1940, voir sa note du 28 juin à Pétain, publiée par Paul Baudouin, op. cit. On peut trouver la version donnée par Weygand, op. cit., 298.
Prologue : été 1940
39
un rôle important. Pierre-Étienne Flandin, apparu sur le tard à Vichy, semble ne pas vouloir souhaiter plus que faire de Pétain le président de la République. C’est donc Laval qui devient le 27 juin vice-président du Conseil. Pétain lui écrit le 7 juillet : « Comme il m’est difficile de participer aux débats [de l’Assemblée nationale], je vous demande de m’y représenter. » Nous ne savons pas dans quelle mesure Laval est à l’origine de la constitution envisagée par le gouvernement ; notons cependant que les projets concernant de nouvelles institutions pullulent à Vichy en juillet 1940 52 . Ce qui est certain, c’est que Laval est chargé de soumettre à l’Assemblée nationale le projet de loi du gouvernement et de le faire adopter. C’est pourquoi il est la vedette de ces deux journées, servi en l’occurrence par ses traits de caractère : ambition, penchant pour un langage brutal, confiance en soi évidente.
Laval, bien entendu, n’a rien à voir dans les récriminations qui montent du pays vers eux quand les députés et les sénateurs se réunissent le 9 juillet, épuisés physiquement et émotionnellement. La plupart d’entre eux du moins sont là. Vingt-neuf députés et un sénateur, toujours décidés à transférer le gouvernement en Afrique du Nord, s’étaient embarqués le 21 juin sur le Massilia, pour se voir d’ailleurs détenus et traités de lâches émigrés trois semaines plus tard ; les quelque 70 communistes avaient été privés de leur siège par le gouvernement Daladier en janvier 1940. Laval n’a pas besoin de persuader ceux qui sont présents d’enterrer la constitution de 1875. La quasi-unanimité la condamne. Même Léon Blum, dans A Véchelle humaine , qu’il écrivit dans sa prison en 1942-43, souligne les insuffisances de l’ancienne République quand il dresse les plans de la nouvelle. L’autre grand projet opposé à celui du gouvernement, présenté par les sénateurs anciens combattants groupés autour de Taurines, et écarté par Laval, comme le prétendent les bien-pensants, propose de « suspendre » la constitution de 1875 et de donner à Pétain pleins pouvoirs pour jeter « les bases d’une nouvelle constitution » avec le concours de la Chambre et du Sénat.
52. La période écoulée entre l’armistice (25 juin) et la séance de l’Assemblée nationale (9-10 juillet) est * encore plus obscure si possible que les jours ayant précédé l’armistice et l’époque de Vichy, à laquelle les mémoires d’après-guerre et la majorité des comptes rendus accordent la part du lion. Il existe deux exemples célèbres des projets de reconstruction de la France : la note de Weygand du 28 juin (voir note 51) et la déclaration de Gaston Bergery (7 juillet), signée de quelque 70 parlementaires et publiée par l’un d’entre eux, Jean Montigny, dans Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire (Clermont-Ferrand, 1940), 139 sq. Cet ouvrage amplifie le rôle joué par Laval en juillet.
La France de Vichy
Même les républicains irréductibles ayant signé la motion manuscrite du député radical-socialiste Vincent Badie qui « refuse de voter une loi qui aboutirait inéluctablement à la disparition du régime républicain », se déclarent convaincus « de la nécessité impérieuse d’opérer d’urgence le redressement moral et économique de notre malheureux pays et de poursuivre les négociations en vue d’une paix durable dans l’honneur ». Pierre Laval n’a pas à faire violence à l’Assemblée pour qu’elle décide, le 9 juillet, par 624 voix contre 4, « que les lois constitutionnelles doivent être révisées 53 ». D’ailleurs, les électeurs français choisiront en 1945 à vingt-cinq contre un de ne pas revenir à la constitution de 1875. L’Assemblée, le 9 juillet 1940, ne fait pas une révolution par le haut. Elle reflète l’opinion publique quasi unanime.
Il ne faut pas se méprendre sur la gravité de l’œuvre accomplie le lendemain. Si l’armistice avait été une révolution diplomatique, rien n’obligeait la France à en faire une constitutionnelle. Un régime d’armistice administrant le pays juste pour assurer le fonctionnement des services indispensables pendant cette période intérimaire, comme ce fut le cas en Belgique et en Hollande, était une solution tout aussi valable. Même le vote du 9 juillet jetant la constitution de 1875 par-dessus bord ne préjugeait pas du futur régime. Après tout, quand la nouvelle constitution serait-elle rédigée et par qui ? Avant ou après la fin de l’occupation et la signature de la paix avec l’Allemagne ? Par une Assemblée élue ou par un régime autoritaire d’exception ? La loi présentée par le gouvernement le 10 juillet donne à ces deux questions la réponse la plus contraire qui soit aux traditions de la IIP République. Elle confère au maréchal Pétain les pleins pouvoirs, et non pas seulement ceux qui permirent à bon nombre de présidents du Conseil de légiférer par décrets-lois en période de crise ; elle l’autorise explicitement à rédiger une nouvelle constitution, qui devra être « ratifiée par la nation et appliquée par les Assemblées qu’elle aura créées ».
La loi ne spécifiait certes pas de calendrier, mais elle répondait au désir massif d’un changement immédiat. On ne charge pas un vieillard de 84 ans de faire une nouvelle constitution sans penser qu’il va se mettre aussitôt à l’ouvrage. Cette impatience a déter-
53. Les propositions de Taurines et de Badie n’eurent qu’une cinquantaine de partisans à elles deux. On en trouve le texte intégral notamment dans le Véritable Procès du maréchal Pétain, Louis Noguères (Paris, 1955), 157, 160-161. Un député socialiste (Biondi), deux radicaux (Roche, Margaine) et un sénateur (le marquis de Chambrun, à ne pas confondre avec le gendre de Laval, le comte René de Chambrun) ont voté « non » le 9 juillet.
Prologue : été 1940
41
miné le reste. Abstraction faite des prédilections autoritaires du gouvernement, il aurait été impossible d’organiser des élections ou de réunir une assemblée constituante bavarde et querelleuse quand les troupes allemandes occupaient les deux tiers du pays. Les assemblées républicaines devaient faire place à un exécutif à la Bonaparte élaborant la constitution. En outre, de grands changements seraient apportés à la vie publique française au plus haut du rebond contre le régime vaincu, en présence d’une armée d’occupation, pendant qu’on attendait de négocier la paix avec un Hitler victorieux. Quelle occasion pour les zélateurs éhontés du nouveau régime !
Une révolution venue d’en haut ? Peut-être, mais c’est beaucoup solliciter les faits que d’y voir le coup de main d’une poignée de conspirateurs. Ce qui nous est parvenu des paroles vraiment prononcées à l’époque donne à penser qu’une majorité écrasante se ralliait à l’idée de construire un nouveau régime immédiatement, fût-ce sous les yeux des Allemands. Il n’y eut pas seulement des monarchistes comme Weygand brûlant de se venger. Il y avait ceux qui croyaient, comme Pétain devait le dire à Hitler le 24 octobre, que la France pouvait espérer une paix plus clémente parce qu’elle aurait « pris un nouveau départ 54 ». Il y avait Gaston Bergery, ce jeune jacobin frustré qui voulait une république pure et forte, capable de combattre à la fois le fascisme et le communisme ; lui qui avait inventé en 1934 l’expression « Front populaire » demandait à la France de « reconstruire aujourd’hui de haut en bas sur les ruines qu’ils [les dirigeants de la IIP République] ont accumulées ». Et il y avait tout simplement ceux qui étaient fatigués, comme Édouard Herriot, le président de la Chambre, qui le 9 juillet adjurait les députés de rester calmes. « Autour du maréchal Pétain, dans la vénération que son nom nous inspire à tous, notre nation s’est groupée dans sa détresse. Prenons garde de ne pas troubler l’accord qui s’est établi sous son autorité 55 . »
Dans ce climat, Laval n’a vraiment pas grand mal à faire approuver le plan du gouvernement par le Parlement de Front populaire élu en 1936. Les députés et sénateurs décident, par 569 voix contre 80 (les fameux 80 qui se targueront ensuite d’avoir engendré la Résistance) et 17 abstentions, de donner naissance au nouveau
54. Voir note 13 supra.
55. La déclaration de Bergery a été publiée par Jean Montigny, op. cit., 139 sq. Le discours d’É. Herriot est reproduit in extenso dans le Journal officiel des débats à la Chambre, 11 juillet 1940.
La France de Vichy
régime 56 . L’opposition qui, selon les mémoires d’après-guerre, aurait été réduite au silence, n’a jamais été très forte. La proposition Taurines qui diffère de celle de Laval, non pas en ce qu’elle préconise de remettre à plus tard la préparation de la nouvelle constitution, mais parce qu’elle prévoit que Pétain doit « consulter » la Chambre pendant qu’il l’élaborera, rassemble à peu près vingt-cinq partisans. Vingt-sept parlementaires signent le texte de Vincent Badie, dernier rempart de la République (qui d’ailleurs demande aussi du nouveau). Quand on lit le compte rendu sténographique de la séance du matin du 10 juillet, on voit à l’évidence que les parlementaires étaient de plus en plus impatients de fouler aux pieds leurs règles de procédure 57 . C’est la troupe, et non pas la claque de Laval, qui réclame un vote immédiat. Pierre-Étienne Flandin, dont on cite souvent les paroles sur la nécessité de s’accrocher aux traditions françaises de liberté, termine son discours en recommandant de voter le projet du gouvernement. Laval n’a rencontré aucune opposition sérieuse.
Le Parlement de Front populaire ne s’est pas tout à fait « crucifié lui-même », comme l’en adjurait le 6 juillet Charles Spinasse, un ancien SFIO profondément déçu. On ne l’a pas non plus obligé à voter contre ses véritables sentiments. Les parlementaires ont plutôt, pour citer Anatole de Monzie, quitté la scène comme des « pénitents » qui ont « consenti tous abandons de pouvoir et tous sacrifices de liberté dans la conviction que l’ordre nouveau assurerait l’ordre 58 ». C’est pourquoi personne ne proteste quand, le lendemain, le maréchal Pétain assume officiellement ses nouvelles fonctions de « chef de l’État français ». Les actes constitutionnels un, deux et trois lui donnent pouvoir de prendre toute décision touchant l’exécutif et le législatif, la déclaration de guerre exceptée, sans en référer à l’Assemblée. On ne saurait surestimer la gravité de ces mesures largement acceptées. La collaboration ne va pas seulement consister à exécuter une tâche routinière sous l’occupation ennemie. Elle va profiter de la présence d’une armée étrangère pour modifier profon-
56. Ceux qui n’ont pas accès au J.O. du 11 juillet 1940, trouveront dans Histoire de Vichy, Robert Aron (Paris, 1954), 153, le nom des « 80 ». Ils comprennent 35 SFIO, 13 radicaux et quelques divers. La majorité des socialistes et des radicaux ont voté « oui » ; 5 socialistes et 2 radicaux (dont Herriot) se sont abstenus.
57. Le compte rendu de la session du 10 juillet au matin n’a pas été publié au J.O. Voir Commission parlementaire d’enquête, Événements survenus en France de 1933 à 1945 II, 479-497.
58. Noguères, op. cit., 158 ; Anatole de Monzie, La Saison des juges (Paris, 1943), 8.
Prologue: été 1940
43
dément la façon dont les Français étaient gouvernés, instruits, employés.
Un vieux monde est mort et le nouveau laisse déjà entrevoir son visage. Jamais il n’y eut autant de Français prêts à accepter la discipline et l’autorité. Le dur martèlement des bottes explique en partie l’attrait que les ligues fascistes ont exercé sur la jeunesse des années 30, qui manifestait déjà sa rébellion contre la III e République par le culte du muscle. « Grâce à nous, la France du camping, du sport, de la danse, des voyages, du tourisme collectif à pied, balaiera la France des apéritifs, des tabagies, des congrès et des longues digestions 59. » Des apôtres de la virilité, comme Montherlant, prônent le retour aux valeurs Spartiates. « C’est avant tout une cure de pureté qu’il nous faut 60 » ? écrit Jacques Benoist-Méchin.
Le thème de la discipline s’infiltre même chez l’élite républicaine. Édouard Herriot, président de la Chambre des députés, âme de la politique d’accommodement de la III e République, presse l’Assemblée nationale, le 9 juillet, d’accepter une « dure discipline ». Gide trouve le discours prononcé par Pétain le 20 juin « tout simplement admirable ». Le maréchal y disait que « l’esprit de jouissance l’a emporté sur l’esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu’on n’a servi ». Pour Gide, il faut mettre un frein à l’excès de liberté : « Je m’accommoderais assez volontiers des contraintes, me semble-t-il, et j’accepterais une dictature qui, seule je le crains, nous sauverait de la décomposition. Ajoutons en hâte que je ne parle ici que d’une dictature française 61 . »
La souffrance devait consumer les scories de la France de l’entre-deux-guerres, purifier et renforcer la fibre nationale. Les Français savent évidemment en juin 1940 qu’ils auront à souffrir, que cela leur plaise ou non, mais trouver du mérite à la douleur les aide à accepter l’armistice. Les porte-parole du régime se plaisent à proclamer que « la souffrance purifie ». Camus les tourne en dérision dans le sermon que le père Paneloux prononce à la fin du premier mois de la peste :
« Si, aujourd’hui, la peste vous regarde, c’est que le moment de
59. Paul Marion, membre du PPF, cité par Robert J. Soucy, « The Nature of Fascism in France », Journal of Contemporary History I, 1 (1966), 55.
60. Jacques Benoist-Méchin, op. cit., 50-51. Voir aussi Henri de Montherlant, Le Solstice de juin (Paris, 1941).
61. Gide, op. cit., 10 juillet 1940. C’était évidemment choisir entre deux maux. « Si demain comme il est à craindre, la liberté de penser, ou du moins l’expression de cette pensée nous est refusée, je tâcherai de me persuader que l’art, que la pensée même, y perdront moins que dans une liberté excessive », Journal, 25 juillet 1940.
La France de Vichy
réfléchir est venu... Dans l’immense grange de l’univers, le fléau implacable battra le blé humain jusqu’à ce que la paille soit séparée du grain 62 . »
Des hommes beaucoup plus éloignés des milieux vichyssois parlent eux aussi de la rédemption par la souffrance. La guerre aura été salutaire, pense Gide, à ceux qui en ont directement souffert et qui ont appris :
« Oui, bien avant la guerre, la France puait la défaite à plein nez. Elle se défaisait déjà d’elle-même, au point que ce qui pouvait la sauver peut-être c’était, c’est peut-être ce désastre même où retremper ses énergies. Est-il chimérique d’espérer qu’elle sortira de ce cauchemar affermie ? 63 »
Cette envie d’une main qui châtie conduisait directement à l’image du père. Que la dévotion jaillisse de ce peuple sceptique, voilà qui aurait été difficile à imaginer dans des circonstances moins dramatiques. En 1940 , n’importe quel chef victorieux de la Première Guerre mondiale aurait été un baume sur l’orgueil blessé. Pétain ne pouvait tomber à un meilleur moment. C’était un véritable héros national, sans lien visible avec la triste politique des années 30 . Trop âgé pour n’avoir pas désarmé les animosités provoquées par sa carrière militaire, trop taciturne pour s’en être attiré de nouvelles. On voyait dans la part qu’il avait prise à la politique depuis sa retraite — ministre de la Guerre du gouvernement Doumergue après les émeutes de février 1934 et premier ambassadeur auprès de Franco en 1939 — le sens du devoir d’un vieux soldat se mettant au service de son pays dans des circonstances critiques. Pour le reste, il parlait peu en public des problèmes nationaux, n’allant pas au-delà du dédain traditionnel de l’officier pour la politique. C’était une page vierge, prête à recevoir l’image que chaque Français se faisait du sauveur.
Pour les uns, Pétain était simplement « le drapeau », personnifiant la France éternelle : un vieux soldat, bien droit, de goûts austères, de souche paysanne catholique, un maréchal de France, membre de l’Académie française, revenant une fois de plus de sa modeste propriété de campagne pour arracher son pays à la canaille. Pour les républicains, Pétain semblait moins dangereux que beaucoup d’autres officiers supérieurs. Ce n’était pas un « jésuite en bottes », comme Foch ou Curières de Castelnau ; il n’avait de
62. ' Général Léon Huntziger, cité par le Temps, 17 août 1941 ; Albert Camus, La Peste, 1294-95 (La Pléiade).
63. Gide, op. cit., 17 juillet 1940, 7 mars 1943.
Prologue : été 1940
45
catholique que l’étiquette. Bien qu’il eût autorisé le colonel de La Rocque à publier en mai 1936, dans son journal, une interview « apolitique » le rangeant parmi ceux qui s’opposaient au Front populaire, Pétain paraissait moins suspect de connivences avec l’extrême-droite que le maréchal Franchet d’Esperey. Encore qu’il eût assumé le commandement de la bataille la plus coûteuse de la guerre de 1914-18 -— Verdun —, il semblait économe du sang français parce qu’il s’était opposé à la stratégie de l’offensive. Il avait liquidé les mutineries de 1917 d’une manière que l’on estimait ferme, mais juste. Même Léon Blum appelait Pétain le « soldat le plus noble et le plus humain » de France, tout en déplorant qu’il soit désigné comme ambassadeur chez Franco. Reynaud le prit à son cabinet, le 18 mai 1940, parce qu’il était une espèce de drapeau. Seule la jeune droite irrévérencieuse des années 30 se moquait de lui sans vergogne 64. En juillet 1940, Pétain convenait donc parfaitement à l’humeur du pays : à l’intérieur, un substitut aux politiciens et une barrière contre la révolution ; à l’extérieur, un général victorieux qui ne ferait plus la guerre. Honneur et sécurité.
Sous l’icône, cependant, il y avait un Philippe Pétain en chair et en os. Quelles décisions pouvait-on attendre d’un homme à qui des millions de Français avaient confié leur destin ?
Contrairement à l’idée communément admise après la guerre, Pétain n’était pas sénile en 1940. Des confrères de Vichy croyaient à l’époque que le D r Bertrand Ménétrel, médecin personnel et secrétaire de Pétain, de surcroît fils d’un de ses vieux amis, remontait le matin le maréchal en lui faisant des piqûres de benzédrine ou d’éphédrine. Cela se peut. En tout cas, en 1943 encore, des visiteurs se sont étonnés de trouver ce vieillard de 87 ans, toujours très droit, aussi alerte, vigoureux et bien portant. Ceux qui ont rapporté les conversations que Pétain a tenues en 1943 avec des Allemands, quelle que fût l’heure, n’avaient aucune raison apparente d’inventer la verve énergique, la vaste curiosité et la maîtrise du détail dont témoignaient ses paroles 65. Les actes de Pétain étaient conscients et ses choix délibérés.
64. Pour Emmanuel d’Astier de la Vigerie, dans Sept fois sept jours, Pétain, c’est toujours « le drapeau ». L’interview paraît dans le numéro du 9 mai 1936 du journal le Flambeau. Pour Léon Blum, voir le Populaire du 9 mars 1939. Céline, op. cit., 84-96, tourne Pétain en ridicule en en faisant « le maréchal Prétartarin ».
65. Janet Flanner [Genêt], Pétain : Old Man of France (New York, 1944), 47, est le seul biographe à parler de drogues. Pour les comptes rendus des conversations tenues par Pétain en 1943, voir chap. IV, note 62 ; cependant, quand il fut interrogé en 1947 par la commission d’enquête parlementaire dans sa prison de l’île d’Yeu, Pétain était sénile, de toute évidence.
La France de Vichy
L’âge, toutefois, avait incontestablement accentué une prudence native. Colonel promis à une proche retraite en 1914, il s’acquit déjà une certaine notoriété par le scepticisme acide que lui inspirait la stratégie de l’offensive qui avait alors la préférence. Il arriva au commandement suprême quand les partisans de cette tactique furent discrédités. Une fois devenu commandant en chef des armées françaises, il n’avança qu’après être certain qu’une préparation minutieuse lui assurait un net avantage, à la manière d’un Eisenhower et non pas d’un Patton ou d’un Montgomery en 1944. Poincaré, dans ses mémoires, laisse entendre que Pétain s’attendait à une défaite en février-mars 1918. Paul Valéry, qui accueillit le maréchal à l’Académie française, en 1934, rappela même dans son éloge son « attitude froide et presque sévère » et sa réputation de pessimiste. En 1940, ces traits de caractère avaient tourné au « scepticisme morose 66 ».
Pétain avait également appris vingt-cinq ans plus tôt ce qu’était la révolution. Quand il remplaça à la tête des armées, en mai 1917, le général Robert Nivelle qui s’était déconsidéré, des divisions du front étaient mutinées. Il comprit mieux que la plupart des autres officiers supérieurs que les attaques dérisoires pour gagner quelques mètres de terrain au prix de milliers de vies humaines, étaient à l’origine de la mutinerie 67 . Comme la plupart des autres officiers, pourtant, il attribuait une puissance presque magique aux « agitateurs de l’extérieur » et à l’influence des bolcheviques.
L’alerte de 1917 marqua Pétain, qui toute sa vie fit grand cas de la morale patriotique. Quand il déclarait, au cours des années 30, que l’éducation était devenue son grand souci, c’est à la morale qu’il pensait et non pas au savoir. En 1940, il était convaincu, comme il le dit à Bullitt, l’ambassadeur des États-Unis, que les instituteurs mauvais patriotes étaient responsables de la défaite 68 .
Tout cela pour dire qu’en 1940 Pétain estimait avoir pour mission non pas tant de définir une bonne politique que d’inspirer de bonnes attitudes. Il se donna énormément de mal pour jouer son
66. Poincaré, Mémoires X, 63-64, 85-86, 88. Valéry, Œuvres I, 1098 sq. (La Pléiade, 1957). Les derniers mots du paragraphe sont tirés d’un discours radiodiffusé de De Gaulle, 26 juin 1940.
67. Guy Pedroncini, dans les Mutineries de 1917 (Paris, 1967), a réuni d’importants documents de l’époque concernant le jugement porté par les officiers sur les mutineries.
68. L’amiral Fernet, dans Aux côtés du maréchal Pétain (Paris, 1953), 150, précise que Pétain voulait être ministre de l’Éducation en 1934. Pour sa remarque à Bullitt, voir F RU S, 1940, II, 384.
Prologue : été 1940
47
rôle de tuteur moral du peuple français. Son style concis, qui se prêtait autrefois à l’ironie comme aux rapports militaires {les soldats l’avaient surnommé « Précis-le-sec »), dégénérait en homélies composées de petites phrases simples qui tournaient plus souvent à la platitude qu’à l’épigramme. Le maître d’école commençait sa classe en expliquant les valeurs de la stabilité sociale : travail, famille, patrie.
Pétain n’avait pas comploté pour accéder au pouvoir ; il ne s’en était pas non plus emparé illégalement. S’il s’y agrippa — ne lâchant les rênes qu’en août 1944 quand les Allemands l’arrachèrent à l’hôtel du Parc, en raison de l’avance des Alliés — c’est, plus subtilement, par vanité. Habitué depuis vingt-cinq ans à être écouté sur tout, lui le sauveur de la patrie, il se croyait indispensable. Comme il le dit dans son message radiodiffusé du 17 juin 1940, il faisait « don de sa personne » à la France. Il resta au pouvoir par conscience et non par ambition, ce qui aurait été beaucoup moins dangereux : un simple ambitieux aurait changé de cap pius tard, au lieu d’entraîner par le fond tous ceux qui adoraient l’icône.
Mais alors, où donc étaient les « résistants de la première heure », aussi nombreux en 1944 que les descendants du JViayjiower à une convention du DAR * ? C'est un tait qu’il se trouva des hommes pour reconnaître, dès 1940 — et c’est tout à leur honneur — que les Français ne pourraient recouvrer leur liberté que par la force. Ils étaient touteiois en nombre intime et allaient encore se ciair-semer au cours de la première année. Il y avait, évidemment, les opposants silencieux, calqués sur ce vieil homme et sa nne qui, dans le Silence de La mer de Vercors, le premier grand roman paru dans la clandestinité, refusent d’adresser la parole à un jeune oihcier allemand, tout à fait convenable, logé chez eux. Nous voulons parler ici de cette résistance active qui perturbe les régimes, et va des renseignements fournis aux Alliés, ou de la publication de journaux clandestins, aux actes de violence. On possède maintenant de très bonnes sources de l’époque : dossiers de police français et surtout allemands. Ils montrent que l’opposition n’a pas posé de graves problèmes au régime avant les derniers mois de 1941.
* Daughters of the American Révolution, organisation célèbre aux États-Unis (N.d.T.).
La France de Vichy
Un certain nombre d’obstacles se dressaient devant une résistance active au début de l’occupation. Il était difficile de croire, fin 1940, que la guerre n’était pas terminée. Seule l’opiniâtreté britannique et les étendues infinies de l’URSS devaient révéler que la campagne de France n’avait pas été aussi décisive qu’il y paraissait. Toute résistance a besoin d’une lueur d’espoir qui faisait alors défaut.
L’existence même du régime Pétain ajoutait à la confusion. Si la présence des Allemands dans les deux tiers nord du pays montrait sans doute aucun où était l’ennemi, on ne savait pas exactement au sud si, pour être antiallemand, il fallait s’opposer à Vichy ou se réjouir de ses simulacres d’indépendance et de sa rhétorique nationaliste. L’un des premiers journaux clandestins, le Combat du capitaine Henri Frenay, porta en manchette jusqu’au début de 1942 des citations de Pétain et de Foch. Ce n’était pas un cas isolé.
Le désarroi de la gauche s’opposait aussi à l’époque à une résistance active. On aurait pensé que l’alliance du Front populaire, la plus ardente naguère à réclamer une action vigoureuse contre Hitler, et la bête noire du régime actuel, aurait fait naturellement converger les énergies vers des réseaux antinazis. Ce ne fut pas le cas, non pas tant à cause de la répression gouvernementale (bien que Pétain eût fait arrêter Léon Blum et cinq de ses ministres en septembre 1940, et que le parti communiste fût dans l’illégalité depuis l’automne 1939) qu’en raison de la confusion idéologique. Les partis du Front populaire avaient tous abandonné leur position de 1936. Les radicaux — c’est un anachronisme d’appeîCr encore ainsi ces bourgeois partisans du laissez-faire —- avaient été les premiers à devenir des tièdes, quand ils perdirent la majorité avec la montée des marxistes aux élections de 1936. Les socialistes, Léon Blum étant relégué dans l’ombre, revinrent en 1940 à un pacifisme traditionnel avec Paul Faure, qui avait été le secrétaire général du parti, et qui nourrissait des doutes au sujet de la défense nationale même en 1938-39. Les communistes firent volte-face fin septembre 1939, si bien que le parti pour lequel un Français sur six avait voté en 1936 dénonça la guerre contre Hitler en 1939 ; c’était à ses yeux une lutte fratricide entre impérialistes dont le vainqueur, que ce fût la Cité de Londres ou le nazisme, ne présentait aucun intérêt pour les travailleurs. Pendant l’été 1940, VHumanité clandestine demanda une paix scellant la réconciliation entre ouvriers français et allemands. Elle attaquait bien sûr Pétain, ce laquais des capitalistes français, ce qui permit au Parti de se targuer, après la guerre, d’être passé le premier à la Résistance. Sur sa lancée, elle s’en prenait aussi aux Alliés, fomenteurs de la guerre impérialiste, et
Prologue : été 1940
49
affirmait que la France ne pouvait rester libre qu’en évitant de devenir un dominion britannique. « Ni Pétain, ni de Gaulle », disait une affiche communiste collée sur les murs de Paris en janvier 1941. « La France ne veut ni la peste, ni le choléra 69 . »
La gauche organisée n’en donnant pas clairement le signal et la droite étant certaine qu’une belle part du gâteau l’attendait à Vichy, la résistance en 1940 fut le fait d’individus exceptionnels, déjà en marge du contexte social, ou se borna à une vague effervescence à l’Université. La première grande manifestation publique de l’opposition fut le défilé illégal des étudiants qui remontèrent les Champs-Êlysées le jour de l’armistice, en se dirigeant vers un symbole, plus patriotique que révolutionnaire : la tombe du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe. Le 6 septembre 1940, Cochet, général en retraite de l’armée de l’Air, fit imprudemment circuler un appel à la désobéissance civile, signé de sa main. Le premier journal clandestin, autre que l'Humanité pacifiste, n’apparut qu’aux derniers jours de 1940. Le capitaine Henri Frenay quitta l’armée en novembre pour fonder Combat. Libération (le futur Libération-Nord ), dû à deux dirigeants syndicalistes modérés, Christian Pineau (Syndicat CGT des employés de banque) et Robert Lacoste (Syndicat des fonctionnaires), sortit ronéographié le 1 er décembre à sept exemplaires. A la fin de l’année, un groupe de professeurs de Droit catholiques, François de Menthon, Pierre-Henri Teitgen et René Capitant préparaient le premier Liberté en zone non occupée. Le premier réseau de renseignements naquit à Paris à la même époque chez des anthropologues du musée de l’Homme, ayant à leur tête deux ethnologues, Boris Vildé et Anatole Levitsky, l’un et l’autre russes émigrés. Ces tâtonnements n'étaient que l’embryon de ce qu’allait devenir la Résistance.
Ces hommes ne posaient alors aucun problème réel au régime. Certains d’entre eux — Frenay, le commandant Loustanau-Lacau, des officiers cachant des armes — déclaraient agir au nom de Pétain. Même les syndicalistes de Libération-Nord demandaient une transformation totale des anciennes institutions et préconisaient une variante de la théorie corporatiste du régime : « Le syndicat libre,
69 Pour les affiches communistes clandestines de 1940 au début de 1941, voir la Guerre des papillons du socialiste italien A. Rossi [Angelo Tascal (Paris. 1954), annexe X. Jacques Fauvet, dans son Histoire du parti communiste français II (Paris, 1965), cite de très larges extraits de la presse du Parti pendant cette période. Même les histoires officielles du Parti ne parlent aujourd’hui qu’en sourdine du prétendu «appel du 10 juillet»
La France de Vichy
dans la profession organisée et dans l’État souverain 70. » Aucun des groupes de résistance n’appuya de Gaulle au début ; la gauche le trouvait trop maurrassien et la droite trop déloyal. Leur audace se limita à une poignée de tracts ronéographiés. Ce qui donne peut-être la meilleure mesure de cette « pré-résistance », c’est le calme des autorités. Les Allemands ne firent aucune « grande opération de répression » les premiers mois, sauf contre les communistes ; la lune de miel dans un Paris occupé se termina par des arrestations massives au cours de la nuit du 4 au 5 octobre. L’inquiétude officielle ne se manifesta pas avant le printemps 1941. Le groupe du musée de l’Homme fut balayé lors de la première grande vague d’arrestations, en mars ; le 2 avril, le préfet de la Seine-et-Oise somma les habitants d’effacer les slogans subversifs inscrits sur leurs murs, preuve indubitable que i’on trouvait partout le « V » que lançait la radio de Londres 71 . Il n’y eut tout bonnement pas à l’intérieur du pays une force organisée capable de prendre la relève de Pétain, pendant presque toute l’année 1940.
La vraie menace contre Pétain, pendant l’été et l’automne, vint de l’opposition d’une élite à l’étranger, plutôt que d’un mouvement de masse dans la mère-patrie. Les responsables des. possessions d’outre-mer trouvaient l’armistice difficile à avaler. N’ayant pas subi le Blitzkrieg et ayant été élevés dans l’idée de garder à la France les ressources de l’empire, les gouverneurs généraux et les chefs militaires étaient les Français les plus belliqueux de l’été 1940. Les deux principaux commandants des forces d’outre-mer, le général Auguste Noguès en Afrique du Nord et le général Mittel-hauser au Proche-Orient élevèrent des objections virulentes avant que l’armistice n’entre en vigueur. La stratégie du général de Gaulle semblait être alors de faire participer son groupe de Londres à ce grand effort. A la fin pourtant, Noguès ravala son angoisse et s’inclina devant les ordres stricts de Weygand, commandant en chef, qui envoya le général Kœltz lui expliquer que, la marine ne passant pas en Afrique du Nord, il était dérisoire de résister plus longtemps. Mittelhauser ne put qu’emboîter le pas. Les seuls chefs militaires ou gouverneurs à rejoindre de Gaulle, les généraux Le Gentilhomme
70. Christian Pineau publie ce texte curieux dans la Simple Vérité (Paris, 1960), 593.
71. Henri Noguères, Histoire de la résistance en France (Paris, 1967), I, 208, montre qu’il n’y eut pas au début de « grandes opérations » contre la Résistance. Voir Délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice (DFCAA), Recueil de documents publiés par le gouvernement français, 5 vol. (Paris, 1947-59), pour les premières exécutions en zone occupée, DFCAA IV, 454.
Prologue: été 1940
51
à Djibouti et Catroux en Indochine, le firent à titre individuel, sans entraîner leurs hommes ni leurs territoires. Repoussé à Dakar en septembre 1940, de Gaulle ne put à la fin de l’année s’assurer l’allégeance que d’une partie de l’Afrique équatoriale française et de quelques îles du Pacifique. La légitimité de Vichy et la force de l’obéissance aux ordres, exploitées vigoureusement par Weygand qui fit en personne la tournée de l’Afrique française, à l’automne, ont maintenu presque tout l’empire dans le droit chemin 72 .
Charles de Gaulle restait donc sur le sable, à Londres, presque seul contre toute attente, après avoir coupé les ponts par son appel du 18 juin. C’est en considérant les premiers gaullistes qu’on comprend peut-être le mieux combien l’opposition à Pétain était alors marginale. Ils étaient peu nombreux et sans aucune notoriété pour la plupart. Ils ne comptaient pratiquement aucune grande figure de l’avant-guerre : un seul député, Pierre-Olivier Lapie, qui se trouvait par hasard à Londres où il était arrivé avec le corps expéditionnaire ramené de Narvik ; un amiral, Muselier, qui s’était pris de querelle avec Darlan un peu avant la guerre. Les seuls officiers supérieurs venaient des colonies : Catroux, qui s’était démis de ses fonctions de gouverneur général en Indochine après avoir fait de larges concessions aux Japonais. Le Gentilhomme arrivé de Djibouti, et Larminat de Syrie. Les hauts fonctionnaires, eux, avaient déjà eu des ennuis avec le nouveau régime. Gaston Palewski et Maurice Dejean, anciens membres du cabinet de Paul Reynaud, ont gagné Londres en août. L’unique inspecteur des Finances, André Diethelm, avait fait partie du cabinet de Georges Mandel et n’eut plus aucun avenir quand l’ancien ministre fut arrêté au Maroc en juin et accusé d’avoir essayé de mettre sur pied, avec l’appui des Anglais, un gouvernement opposé à l’armistice. Le seul universitaire éminent fut le professeur René Cassin de la faculté de Droit de Paris et le journaliste le plus ancien était probablement Maurice Schumann, qui avait tenu la rubrique religieuse à Havas. Il sera ministre des Affaires étrangères sous la V e République.
Les gaullistes se recrutaient surtout parmi des hommes bannis par le nouveau régime ou se trouvant déjà outre-mer. Tous les bannis n’étaient d’ailleurs pas gaullistes pour autant. A gauche, on trouvait l’entourage de De Gaulle trop clérical, militaire et nationaliste. Les relations chaleureuses entre de Gaulle et les résistants de gauche, ce sera pour deux ans plus tard, au bas mot. Un proscrit
72. J’ai suivi ce processus beaucoup plus en détail dans Parades and Politics at Vichy (Princeton, N.J., 1966), chap. III.
La France de Vichy
aussi célèbre que Léon Blum espérait bien s’installer tranquillement dans le sud de la France. Rares sont les fonctionnaires rayés des cadres qui partirent pour Londres, du moins dans l’immédiat. Jean Moulin est l’unique préfet révoqué, parmi les gaullistes de 1940. Le seul ambassadeur qui rejoindra de Gaulle et sera son commissaire aux Affaires étrangères, René Massigli, rappelé de Turquie à la demande instante des Allemands lorsqu’ils découvrirent des plans concernant une opération militaire dans les Balkans, resta en France jusqu’au début de 1943.
Quitter le sol de la France était une entreprise difficile. En s’assurant le contrôle de la plus grande partie de l’empire, Vichy a remporté une grande victoire, car pour rejoindre de Gaulle il fallait rompre complètement avec la vie normale, fuir et s’exiler. Seuls les soldats et les fonctionnaires des colonies qui basculèrent totalement dans le camp gaulliste, comme le fait presque toute l’AEF en octobre-novembre 1940, pouvaient s’offrir le luxe de devenir des Français libres sans bouger de chez eux. Le reste devait s’exposer à des poursuites, au danger ; en outre, émigrer, n’était-ce pas s’enfuir comme un malpropre ? « J’aurais honte d’abandonner mes compatriotes quand tout va mal », écrivait Jean Renoir au scénariste américain Robert Flaherty le 8 août 1940 73. En particulier, aller à Londres c’était en quelque sorte changer d’ennemi. En effet, les 3 et 4 juillet, la marine britannique avait attaqué préventivement l’escadre ancrée à Mers el-Kébir (Algérie) et saisi les bateaux français se trouvant dans les ports anglais, estimant que les assurances verbales de Vichy ne suffisaient pas à garantir que les Allemands ne s’empareraient pas de la flotte française quand ils le voudraient. Plus de 1 200 marins français ont trouvé la mort dans cette douloureuse affaire relevant de la Realpoliîik. De Gaulle dut ensuite se défendre vigoureusement de servir les intérêts impérialistes britanniques.
Ceux qui étaient déjà hors de France n’étaient pas tous gaullistes, eux non plus. Bien des hommes qui en auraient eu la possibilité matérielle ne gagnèrent pas Londres. Le colonel André Béthouart, un ancien camarade de promotion de De Gaulle qui sera arrêté pour avoir aidé les Alliés à débarquer au Maroc en novembre 1942, se trouvait en Angleterre en juin 1940, au retour de la campagne de Norvège. Tout en laissant ses officiers et ses hommes libres de choisir, il estima de son devoir de repartir là où son gouvernement
73. Lettre de Jean Renoir à Robert Flaherty, 8 août 1940, dans Robert Flaherty MS, Columbia University.
Prologue: été 1940
53
l’avait affecté. La marine fut encore moins gaulliste après la tragédie de Mers el-Kébir. Il y avait environ 500 officiers et 18 000 marins français en Angleterre en juin 1940 ; tous, hormis 20 officiers et 200 marins, aimèrent mieux repartir que de rester avec de Gaulle 74 . Le seul homme d’affaires en vue qui fût opposé à Vichy, Jean Monnet, gros négociant en cognacs qui avait été officiellement chargé par le gouvernement d’acheter du matériel de guerre à Londres et à Washington, préféra rester aux États-Unis ; ce fut aussi le cas d’Alexis Léger, ancien secrétaire général du Quai d’Orsay. Ils furent rejoints par un flot de réfugiés : Pierre Cot, ministre de l’Air sous le Front populaire, les Rothschild, les Curie, le journaliste Henri de Kerillis, les romanciers Jules Romains et André Maurois. Jacques Soustelle, un anthropologue revenant de l’Amérique centrale à Londres, via les États-Unis, à la fin de l’été 1940, était en droit de penser qu’il allait à contre-courant 75 .
Le mouvement gaulliste ne dépassait pas au total 7 000 hommes en juillet 1940 et atteignit à peu près les 35 000 à la fin de l’année. Il plafonnera à ce chiffre jusqu’en novembre 1942 76 . L’essentiel de cet effectif se composait de ces gaullistes plus ou moins « automatiques » qu’étaient les soldats et les fonctionnaires d’AEF ; il s’y ajoutait, il est vrai, des gaullistes authentiques, par exemple des villages entiers de pêcheurs bretons. Les chefs étaient en très grande majorité des hommes nouveaux attirés par une carrière inespérée. L’obscurité avant la guerre de ceux qui devinrent Compagnons de la Libération montre combien furent rares les dirigeants français qui ont rejoint de Gaulle en 1940.
La plupart des futurs gaullistes ne franchirent le pas que beaucoup plus tard. Certains d’entre eux ont eu le malheur de publier tout chaud ce qu’ils pensaient pendant l’été 1940. Ces rappels des émotions intenses et confuses que leur inspira cet horrible été, ne laissèrent pas de les embarrasser par la suite. Les éditoriaux lénifiants de François Mauriac en sont un exemple célèbre. L’ode ardente de Paul Claudel au maréchal Pétain en est un autre ; les cyniques se sont d’ailleurs fait un plaisir de la comparer à l’hommage tout aussi vibrant qu’il rendit à de Gaulle en 1944. Jean Maze fit la joie des lecteurs français de 1948 en rassemblant une série de ces citations étranges dans le Nouveau Dictionnaire des girouettes ,
74. Mitteilungen liber die Arbeiten der Wako. no 46, 19 août 1940 (T-120/353/ 206537-540).
75. Jacques Soustelle, Envers et contre tout (Paris, 1947), I, 29.
76. Charles de Gaulle, op. cit., 100 ; Marcel Vigneras, Rearming the French (Washington, D.C., 1957), 10.
La France de Vichy
dont il emprunta le titre à un libelle très connu de la Restauration exposant les tergiversations des célébrités qui tournèrent casaque pendant les Cent-Jours 77 . M. Maze dut utiliser lui-même un pseudonyme, car il avait été rédacteur en chef adjoint du journal de Gaston Bergery, partisan enthousiaste du nouveau régime en 1940 et ambassadeur de Vichy en Union soviétique. Les authentiques « résistants de la première heure » étaient vraiment une denrée rare en 1940.
Il faut un recul historique plus long que de coutume pour appréhender les impondérables du climat de l’été 1940. Le coup de massue de la défaite, qui en un instant avait fait d’un peuple fier et sceptique une foule de flagellants avides de souffrance et de discipline, se dissipa aussi vite que l’hébétude de la victime d’un accident de voiture. Les bribes de conversations et de documents qui nous sont parvenues expriment l’opinion de gens sortant de l’ordinaire — écrivains, publicistes, diplomates — comme le montre ce prologue. Et surtout, on voit 1940 à travers le prisme de la Libération, des procès et mémoires d’après-guerre qui ont imposé leurs perspectives sur une image fondamentalement fausse. En 1944, l’univers ^avait pivoté sur son axe à un point tel que les grandes supputations stratégiques de 1940 — guerre courte, risque de révolution, paix imminente — paraissaient des non-sens. Les anciens Vichyssois avaient toute raison de produire un fleuve de documents bien choisis, justifiant leur conduite et visant à montrer qu’en 1940 ils avaient déjà vu le monde dans l’optique de 1944. Leur vie en dépendait.
Pour retrouver le climat de 1940, il faut oublier totalement l’éclairage de l’après-guerre. Il a si bien pénétré les esprits que l’on a tendance à couler les informations nouvelles dans les vieux moules. C’est ce qui arrive, par exemple, avec les documents allemands oubliés par mégarde, qui parurent de temps à autre dans des périodiques français après la Libération. Je me suis attaqué dans ce livre à la rude tâche de briser les vieux moules et de proposer une autre vision d’une période controversée. Chaque fois que possible, je me suis appuyé sur des documents de l’époque et non pas de l’après-guerre — témoignages apportés lors des procès ou dans des mémoires — lorsqu’ils ne concordent pas.
Une notion dont il faut se débarrasser, c’est celle du « double jeu ». Il était tentant de dire en 1944 que l’on avait toujours prévu la Libération et que l’on s’était rallié en apparence à Vichy uniquement pour gagner du temps. Hitler le croyait, au début, et c’est
77. Orion [Jean Maze], Nouveau Dictionnaire des girouettes (Paris, 1948).
Prologue : été 1940
55
seulement en octobre 1940, après son entrevue avec Pétain, qu’il fut persuadé que le maréchal et son ancien protégé de Gaulle n’étaient pas de connivence. De nombreux Français, qui avaient appuyé Vichy un certain temps, exposèrent ensuite leur vie dans la Résistance ; ils sont donc passés de la perspective de 1940 à celle de 1944. Mais il ne faut pas, en les télescopant, fondre ces deux attitudes successives en un double jeu. On connaît maintenant la teneur de toutes les conversations que les diplomates allemands et américains eurent avec les dirigeants français, et il est tout à fait évident que les membres du cabinet de Vichy leur dirent à peu près la même chose. Il n’y eut pas de double jeu officiel. Dans les premier et quatrième chapitres de cet ouvrage, je m’efforce de montrer que Vichy a sincèrement recherché la neutralité, une paix rapide et un règlement final satisfaisant avec l’Allemagne.
Plus tenace encore est l’idée que l’on se fait de la passivité de Vichy. Après la Libération, les amis et ennemis du régime ont estimé qu’il s’était borné à réagir aux initiatives de l’Allemagne. Pour les sympathisants, Vichy fut un frein, un obstacle, un moyen de différer ou d’atténuer les exigences sans bornes de l’ennemi et d’éviter l’occupation totale (comme si les Allemands la voulaient !). « Après nous, la polonisation. » Pour les opposants, Vichy a capitulé — de gaieté de cœur ou la corruption aidant — devant les désirs insatiables du Reich. Pour les uns et les autres, l’énergie motrice venait de Berlin. La « collaboration » n’était qu’une réponse à cette impulsion.
Nous pouvons fixer presque exactement aujourd’hui le moment où s’est opérée cette distorsion, adroitement exploitée par la défense lors du procès de Pétain. Quand les armées allemandes battant en retraite ont emmené le maréchal, en août 1944, au vieux château des Hohenzollern à Sigmaringen, où le Danube sort de la Forêt-Noire, sa dernière déclaration a donné le la de la défense passive : « Si je n’ai pas pu être votre épée, j’ai essayé d’être votre bouclier. » Il revient sur cette idée dans la déclaration qu’il fit au cours de son procès, en 1945 : « Chaque jour, un poignard sur la gorge, j’ai lutté contre les exigences de l’ennemi 78. » Ce n’était pas tant un mensonge qu’une demi-vérité. Elle obscurcit tout ce qu’a fait Vichy sans y être obligé par l’Allemagne et tout ce que Vichy a supplié l’Allemagne de faire. L’accusation mal préparée et cherchant plus à rassembler des ragots sur une conspiration qu’à porter un jugement
78. Dans Pétain (Paris, 1966), Georges Blond attribue à Henri Massis la rédaction du message d’août 1944. Voir aussi Le Procès du maréchal Pétain, 9.
La France de Vichy
historique serein, laissa le procès dévier : on glissa de ce pour quoi à ce contre quoi Vichy avait lutté. Incapable de prouver que Pétain avait activement conspiré avant la guerre pour assurer la victoire allemande, l’accusation passa du péché de commission au péché d’omission.
Lors des procès suivants, les accusés suivirent allègrement la voie ainsi ouverte : initiative de Berlin et passivité de Vichy. Par exemple, quand on interrogea Laval sur les lois relatives à la franc-maçonnerie, il répondit que les Allemands les lui avaient imposées, ce qui est un mensonge éhonté 79 . D’autres prétendirent simplement qu’ils avaient eu un rôle subalterne ou technique les laissant dans l’ignorance de la grande politique. Darlan avait été assassiné et le procès de Laval fut trop précipité et trop passionné pour déboucher sur les problèmes de fond. Des affaires jugées par la Haute Cour de justice, seuls les procès de Jacques Benoist-Méchin et de Fernand de Brinon, représentants de Vichy à Paris, jettent une lueur sur les initiatives du gouvernement. Quand on considère ces procès et la marque qu’ils ont laissée sur l’opinion publique, on est stupéfait de constater combien l’image du régime est réduite à une alternance : demande de Berlin - réponse de Vichy (habile ou lâche, selon les préférences de chacun). M e Isomi, l’avocat de Pétain, a gagné son procès devant le pays, sinon devant la Cour.
Pour rétablir la vérité historique, il faut donc surtout remettre en lumière les initiatives prises par Vichy. La France, en réalité, a joui d’une liberté d’action tout à fait exceptionnelle pour un pays vaincu et plus qu’à moitié occupé. Le contrôle allemand sur la zone sud n’a pas été strict pendant quelque temps, pour des raisons délibérées ou non. Raisons délibérées, le facteur économique et l’habileté politique de laisser une France docile se tenir à l’écart de la guerre aussi longtemps qu’elle paraissait désireuse de le faire. Moyennant quoi, la France fut le seul pays à pouvoir négocier un armistice d’État à État 80 , et à être divisé en deux zones, l’une occupée, l’autre libre. Pour des raisons non délibérées, il fallut un certain temps pour qu’une direction politique allemande s’instaurât à Paris. Au début, c’était le Militàrbefehlshaber in Frankreich qui représentait réellement la puissance du Reich en France et toutes les tractations avec les autorités françaises se faisaient par le truchement de la Commission d’armistice de Wiesbaden. On pensait
79. Le Procès du maréchal Pétain, 191.
80. Spaak et d’autres ministres belges désiraient un armistice, que les Allemands refusèrent. Voir Thomas J. Knight, « Belgium Leaves the War, 1940 », Journal ol Modem History 41, 1 (mars 1969), 62-63.
Prologue : été 1940
57
alors que les relations franco-allemandes se limiteraient, pendant la brève période précédant les négociations de la paix, à des questions techniques : démobilisation des Français et sécurité des Allemands. Au début, Otto Abetz représentait simplement les Affaires étrangères auprès du Militàrbefehlshaber. Au cours du mois qui suivit l’armistice, il ne rencontra qu’un seul membre du gouvernement Laval, le 16 juillet. Hitler le nomma ambassadeur le 8 août et, peu à peu, un service politique indépendant se constitua dans la capitale, à l’écart des militaires plus pragmatiques de Paris et de Wiesbaden 81 .
Vichy vécut donc ses cent premiers jours sans être trop soumis à une direction politique directe de l’Allemagne. Cette direction fut d’ailleurs surtout négative — interdiction plutôt qu’obligation de faire ceci ou cela — jusqu’à l’été de 1941, quand on commença à assassiner des Allemands, et l’été de 1942, début du travail obligatoire et de la déportation des juifs vers l’est. Les préoccupations essentielles de Vichy n’ont jamais beaucoup intéressé Berlin. Je me propose donc, dans ce livre, de faire la lumière sur les initiatives de Vichy. Je veux replacer Vichy à la juste place qu’il occupe dans l’histoire française ; ce fut un lien entre la guerre civile naissante de l’avant-guerre et les transformations sociales de l’après-guerre.
Je vais donc braquer le projecteur sur les Vichyssois, aux dépens des collaborateurs de Paris. On les met trop souvent dans le même sac. Parmi les célébrités de la collaboration, il y a ceux qui dirigèrent des mouvements politiques ou publièrent des journaux, pour mener la grande vie dans la capitale occupée et, dans bien des cas, pour émarger à l’ambassade d’Allemagne 82 . Ils sont notoirement connus, certes, mais il est douteux qu’ils aient directement infléchi la politique de Vichy, et certain en revanche qu’ils furent à la botte d’Abetz. Ils n’ont eu ni l’indépendance, ni la grande influence qui font l’intérêt de Vichy. Ils étaient hostiles au régime du maréchal, lui reprochant d’être trop vieux jeu et trop timoré devant la révolution fasciste. Il fallut attendre janvier 1944, pour qu’avec Déat, Darnand et Henriot, des personnages importants de Paris prennent de l’influence dans un Vichy sur le déclin. Le plus habile de toute
81. Voir Délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice, Recueil de documents publié par le gouvernement français, 5 vol. (Paris, 1947-59). Exception faite de quelques documents importants qui n’y figurent pas, c’est le meilleur compte rendu au jour le jour des négociations techniques entre les militaires allemands et le gouvernement de Vichy.
82. On peut trouver des renseignements sur la presse subventionnée par Abetz dans Pariser Botschaft, Ordner 1134, « S 8 Geheim, 1940-44 » (T-120/3112).
La France de Vichy
la bande — Doriot — n’y est jamais parvenu. Les collaborateurs parisiens occupent donc les coulisses plutôt que le devant de la scène dans ce livre.
J’y mets aussi l’accent sur l’histoire sociale. Certains des aspects les plus poignants et les plus dramatiques de la vie sous le maréchal Pétain n’ont pas reçu l’attention qu’ils méritent. La politique intérieure du régime est toujours enveloppée d’un grand mystère ; il faut encore aujourd’hui se tourner vers le Bon Beurre de Jean Dutourd ou les Forêts de la nuit de Jean-Louis Curtis pour savoir ce que furent la misère et l’héroïsme de la France occupée. Je pense que d’autres questions, dont les réponses sont déjà moins obscures, pourraient aussi éveiller la curiosité du lecteur et lui permettre de prendre parti. Qu’a fait le régime de Vichy avec la marge d’indépendance qui lui fut laissée ? Quels groupes en ont-ils profité ? Quels étaient ses thuriféraires ? Nous allons donc commencer par voir comment la France a employé, pour usage externe, cette indépendance en s’efforçant d’obtenir un règlement franco-allemand.
A la recherche de la collaboration
1940-1942
Pourquoi ne nous avez-vous jamais aidés ?
Laval au général von Neubronn, juin 1943.
Nous connaissons les immenses difficultés qui nous attendent pour assurer les besoins vitaux du pays, et, d'autre part, nous ignorons tout des intentions du gouvernement du Reich, qui ne nous a pas encore donné le moindre indice d’une volonté de collaboration.
Yves Bouthillier au général Doyen, 23 octobre 1940 1 .
La collaboration, ce ne fut pas une exigence allemande à laquelle certains Français ont répondu, par sympathie ou par ruse. Ce fut une proposition de la France, qu’Hitler repoussa en dernière analyse. Aussi brutalement exprimé, ce jugement appelle certes des réserves. Hitler ne restait pas passif, bien sûr. Il voulait une France docile qui lui assurât une solide base de départ contre l’Angleterre, et les ressources les plus riches de l’Europe occidentale occupée. C’est pourtant le régime de Pétain qui fit d’innombrables ouvertures en vue d’un travail en commun : large règlement franco-allemand, neutralité volontaire permettant de soutenir les efforts que faisait Hitler pour interdire l’Europe et l’empire aux Alliés et, en définitive, association à part entière dans le nouvel ordre européen. Hitler fut tenté d’accepter en octobre-décembre 1940, puis à nouveau en mai 1941, quand une France libre de ses actes, associée de son plein gré, semblait utile aux visées allemandes en Méditerranée. Des conseillers militaires, tels l’amiral Raeder et le général Walther
1. Deutscher General Vichy, Akte 7a (T-501/120/412-416) ; Ministère public c! Bouthillier, 52.
La France de Vichy
Warlimont, et des hauts fonctionnaires des Affaires étrangères, comme l’ambassadeur Ritter (mais jamais Ribbentrop) accueillirent l’idée avec enthousiasme. En fin de compte, Hitler repoussa la main tendue. En fin de compte, la Kollaboration, ce fut la botte, un moyen d’obtenir à bon marché que les Français se tiennent tranquilles ; c’était aussi la paix de revanche à venir.
Des deux côtés, on supposait que l’armistice serait un arrangement provisoire permettant de faire sortir la France de la guerre et d’y maintenir l’ordre pendant la dernière bataille qui assurerait la défaite de l’Angleterre. Les signatures étaient à peine sèches que la situation évolua d’une manière imprévisible. La guerre ne fut pas terminée. Churchill ne demanda pas la paix dans le sillage de Pétain. Or, l’Allemagne n’était pas capable d’envahir la Grande-Bretagne avant d’avoir la maîtrise de l’air, ce qui reportait la traversée de la Manche à l’automne. Le nord de la France resta zone de guerre. L’armistice, d’instrument assurant dans le calme le contrôle du désarmement français, devint le moyen de poursuivre la lutte contre l’Angleterre, à partir du sol de France. Berlin commença à se soucier moins de la lettre de l’armistice que de l’esprit de son préambule, une déclaration du général Keitel qui ne faisait pas partie du document même : la France devait tout faire pour que l’Allemagne puisse poursuivre la guerre contre la Grande-Bretagne 2 .
« L’Allemagne pouvait penser, il y a deux semaines encore, que des négociations avec l’Angleterre étaient possibles », dit le général Otto von Stülpnagel au général Huntziger, le 1 er août, à Wiesbaden, « cet espoir fut déçu et le Reich a été obligé de prendre les mesures de sécurité qu’imposent les circonstances et la nécessité de continuer la guerre. » En rejetant carrément le blâme sur une Angleterre récalcitrante (le général Huntziger dit le 7 août : « Nous sommes une fois de plus victimes de la poursuite de la guerre »), les Allemands vont désormais interpréter l’armistice avec la dernière rigueur 3 . Pendant la première semaine d’août, le matériel militaire jusque-là stocké en France, aux termes de l’article 5 de l’armistice,
2. Pour le préambule, voir DGFP XI, n° 512, 644. En ce qui concerne son utilisation ultérieure en vue de justifier les exigences allemandes après l’armistice, voir, par exemple, l’obligation faite à la France de fournir du pétrole à l’Italie en janvier 1941 (T-120/378/209359-60).
3. La conversation du 1er août 1940 ne figure pas dans DFCAA. Voir Délégation française auprès de la Commission allemande d’armistice pour l’économie,
« Comptes rendus des réunions du 1er juillet 1940 au 5 août 1944 » (consultés à la Bibliothèque de documentation internationale et contemporaine [BDIC] Paris). Pour le 7 août, voir DFCAA I, 110.
A la recherche de la collaboration , 1940-1942
61
commence à prendre le chemin de l’Allemagne 4 . Le 26 août, après des semaines de négociations vaines, Vichy doit accepter de payer 20 millions de marks par jour au titre des frais d’occupation prévus par l’article 18 ; ce qui représente 400 millions de francs, avec le taux de change exorbitant de vingt pour un. Les prisonniers de guerre, dont la libération « avant même le début des pourparlers de paix » a été demandée par le général Huntziger, quittent les camps provisoires français pour les stalags 5 . Les premiers plans relatifs à une armée d’armistice sont renvoyés à Vichy pour « élagage ».
Fait plus inquiétant encore, la ligne de démarcation devient une frontière pratiquement étanche. Trois cents lettres seulement par jour peuvent la franchir, à un moment où des millions de Français essaient de retrouver leur famille ; en août, Laval et Abetz mettent au point une carte postale où l’on biffe les mentions inutiles (« je vais bien », « je ne vais pas bien », etc.), unique contact fragile entre les deux zones. Les Français autorisés à passer la ligne n’ont pas le droit, après le 13 septembre, d’emporter plus de 200 francs 6 . Ils sont rares à pouvoir la franchir, ce qui gêne les voyages officiels en particulier. Au moment où Vichy essaie désespérément d’asseoir son autorité, l’administration de la zone occupée connaît à peine son existence. Bien que l’article 3 de l’armistice reconnaisse la souveraineté du gouvernement français sur l’ensemble du territoire, sous réserve des « droits de la puissance occupante », et l’autorise expressément à rentrer à Paris, toutes les demandes qu’il formule à ce sujet, à commencer par la proposition de Paul Baudouin du 7 juillet, sont repoussées 7 . La ligne de démarcation devient un garrot.
Le Reich se met également à explorer la possibilité d’exploiter les ressources françaises plus largement que ne le prévoit l’armistice. Dès la fin de juillet, un groupe d’officiers et d’industriels allemands
4. Mitteilungen über die Arbeiten der Wako, no 35 et 38, 2 et 6 août 1940 (T-120/365/206457, 206473). Les Français essaient d’en envoyer une partie dans les colonies (T-120/368/206878). En février 1941, 7 500 wagons d’armes avaient été envoyés en Allemagne (T-120/1067/313181).
5. Hemmen (Wiesbaden), 81 à Berlin, 23 août 1940 (T-120/365/206573-4) ; DFCAA I, 167-174 ; Mitteilungen über die Arbeiten der Wako, no 35, 2 août 1940 (T-120/365/206457-8).
6. DFCAA I, 137, 140, 190-1 ; U.S. Department of State Serial File 851.00/2094. La Ligne de démarcation de Gilbert Renaud [Rémy] est une longue série d’anecdotes sur le passage de la ligne. Dans les Forêts de la nuit, Jean-Louis Curtis imagine un passage clandestin très émouvant.
7. Paul Baudouin, op. cit., 227, 238, 270 ; (T-120/121/119692). Le 19 août, Ribben-trop ordonne d’opposer des réponses « dilatoires » aux demandes du gouvernement français (T-120/121/119810).
La France de Vichy
insistent pour visiter des usines d’aluminium en zone sud (jusqu’à la conquête de la Yougoslavie, la France sera la plus grande source de bauxite dont disposera l’Axe 8 ). Il paraît probable qu’ils se proposent d’exiger que la bauxite ou l’aluminium soient livrés à Berlin. Par ailleurs, des industriels allemands approchent directement des chefs d’entreprise de la zone occupée pour leur faire accepter des contrats de guerre. Au début, le ministre de la Production industrielle, René Belin, et Léon Noël, le représentant du gouvernement à Paris, auraient pressé les industriels français d’accepter. Toutefois, le 27 juillet, Vichy, pressentant qu’ils y sont de toute façon décidés et espérant négocier lui-même, donne son accord, à condition que les contrats allemands conclus avec l’industrie de la zone nord passent par le canal d’un service français, et que les livraisons se limitent à des produits « passifs » et non pas « agressifs ». A la fin, le général Stülpnagel affirme simplement, dans une lettre du 2 septembre, que le Haut Commandement allemand a le droit de faire appel à l’industrie française [en zone occupée] sous la forme et dans la mesure où l’exige la poursuite de la guerre contre la Grande-Bretagne 9 .
Puis, le 4 septembre, le délégué économique allemand à la Commission d’armistice de Wiesbaden propose que les usines d’aviation et de moteurs d’avion de la zone libre travaillent elles aussi pour le compte du Reich 10 . Il est évident que les services économiques allemands insistent pour obtenir de la France des avantages matériels allant au-delà de la lettre de l’armistice. Vichy a donc perdu la haute main sur l’industrie de la zone occupée ; mais, comme le dit le général Huntziger le 6 septembre : « La situation paraît beaucoup plus favorable en ce qui concerne les industriels de la zone libre 11 . » Raison de plus pour essayer d’obtenir des concessions substantielles en contrepartie des nouvelles propositions allemandes.
Le Reich prend des mesures non prévues par l’armistice encore plus inquiétantes, qui dévoilent son intention d’annexer l’Alsace-Lorraine. Les Français apprennent le 15 juillet qu’un cordon douanier est établi sur les anciennes frontières de 1871. Le 19 octobre, la Commission d’armistice demande que tous les jeunes gens nés en Alsace-Lorraine quittent l’armée d’armistice et les
8. Pour les réticences et l’agrément final de la France, voir DFCAA I, 73-75, 84.
9. On peut suivre dans DFCAA I, 118-120, 155-156, 206-224, le problème des contrats passés avec les Allemands par l’industrie française de la zone occupée.
10. DFCAA I, 194, 206-224.
11. DFCAA I, 207.
A la recherche de la collaboration , 1940-1942
63
Chantiers de jeunesse. Puis, le 18 novembre, en dépit des objections d’Abetz et malgré l’ère des « bonnes relations » qui a été ouverte à Montoire trois semaines plus tôt, le Gauleiter Bürckel expulse 100 000 Lorrains qui veulent rester citoyens français. Début décembre, le Gauleiter Wagner chasse d’Alsace 4 000 réfugiés. Jusqu’à la mi-décembre on voit des trains entiers de ces malheureux, n’ayant guère que ce qu’ils portent sur le dos, se déverser sur une France déjà appauvrie. Bon nombre d’entre eux, dont une partie de l’université et de l’évêché de Strasbourg, se rassemblent autour de Clermont-Ferrand où ils tarabustent l’ennemi avec les souvenirs de sainte Odile, la patronne de l’Alsace, et ses prophéties sur les maux qui vont venir de « l’Antéchrist du Danube ». Réagissant plus vivement qu’à tout autre « incident », sauf peut-être l’exécution des otages en août 1941, le maréchal Pétain fait paraître un communiqué où il déclare que les négociations franco-allemandes en cours n’ont rien à voir avec une « mesure de ce genre », communiqué censuré en zone occupée. D’autres ennuis d’ordre territorial attendent le gouvernement : le Nord est déclaré zone interdite et aucun réfugié n’a le droit d’y retourner ; l’administration du Nord et du Pas-de-Calais est confiée à Bruxelles ; les Allemands favorisent le séparatisme breton et flamand 12 . Arrangement provisoire, l’armistice est humiliant, arrangement définitif, il est intolérable. Ainsi que le dit Huntziger à Stülpnagel, le 21 août à Wiesbaden, il « mène la France à la ruine 13 ».
Par ailleurs, une évolution parallèle conduit la France et l’Angleterre au bord de la guerre, au cours des journées qui suivent l’armistice. Les relations franco-britanniques ont déjà été tendues à craquer par des priorités antagonistes lors de la bataille du nord de la France 14 . La lutte pour le contrôle de la flotte française les
12. (T-120/365/206284) ; DFCAA II, 380-389. La note de protestation du maréchal Pétain du 19 novembre 1940, et son rejet par Berlin, sont publiés dans DGFP XI, no 351 et 354, 570, 610. André Lavagne, dans le Procès Pétain, 310, déclare que quelques protestations ont été élevées au sujet de l’Alsace-Lorraine. Les rapports des services de renseignements allemands sur les réactions des réfugiés figurent dans Oberkommando der Wehrmacht (OKW). Abteilung für Wehrmacht-Propa-ganda, « Geheime-Akten über fremde Staaten : Frankreich » (T-77/OKW-1605). La meilleure étude de la politique allemande à l’égard de la Bretagne est due à Eberhard Jâckel, la France dans l'Europe de Hitler (Paris, 1968), 74-78. Pour le mouvement flamand, voir E. Lejonghe, « Un mouvement séparatiste dans le Nord et le Pas-de-Calais sous l’occupation, 1940-44 », Revue d'histoire moderne et contemporaine XVII, 1 (janvier-mars 1970).
13. DFCAA I, 170.
14. John Cairns, « Great Britain and the Fall of France. A Study in Allied Disunity », Journal of Modem History 27, 4 (décembre 1955).
La France de Vichy
fait voler en mille morceaux. L’article 8 de l’armistice prévoit que la marine de guerre française, la deuxième d’Europe, doit regagner ses ports d’attache, dont la plupart sont en zone occupée. Faisant litière d’engagements que l’amiral Darlan peut ne pas pouvoir tenir, même s’il le souhaite, Churchill est persuadé que la marine française est sur le point de tomber entre les mains de Hitler. A l’aube du 4 juillet, un ultimatum anglais mettant l’escadre dè la Méditerranée en demeure de rejoindre l’Angleterre, de gagner des ports coloniaux éloignés ou de se saborder, est repoussé ; les navires britanniques ouvrent le feu sur les bâtiments français à Mers el-Kébir, tuant 1 267 marins et déclenchant une colère noire en France. Le même jour, les Anglais s’emparent des bateaux français ancrés dans les ports de Grande-Bretagne. Le gouvernement du maréchal Pétain envisage une opération navale franco-italienne contre Alexandrie et, le 8 juillet, ordonne de préparer, à partir de Dakar, une attaque contre Freetown, en Sierra Leone. Il se contente cependant d’un petit raid aérien sur Gibraltar, le 5 juillet 15 . Un conflit de fait vient de s’ouvrir, qui va opposer les forces françaises aux anglo-gaullistes à Dakar, en septembre 1940, en Afrique équatoriale française de septembre à novembre 1940, et en Syrie en mai-juin 1941. Une rupture éventuelle avec l’Angleterre n’était pas nécessairement un mauvais calcul. Après tout, au moment de la conquête des colonies, l’Anglais avait été un rival plus redoutable que l’Allemand. Dans un monde où l’Allemagne semblait monter et la Grande-Bretagne décliner, la France pouvait compenser outremer ce qu’elle perdait sur le continent. Des cerveaux fertiles de Vichy, tirant des conclusions géopolitiques hardies de la vague d’anglophobie qui déferla après Mers el-Kébir, virent même la possibilité d’étendre les possessions coloniales aux dépens de la Grande-Bretagne.
Les rêves d’empire que caressa Vichy au cours de l’été 1940 procédaient, comme bien d’autres de ses positions, d’un courant d’opinion né à la fin de la III e République. Après Munich, un « repli impérial » était, pour beaucoup, la seule politique active qu’on
15. P.M.H. Bell, « Prologue à Mers el-Kébir », Revuç d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, no 33 (janvier 1959). La colère de la France a été d’autant plus violente que l’amiral Gensoul n’a pas transmis le texte intégral de l’ultimatum anglais (une nouvelle dépêche d’Ems). On trouvera les documents de l’époque relatifs à l’attaque envisagée contre Alexandrie dans DFCAA V, 440-444 ; et ceux qui concernent la Sierra Leone dans Ministère public c! Weygand, 25, et Ministère public d Rivière. I.S.O. Playfair, The War in the Mediterranean (Londres, 1954), I, 142-143, décrit le raid aérien contre Gibraltar dont on pourrait penser qu’il a été différé sine die, en lisant Neuf mois au gouvernement de Baudouin.