Chapitre 5
De la fama au bûcher : la machine infernale
« Tu ne laisseras pas vivre les sorciers [maleficos] », est-il écrit dans la traduction latine de la Bible (Exode, 22, 18) qui traversa les siècles, la Vulgate (alors que le texte hébreu utilise en fait une forme féminine – « les sorcières » – qu’adoptèrent Luther et les réformateurs). Voilà ce que confirmait en 1607, dans sa Theorica criminalis, le juriste bressan Godeffroy de Bavoz, autorité moins prestigieuse mais non moins décisive, en son époque et à son échelle, puisqu’il présidait la Chambre criminelle du duché de Savoie : « Pourquoi hésiterions-nous à punir de mort ceux qui par des maléfices vivent en société avec le démon ? » Le lien entre la sorcellerie et le bûcher est aujourd’hui évident ; il relève d’un imaginaire, construit sur une réalité qui fait horreur. Toutefois, la lutte contre Satan pouvait-elle être envisagée autrement qu’en prévoyant d’aller jusqu’à l’élimination physique des soldats du diable ? On ne négocie pas avec le Mal : dès lors que l’on croit à son existence, l’éradiquer paraît légitime. Le drame de l’humanité est bien qu’hier comme aujourd’hui, des hommes y ont cru – et hier ils étaient une immense majorité… Ce qui importe dans ces pages n’est pas le supplice de la sorcière sur le bûcher, c’est de décrire le chemin qui y mena, en un engrenage dont il fut, non pas impossible, mais bien difficile de s’extraire. Dans cette histoire, s’il y eut quelques bons et quelques méchants, il y eut surtout des croyants, certains estimables – y compris du côté des chasseurs –, d’autres moins ; des rapports de force, suscitant résistance courageuse ou faiblesse conciliante ; des comportements individuels, en définitive, parfois beaux, souvent médiocres, dans certains cas dramatiquement pitoyables.
Le piège : le poids de la diffamation
L’historien de la justice et de la criminalité voit bien la place croissante tenue par la fama, à partir du xiie siècle, dans les pratiques judiciaires. Le rôle de la « commune renommée », toutefois, reflète plus largement la nature de sociétés médiévales dans lesquelles le statut d’un individu découlait de son insertion au sein d’un groupe et son honneur devait sans cesse être attesté par le jugement des autres. Rien d’étonnant, alors, à ce que dès le début de la Chasse, au xve siècle, le soupçon jeté sur la réputation d’une personne ait été le principal déclencheur des poursuites. En Haut Dauphiné, l’enquête des inquisiteurs et des officiers royaux débutait post clamorem multorum (ou ex clamore populi, littéralement « par la clameur du peuple »), autrement dit, lorsque bruits et murmures devenaient comme un cri collectif ; lorsque ce qui n’avait d’abord été qu’une pensée, ce qui avait coulé et grossi dans le flot des ragots de village, était devenu indice de la présence, au sein d’une communauté, d’un soldat de l’Ennemi. La rumeur publique portait sur des maléfices, l’enquête se déployait, elle, sur le terrain du pacte satanique.
En dehors même des conflits ouverts, bien des situations pouvaient être à l’origine de dégâts souvent irréparables. Les histoires de sabbat se nourrissaient de la lecture publique des aveux avant chaque bûcher, elles circulaient lors des veillées au coin du feu, finissaient aussi par s’échanger entre enfants et adolescents, loin de songer au poids des mots et aux conséquences de leurs paroles. Ainsi, les déclarations en 1602 à Brouramont (Lorraine) des deux sœurs Marion et Fleuratte, âgées respectivement de 22 et 18 ans, au sujet de leur cousine Mengeotte, 9 ans seulement, mirent en danger toute une famille :
Elles ont dit que peult avoir environ ung an que ladite Mongeotte leur a heu dit tant ensemblement que conjoinctement par divers fois, que sa grande mere l’avoit porté la premiere fois au sabat, ey que le diable les venoit querir de nuict sur ung char attallé d’ung cheval noir, et les menoit sur la pierre de la Roche, scavoir Rollat son grand pere, Jannon sa grande mere, Demenge son pere, Marion sa mere, George son oncle et Margo sa femme, ou estant font grand chere et dansoient, et Georgel fils dudit Georges jouoit de la fiffre, bancquetoient et mangeoient du pain, chaire, millesses, poils et buvoient du vin, que Collatte leur servante alloit querir : mais n’y avoit poinct de sel, ce faict s’en retournent sans char ny cheval, et se retrouvent en leur maison.
Une fois nommé, il était difficile de se débarrasser de cette macule. Lorsqu’en 1584 Mengeatte des Woirelz, de Saint-Nicolas en Lorraine, se rétracta, échappant ainsi au bûcher (mais pas au bannissement), elle expliqua qu’elle avait sciemment avoué les détails de sa participation au sabbat « par désir de la mort », en puisant dans les souvenirs des aveux d’une autre femme. Ce qui l’avait menée à ce que ses juges appelaient « homicide d’elle-même », c’étaient la détention et la torture, mais aussi le désespoir face à l’acharnement dont elle faisait l’objet et aux conséquences de l’autre condamnation, l’opprobre social :
ennuyée de la prison, et des tourments de la question, joint l’appréhension de méchant bruit, que faulsement on luy donne par ville, choisit plutôt mourir, que vivre en telle angoisse, dont estimat qu’en declairant cela qu’elle nous at eu dit, secondant la confession d’une executée à Creny, et puis le soupçon qu’avaient de luy les aucuns des témoins, employés contre elle, aurions assez d’occasion pour la condamner à mort.
La traque des sorciers reposait, fondamentalement, sur la dénonciation, jusqu’à un stade ultime, celui où même la fama ne jouait plus de rôle, puisque le simple fait d’être nommé par un inculpé comme participant au sabbat suffisait pour être arrêté. Dans les épisodes les plus dévastateurs de la Chasse, les persécuteurs exigeaient des fournées de noms, comme à Trèves à la fin du xvie siècle, où les accusées dénoncèrent fréquemment entre 100 et 150 personnes. À Bamberg, au début du xviie siècle, le juriste Ernst Vasoldt, membre du Comité chargé des sorcières (Hexen-Kommission) et obsédé par le sabbat, usait de la torture pour obtenir le plus de noms de participants possible, souvent une centaine.
Dans cette même ville de Bavière qui a constitué le théâtre de l’un des plus grands délires persécuteurs de l’histoire occidentale, la façon dont le bourgmestre Johannes Junius fut interrogé et condamné témoigne de façon extrême, mais exemplaire de l’importance de la dénonciation comme des procédés utilisés pour l’obtenir. Âgé de 55 ans, Junius fut arrêté à la fin du mois de juin 1628 et avoua pacte satanique et participation au sabbat le 5 juillet, après plusieurs jours de torture. Il avait déjà perdu sa femme, condamnée pour sorcellerie ; c’est donc à sa fille qu’il parvint à faire passer une lettre, écrite le 24 juillet, deux semaines avant son exécution. La traduction du début de ce texte, proposée ici, ne recherche pas les effets de style, à la différence des extraits que l’on peut consulter sur internet en français ou en d’autres langues. Certes, l’écriture poétique peut être une façon de résister, ou l’expression de l’expérience mystique, comme dans le cas de Jean de la Croix († 1591) ; mais ici, les phrases sont celles d’un homme torturé pendant plusieurs jours, d’un père à sa fille qu’il ne reverra plus (« Sois certaine que je ne suis pas un sorcier, mais un martyr, qui meurt ainsi. Mille fois bonne nuit, car ton père Johannes Junius ne te verra plus jamais »). En même temps, il s’agit d’une façon de briser la profonde solitude dans laquelle il a dû se débattre avec ses pensées pour décider d’une voie à suivre ; d’une sorte de confession, en définitive, puisqu’il n’a pu obtenir la visite d’un prêtre, comme il l’avait demandé. L’historien n’a donc pas à chercher du beau en créant du style. La beauté, dans cette lettre, tient à la charge émotionnelle qu’elle contient, mais aussi à la manière dont Junius trouve dans sa dévotion aux Plaies du Christ le moyen de supporter sa propre souffrance. La leçon d’un tel texte est là : éduqué depuis l’enfance dans le culte de la Passion, familiarisé intimement avec le récit évangélique au gré des lectures et des prêches publics, mais aussi avec les vies des saints martyrs transmises depuis des siècles par l’hagiographie, le chrétien du xviie siècle convoque naturellement, instinctivement le modèle christique pour exprimer sa propre souffrance et essayer de la supporter. Comment faire, sinon en la sublimant, c’est-à-dire en faisant autre chose de ce qui est, en cherchant de l’or à partir de la boue – en l’occurrence, ici, le massacre méthodique d’un innocent ?
Cent mille fois bonne nuit, ma chère fille bien-aimée, Veronica. Je suis arrivé innocent en prison, j’ai été torturé innocent, je dois mourir innocent. Car quiconque arrive dans cette maison doit être un sorcier, ou bien il est torturé si longtemps qu’il doit inventer quelque chose ou – que Dieu ait pitié de lui – imaginer quelque chose. Je veux te raconter comment cela s’est passé pour moi. Lorsque je fus amené pour la première fois à l’interrogatoire, étaient présents le Dr Braun, le Dr Kötzendorffer et deux docteurs inconnus […] Le Dr Braun me demanda d’abord : “Parent, comment êtes-vous arrivé ici ?” Je répondis : “Par […] malchance”. “Écoutez, vous, dit-il, vous êtes un sorcier ! Voulez-vous l’avouer de votre plein gré ? Sinon, on vous amènera des témoins et on vous présentera au bourreau”. Je dis “j’ai été trahi, j’ai une conscience pure dans cette affaire. Et quand bien même il y aurait mille témoins, cela ne m’inquiète pas. Mais je veux volontiers écouter les témoins”. Alors me fut présenté le fils du chancelier. Je lui demandai : “Messire Dr, que savez-vous sur moi ? je n’ai, au cours de ma vie, jamais eu affaire à vous, ni en bien, ni en mal”. Alors il me fit cette réponse : “Messire Collègue, à cause du tribunal [de la principauté]. Je vous demande pardon – Je vous ai vu à la cour ! Oui, mais comment ?” Il ne le savait pas. Je demandai alors les sieurs commissaires, il fallait lui faire prêter serment et l’interroger avec précision. Dr Braun dit, “on ne fera pas comme vous le voulez. Cela suffit, qu’il vous ait vu. Allez, Messire Dr !” Je dis : “Vous messires, de quel témoin s’agit-il là ? Si cela se passe ainsi, alors vous n’êtes pas plus à l’abri que moi ou n’importe quel homme honnête”. Mais on ne m’écouta pas. Ensuite vint le chancelier et il dit comme son fils, il m’aurait également vu. Il ne m’avait vu que debout et ne savait pas comment. Puis vint Else Hopfen, elle m’aurait vu danser dans [la forêt de] Hauptmoor. Je demandai avec qui. Elle dit qu’elle ne le savait pas. J’implorai ces messires, “pour l’amour de Dieu, vous entendez, ce sont tous de faux témoins !”. Il fallait leur faire prêter serment et les interroger correctement. Mais on n’a pas voulu le faire, et au contraire il fut dit que je devais avouer de mon plein gré ou le bourreau m’y forcerait bien. Je répondis que je n’avais jamais renié Dieu et que je ne le ferais pas. Que la clémence de Dieu me garde de cela. Plutôt endurer tout ce qui devait l’être. Alors entra malheureusement – que Dieu aie pitié, au plus haut des Cieux – le bourreau, et il m’a lié les deux mains ensemble et appliqué les poucettes, jusqu’à ce que le sang jaillisse des ongles et de partout, si bien que je n’ai pu me servir de mes mains pendant quatre semaines, comme tu peux le constater à mon écriture. Alors je me suis recommandé à Dieu dans ses Cinq Plaies et je me suis dit que puisque cela concerne l’honneur et le nom de Dieu, que je n’ai pas renié, alors je veux mettre mon innocence et tout mon martyre et mes tourments dans ses Cinq Plaies. Cela soulagera mes douleurs, si bien que je pourrai supporter de telles douleurs.
Suit la description du supplice de l’estrapade, au cours duquel Junius, entièrement nu, les mains liées derrière le dos, fut hissé en l’air et laissé choir lourdement à six reprises. Il continua, toutefois, à dénoncer de faux témoignages, et demanda un jour de réflexion ainsi que la visite d’un prêtre. On la lui refusa. Même le bourreau, en le ramenant dans sa prison, l’implora de céder (« Reconnaissez quelque chose, que ce soit vrai ou non ! Imaginez quelque chose, car vous ne pouvez pas supporter le martyre que nous vous faisons endurer »).
Maintenant, ma chère fille, tu comprends dans quel danger je me suis trouvé et me trouve encore. Je devais dire que je suis un sorcier et je ne le suis pas ! Je devais d’abord renier Dieu, je ne l’avais pas fait auparavant. J’ai beaucoup lutté jour et nuit avec moi-même, finalement l’inspiration m’est venue, en prière, dans la nuit, je devais cesser de me tourmenter. Puisque je ne pouvais avoir de prêtre avec lequel m’entretenir, je devais imaginer quelque chose et simplement le dire. Ce serait mieux si je le disais seulement avec la bouche et des mots, sans l’avoir fait réellement cependant. Je devais ensuite le confesser et laisser ceux qui me contraignaient à cela en assumer les conséquences. Ensuite, j’ai demandé le père prieur du couvent des Prêcheurs, mais je n’ai pas pu l’obtenir. Et ce qui suit est ma déposition, elle est toutefois complètement mensongère.
Suit maintenant, chère enfant, ce que j’ai déclaré, grâce à quoi j’ai échappé au grand martyre et à la dure torture que je n’aurais pu supporter plus longtemps.
On voit donc comment cet homme intelligent a décidé de céder sur le terrain de son honneur et de la raison, en pensant, de façon presque naïve, qu’il donnerait à ses tortionnaires juste ce qu’il fallait pour en finir avec son calvaire. C’était sous-estimer l’obsession qui se dressait en face de lui. Pour connaître ses compagnons de sabbat (dans la salle de vote du Conseil, après avoir chevauché un chien noir), son interrogateur lui fit donner des noms, méthodiquement, en arpentant mentalement l’espace urbain, rue par rue à partir du marché, et lorsqu’il ne fut pas satisfait il remit Junius à la torture, jusqu’à l’aveu du vol d’une hostie pour la profaner. Une fois atteint ce sommet dans l’abjection, les esprits consciencieux et maniaques, peut-être pervers, qui avaient mené à bien leur mission le laissèrent en paix. Peut-être pervers : est-il possible, en historien, d’écrire ceci ? Et s’il y eut une part de perversité chez certains juges et inquisiteurs, en certains lieux et certaines époques, comment la repérer ? Peut-on faire ainsi une sorte de tri, et porter un regard plus dur sur ce qui s’est passé ici que sur ce qui s’est déroulé là-bas, en d’autres circonstances ?
Il est de bon ton d’estimer que l’historien doit s’abstenir de tout jugement moral. Lorsqu’il a pris soin, cependant, d’éviter l’anachronisme, doit-il s’empêcher de penser, puis d’écrire que certains personnages lui paraissent plus estimables que d’autres ? L’on ne peut sonder les cœurs et les consciences, mais l’on peut cerner des personnalités. Le traité écrit vers 1436 par le juge-mage du baillage du Briançonnais Claude Tholosan, acteur important des débuts de la Chasse, permet ainsi de distinguer un profil qui ne fut probablement pas singulier, celui d’un homme de mission et de devoir dont les actes ne peuvent être appréhendés avec nos seules catégories actuelles du « bien » et du « mal ». Le propos développé dans son traité repose avant tout sur des citations de l’Ancien Testament énonçant les interdits et prohibitions de la Loi, présentant des épisodes relatifs à la colère de Dieu, et sur les deux grands piliers du droit qu’étaient le Décret de Gratien pour le droit canonique et le Code de Justinien pour le droit civil. Tholosan n’était pas un théologien qui conceptualisait et poussait sa réflexion jusqu’aux limites, mais un juriste imprégné d’un esprit de combat et de mission, persuadé qu’il s’était engagé dans une lutte contre l’Ennemi. Sa croisade serait victorieuse et déboucherait sur la destruction du « Palais infernal », il n’en doutait pas ; il la menait au service du Roi, dont il était un officier en Dauphiné. Pour Tholosan, le prince était le dépositaire direct de la justice de Dieu à l’égard du plus grave des crimes, celui de lèse-majesté divine ; la justice de l’État, supérieure à toutes les justices seigneuriales locales, n’avait donc pas le rôle de simple « bras séculier » épaulant l’Inquisition. C’étaient ses officiers qui prenaient l’initiative des poursuites dès que la diffamation d’un individu avait été enregistrée. Ils le livraient aux juges d’Église, pour un procès qui précédait celui du juge laïque, le plus sévère n’étant pas celui que l’on aurait pu croire. En Dauphiné, Claude Tholosan œuvrait certes à la défense de la foi, mais il affirmait aussi la prééminence de l’État alors en plein essor.
Un petit dossier documentaire, encore mal exploité, peut contribuer à montrer, s’il en était encore nécessaire, qu’il serait totalement abusif de faire de la traque des sorciers l’affaire de la seule Inquisition (le mot fait trembler et fascine aujourd’hui, mais qui sait vraiment quelle réalité il recouvrait ?). En Vivarais, dans l’actuel département de l’Ardèche, une première condamnation à mort est prononcée par la cour ordinaire d’Aubenas en 1457. La chronologie des affaires de sorcellerie, telle qu’elle est actuellement connue, ne permet pas d’assimiler ces contreforts du Massif central aux « montagnes magiques » chères à Emmanuel Le Roy Ladurie : deux cas en 1480, à Vals, une pendaison en 1490 à Vogüé, deux nouveaux cas en 1511 à Vogüé encore. Puis, à l’automne 1519 et au début de l’année 1520, a lieu une mini-chasse, dans laquelle on voit s’activer deux vicaires généraux de la sainte Inquisition (ou vice-inquisiteurs, représentants de l’inquisiteur général) dans le diocèse de Viviers, les franciscains Louis Brun et Philippe Bernard, du couvent d’Aubenas. Les victimes en sont exclusivement des femmes, surtout des veuves. Catherine Peyretone, de la paroisse de Montpezat, qui endosse la panoplie complète de la disciple de Satan, y compris le cannibalisme d’enfants, aurait été brûlée vive. Jeanne Chareyre, de la même paroisse, nie, en appelle au roi, est relâchée et assignée à comparaître au bout d’un an pour entendre la sentence. Agnès Colombe est incarcérée dans les prisons de l’abbaye cistercienne de Mazan pour avoir passé un pacte avec le diable afin, avoue-t-elle, de se venger de l’un des moines qui l’avait délaissée pour courtiser d’autres femmes ; on ne connaît pas l’issue de son procès. Les religieux de l’abbaye font également arrêter Béatrice Laurence et Catherine Vesse ; détenue dans la prison de l’abbaye, cette dernière est torturée, mais revient sur ses aveux et s’en sort avec une peine de pénitence et d’amendement. Plus surprenant encore, Jeanne Perayrone, femme d’un savetier de Montpezat, comparaît devant l’inquisiteur le 26 janvier 1520. Dénoncée par certains de ses ennemis, elle a été incarcérée au château de Montpezat avant d’être relâchée, ce qui n’efface pas la tache jetée sur sa réputation ; elle demande donc à recevoir la purgation canonique, ancien rituel qui, contrairement à l’ordalie, ne consiste pas à prouver sa bonne foi par une épreuve mais par un serment. Sa requête ayant été acceptée par l’official, juge de l’évêque, Jeanne jure sur l’image de la Passion qu’elle n’a pas renié la foi catholique et ne s’est pas donnée au diable. Des témoins à décharge viennent déposer contre l’accusation de maléfices, et elle obtient finalement l’absolution.
Au printemps 1530, Catherine Las-Hermes, déjà condamnée onze ans auparavant à la fustigation et au bannissement, reconnaît sa participation au sabbat et avoir jeté une poudre, donnée par le diable, sur un enfant qui en est mort, sur les blés et sur des animaux. Elle recrachait l’hostie à Pâques, parce que « quand le corps de Dieu était dans sa bouche, lui croissait comme une noix ». À la fin du mois de mai, elle est condamnée à faire pénitence publique, le dimanche, à être fouettée jusqu’à effusion de sang, puis bannie définitivement du territoire soumis à la juridiction de la cour de Mazan. La justice séculière, ici, conduite par le lieutenant du bailli en présence du procureur fiscal, a seule mené le procès.
Les quelques cas connus pour la fin du xvie siècle et le xviie siècle montrent que c’est dans ce cadre judiciaire qu’ont été traitées les affaires de sorcellerie en Vivarais. On voit donc bien que l’intervention de l’inquisiteur, au début de l’époque moderne, n’a été ni permanente, ni exclusive ; au contraire, elle s’est appuyée sur les cours séculières et s’est effacée, après 1520, devant les juges seigneuriaux et, de plus en plus, les officiers et rouages de la justice du Roi. L’Inquisition n’a-t-elle « pris l’initiative de la répression, aux environs de 1519-1520, que pour stimuler le zèle des cours séculières », comme l’écrivit un érudit ardéchois au début du xxe siècle, Jean Régné ? Autrement dit, s’est-elle chargée d’allumer l’étincelle afin que les autres pouvoirs attisent le feu ? Le petit dossier vivarois ne permet pas d’appuyer fermement cette affirmation. Intervenus parce qu’il y avait problème, effectuant sans aucun doute une veille sur la foi et l’orthodoxie des pratiques dans le diocèse de Viviers, les vice-inquisiteurs Louis Brun et Philippe Bernard, pour s’en tenir à eux, semblent plutôt avoir cherché à agir avec pondération.
À côté des agents officiels de la traque, villageois et citadins s’organisaient parfois eux-mêmes en associations, fondées sur le serment mutuel, telles les « Monopoles » ou « Comités » (Ausschüsse) attestés à partir de la première moitié du xvie siècle dans la partie germanique du Luxembourg puis dans le reste de l’archevêché de Trèves. Par ailleurs, certains individus s’étaient fait une spécialité de repérer les sorciers et sorcières. On rencontre ainsi dès le xve siècle dans le sud-ouest de la France, notamment dans les vallées d’Aure et du Louron (Hautes Pyrénées), des « connaisseurs de sorciers » appelés deux siècles plus tard « visiteurs des sorciers et sorcières ». Il s’agissait soit d’illettrés, souvent adolescents (à l’époque moderne), qui soutenaient avoir participé au sabbat et pouvoir dénoncer des sectateurs de Satan, soit de médecins ou de chirurgiens. Ils étaient rémunérés par les communautés d’habitants et devaient identifier les sorciers, en se fondant sur l’existence de la marque diabolique et la recherche de points insensibles, l’examen de l’œil ou même leur propre jugement, à première vue pourrait-on dire. Au xviie siècle, dans trente villages du Béarn, un apprenti tisserand actif dès l’âge de seize ans, Jean-Jacques Bacqué, découvrit au total 6 210 sorciers, soit en moyenne 207 par localité ! En 1672, un arrêté du Conseil du Roi interdit cette activité, probablement lucrative, mais d’une popularité ambiguë et potentiellement dangereuse. En 1459, « Maître Jehan » fut tué par un fermier de Vignec-en-Aure, qui l’avait prévenu de cesser ses accusations contre deux proches parentes. Cet homme qui se disait médecin venait du bas-pays ; il était extérieur à la communauté, mais parlait la langue locale ; il ne communiait pas à Pâques : étrange étranger (pléonasme ?), qui ne pouvait, au jugement de tous, être expert en sorcellerie qu’en étant… sorcier lui-même. Les devins-guérisseurs, « experts » populaires en sorcellerie, jouaient en effet un jeu périlleux, puisqu’ils nourrissaient et contribuaient à imposer un système de croyances qui leur conférait un rôle particulier, dont ils s’enorgueillissaient, mais s’exposaient aussi à un très brutal retour de bâton.
Certains individus ont ainsi fait carrière, de façon plus ou moins brève, dans la traque des sorcières, comme le célèbre Matthew Hopkins, qui exerça à partir de 1644 dans l’est de l’Angleterre, accompagné d’une petite équipe. Il publia en 1647, année de sa mort, The Discovery of Witches, ouvrage dans lequel les thèmes de la marque diabolique et des démons familiers apparaissent comme véritablement obsessionnels. Un nouveau degré avait été franchi, dans l’intensité et l’ampleur de la Chasse, on l’a vu, au cours du dernier tiers du xvie siècle. La place des enfants dans le processus de reconnaissance des sorciers en rend également compte : en 1595, en Navarre, une découvreuse de sorcières (catadora de brujas) n’avait que douze ou treize ans…
Le piège qui se refermait sur ses victimes avait aussi un prix. Pour le Dauphiné du xve siècle, par exemple, la comptabilité des châtelains présentant leurs « notes de frais » permet de suivre presque pas à pas le cheminement de l’accusé, arrêté chez lui, transféré au château delphinal puis à Briançon pour son procès, avant d’être ramené dans son village où devait avoir lieu l’exécution. Ainsi, Albert Albert, vice-châtelain du Queyras, se rendit à Ristolas le 21 septembre 1428, pour appréhender Françoise, épouse de François Isnard, et Siméonde, veuve de Georges Flandin. Trois jours plus tard, le cortège qu’il formait avec quatre cavaliers, cinq hommes à pied et les accusées juchées sur deux mules, franchit le col de l’Izoard et parvint à Briançon le 25. Au retour de ces femmes, le 19 novembre, cinq hommes accompagnèrent Albert, ainsi que dix personnes envoyées par la paroisse de Ristolas. Il y a mieux, ou pire : en juillet 1430, le châtelain de Château-Dauphin Aubert de Névache alla chercher la femme de Philippe Sourate en Maurienne, où elle s’était enfuie, afin de la ramener à Bardonnèche puis à Briançon ; comme il passait dans le duché de Savoie, il emmena avec lui cinquante-huit hommes armés. À Briançon, au xve siècle, deux procès avaient lieu : celui de l’inquisiteur précédait celui du juge delphinal, qui durait au moins deux ou trois semaines, parfois deux mois ou davantage.
Le dire : l’importance de l’aveu
Le paysage judiciaire européen de la fin du Moyen Âge et de l’Époque moderne était une mosaïque, ou plutôt une juxtaposition de mosaïques… superposées. Sur le territoire de la France actuelle, elle comportait trois niveaux principaux : celui, local, des prévôtés (ou vicomtés, vigueries, châtellenies) ; celui des bailliages et sénéchaussées, dont le tribunal était présidé par le juge-mage ; enfin, celui des cours souveraines, les parlements ou, dans le duché de Savoie, le Sénat, qui jugeaient en appel les causes rendues par les juridictions subalternes. La justice d’Église, pour les clercs, était rendue par le juge épiscopal, l’official. Enfin, l’Inquisition était une juridiction d’exception, créée par délégation d’autorité – celle du pape, même théorique comme dans les cas des Inquisitions espagnole et portugaise (fondées en 1478 et 1536) – à un religieux, dominicain ou franciscain, qui devenait seul compétent pour juger les affaires de foi dans une région donnée. À l’Inquisition médiévale succéda, en 1542, la Sacrée Congrégation de l’Inquisition romaine et universelle ou du Saint-Office (réformée en 1908 et devenue en 1965 Congrégation pour la doctrine de la Foi), qui à l’Époque moderne se montra plus sceptique et plus prudente que les justices civiles en matière de sorcellerie. Juridiction d’exception, procédure exceptionnelle pour un crime exceptionnel (contre la majesté de Dieu) relevant de la catégorie de l’indicible (nefandum) et que, pourtant, l’aveu allait faire dire : on peut dès lors comprendre que l’usage de la torture, aussi choquant qu’il nous paraisse aujourd’hui, ait paru légitime aux juristes de la fin du Moyen Âge. Encore encadré par certaines restrictions (sur les personnes, sur les tourments, sur le nombre de séances) et conçu aux xiiie-xive siècles comme ayant une valeur purgative (la résistance à la torture lavant, au moins en partie, l’inculpé de ses fautes), il a incontestablement atteint un degré supérieur au cours de la Chasse, dès le siècle suivant, même s’il a recouvert en Europe des réalités très diverses. Lors de la « Vauderie d’Arras », en 1459-1460, la perspective d’être torturé de façon répétée, sans limite sinon celle de la résistance du corps, a dû jouer un rôle essentiel dans l’effondrement rapide des inculpés, donc dans l’efficacité de la chaîne des aveux et dénonciations, comme l’a souligné Franck Mercier. La résistance à la torture était considérée par les auteurs du Marteau des sorcières (1486), Jacques Sprenger et Henri Institoris, comme le signe de la dureté naturelle de l’accusé ou le résultat d’une amulette, voire d’un maléfice ; heureusement, tous les juges ne suivirent pas cet avis et l’on trouve trace, dans la documentation, d’individus qui eurent la vie sauve, faute d’aveux. Payant le prix du scandale que leur affaire avait suscité et de l’obstination de ceux qui les avaient harcelés, ils furent cependant souvent condamnés au bannissement, au moins temporaire, donc confrontés au danger de la mort sociale. Au xvie siècle, les justices séculières, qui s’étaient emparées de la lutte contre le fléau comme des éléments de la procédure inquisitoire, renforcèrent la dureté et l’arbitraire régnant au cours des interrogatoires. Ce n’est évidemment pas un hasard si l’une des dénonciations les plus fortes de la « question » vint d’un homme, le jésuite Friedrich Spee von Langenfeld, qui, formé dans les années 1610, notamment à Wurzbourg, enseigna et prêcha à Paderborn, Cologne et Trèves entre 1623 et 1635. Il publia anonymement en 1631 sa Cautio criminalis, traduite en français en 1660 sous le titre Advis aux criminalistes sur les abus qui se glissent dans les procès de sorcellerie, qui récusait l’usage de la torture. Elle contient plus de six cents fois les mots « torture » et « tourment » ! Son auteur avait visité des accusées dans leurs cachots, assisté à des séances de torture, accompagné des condamnées jusqu’au gibet ou au bûcher. L’examen systématique du problème, point par point, débouche sur la négation même de la sorcellerie :
Pour moi, après avoir tout bien considéré et jugé avec prudence, j’affirme sous serment qu’ayant accompagné nombre d’accusées au bûcher, je ne puis affirmer d’aucune qu’elle était coupable. J’ai entendu la même chose de deux savants et circonspects théologiens qui n’avaient pourtant omis aucune sorte de diligence et d’industrie pour parvenir à connaître la vérité, comme je l’ai dit ci-devant.
Compositeur de chants religieux et de poèmes lyriques, Spee œuvra, comme pasteur, à la pénétration des idées du Concile de Trente ; celles-là mêmes au nom desquelles, ou dans l’esprit desquelles des princes-évêques amenaient la persécution, en Allemagne, à des degrés inégalés jusqu’alors. Les voies de la réforme religieuse sont-elles impénétrables ? Elles peuvent surtout mener dans des directions opposées, parfois éminemment dangereuses.
Être défendu, comme eut la chance de l’être la Valaisanne Françoise Bonvin en 1467 par le juriste Heyno Am Troyen – dont le dossier a été édité par Sandrine Strobino dans Françoise sauvée des flammes ? (1996) – fut chose exceptionnelle, même si, en théorie, le Directoire des Inquisiteurs rédigé par Nicolas Eymerich en 1376 prévoyait qu’un avocat pût assister l’accusé. Prise dans les mailles d’un questionnement serré, la sorcière essayait d’échapper à la torture et de répondre aux attentes de son interrogateur, qui ne retenait que ce qui pouvait alimenter l’accusation et cédait aussi au jeu fascinant – mais balbutiant et dévastateur – de la preuve. Alors elle nourrissait ses aveux de détails réalistes issus de son environnement et des croyances traditionnelles et, souvent, s’enferrait. Le scribe aggravait encore son cas en formalisant ces paroles selon la grille du vraisemblable (il fallait que cela corresponde à la vérité) et certaines conventions d’écriture (ainsi de la forme dialoguée, qui rendait la scène plus « réelle »). Dans ce jeu à trois (au moins), on cherchait à dire le vrai, ou plutôt « à faire vrai »… Ici réside un problème fondamental, qui tient dans le rapport au vrai des hommes de la fin du Moyen Âge ; donc, dans leur façon de croire.
Le corps de la sorcière devenait un territoire sur lequel rechercher des signes. La marque (stigma ou punctum) diabolique faisait partie, comme l’hérédité ou la vie scandaleuse, des signes considérés à l’Époque moderne comme « probables ». Elle tendit à jouer un rôle essentiel et fut l’objet de traités savants qui la théorisèrent, comme celui du médecin Jacques Fontaine, Des marques des sorciers et de la réelle possession que le diable prend sur le corps des hommes, paru à Lyon en 1611. Aux Îles Canaries, Malgarida, jugée en 1581, avait reçu du démon une goutte de sang sur la main ; à la même époque, Luisa de Arias était affligée d’« une taie sur un œil dont on disait que c’était un signe du diable » ; quant à María de Acosta, elle présentait un grain de beauté sur la poitrine qui changeait de couleur le lundi, le mercredi et le vendredi, jours de réunion diabolique. On repérait la marque en piquant certains endroits du corps, en quête d’une insensibilité dénonciatrice. Cette marque, véritable signature du démon, souvent effectuée avec sa griffe, était fréquemment recherchée, après avoir rasé entièrement le suspect, sur sa partie gauche, en des endroits de son corps peu accessibles au regard ou relevant de l’intime, voire de l’obscène comme les parties sexuelles. Au contraire des marques d’esclavage, d’infamie (pour les condamnés) ou militaires (appartenance à l’armée romaine, dans l’Antiquité), au contraire aussi des attributs visuels qui caractérisaient le clerc, le croisé ou le saint mystique stigmatisé, au contraire, enfin, de ces marquages qui s’étaient développés depuis le xiiie siècle à l’encontre des Juifs, des lépreux ou des cagots (véritables parias de l’ouest de la France et du nord de l’Espagne), la marque diabolique n’était pas immédiatement et clairement visible. Elle pouvait en outre s’accompagner d’autres traces, « marques des sorcières » ou signes complémentaires, dans l’œil notamment. Preuve d’appartenance aux disciples de Satan, elle était une véritable « anti-marque », car elle ne se comprenait que dans une exacte opposition à la marque du baptême, portée par tous les membres de la communauté chrétienne – corps mystique de Jésus Christ – et qu’elle prétendait effacer. La tache, car c’en était une, pouvait être symbolisée par l’ablation d’un membre, notamment d’un doigt. Le fait de donner une partie de son corps à Satan accompagnait l’entrée dans sa vassalité. Aux Canaries toujours, sur l’île de Lanzarote, Sebastiana Enríquez déclara en 1624 devant l’inquisiteur qu’une nuit deux femmes de sa connaissance entrèrent dans sa chambre et
Elles lui enduisirent avec elle ne sait quoi le cerveau et sous ses aisselles et les parties honteuses et derrière les genoux […] en lui demandant d’offrir au diable un de ses membres, ou du sang ou une dent et, après l’avoir enduite, elles lui montrèrent le démon en disant : « Voici le diable, tu viendras avec nous à califourchon sur lui et tu verras et apprendras bien des choses ». Elle vit alors sur son lit un bouc noir avec une longue barbe, mais elle n’eut pas le courage d’aller avec elles et avec lui et elle dit : « Doux Jésus et Sainte Trinité », et ils disparurent ; puis ils revinrent et, comme elle ne voulut pas partir, elles prenaient le bouc et lui disaient : « Reste ici, car tu as baisé le derrière du diable et il t’a possédée ».
La découverte de la marque-tache était cruciale pour le juge, puisqu’elle répondait au grand défi que s’était lancé cette justice balbutiante de l’Occident et auquel elle avait pendant plusieurs siècles cherchés à répondre par l’ordalie, ou jugement de Dieu : prouver. Dans une étude classique sur La preuve judiciaire (1964), Henri Levy-Bruhl a souligné que cette dernière, à la différence de la preuve scientifique, n’est pas qu’« un mécanisme destiné à établir une conviction sur un point incertain », à tendre vers une vérité, mais qu’elle a aussi pour fonction de susciter l’adhésion du corps social. Voilà à quoi servaient la fama, l’aveu, et donc, aussi, la marque. Jamais, toutefois, ne disparurent les interrogations et les doutes suscités par des théories pétries de contradictions, dans des systèmes de pensée à la rationalité tortueuse et, jugera-t-on aujourd’hui, souvent fantaisiste – mais d’une fantaisie destructrice. Ainsi, rien, aux yeux des juges, ne pouvait avoir la valeur de l’aveu. Seul celui-ci permettait de percer l’occulte, puisque, depuis la mutation majeure des xiie-xiiie siècles, entérinée par la législation du concile de Latran IV sur la confession obligatoire, l’Église ne s’interdisait plus, bien au contraire, de pénétrer les « secrets du cœur » (occulta cordis). On se tromperait en pensant que l’homme médiéval était incapable d’envisager la dissimulation et l’hypocrisie. La dénonciation des moines hypocrites relevait d’une longue tradition, et l’hérétique était, par essence pourrait-on dire, un dissimulateur. En outre, comme l’a bien souligné Peter Von Moos dans son article « Occulta cordis. Contrôle de soi et confession au Moyen Âge », paru en 1996 dans la revue Médiévales, les grands maîtres spirituels Jean Cassien († v. 435) et Grégoire le Grand († 604) avaient élaboré, à l’intention des directeurs de conscience, un véritable art du discernement afin de faire remonter ce que l’âme tenait caché, refoulé au fond d’elle-même. Ainsi Cassiodore († v. 580) écrit-il, dans le premier Livre de ses Institutions, au sujet de Cassien :
D’une façon si géniale il fait deviner […] les mouvements nocifs de l’âme, qu’il contraint l’homme à voir clairement et à éviter les fautes qu’il ignorait auparavant, dans la confusion de son brouillard intérieur.
Il fallait tenir compte des phénomènes visibles, signa, indices ou symptômes, mais aussi des particularités de chaque cas et de chaque situation concrète, puisque, comme le signale Grégoire le Grand dans ses Homélies sur Ézéchiel,
Enraciné sur cet héritage, le savoir-faire des clercs en matière d’interrogatoire a pu se développer, à partir du xiiie siècle, sur le triple terreau des prescriptions de Latran IV, de la création des ordres mendiants (Dominicains et Franciscains, pour qui la confession était le corollaire de la prédication) et du développement de la procédure inquisitoire. Les occulta cordis ont alors volé en éclat, parce que la lutte contre l’hérétique, et au xve siècle contre le sorcier, s’attaquait au secret comme mode de fonctionnement. Pour démasquer les adeptes du diable, on usa donc également du huis clos et de la dissimulation : le prévenu ne connaissait ni les charges pesant contre lui, ni l’identité de celui qui l’accusait, il n’avait aucune assistance juridique à ses côtés. Secret contre secret, donc, jusqu’au moment où la vérité devait éclater au grand jour, être étalée sur la place publique, en une justice qu’on qualifie aujourd’hui volontiers de « spectacle », mais qui avait surtout pour but de produire comme un exemplum, une histoire racontée par les prédicateurs à des fins édifiantes. Seulement, l’histoire ne se déployait plus dans le récit, ni dans la représentation, mais bien dans la réalité, frappante et effrayante.
Le voir : la justice exemplaire
À la fin du Moyen Âge, la répression de l’hétérodoxie, à l’instar de l’administration de la justice en général, a été marquée par un caractère public et rituel, de plus en plus théâtralisé. Peter Schuster a bien montré la façon dont, à partir du xve siècle, dans l’Empire, les exécutions ont fait l’objet de véritables mises en scène religieuses. Dans le coutumier de la ville franconienne de Volkach composé en 1504 (le Salbuch), une miniature en couleurs représente une scène de pendaison d’un voleur de vin ; le chemin qui mène à la potence est un Chemin de Croix et l’endroit où a lieu l’exécution est nommé locus calvarie. D’une façon générale, les scènes d’exécutions de cette époque contiennent toujours des allusions à la Passion. Quant aux textes, ils témoignent de l’engagement du public, touché par le supplice d’un condamné dont il avait fréquemment pitié. L’intégration d’éléments religieux dans les rituels d’exécution (notamment, leur accès à la communion et le fait qu’un clerc accompagnât le condamné sur le chemin de la potence en portant une croix devant lui) montre que dans l’Empire, vers 1500, la tendance qui s’imposait, non sans résistances, était la reconnaissance du droit des condamnés à être membres à part entière de la communauté chrétienne. Dans le cas des adeptes de Satan, toutefois, les éléments de dramatisation ne donnent pas le même sentiment. Incontestablement, ce qui l’emportait, c’était la double volonté d’une destruction corporelle qui fût véritable purgation et d’une exemplarité fondée sur la terreur.
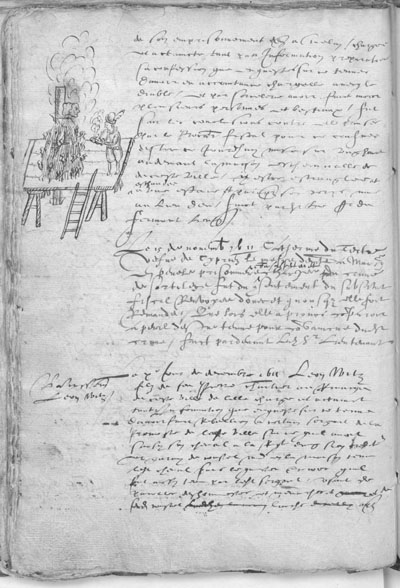
Source à la fois dérisoire (puisqu’elle ne nous apprend rien) et précieuse (puisqu’elle témoigne d’une dramatique accoutumance), un petit dessin laissé, par le greffier, sur une page de registre de condamnations pour sorcellerie au début du xviie siècle (© Ville de Lille, Archives municipales, cote AML 12120]).
Pendus ou plus souvent brûlés, parfois noyés comme en Haut Dauphiné – et c’était là signe que les juges avaient reconnu la grande contrition de celui qu’ils envoyaient à la mort –, les condamnés l’étaient dans leur paroisse d’origine, en une exécution théâtralisée et ritualisée. Ils devaient confesser avoir renié Dieu et se repentir devant les paroissiens, leurs parents, leurs amis, parfois leurs femmes et leurs enfants ; devant l’église, à l’heure de la messe, ou à genou devant le Saint-Sacrement du maître-autel. En 1441, Béatrice Faure-Cuchat, de Cervières (Briançonnais), fut noyée le 8 septembre, le jour de la fête de la Nativité de la Vierge, au moment de la grande foire annuelle de Briançon, en une pastorale illustrée par la mort. Parfois, les proches imploraient une exécution secrète, comme ce fut le cas en novembre 1437 pour Marguerite Coissier, Marguerite Meyssimili et Catherine Aymar, bien intégrées à Arvieux (Queyras), qui avaient plus de vingt enfants et petits-enfants, dont plusieurs filles en âge d’être mariées : « le pays n’a pas besoin de semblables exemples… » déclarèrent leurs fils. Et les adolescentes, surtout, n’avaient pas besoin de semblable opprobre. Le gouverneur du Dauphiné accéda à leur demande. Parfois, aussi, on cherchait à faire s’échapper le condamné : en mai 1424, à Exilles (Dauphiné italien, province de Turin), il fallut faire garder Jeanne Garcin nuit et jour tandis que l’on construisait la cabane dans laquelle elle allait être enfermée et brûlée, et le bourreau ne quitta la prison qu’au dernier moment. Manifestement, cette veuve avait encore des parents fidèles et des amis solides. Souvenons-nous, toutefois, des dix paroissiens de Ristolas envoyés en 1428 pour ramener Françoise et Siméonde sur le lieu de leur exécution : le fait est significatif de l’intense psychose faisant des communautés d’habitants, par leur aide et leurs dénonciations, d’actifs participants à la traque des sectateurs de Satan.
Il faut bien saisir combien, au-delà du climat de terreur, une affaire de sorcellerie était une affaire de justice, donc de pouvoir à faire reconnaître. Quand les intérêts étaient divers, la structure politique et judiciaire locale complexe, toute vie humaine qui était en jeu devenait un enjeu faisant peu de cas de l’humain : ce qui importait, pour l’une ou l’autre des parties en dehors de l’accusé, était de faire respecter son droit. Le cas de la vallée de Chamonix, étudié dans un petit livre, Des montagnards endiablés*, par Carine Dunand est particulièrement représentatif du poids des rivalités héritées des siècles antérieurs. La seigneurie temporelle y relevait d’un prieuré bénédictin à la tête duquel se trouva pendant près de soixante ans, de 1439 à 1487, un membre de l’une des plus puissantes familles du diocèse de Genève, proche du duc de Savoie, Guillaume de Ravoire. Celui-ci fit preuve d’un népotisme actif, plaçant notamment son frère Guy comme châtelain, donc représentant du pouvoir séculier dans la vallée, en 1446 (il le resta jusqu’en 1483) et son frère Hugues comme curé en 1456. Autrement dit, la famille de Ravoire avait mis la main sur la vallée lorsqu’entre 1458 et 1462 treize bûchers furent allumés. En vertu des franchises obtenues par des luttes plus d’un siècle auparavant, la communauté des habitants de Chamonix avait, fait rare, des droits sur la haute justice, c’est-à-dire la justice criminelle : ils pouvaient juger au nom du prieur, après qu’une procédure avait été faite par le clerc de la cour du prieur ou par quelqu’un d’autre ayant ce pouvoir ; ils recevaient le concours d’un juriste que le prieur avait obligation de leur fournir pour les conseiller. Voici donc le décor succinctement planté : une vallée exiguë d’accès difficile, entourée de bois et de hautes montagnes, théâtre idéal pour un huis clos pesant ; une puissance seigneuriale locale tissant sa toile ; une communauté d’habitants peu encline à se soumettre, s’agitant pour ne pas se laisser prendre dans les fils qui la cernaient de toute part ; et l’inquisiteur, que l’on oublierait presque, venu du couvent dominicain de Genève.
Le 29 avril 1462, quatre hommes et quatre femmes du mandement de Chamonix, dont la femme de l’un des gros propriétaires fonciers du lieu qui avait été syndic de la communauté trois ans auparavant, furent exposés devant l’église paroissiale, où l’inquisiteur Claude Rup, dominicain, prononça un sermon et se prononça en faveur de la culpabilité des accusés ; un à un, ils confessèrent leurs crimes publiquement. On les amena ensuite dans la cour du prieuré, à l’endroit où étaient rendus les jugements de la justice temporelle, pour que fût prononcée la sentence. C’est Jacques Bollet, désigné par la communauté des prud’hommes de Chamonix, qui lut la condamnation, d’abord pour six des sorciers et sorcières :
Premièrement, il est manifeste et il résulte de façon suffisante et légitime de ce qui précède que les susnommés Jean Effrancey junior, Jean Dumolard dit Pesant, Pierre du Nant, Michelle femme de Ramus de La Ville, Jeannette femme de Michaud Gillier et Perronette femme de Martin du Bettex sont tombés expressément dans le crime d’hérésie soit d’apostasie : avant tout par l’abnégation de la majesté divine et éternelle de Dieu tout puissant et de toute la cour céleste ; en outre par la prestation d’hommage, à genoux, au diable infernal apparu sous de fausses apparences dont il a été fait mention dans les procès formés contre les accusés, rendus publics par le vice-inquisiteur dans son sermon général ; enfin par la livraison annuelle d’animaux au diable qu’ont accomplie les accusés, mentionnée au même endroit.
C’est pourquoi Jacques Bollet, juge au nom de toute la communauté, a jugé, prononcé et ordonné par cette sentence définitive que Jean Effrancey, Jean Dumolard dit Pesant, Pierre du Nant, Michelle femme de Ramus de La Ville, Jeannette femme de Michaud Gillier et Perronette femme de Martin du Bettex soient personnellement brûlés vifs par le feu afin que par ceci leur âme soit séparée de leur corps, que les os de leurs cadavres soient réduits en poussière et qu’ainsi il ne reste rien d’eux que le feu puisse brûler. Et cela de manière publique devant tout le peuple qui voudra assister à ladite crémation et dans un lieu haut et visible, afin que leur peine serve à en terrifier beaucoup. De plus, il a prononcé et déclaré que leurs biens quels qu’ils soient doivent être confisqués et dévolus au révérend seigneur le prieur de Chamonix, en tant que seigneur temporel de ce lieu.
Deux des accusés firent l’objet d’un traitement particulier, pour lequel il n’est guère besoin de commenter l’énoncé du jugement :
En ce qui concerne la susnommée Perronette, veuve de Michel des Houches, dont on a constaté qu’outre le crime d’hérésie cité ci-dessus elle a aussi commis d’autres actes tout à fait indicibles, tant en soumettant, souvent et de façon répétée, sa propre personne au diable infernal, qu’en commettant en plus l’abominable péché contre nature avec quelques hommes, que finalement en mangeant des enfants à la synagogue et pour plusieurs autres actes qu’il vaut mieux ne pas dire, il [= Jacques Bollet] a prononcé, jugé et déclaré, dans le but que cette même Perronette reçoive une punition qui corresponde à ce qu’elle a fait, qu’elle devra être attachée fermement à une colonne de justice en bois, haute et visible de tous et, qu’ainsi attachée, elle devra rester assise sans protection au-dessus d’un fer brûlant et ardent pour la vingtième partie d’une heure ; qu’après ce temps, le feu devra être mis à un amas ou masse de bois posés les uns sur les autres, de telle manière que la personne de Perronette elle-même soit brûlée dans son entier, que son âme soit séparée de son corps et que les os de son corps soient réduits en cendres ; quant à ses biens, ils seront confisqués et dévolus au seigneur précité.
En ce qui concerne le susnommé Jean Grelant dont on a constaté que lui aussi, outre le crime d’hérésie, a commis d’autres crimes encore plus inhumains et plus indicibles et surtout pour l’outrage inhumain et inaudible qu’il a fait subir au très sacré corps du Christ en le foulant aux pieds, afin qu’il reçoive une punition qui corresponde à ce qu’il a fait – ou du moins qui s’en approche, car on ne peut pas infliger une peine qui corresponde à cela –, Jacques Bollet, au nom que dessus, a prononcé, jugé et déclaré que le même Jean devra être entièrement déshabillé et être conduit ainsi personnellement au lieu où il a foulé aux pieds le corps du Christ ou du moins dans un lieu de justice. Là, que l’extrémité inférieure de son pied devra être coupée et amputée, et qu’il devra embrasser par trois fois la terre où l’on aura tracé auparavant le signe de la croix. Enfin, qu’il devra être mené mort ou vif au dernier supplice et que, lié à la colonne avec la partie amputée de son pied, il devra brûler entièrement dans le feu. Tous ses biens, quels qu’ils soient, seront dévolus au seigneur du lieu. […]
Entre le risque de faire peser sur la communauté le soupçon de complicité avec les sectateurs de Satan, et celui de fragiliser leur droit d’exercice de la justice criminelle – jusqu’à le voir contesté –, les prud’hommes avaient-ils vraiment d’autres choix que de s’aligner sur la sentence de l’inquisiteur ? Il est probable que, sans la pression exercée sur eux par le pouvoir seigneurial et l’intense rivalité avec la famille Ravoire, les événements ne se seraient pas déroulés ainsi. Toutefois, en condamnant plusieurs habitants, la communauté renforçait sa cohésion… jusqu’à un certain point sans doute, qu’il est impossible d’évaluer. Car les bénéfices de la dynamique du bouc-émissaire, on l’a dit, sont d’une grande fragilité : lorsque c’est au sein même du groupe que la faille est recherchée, il faut prendre garde à ce que, de virtuelle, elle ne devienne pas réelle. Par ailleurs, le cas de Chamonix montre à sa façon combien, dans la mise en œuvre de cette justice exemplaire, qui éduquait en terrifiant, les pouvoirs laïques, quels qu’ils aient été, ont joué un rôle majeur dès le xve siècle.
Dans les diocèses voisins de Lausanne et Sion, on a brûlé sans amputer, sans ce type de peines dites « réfléchissantes », c’est-à-dire proportionnées au crime. En 1462, à Chamonix, un élément du droit coutumier a donc vraisemblablement été appliqué. La sentence de l’inquisiteur, qui nous est parvenue, ne mentionne pas de peines corporelles. Demandant à ce que les « hérétiques perfides » qu’il venait de démasquer soient livrés au bras séculier afin d’être punis, le frère Claude Rup a d’ailleurs ajouté des mots qui peuvent surprendre :
Et nous vous supplions affectueusement, vous seigneur juge, les autres officiers et le pouvoir séculier de bien vouloir, dans la peine infligée, modérer votre sentence envers eux en n’allant pas jusqu’à la mort ou à la mutilation des membres et de les traiter de manière humaine et bienveillante.
Ne fantasmons pas sur « l’humanisme » de notre homme, qui savait parfaitement ce qu’il advenait d’un sectateur de Satan. Il n’empêche, si l’Église ne pouvait faire couler le sang, la question de sa capacité à condamner à mort était posée à la fin du Moyen Âge. Dans son traité, au tout début de la Grande Chasse, le juriste dauphinois Claude Tholosan déclare que « l’Église ne peut ordonner la mort naturelle ou corporelle » et qu’il revient à des juges séculiers de prononcer la mise à mort par le feu. Les historiens ont nettement nuancé le tableau si tranché hérité, en particulier, des luttes idéologiques du xixe siècle. Soumis aux volontés de contrôle des pouvoirs séculiers, en particulier princiers, à l’âge de la genèse de l’État, l’inquisiteur du xve siècle n’était pas le deus ex machina ayant droit de vie et de mort dans l’arbitraire absolu que l’on se plaît parfois à représenter. Des cruels, voire des pervers, parmi les gardiens de l’orthodoxie, il y en eut certainement ; mais ceux qui envoyèrent à la mort, à l’Époque moderne, furent avant tout des laïcs, ou des hommes d’Église qui, tels plusieurs évêques allemands, se comportaient en princes temporels. Ils le firent, en outre, avec le soutien fréquent de la population locale, au gré des règlements de compte, mais aussi de la violence inhérente à la relation entre le sorcier-guérisseur et ses clients, partagés à son égard entre le besoin, la crainte et la rancœur en cas d’échec. Comme l’a montré Claude Gauvard dans ses travaux sur les lettres de rémission, par lesquelles le roi octroyait son pardon à un condamné et arrêtait ainsi le cours de la justice, les hommes qui réglèrent leurs comptes avec un prétendu sorcier surent exploiter la connaissance qu’ils avaient des pratiques et mécanismes judiciaires, se livrant à des parodies de procédures ou utilisant la justice locale au profit de leur cause.