14
Le chroniqueur vedette
(23 décembre 1947)
Le chroniqueur vedette
(23 décembre 1947)

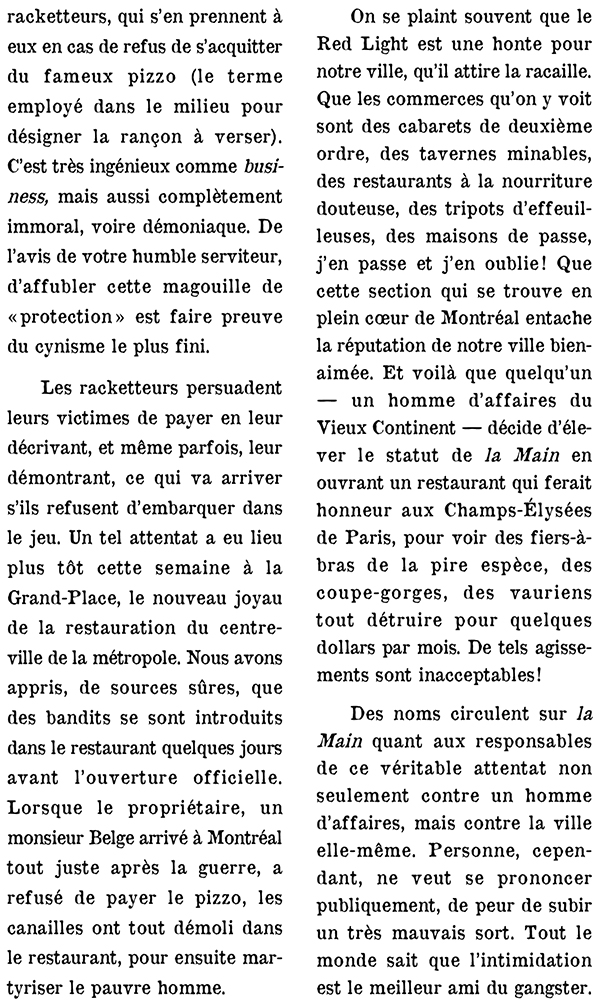
Jérôme en a assez lu. Il plie le journal et se tourne vers Charlot.
— Il est temps d’avoir une conversation avec un certain Monsieur Bellefeuille.
— C’est qui, ce Bellefeuille ?
— Quelqu’un qui se mêle de mes affaires, déclare Jérôme en brandissant sa copie de La Cité.
— C’est pas bien, ça…, dit Charlot en rigolant.
* * *
À la sortie des bureaux de La Cité, Jérôme et Charlot abordent Roch Bellefeuille, un homme court sur pattes mais robuste, les épaules bien carrées dans son manteau de l’Armée rouge qu’il a dégoté lors d’un voyage à Moscou l’hiver précédent. Il a le physique d’un déménageur de pianos beaucoup plus que celui du chroniqueur vedette du journal le plus lu en ville. Seule la pipe qu’il a au bec lui donne une allure d’intello.
— Qu’est-ce que vous me voulez ? demande-t-il en regardant Charlot d’un air hautain.
— J’ai à vous parler, lui rétorque Jérôme.
— Mais j’ai rien à vous dire, moi. Je ne sais même pas qui vous êtes.
— Inquiétez-vous pas. Vous allez apprendre à me connaître.
Charlot agrippe le chroniqueur avec une telle force qu’un éclair de douleur lui traverse le bras jusqu’au bout des doigts. Il pousse un « Ha ! », qui lui fait échapper sa pipe sur le trottoir.
— Vous avez bien quelques minutes, insiste Charlot.
— Oui, répond Bellefeuille en grimaçant.
— Je vous inviterais à casser la croûte à la Grand-Place, dit Jérôme, mais c’est pas encore ouvert, comme vous le savez bien. Dans une semaine, il paraît. Mais il y a un endroit tranquille pour parler pas loin d’ici.
Bellefeuille, toujours sous l’emprise de la main de fer de Charlot, ne peut que suivre.
Les opinions et le style de Bellefeuille en ont choqué plus d’un au fil des ans. Il a reçu des dizaines et des dizaines de lettres de bêtises, certaines tellement vitrioliques qu’il s’en inquiétait pendant quelques heures, sinon quelques jours. Il s’est même fait apostropher dans la rue trois ou quatre fois par des lecteurs courroucés. Mais jamais on ne l’a approché comme ces deux fiers-à-bras qui le contraignent à les suivre sur la rue Clark. Il pourrait tenter de s’esquiver, mais il sait que le rapport de force n’est absolument pas en sa faveur. Et, bien sûr, pas un maudit policier en vue.
Enfin ils s’arrêtent devant la boutique d’un fourreur. L’affiche peinte à la main avec des lettres de style gothique dit :
DREYFUS’ FURS, Est. 1927.
Jérôme entre le premier et aperçoit tout de suite Monsieur Dreyfus, le propriétaire du commerce. Dreyfus est entouré de mannequins portant des manteaux de fourrure de toutes sortes, de toutes formes, de tout poil. Sur une étagère, une série de têtes blanches coiffées de chapeaux. Non loin de l’entrée, un comptoir sur lequel se trouve le tiroir-caisse. Dreyfus, lui, porte un tablier de cuir. Des petites lunettes reposent sur son nez, qui surplombe ses grandes moustaches et sa barbe couleur farine.
Bellefeuille remarque l’air que fait le vieux fourreur à la vue de la moustache à la Hitler du colosse qui lui tient toujours le bras.
— Monsieur Jérôme, dit Dreyfus. Un de vos hommes est déjà passé ce mois-ci.
— Je sais bien, Monsieur Dreyfus. Il s’agit pas de ça. J’ai besoin d’un espace tranquille pour quelques minutes. Est-ce que je peux emprunter votre arrière-boutique ?
Dreyfus regarde Jérôme, puis l’homme trapu qu’il ne connaît pas, puis de nouveau Jérôme.
— Vous allez pas faire de dégâts là derrière, n’est-ce pas, Monsieur Jérôme ?
Jérôme lui envoie un sourire énigmatique et se dirige vers l’arrière de la boutique.
Charlot pousse Bellefeuille dans cette même direction.
— Faites-moi pas de mal, implore Bellefeuille.
Les trois pénètrent dans l’arrière-boutique du fourreur. En plein centre de la pièce trône une grande table jonchée de larges bandes de fourrure de castor, de ciseaux, d’aiguilles, de bobines de fil, de lames de différentes tailles et de boutons noirs entourant une machine à coudre. Accrochés sur tous les murs et occupant chaque pouce d’espace — du plafond au plancher — il y a des pelisses, des manteaux, des étoles, des capes de fourrure de divers types — castor, renard, loup, vison, chat sauvage, loutre, lapin, hermine. Pendant qu’il jette un coup d’œil circulaire autour de lui, Bellefeuille se fait la réflexion qu’on se croirait dans une caverne préhistorique, entouré de bêtes sauvages.
Jérôme enlève son manteau et s’assoit sur la chaise de Dreyfus. Il pointe un vieux fauteuil à moitié défoncé dans le coin de la pièce et indique à Bellefeuille de s’asseoir. Charlot, lui, reste debout. Il admire les fourrures sur les murs, les caresse. Lui aussi ôte son lourd manteau.
Les deux tubes fluorescents installés au plafond au-dessus de la table de travail font pleuvoir des torrents de lumière spectrale sur Jérôme.
— Allez-vous enfin me dire ce que vous voulez ? demande Bellefeuille, essayant de ne pas trahir la peur qui l’étouffe de plus en plus. Je n’ai pas que ça à faire, moi.
Jérôme s’adosse sur sa chaise et, l’air pensif, se frotte les narines avant de déclarer :
— Je veux parler journalisme avec vous. J’aime beaucoup ce que vous faites.
Bellefeuille s’attendait à tout, sauf à être complimenté pour son travail par ce type louche. Il se détend un peu.
— Laissez-moi d’abord me présenter. Je m’appelle Jérôme Ménard.
Bellefeuille pâlit en reconnaissant immédiatement le nom. Le fameux « roi de la Main » dont certains lui ont parlé lors de son enquête. Le racket de la protection… Bellefeuille est maintenant certain que Ménard va s’en prendre à lui. Il commence à suer et déboutonne son manteau soviétique.
— Je lis vos articles sur l’état de délabrement des logements dans les quartiers ouvriers de la ville et sur la malpropreté du fleuve Saint-Laurent, dit Jérôme. Vous m’impressionnez, je dois avouer.
— J’aime bien écrire au sujet des causes sociales brûlantes de mon époque, répond Bellefeuille avec un sourire satisfait. Brasser la cage, comme on dit.
Jérôme transperce le chroniqueur de ses yeux noirs.
— Mais votre papier de ce matin, dit-il, je dois reconnaître que je l’ai pas beaucoup apprécié.
— J’ai 200,000 lecteurs chaque jour à La Cité, répond Bellefeuille. Je ne peux pas plaire à chacun d’entre eux.
— Pour ça, vous avez sûrement raison. Moi, ce que je vous reproche, c’est d’avoir fait le fanfaron, d’avoir écrit une chronique sensationnaliste.
Bellefeuille fronce les sourcils.
— Qu’est-ce que vous voulez dire ?
— Le racket de la protection sur la Main, un « fléau » ? Vous charriez un peu, à mon avis. Je vais vous rappeler, moi, c’est quoi un fléau. Un fléau, c’est les femmes abandonnées par leur mari et qui crèvent de faim avec leurs enfants parce qu’elles ont aucun droit. Un fléau, c’est l’Église catholique qui incite les pauvres gens pas éduqués à voter pour un parti politique qui a tout intérêt à ce que les pauvres gens pas éduqués restent comme ça pour toujours. Un fléau, c’est la grosse business anglaise qui exploite les Canadiens français et qui contrôle l’économie. Un fléau, c’est tous ces cultivateurs qui s’enfuient à Montréal chaque année, pauvres comme Job dans la Bible, et qui se ramassent quatorze dans un logement gros comme ma main et infesté de souris, de punaises et de coquerelles. Un fléau, c’est des enfants qui vont au lit le soir avec des gargouillis dans l’estomac parce qu’ils ont pas eu assez à manger à l’heure du souper. Un fléau, c’est les enfants qui sont obligés d’abandonner l’école après leur 3e année pour aller travailler dans une shop parce que leurs parents arrivent pas. C’est ça, un fléau. Pas les trucs qui se passent sur la Main, même si ces trucs sont pas toujours très catholiques.
— Ça va me donner de l’ouvrage, tous ces sujets, ironise le chroniqueur.
— J’aime aider mon prochain, dit Jérôme. Me rendre utile. Et d’ailleurs, je vais me rendre encore plus utile en vous renseignant au sujet du racket de la protection de la Main.
— Bon… dit Bellefeuille avec un ricanement sceptique. Je suis prêt pour la leçon.
— D’abord, je déteste le mot « racket ». C’est très péjoratif et, en plus, c’est faux. Et puis j’aime pas beaucoup le terme « gangster ». Moi, je me vois plus comme un entrepreneur. Ce que votre article précise pas, ce que vous semblez pas comprendre, c’est que je les protège vraiment, les commerçants sur mon territoire. Vous avez pas idée du nombre de délinquants et de bandits à la petite semaine qui rêvent de faire un coup d’argent facile en mettant la main sur la caisse d’un restaurant ou un magasin dans le quartier. Mais ils savent que Jérôme Ménard protège ces commerces. Et s’ils le savent pas, ils l’apprennent et c’est pas long. Il y a des jeunes excités dans le coin, en manque de cash pour s’acheter de l’alcool ou de la drogue ou — je sais pas, moi — des bijoux pour leur dulcinée, et qui parfois décident de s’offrir la caisse d’un commerce. Eh bien moi et mes gars, on intervient. Par exemple, deux jeunes crottés ont justement hold-uppé la bijouterie au coin de Saint-Laurent et Marie-Anne la semaine dernière. Mes gens m’ont dit de qui il s’agissait et je leur ai mis la main au collet. Non seulement on leur a donné une bonne leçon — autrement dit, une méchante dégelée —, on a même retrouvé à peu près tous les bijoux qui avaient été volés et on les a remis au propriétaire. Il était très content, vous savez… On appelle ça la paix sociale. C’est important.
Bellefeuille laisse échapper un petit rire que Jérôme sent rempli de condescendance.
— Ce genre de service, continue-t-il, l’ordre que je fais régner sur mon territoire, ça se paye. Je suis pas à la tête d’une œuvre de charité. Mais des récalcitrants, il y en a toujours, des propriétaires de commerce qui refusent mes services. C’est surtout ceux qui viennent d’arriver dans le quartier, ceux qui connaissent pas les us et les coutumes de la Main. S’ils veulent pas t’écouter, ceux-là, tu les envoies à l’hôpital pour quelques jours, puis tu leur parles de nouveau. En général, leurs oreilles sont plus grandes ouvertes la deuxième fois.
Charlot se tient devant un long manteau de chinchilla, le décroche du mur et l’enfile, se donnant ainsi des allures de yéti. Il caresse la fourrure tout le long de son bras, avant de remettre le manteau sur son crochet.
— La violence, enchaîne Jérôme, c’est une façon très efficace d’obtenir ce qu’on veut. J’ai appris ça très vite dans la vie. En fait, la seule chose dans votre article qui était vraiment exacte est la phrase : « Tout le monde sait que l’intimidation est le meilleur ami du gangster. » Quoique c’est un peu fendant comme déclaration, surtout venant d’un journaliste qui doit perdre connaissance quand il se coupe un doigt avec une feuille de papier et qu’il voit un peu de sang.
Bellefeuille est offusqué mais décide de ne pas gratifier cette mesquinerie d’un commentaire.
— La violence, mon ami, il y a rien de tel. Mes clients parlent français, anglais, yiddish, polonais, russe, grec, allemand, ukrainien, roumain, you name it, mais ils comprennent tous une chose — une sorte de langage universel : la violence.
Jérôme se penche vers la table, ramasse une des lames que Dreyfus utilise pour son travail. La lumière des néons explose au contact de l’acier de la lame. Jérôme l’examine en silence avant d’expliquer :
— Quand tu coupes quelqu’un, tu t’arranges pour que l’entaille soit assez longue et profonde pour que ça devienne une belle, grosse cicatrice. Comme ça, le message est bien clair pour tout le monde. Mais en même temps, il faut éviter la veine jugulaire, sinon le gars meurt au bout de son sang comme un porc dans un abattoir. À moins que ça soit ça ton but. Et quand, justement, il faut que je fasse la peau à quelqu’un qui veut rien comprendre, j’amène le corps à un de mes associés sur la Main. Mon associé est boucher — je vous dirai pas dans quelle boucherie il opère — et il se fait un plaisir de désosser le corps, entre une vache et une truie. Puis on vend la viande à des restaurants du quartier chinois.
Les traits de Bellefeuille sont tordus de dégoût.
Jérôme rit et dit :
— Mais non, je vous niaise… Vous êtes bien cruche pour un journaliste. Mon boucher se débarrasse des morceaux du corps avec les pièces de viande qu’il arrive pas à vendre. Il brûle tout ça. Ce qui veut dire que le cadavre du gars disparaît sans laisser de trace. Ni vu ni connu, tant pis pour la police.
Bellefeuille parvient à se remettre de ses émotions pour retrouver un minimum de flegme.
— Et la police, justement, demande-t-il, elle vous inquiète pas ?
— La police de Montréal ? Elle est bonne, celle-là. Je connais les policiers qui travaillent dans le coin. Je les ai tous dans ma poche.
— Et vous avez beaucoup de gens qui travaillent pour vous ?
— Oui. Il y a toujours des gars qui viennent me voir pour m’offrir de se joindre à mon équipe. Il s’agit de savoir à qui on a affaire. On teste. Il y a un gars un jour qui disait vouloir travailler pour moi. Je ne l’avais jamais vu auparavant. Je l’ai conduit dans une ruelle, puis je lui ai donné un coup de poignard dans la cuisse et je l’ai laissé là. Le gars aurait pu aller à la police pour se plaindre ou il aurait pu essayer de se venger. Mais il s’est plutôt rendu chez lui et il s’est soigné et il a fermé sa gueule. Puis il est revenu me voir pour me redemander de se joindre à ma gang. C’est le genre d’homme que je recrute, parce que je sais que je peux lui faire confiance. Ce gars-là est un de mes meilleurs collecteurs. Il a peur de rien, surtout pas de prendre les grands moyens quand c’est nécessaire.
Charlot attrape un énorme chapeau de vison, du type que portaient les Cosaques dans les steppes russes, et se le place sur la tête.
Jérôme poursuit sur sa lancée :
— Reste qu’on n’est pas toujours obligé d’éclater le crâne de ceux qui ne veulent rien comprendre. Par exemple, tu mets le feu à une voiture devant le commerce du proprio qui fait des chichis. C’est un message clair, bien viril, sans avoir à tabasser qui que ce soit. Prenez votre cher Simonin et son restaurant pompeux. Vous avez écrit dans votre chronique qu’il avait été « martyrisé ». Vous avez vraiment une manière particulière de formuler les choses, vous. J’ai tout simplement essayé de lui faire comprendre la situation, à Simonin. J’ai été très poli avec lui. Un parfait gentleman. Pas vrai, Charlot ?
Charlot, toujours en train d’inspecter les fourrures, fait oui de la tête.
— Mais il était complètement bouché, reprend Jérôme. Je ne lui ai pas fait mal. Pas physiquement… Je lui ai fait peur, c’est tout. Et tout le monde sur la Main a peur de moi. Quand j’entre dans un bar ou un restaurant, les gens savent pas trop s’ils devraient se pousser par la porte d’en arrière ou embrasser ma bague comme si j’étais un monseigneur. J’adore ça.
« Moi, poursuit Jérôme, je fais dans la protection parce que je m’y connais et c’est un business qui convient à mes talents et à ma personnalité. C’est pas que j’aime tant la violence, que ça m’amuse de faire mal à quelqu’un. Je déteste pas ca, d’un autre côté. Il y en a qui le méritent. Reste que je suis en train d’étendre mes activités. »
— Vous allez faire quoi ? lui demande Bellefeuille. Les maisons de jeu ? La prostitution ?
— Jamais je me baderai avec la prostitution. Les putes — les femmes en général —, c’est trop compliqué. Elles ont toutes sortes de besoins, tout plein d’attentes. Et puis les putes, faut les battre pour les contrôler, et moi c’est pas mon genre de cogner les femmes. J’ai vu assez souvent ma propre mère se faire tapocher par mon père pour que ça m’écœure à vie.
Charlot saisit une étole de castor et se la jette sur les épaules d’un geste quasi féminin.
Jérôme, excédé, lève la voix :
— Charlot ! T’as pas un peu fini ? J’essaie d’avoir une conversation sérieuse avec Monsieur Bellefeuille et toi tu fais le clown.
Penaud, Charlot enlève l’étole et la remet à sa place.
Un lourd silence s’installe dans l’arrière-boutique, que Bellefeuille rompt finalement :
— Tout ça est fascinant, Monsieur Ménard. Ça va faire de la maudite bonne copie.
Le sourire de Jérôme est une grimace bizarre, voire inquiétante.
— De la bonne copie ? Si tu publies quoi que ce soit de ce que je viens de raconter, t’es un homme mort. Tu gardes ça on the Q.T., comme disent les Américains.
Complètement abasourdi, Bellefeuille balbutie :
— Mais… Je croyais…
— J’ai dit tout à l’heure que j’aimais ton travail. Je mentais. Tu te prends pour Henri Bourassa, mais moi j’aime pas ton style et j’aime particulièrement pas le fait que tu te mêles pas de tes oignons. Tes reportages minables sur la Main, c’est un petit jeu extrêmement risqué. Un homme de ton expérience devrait savoir que rien est plus dangereux que les mots. À part la colère du roi de la Main.
— Mais… Mais pourquoi m’avoir raconté tout ça si je ne peux rien rapporter ?
— Je te l’ai expliqué : c’était pour te renseigner.
— Mais je ne peux pas garder tout ça pour moi ! Ça va tout à fait à l’encontre de ma responsabilité envers mes lecteurs. C’est aux antipodes de mon éthique professionnelle.
— J’espère pour toi que ton instinct de survie est plus fort que ton éthique professionnelle. Un seul mot de tout ça et on te fait la peau.
Charlot se penche vers Bellefeuille et lui glisse à l’oreille :
— Ça me ferait plaisir, moi, de te faire la peau. Un peu comme les fourrures ici-dedans…
— Bon, annonce Jérôme, le meeting est fini.
Bellefeuille s’arrache avec peine de son fauteuil et titube vers la porte.
Avant de sortir à son tour de l’arrière-boutique, Charlot s’empare d’une paire de mitaines en fourrure de chat sauvage.
— C’est pour Marcelle. Elle se plaint toujours qu’elle a froid aux mains.