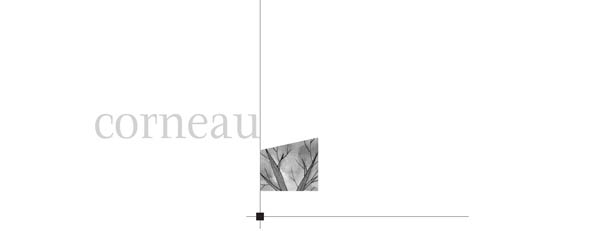
Chapitre trois
La part oubliée
L’aspect psychosomatique d’une maladie
Juin. Mes proches sont avisés. Mes traitements ont commencé. Je veux maintenant connaître le sens de ce qui m’arrive. Que voulez-vous, on ne devient pas psychanalyste pour rien ! J’ai besoin de parler avec moi-même et j’en ai le temps plus que jamais à travers ces longues journées de maladie. Je décide donc d’entreprendre un bilan psychologique profond. Je veux savoir comment j’ai prêté le flanc à la maladie. Mon récit va donc changer de rythme. Je vais passer à celui, plus intime, de la vie intérieure et de la psychologie.
La psychanalyse s’est toujours intéressée à l’aspect psychologique des troubles physiologiques. Carl Jung disait d’ailleurs : « La maladie est l’effort que fait la nature pour nous guérir. » Très tôt, dans ma propre démarche, j’ai investigué les éléments associés à la colite ulcéreuse. Cette dernière va me permettre de vous donner un exemple de ce que peut être la pensée analytique par rapport à la maladie. Je peux d’autant mieux vous parler de la colite que je n’ai pas eu de crise depuis plus de dix ans, et qu’avec les années j’ai acquis détachement et clarté par rapport à ce sujet. Je me donne donc quelques paragraphes pour vous résumer mes trouvailles avant de reprendre le fil de mon récit. Je ferai ensuite le même genre d’exercice par rapport aux parties qui sont touchées par le cancer.
Au centre d’une maladie, il y a une psychologie liée à l’organe atteint. Dans le cas de la colite, c’est le côlon, aussi appelé gros intestin. Situé au bout de la chaîne alimentaire, cet organe sert principalement à l’élimination des déchets qui ne peuvent être recyclés par l’organisme. Or, la colite produit paradoxalement constipation et diarrhée en alternance. Au pire moment d’une crise, celui où la muqueuse de l’intestin s’est enflammée et s’effrite, la personne malade peut aller aux toilettes une vingtaine de fois par jour, perdant à chaque fois un mucus composé de plasma sanguin et de matière fécale.
Sur le plan psychologique, on constate fréquemment que la personne souffrant de colite a subi des atteintes psychiques durant son enfance à l’occasion de situations qu’elle a trouvées injustes. Elle en a éprouvé humiliation et dévalorisation. Elle n’a pas compris ces situations, elle les a rejetées et celles-ci ont provoqué chez elle une révolte qu’elle s’est efforcée de contenir le mieux possible. Ainsi, tel individu n’a jamais pu exprimer ni éliminer ce qui l’affectait véritablement. Cela est resté bloqué dans le système et c’est précisément ce que le côlon reflète : une alternance entre un effort constant pour se contenir et des moments de relâchement total quand l’inflammation s’en mêle et qu’il y a aggravation du malheur intime.
En gros, des déchets intérieurs n’ont pu être ni assimilés ni éliminés, parce que le sujet a trouvé certaines expériences indigestes et que celles-ci l’ont « emmerdé », si vous me permettez l’expression. Il n’a pas pu exprimer non plus les réactions de rage et de colère que ces expériences ont fait naître en lui, parce qu’il craignait de perdre l’affection de ses proches en les manifestant haut et fort. De fait, ces puissants mouvements intérieurs liés à la rage et à la colère provoquent honte et culpabilité chez la personne. Cela l’angoisse parce qu’elle craint que les gens devinent son état intérieur. Elle tente alors de cacher le tout et de se faire pardonner à l’avance en devenant très performante. Elle cherche ainsi à gagner l’estime et l’affection des autres malgré ses troubles internes. Mais la performance l’épuise et la place éventuellement en situation d’échec. Une crise de colite se déclenche alors pour lui permettre de sauver la face vis-à-vis de ses proches et avoir du temps afin de penser à ce qui se passe en elle. Nos intimes réagissent en effet mieux à la maladie qu’à l’étalement brut de nos rages enfouies.
La personne aux prises avec une inflammation de l’intestin vit donc un conflit inconscient qui pourrait se résumer ainsi : je dois exprimer ma colère et ma rage pour me guérir, mais si je parle, je vais perdre l’estime des gens qui m’aiment. À la limite, il s’agit d’une sorte d’offrande sacrificielle par laquelle l’individu affirme inconsciemment : « Voyez, je fais tout en mon possible pour être bon et répondre à vos demandes. Je ne peux pas faire plus, j’en suis à donner mon sang. » Du point de vue de la psychanalyse freudienne, la maladie révèle le conflit en même temps qu’elle le cache. Elle nous permet d’ennuyer nos proches avec nos besoins — c’est l’aspect rage et colère — et de recevoir malgré tout leur attention et leurs soins parce que nous sommes malades — c’est l’aspect reconnaissance et estime. La maladie apparaît ainsi comme une véritable solution de compromis, mais qui invite à changer de stratégie si l’on ne veut pas que les crises se répètent de plus en plus gravement.
Je vous donne cet exemple pour mettre en valeur le sens psychologique d’une maladie pourtant physique. J’ajoute tout de suite que la prise de conscience de ce qui est en jeu sur le plan psychologique ne suffit pas toujours à modifier le plan physiologique. La raison principale est qu’une habitude d’évacuation du stress par des voies organiques a été prise et qu’il est difficile de la renverser. Néanmoins, le bilan psychologique revêt une importance capitale à mes yeux. On ne saurait faire l’impasse sur l’observation intérieure, car, à long terme, l’examen psychique permet un assainissement du terrain global et encourage la transformation de certaines attitudes d’évitement ou de déni du conflit. Cette action sur les évitements et les dénis s’avère nécessaire si l’on veut éviter les crises à répétition.
Il y a d’ailleurs psychothérapie et psychothérapie. La plupart d’entre elles favorisent l’établissement d’un moi fort et confiant devant la vie, ce qui est absolument nécessaire au bon fonctionnement d’une personne dans la réalité. Ce moi occupe en somme le centre du champ de la conscience. La psychanalyse aborde cependant la question de façon différente. Elle invite le moi à se mettre à l’écoute de l’inconscient, ce partenaire caché en nous et qui entoure la conscience de toutes parts. Ainsi, lorsque l’on est malade, il est très important d’écouter les productions autonomes de la psyché, comme les rêves, les impressions, les intuitions, voire les obsessions, car elles nous révèlent la présence d’un autre point de vue en nous. La maladie met en échec le fonctionnement habituel du moi pour permettre cette écoute profonde. Il ne faut pas manquer cette opportunité de s’entendre en profondeur et se faire aider par un thérapeute si l’on est peu habile ou peu enclin à ce genre d’exercice.
Je désire également ajouter un mot de prévention par rapport au sens d’un symptôme : cette recherche peut devenir tyrannique. Il m’a fallu des années pour comprendre ce que je viens de vous expliquer en quelques pages. Le sens constitue donc quelque chose qui émerge peu à peu de l’intérieur, à force d’attention bienveillante. Il ne sert à rien de l’imposer de l’extérieur de façon idéologique. La souffrance peut avoir un sens et ce sens aide à vivre assurément. Toutefois, il y a des souffrances difficiles à expliquer, la souffrance des enfants est de celles-là. Elle oblige à un élargissement extrême du cadre de réflexion. On doit parfois se consoler en constatant simplement combien cette souffrance transforme les proches aidants en profondeur dans leur cœur. Elle nous invite sans cesse à lutter pour une humanité plus respectueuse de la vie. Sur cette route, on en arrive même à penser à des âmes missionnaires venues, au fond, nous faire évoluer.
Une visite opportune
Revenons à notre récit. Le téléphone arabe fonctionne à plein depuis quelques semaines et de plus en plus de personnes sont au courant de ma situation. Je reçois un appel téléphonique de Claude Sabbah. Il est de passage au Québec pour une formation et il propose de venir me visiter le soir même pour me donner un coup de main. Le Dr Claude Sabbah est le chantre d’une discipline qu’il a nommée la biologie totale, mieux connue sous le nom de décodage biologique. Elle s’inspire des travaux du neurobiologiste Henri Laborit et de ceux du médecin allemand Ryke Geerd Hamer, le fondateur de la nouvelle médecine germanique.
J’ai entendu Claude Sabbah à quelques reprises en conférence et en séminaire et j’ai apprécié son enseignement. Je l’ai entendu décrire avec passion l’intelligence des symptômes, débusquant leur sens dans les moindres manifestations d’un dérèglement, nous faisant comprendre qu’une maladie est véritablement une solution parfaite de survie déclenchée par le cerveau. Car, contrairement à ce que l’on pourrait penser, on meurt moins vite d’un cancer que d’un stress qui s’est transformé en détresse, ou d’une situation intenable à laquelle on ne trouve pas de solution viable.
Les propositions de la biologie totale prennent place à côté des démarches proposées par la médecine psychosomatique, la psychanalyse, l’ostéopathie ou encore la médecine chinoise. Toutes se basent sur une psychologie qui met un organe en relation avec une émotion et un conflit émotionnel la plupart du temps inconscient. Au moment où j’écris ces lignes, par exemple, mon acupunctrice remarque que le dessous de ma langue est strié. Elle observe en même temps un manque de vigueur de mon foie et une « stase sanguine », c’est-à-dire un ralentissement du rythme de la circulation de mon sang. Elle me demande le plus simplement du monde s’il y a des contrariétés importantes dans ma vie. Elle vise juste, il y en a amplement. Pour elle, les irritations et les frustrations se reflètent directement dans le comportement du fluide sanguin et du foie. Si on se fait de la bile, cela finit par provoquer l’accumulation de toxines qui affaiblissent le foie et ralentissent la circulation du sang.
Claude Sabbah arrive à la maison. D’entrée de jeu, il me demande de préciser la nature du cancer qui m’affecte. Je lui explique qu’il s’agit d’un lymphome dont le foyer principal est l’estomac.
« Cet organe est l’un des premiers organes de préhension du monde pour le nouveau-né, qui a tendance à tout mettre dans sa bouche, m’explique-t-il. L’estomac nous met ainsi sur la piste de nourritures affectives qui, dès le premier âge, ont été difficiles à assimiler par l’enfant. En général, il s’agit d’humiliations et de dévalorisations.
– Je te suis bien.
– Puisque ta tumeur affecte la partie supérieure de l’estomac, le pylore, on peut regarder du côté du père », ajoute-t-il.
Là, je suis étonné de ce qu’il me raconte. Bien que j’aie écrit Père manquant, fils manqué1, ce qui a fait dire à mon paternel avec humour que j’avais fait de lui « le père manquant officiel du Québec », je n’ai jamais pensé que notre relation se situait dans une dynamique de dévalorisation. Je partage mon étonnement avec Claude qui trouve que je résiste à l’interprétation. Je ne peux pas nier que j’aie la résistance facile. Quand je n’ai pas le droit de résister ou de réfléchir, je ne m’y retrouve pas. Je réagis mal lorsque j’ai l’impression que l’on tente de m’imposer quoi que ce soit. Je me sens mieux devant une invitation à considérer les choses sous un angle différent. J’ai toujours eu besoin d’un certain flou artistique, car il me permet de penser par moi-même. Il est vrai que nous n’avons qu’une soirée et Claude veut sans doute m’aider le plus efficacement possible en me faisant gagner du temps. Toutefois, devant un patient aussi « psychologisé » que moi, il vaut mieux y aller doucement. Je me dis même qu’il ne doit pas y avoir de client plus difficile que Guy Corneau, car il proteste sans cesse. Mais je ne peux pas m’en empêcher. Mes vieux complexes resurgissent devant l’autorité.
« Le mot “mort” revient souvent dans ton langage, me fait-il également remarquer. Selon moi, tu ne devrais même pas te permettre d’y penser.
– Mais, Claude, je sais que si je ne peux pas envisager mon décès possible, je ne pourrai pas revenir à la santé. Il en a toujours été ainsi dans mon existence. Je ne suis pas le seul. J’ai un ami qui a déjà fait ériger sa pierre tombale. Il va la visiter chaque semaine au cimetière pour se rappeler de jouir de la vie pendant qu’il en est encore temps. Pour ma part, j’estime que, si l’on se promène au bord d’un précipice, il vaut mieux en connaître les contours.
– Oui, mais c’est aussi comme ça que l’on risque de s’abîmer dans une spirale de pensées morbides qui conduisent au fond
du ravin. »
Je comprends bien de quoi il veut me prévenir. Il trouverait regrettable que ces pensées négatives tissent peu à peu la voie à suivre à mon devenir. Toutefois, il me semble que ce n’est pas le cas. La pensée de l’issue fatale me donne la force d’entreprendre ce qu’il y a à entreprendre, notamment sur le plan psychologique. En fait, je ne rejette pas ce qu’il me dit. Je trouve simplement que ça ne colle pas tout à fait à mon expérience et qu’il me faut du temps pour y penser. Puis il m’aide à réfléchir sur ce qui touche la rate et les poumons. D’accord ou non, la visite de Claude a le mérite de m’offrir d’autres pistes pour plonger à fond dans mon bilan psychologique.
Un aparté
En lisant ces lignes, mes éditeurs m’ont souligné que la biologie totale de Claude Sabbah et la nouvelle médecine germanique du Dr Hamer sont devenues des sujets fort décriés. Je me permets donc un aparté. Je veux faire valoir que nous nous trouvons devant un corpus d’informations très intéressantes sur les liens possibles entre le corps et l’esprit. En ce sens, même si l’on juge sévèrement les personnes qui défendent ces théories, il me semble qu’il ne faut pas commettre l’erreur de jeter le bébé avec l’eau du bain. Sans détenir la vérité absolue sur la maladie, ces propositions ont le mérite de guider la recherche psychologique dans un champ bien déterminé en relation avec des organes ou des parties du corps donnés. Pour tout dire, le décodage biologique offre un outil diagnostic intéressant. Les pistes psychologiques qu’il présente peuvent être fertiles et elles ont leur place dans une approche globale à côté d’autres outils.
Néanmoins, peu importe la théorie, la rigueur scientifique exige que l’on garde à l’esprit qu’il s’agit d’hypothèses et de pistes de réflexion, pas de dogmes. On ne peut pas penser qu’une personne va guérir si l’on se contente de nommer la relation jusque-là inconsciente entre son état psychologique et l’un de ses organes. C’est de la pensée magique. L’essentiel réside dans le fait que ces hypothèses soient porteuses de sens pour la personne qui les reçoit de la part d’un intervenant. Le problème survient lorsque des praticiens imposent des propositions de travail comme des vérités que l’on ne peut pas remettre en question, ce qui semble arriver beaucoup trop souvent, tant du côté des médecines alternatives que de la médecine conventionnelle, d’ailleurs. On passe alors de la science à la croyance. L’individu se trouve évacué et la théorie affaiblie.
Un autre problème posé par la nouvelle médecine germanique et la biologie totale vient de ce que l’on y reste collé à un modèle médical où l’on utilise les affirmations psychologiques comme des médicaments : au lieu de traiter un virus avec un remède, on traite un symptôme avec une interprétation. Le modèle devient stéréotypé. Il s’avère dès lors difficile de l’adapter au patient qui consulte, alors qu’en psychothérapie tout l’art consiste justement à suivre la personne dans l’intégration d’une nouvelle donnée. Il importe de se rappeler que le sens d’une expérience peut varier d’une personne à une autre puisque nous sommes tous distincts. Une hypothèse prend en fait tout son sens lorsqu’elle provoque une adhésion de l’individu, adhésion qui modifie la façon dont ce dernier se situe par rapport à lui-même et à ce qui l’affecte. Sinon, la théorie peut être juste mais elle n’a pas d’efficacité psychique.
Il est vrai qu’à l’occasion l’effet revitalisant d’une prise de conscience permet un renversement réel des processus de dégénérescence. Le psychologue et humoriste québécois Pierre Légaré, aux prises avec un cancer qui l’a entraîné au seuil de la mort, a senti la situation s’inverser en 24 heures à mesure qu’il lisait un livre traitant des théories du Dr Hamer sur le sens de sa maladie. Il est revenu à la santé en quelques mois alors qu’il était condamné. Cette révélation a agi instantanément et efficacement sur ses processus d’autoguérison2. Il n’en va toutefois pas de même pour tous et pour toutes.
Le psychiatre et psychanalyste Jean-Charles Crombez a un point de vue rafraîchissant sur tout cela. Il invite à relativiser toute méthode qui prétendrait détenir la vérité sur le sens des maladies. Ce médecin spécialisé en intervention psychosomatique pense que la justesse de l’interprétation n’a pas une importance capitale, quelle que soit l’approche dont elle émane. Ce qui compte, selon lui, c’est que la théorie à laquelle nous nous référons permette de se décoller de la fixité que le diagnostic de maladie provoque en nous pour transformer celle-ci en un objet intérieur avec lequel nous pouvons jouer plus librement. Il est en cela fidèle aux idées de la psychanalyse qui conçoit les interprétations comme des moteurs psychiques, leur but étant de provoquer un nouveau mouvement, une circulation des contenus.
« Ainsi, si tu penses que ton cancer est lié à une situation d’impasse, il n’est pas grave que ce soit vrai ou plus ou moins vrai, m’explique Jean-Charles en déjeunant.
– Ah bon ! Comment ça ?
– Ce qui importe est que tu aies le sentiment d’avoir une prise nouvelle sur ton problème. Cela permet une reprise de puissance au niveau subjectif. Tu existes à nouveau en tant que personne. Tu n’es plus une maladie, tu as une maladie que tu peux traiter. »
La méthode ECHO3, développée par le Dr Crombez lui-même, ou d’autres techniques qui permettent de symboliser la maladie par des images intérieures ou des objets extérieurs offrent de tels leviers. Par exemple, si je vois ma tumeur comme une fourmilière, cela me donne une métaphore avec laquelle je peux jouer plus facilement qu’avec le seul diagnostic de cancer. Je gagne ainsi une distance qui me permet un dialogue avec la maladie. Alors un sens peut jaillir et venir éclairer mon chemin de guérison. Bref, la méthode d’interprétation que l’on utilise n’a pas une importance absolue, n’en déplaise aux tenants de telle ou telle discipline. L’important est de se mettre en mouvement, à la recherche d’un sens vivant qui se transforme en chemin et qui nous transforme également.
Ce que dit mon estomac
Je vous invite maintenant à une plongée très personnelle dans mon passé. Comme je l’ai dit au début de ce livre, ce récit ne correspond pas à un besoin exhibitionniste de « confession »; il est destiné à suggérer, à partir de l’exemple que je connais le mieux, moi-même, un itinéraire personnel d’ouverture sur soi et de guérison. Il correspond à ce que je découvre des sources psychologiques de mon cancer dans le mois qui suit la visite de Claude Sabbah. Je réalise toutefois en vous livrant ces pages qu’elles impliquent d’autres personnes que moi, mon père et ma mère notamment. Je mesure combien cela est affaire délicate, d’autant plus que je me rends compte, avec les années, combien mes parents se sont dévoués pour leurs enfants et nous ont aimés de tout leur cœur. Ma mère a lu les lignes qui suivent. Je voulais avoir son avis avant de les publier. Elle m’a dit : « Laisse cela comme c’est. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, ayant à cœur votre éducation et votre instruction. Nous n’avons pas ménagé nos efforts et nous avons dit notre amour par notre travail et notre présence. » Sa réponse m’a ému. Ces paroles généreuses l’honorent.
Pour me lancer dans mon exploration psychologique, je commence par voir Claude Vallières à quelques reprises. Ce dernier est un formateur en programmation neurolinguistique (PNL). Il accompagnait d’ailleurs Claude Sabbah le soir de sa visite. Dès le départ, il a un excellent réflexe. Lorsqu’il constate que je suis très mentalisé et que cela peut nuire à une descente en profondeur, il me propose de m’étendre sur le divan pour les séances. C’est un peu le jeu de l’arroseur arrosé, car c’est exactement ce que nous faisons en tant que psychanalystes pour permettre à nos patients de laisser quelques-unes de leurs résistances au vestiaire.
Il me guide alors vers un état de détente puis m’invite à laisser monter du matériel de l’inconscient. J’aime bien me faire guider ainsi à travers la relaxation, ce que je n’ai jamais fait comme psychanalyste à l’égard d’un patient. En deux ou trois séances, nous allons explorer l’estomac, la rate et les poumons. Certaines des interprétations proposées me parlent, d’autres moins.
En fait, je ne veux pas me contenter d’appliquer une méthode, je désire entendre la parole de mon inconscient. Que me suggère chaque organe lorsque je me mets à son écoute ? Il ne s’agit pas ici d’imposer un sens à l’organisme à partir d’une théorie, mais bien de laisser parler mon être profond pour entrer en dialogue avec lui. Mon thérapeute n’est pas dogmatique. Il me suit dans mon processus, un processus orienté vers l’organe atteint comme le propose la biologie totale, mais suivant une trajectoire modifiée, en quelque sorte. J’aime bien me déplacer ainsi, dans un parcours balisé. J’ai une direction et c’est ce que j’apprécie le plus de ce travail : on ne cherche pas n’importe où.
Bien que j’y croie peu, je commence par explorer les dévalorisations du côté du père. Mon père était un homme bon et doux. Je le vois mal dans le rôle du tyran qui écrase et humilie. Il y a tout de même une anecdote qui me revient. Bien que j’aie complété une formation de psychanalyste jungien, l’équivalent de dix années d’études universitaires, il ne cesse de me demander quand j’enseignerai à l’université. J’ai beau lui expliquer qu’avec mes conférences et mes séminaires, c’est un peu comme si je le faisais, rien à faire. Son fantasme est que j’enseigne dans une institution universitaire. Il voit la carrière de professeur comme l’accomplissement suprême d’une vie vouée à l’intellect. Après tout, ce n’est pas pour rien qu’il a épousé une institutrice. Comme ce jeu dure depuis plus d’une trentaine d’années, je dois un jour faire mon deuil : mon père ne pourra jamais reconnaître mes accomplissements. Je ne serai jamais à la hauteur de son fantasme.
Deux ans avant sa mort il me dit pourtant : « Au fond, ce que tu fais, c’est un peu comme enseigner à l’université.
– Bingo ! Je n’en reviens pas, tu as fini par comprendre ! »
Même que notre dernière conversation a pour sujet le séminaire que je m’apprête à donner pendant l’été 2001. Je me prépare alors à quitter sa chambre d’hôpital, mais il ne me laisse pas partir.
« C’est un séminaire que tu vas donner ?
– Oui, à Tadoussac, sur les bords du Saint-Laurent.
– Ça s’appelle comment ?
– « Rencontre avec les baleines », ça mélange le kayak, l’écoute de la nature et l’écoute de soi.
– Je pense que j’aimerais ça.
– J’en suis sûr.
– Mais tu es certain que tu dois y aller tout de suite ?
– Ils m’attendent déjà.
– Tu vas revenir me voir après ? »
Les questions se bousculent, m’empêchant de refermer la porte de sa chambre. Ni lui ni moi ne savons à ce moment-là qu’il n’y aura pas d’après. Ce sera notre dernier entretien. Néanmoins, il doit le pressentir, car deux jours plus tard il sera mort alors que rien ne le laissait présager. Il a peut-être voulu, dans cette ultime rencontre au seuil de l’au-delà, me dire combien il m’aimait et racheter toutes ces années à vouloir autre chose pour moi.
C’est tout ce que je trouve par rapport à mon père. Puis, peu à peu, le drame de cette relation émerge, un drame qui a marqué ma vie et que j’ai réussi à occulter tant bien que mal, sans doute pour protéger le meilleur de notre rapport. Lorsque j’étais jeune, mes parents partageaient une valeur commune : l’instruction. Ils savent tous les deux qu’elle offre des choix que l’on n’a pas autrement. Tout leur dévouement se mesure à cet étalon. De plus, ils ont tous les deux une grande sensibilité artistique. Mon père possède un véritable talent manuel. Il aime la peinture, et après sa retraite, il s’adonnera avec ferveur à la sculpture sur bois, domaine dans lequel il excellera. Ma mère, de son côté, a des souches irlandaises, et elle adore la musique.
Aussi, en plus de nous envoyer à l’école, mes parents veillent à ce que nous ayons une éducation aux arts d’expression. J’apprends le piano et je prends des cours de diction. Très tôt, j’excelle dans la production de piécettes qui réjouissent mon entourage. À dix ans, je participe à mon premier spectacle théâtral à la salle paroissiale. Puis, entré au pensionnat, ce sont la chorale, la philharmonie, les concours oratoires et le groupe théâtral qui m’occupent. La scène m’enchante. La chaleur des éclairages, l’odeur des maquillages, la présence des filles qui viennent jouer du Labiche ou du Feydeau dans un pensionnat de garçons, tout cela nourrit en moi une ferveur remplie de rêves fantaisistes.
De production en production naît l’idée de consacrer ma vie au théâtre. C’est là mon vœu le plus cher. La rencontre des auteurs québécois et français fait éclater mes frontières. La poésie de Rimbaud me donne des ailes. Mes parents approuvent tout cela timidement. À 17 ans, je participe activement à deux troupes de théâtre de création, dont une que je dirige.
La fin des études collégiales approchant, la plupart de mes amis se dirigent vers des écoles de formation théâtrale. Ils préparent leurs auditions et je m’apprête à faire de même. Pourtant, il y a un hic : j’ai besoin de la signature de mes parents pour m’inscrire dans une telle école. Je sais que cela n’ira pas sans heurt. Mon père souffre de son manque d’instruction et il est pratiquement intolérable pour lui que son premier fils n’aille pas à l’université alors qu’il en a l’occasion.
Un jour, je laisse le fameux formulaire, que mes parents doivent signer, sur la table de la cuisine en partant pour le collège. Quelques jours plus tard, leur refus m’est exprimé. Leur verdict est sans recours : « Nous n’avons pas fait autant de sacrifices pour te voir devenir artiste, mon garçon. Nous voulons le meilleur pour toi et de toute évidence tu as l’intelligence nécessaire pour continuer tes études. »
Je ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre. Les artistes ne sont donc pas « intelligents » ? Moi, je les juge au contraire comme les êtres les plus intelligents et les plus sensibles de la Terre ! Mes parents qui aiment tant les arts, qui encouragent même ma sœur à faire les Beaux-Arts, pourquoi refusent-ils que je devienne acteur ? Ma mère qui voue une admiration sans bornes aux chansonniers et aux poètes québécois, mon père qui joue de l’harmonica tout en tapant du pied pour nous faire danser, comment se fait-il que ces deux-là feignent de ne pas comprendre mon aspiration la plus chère ? Je suis sans voix, touché comme un oiseau en plein vol.
J’opte pour un compromis somme toute honorable mais qui introduit un dilemme bizarre dans ma vie. Je m’inscris au programme de Communication Arts du collège Loyola. On y forme des praticiens en cinéma et en télévision. Ce programme a l’avantage d’appartenir au réseau universitaire. Ainsi, je donne à mon père le diplôme dont il a tant rêvé pour lui-même et je ne dérive pas trop de ma trajectoire artistique. Toutefois, le ver est dans la pomme. À la fin de mon premier cycle universitaire, je ne sais plus si mon avenir se situe devant ou derrière la caméra.
La décision de mes parents laisse des traces dans notre relation. J’en rends ma mère responsable puisque c’est par elle qu’elle est venue. Je tire à bout portant sur la messagère toutes les fois que j’en ai l’occasion. Jusqu’à ce que, excédée, elle laisse échapper : « Mais c’est ton père qui a décidé cela ! »
Je suis consterné. La trahison vient de mon père qui semble toujours si conciliant. Je n’ai pas les moyens psychologiques pour le confronter directement, mais je suis traumatisé par la révélation. À peine mon diplôme obtenu, je retourne au travail théâtral. Mes parents désapprouvent ma démarche.
« Tant qu’à faire du théâtre, tu ferais mieux de me rejoindre au commerce, me dit mon père.
– Mais tu sais bien que le commerce, ça ne m’intéresse pas beaucoup. »
Je me sens coupable de lui tourner ainsi le dos. Je fais même des cauchemars où il tente de me jeter en bas d’une falaise. Mais je veux poursuivre mon rêve. Toutefois, je ressens cruellement le poids de la désapprobation familiale. Je cherche une voie de sortie et la trouve du côté de la psychanalyse jungienne. Je reprends le chemin de l’université pour compléter un diplôme de deuxième cycle en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal. Puis j’entreprends mon doctorat. Je travaille au sein du Laboratoire de recherches sur la télévision et l’enfant. On m’y laisse faire des recherches du côté de la psychologie jungienne. Je prépare mon admission à l’Institut C. G. Jung de Zurich. J’y entre en octobre 1977.
Mon idée est que la profession de psychanalyste m’offrira l’argent nécessaire pour continuer à pratiquer mon métier d’homme de théâtre sans soucis financiers. Je comprends que je dois protéger ma création pour pouvoir l’exercer librement. Je vois le théâtre comme une vocation, je ne le vois pas comme un moyen de gagner beaucoup d’argent. Cependant, ce qui m’est arrivé avec le théâtre m’arrive avec la psychanalyse jungienne : la connaissance du psychisme humain me fascine — mon théâtre vient de changer de scène !
Ce qu’avait dit mon intestin trente ans plus tôt
Neuf mois après mon entrée à l’Institut C. G. Jung, je commence à souffrir de douleurs abdominales très fortes, comme si on me donnait des coups de poing dans le ventre. Je plie en deux sous l’impact des élancements. On finit par diagnostiquer une colite ulcéreuse. J’entends bien le commentaire de mon inconscient par rapport à ma nouvelle orientation : quelque chose ne va pas du tout, m’indique-t-il, je renforce mon monde mental alors qu’il faudrait plutôt que j’ouvre la porte à ma spontanéité créatrice.
Il se passe alors quelque chose de cocasse. Le médecin qui me traite à l’Hôpital universitaire de Zurich me demande si j’accepte d’être interviewé par rapport à ma colite devant des étudiants en médecine. Je dois me présenter à son cours à dix heures du matin. Je me retrouve quelques jours plus tard à déambuler à travers un labyrinthe de corridors dans les sous-sols du centre hospitalier. Une chatte y aurait perdu son chat. Passant à travers la buanderie, je me dis que je me suis définitivement égaré lorsque je découvre le numéro de porte où je suis convié. Une petite chaise y est placée : c’est là que je dois attendre que l’on vienne me chercher. Mon environnement ne paie tellement pas de mine que je me dis que je vais entrer dans un cours donné à de rares étudiants dans le fin fond de nulle part.
Surprise ! Lorsque la porte s’ouvre, je me retrouve directement sur scène, dans un auditorium high tech aux lumières tamisées, devant plusieurs centaines d’étudiants. Le professeur me présente à son immense classe et, tout en me posant des questions, il projette des photographies de mon intestin malade sur un écran géant derrière nous. Je suis dans un état second sous les projecteurs. Tout en désapprouvant cet abus de confiance de la part de l’enseignant, je ne peux que rire en mon for intérieur : puisque j’ai refusé le théâtre, c’est mon intestin perturbé qui me rendra célèbre !
À partir de ce moment-là la colite se met à faire partie de ma vie. Les crises surgissent sur une base régulière en fonction des stress de mon existence. Moi qui n’ai jamais été malade, je découvre ce que cela veut dire au quotidien. Je découvre aussi la dépendance aux médicaments anti-inflammatoires. Si la maladie m’use, en même temps elle m’humanise. Je termine mon diplôme de psychanalyste jungien en novembre 1981. Je rentre au Québec en janvier 1982, mais sans ma compagne de l’époque. L’année d’avant, elle m’a laissé pour un jeune freluquet. Ironie du sort, il est acteur !
Ma pratique d’analyste s’établit rapidement à Montréal. À un point tel que je ne termine pas l’écriture de ma thèse de doctorat. Je dois beaucoup d’argent et il faut que je travaille. De plus, je crains que l’obtention de ce diplôme ne m’enchaîne définitivement à une profession intellectuelle, sans ajouter qu’elle ouvrirait la voie à la réalisation du fantasme de mon père.
Au détour d’une conversation avec ma sœur Joanne, j’apprends que mon père lui a confié que, lorsqu’il était jeune, il avait pensé ouvrir un atelier de jouets en bois avec l’un de ses frères. Ils sont très habiles manuellement tous les deux et ils ont de bonnes idées. Finalement, il a pris le chemin du commerce et délaissé celui de l’artisanat. Avec le recul toutefois, il juge qu’il a manqué de courage et qu’il aurait dû suivre son élan. Je n’en reviens pas. Mon père m’a imposé le même sort qu’il s’était imposé à lui-même, tout en faisant semblant de ne pas comprendre mon aspiration.
C’en est trop pour moi. Je ne comprends pas cette lâcheté envers son fils. Je ravale ma colère difficilement. Nous n’en parlerons jamais ouvertement. Cela motive sans doute l’écriture de Père manquant, fils manqué, mon premier essai de psychologie. En réalité, mon père n’a jamais été manquant physiquement, et je ne me suis jamais considéré comme un fils manqué en tant que tel. Mais il y a un ratage dans notre histoire.
Ce ratage aura une conséquence amère. Il m’amènera à négliger une partie très importante de moi-même liée à la création artistique. Je ne juge pas pour autant que l’enseignement, qui occupera la plus large portion de ma vie à travers conférences, livres, séminaires et émissions de télévision, ne possède pas sa légitimité. Le problème vient plutôt du fait que cet enseignement me conduit à me réfugier dans la partie la plus conservatrice de mon être, celle qui rassure tout le monde, moi y compris. Cette profession aurait pu tout aussi bien servir à soutenir mon geste créateur comme je l’avais envisagé au départ. Mais l’esprit de sérieux l’emporte.
Pour sûr, pour que je souffre d’une colite et par la suite d’un cancer, il faut qu’il se soit passé quelque chose de grave en moi. Je crois maintenant que ce quelque chose est de l’ordre d’une dissociation profonde. Je pèse bien mes mots. La dissociation signifie qu’une part de soi a été séparée du reste. En général, c’est l’esprit qui se sépare du corps. L’unité naturelle est perdue. On pourrait comparer cet état psychique à une amputation. Pour survivre, j’ai dû, comme certains animaux pris au piège, sacrifier un membre. Les parties abolies continuent toutefois à vivre en nous. Elles mènent une existence fantôme, et leur seule façon de s’exprimer est la maladie ou les dépendances. Cette dissociation a amoindri mon rapport avec mes sensations corporelles. Je me suis réfugié dans ma tête et j’ai toujours eu de la difficulté à être vraiment dans mon corps. Une telle division intérieure complique le rapport avec soi : on a peine à se reconnaître et à agir selon ses élans. Je crois que j’ai eu besoin de la turbulence provoquée par le cancer pour me guérir de cette dissociation.
Je trouve aussi que la colite témoignait particulièrement bien de cela, car cette maladie est réputée pour être auto-immune. Ce terme signifie que le système immunitaire se met à combattre des cellules saines de l’organisme comme s’il s’agissait de virus étrangers. La muqueuse de l’intestin se trouve donc éliminée par les cellules tueuses associées à l’immunité. Cela représente bien au niveau symbolique ce que je m’étais fait pendant toutes ces années : meurtrir une partie de moi-même qui était en bonne santé. D’ailleurs le Dr Alfred Ziegler, un psychiatre psychosomaticien de Zurich que j’ai consulté dès l’apparition de ma colite, ne s’y était pas trompé. Il me déclara derechef après cinquante minutes d’entretien : « Votre maladie est la partie la plus saine de votre personnalité ! »
On peut s’étonner qu’une histoire si ancienne ait encore autant d’importance dans ma vie. C’est un deuil que je ne suis pas arrivé à faire. La médecine chinoise dit que l’énergie vitale se situe dans les reins. Elle appelle l’énergie de cet organe le vouloir vivre. Quand cette énergie est bloquée, la volonté de vivre en souffre en premier lieu — tout comme si on nous cassait les reins. On se sent alors coupable de ne pas obéir à ce vouloir vivre. Une collègue qui travaille sur le cancer m’a ainsi dit s’étonner de constater que la formule du repentir chrétien, « Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa », s’accompagne d’un geste qui touche l’estomac. Pour elle, le cancer de cet organe est en effet lié à la culpabilité inconsciente. D’après elle, cette culpabilité est de trois ordres. Le premier type de culpabilité concerne celle que nous ressentons à l’égard des autres en raison des fautes que nous avons commises à leur endroit. Le deuxième type concerne celle que nous éprouvons lorsque nous ne nous sentons pas à la hauteur ou, au contraire, lorsque nous nous sentons au-dessus de tout le monde dans une sorte d’orgueil excessif. Le troisième est celui qui nous occupe ici. Il s’agit d’une culpabilité intrapsychique qui ne se rapporte pas aux autres. Elle est liée au fait d’avoir perdu le contact avec le sens de soi-même, avec son essence créatrice.
Dans les catacombes
Au cœur de ces souvenirs et de ces prises de conscience, je fais le rêve le plus marquant de toute cette traversée.
Je suis avec une femme qui reste énigmatique tout au long du rêve. Nous devons nous rendre dans les catacombes de Montréal pour aller assister à un exploit scientifique. En effet, des savants ont réussi à isoler un cœur qui bat depuis trente ans sans aucun support technique et sans être connecté à aucun organe vivant. Cela relève du miracle. Avec mon amie, nous nous présentons donc devant la porte du souterrain. Il s’agit d’une énorme porte en pierre blanchie à la chaux. Une minuscule serrure doit être activée pour que nous puissions entrer. Je fouille dans mes poches et, à ma grande surprise, j’y trouve la clé. Elle a une forme spéciale, petite et carrée. La porte s’ouvre et nous nous retrouvons dans une pièce qui n’a pas été visitée depuis trente ans. Je m’attends à y trouver un cœur dans un bocal, mais rien de la sorte. Il y a plutôt deux consoles installées de façon très sommaire sur des boîtes de carton. Elles servent à faire du montage de musiques ou de films, à l’ancienne, avec de grosses bobines. Pour sûr, cette installation date d’avant le numérique.
Par contre, la pièce où nous sommes est high-tech. Elle ressemble à une soucoupe volante qui serait complètement vitrée. Mon amie s’approche de l’une des fenêtres. Celle-ci donne sur un débarcadère de ciment qui s’enfonce dans le fleuve Saint-Laurent. Je m’approche et je vois le spectacle suivant : une femme est en train d’accoucher d’un enfant, étendue à même la dalle. Elle a de l’eau jusqu’aux hanches. Elle veut noyer son nouveau-né en l’abandonnant au fleuve. Nous nous précipitons dehors. Je pénètre dans l’eau pour y récolter un beau bébé tout rose pendant que mon amie aide la mère à se relever de son accouchement. Je lui apporte le bébé et le mets dans ses bras. Nous l’encourageons à garder son enfant et lui promettons de l’aider. En me penchant sur elle, je reconnais avec surprise l’actrice Céline Bonnier.
Ce rêve m’époustoufle. D’abord, il y a des catacombes à Rome et à Paris, mais il n’y en a pas à Montréal. Symboliquement, il semble parler de choses enfouies dans mon passé lointain, dans mes catacombes personnelles. Je suis même surpris de lire dans le dictionnaire que les catacombes se réfèrent à un vaste souterrain ayant servi de sépulture ou d’ossuaire. Le songe parle donc de choses mortes en moi, mais, dans mon cimetière intérieur, un organe aussi central que le cœur est resté vivant. L’exploit scientifique « du cœur battant depuis trente ans sans soutien technique ou organique » me ramène à quelque chose qui m’a fait battre le cœur trente ans plus tôt mais à quoi je n’ai pas donné suite : en 1977, voilà exactement trente ans !, j’ai fait mon entrée à l’Institut Carl Gustav Jung de Zurich, délaissant une carrière au théâtre ainsi que mon intérêt pour la musique et le cinéma.
Les consoles de montage appuyées sommairement sur des boîtes de carton me rappellent mes années d’étudiant en communication, au cours desquelles, peu fortuné, je me servais de tout ce qui me tombait sous la main pour en faire une tablette ou un article de rangement. Cette pièce de création est restée totalement intacte. La porte blanchie à la chaux me renvoie à l’illustration de la pierre qui fermait le tombeau du Christ dans Le petit catéchisme québécois, et que l’on a trouvée ouverte après sa résurrection. Elle évoque la renaissance. J’ai longtemps cherché où j’avais pu voir la petite clé carrée qui m’a servi à l’ouvrir dans le rêve. Je connaissais cette clé. Un jour, je la vois simplement attachée à la poignée de mon vieux boîtier de guitare. La clé des catacombes est donc directement reliée à l’expression artistique. Par contraste, le climat high-tech et « soucoupe volante » de la pièce me renvoie à la série Star Trek qui se déroule à bord du vaisseau Enterprise. Il y a du renouveau dans l’air…
L’action centrale du rêve, sa partie la plus émouvante, est sans conteste le sauvetage de cet enfant que sa mère veut abandonner à une noyade certaine. Le bébé est tout rose. Lui aussi parle de renouveau. Mais il est moins une. Il allait vers une mort certaine lorsque je l’ai récupéré. Et pour moi aussi, il est moins une. Il faut que je me récupère. Céline Bonnier est une actrice que j’admire pour son talent et sa créativité. Je me dis qu’elle représente mon anima théâtrale et que celle-ci veut maintenant donner la mort plutôt que donner la vie, sans doute en raison de la négligence dont elle a été l’objet. Le fait que nous nous engagions, mon amie et moi, à lui venir en aide, me semble de très bon augure.
Ce rêve représente un point tournant par rapport à ma survie. Il me semble que tout s’est décidé là. Il est moins une, mais l’enfant de la création est sauvé. Bien que fréquentant mes rêves depuis des décennies, j’en ai rarement vu un aussi clair et aussi direct. Presque trop clair. D’une lueur aveuglante. Tous mes soupçons sont confirmés. L’abandon de mon expression artistique s’est fait au détriment de ma santé. Je le sais depuis trente ans, mais je ne veux pas le savoir. Je me raconte des histoires. Je fais de la psychologie avec moi-même. Je rationalise au lieu de suivre le message de mes tripes.
En vérité, toutes ces découvertes ne cessent de m’étonner. Je constate avec humilité combien l’écriture d’une chanson, d’un poème ou d’une pièce de théâtre donne du sens à ma vie et me fait vibrer de plaisir. Certaines choses en nous ne se discutent pas. Elles doivent être accueillies et suivies parce qu’elles nous mènent à nous-mêmes, parce qu’elles nous amènent à la joie d’exister.
Je pense sincèrement qu’il en va de même pour chacun et chacune. Chacun de nous a des talents, des dons, des qualités qui lui sont inhérents. Pour certains, il s’agit d’enseigner, pour d’autres de faire de l’art, pour d’autres encore de construire des maisons, de fonder des sociétés, de soigner les autres ou de les accueillir chaleureusement. Les élans créateurs sont multiples et leur mise en œuvre nous rapproche du bonheur et de la santé. J’ai suffisamment payé avec des douleurs et des souffrances pour avoir le droit de vous dire qu’il n’est pas bon d’aller contre ses élans vitaux. Il ne s’agit pas de changer de profession, il s’agit de consacrer une partie de son temps, de son argent et de son énergie à ce qui favorise la vie en nous. Quant à moi, je me porte mieux lorsque le ménestrel m’accompagne au fil de mes jours. Ainsi, au cœur de l’épreuve, je me remets à la poésie et à la chanson. La pratique d’un art d’expression contribue réellement à la santé. Dans la Chine traditionnelle, une telle pratique faisait partie de toute éducation.
Ce que dit ma rate
La rate ! Au moment où je l’aborde, je ne sais même pas où elle se trouve dans l’organisme. Je l’apprends. Je ne sais pas non plus quel est son rôle. Elle a pour fonction de produire les globules rouges et blancs ainsi que les plaquettes du sang. Elle filtre aussi ce dernier en captant les germes et en éliminant les globules inutiles ou dégénérés. Elle joue donc un rôle central dans l’immunité, un élément qui va fort mal chez moi. Je ne sais rien sur cet organe, mais je connais une anecdote que m’a racontée une femme qui pratique le massage. Elle trouve que j’ai une grande rate et que cela est le fait des gens courageux ; en effet, les Chinois disent des guerriers redoutables que ce sont de « grandes rates ». Je me vois très bien dans la peau d’un guerrier très déterminé. À cela près que, pour le moment, je ne jouis pas de l’ivresse du combat, je suis plutôt ivre de fatigue. Je me vois debout sur le champ de Mars, revenant de bataille exténué, essuyant mon épée souillée de sang et de terre.
Selon Hamer et la biologie totale, la rate agit comme une espèce de gros ganglion un peu spécial. Dans un cas de conflit, la solution envisagée par le cerveau organique consiste à commander qu’elle se développe. Elle produit ainsi une énorme poche de sang dont le but est de fournir une réserve « prête à être utilisée en cas de manque, ce qui dans la nature se produit en cas de blessure accidentelle ou au combat4 ». Une atteinte à la rate symbolise justement une inaptitude à combattre dans la conjoncture d’une plaie saignante, or j’en ai une à l’estomac.
« Une atteinte à la rate indique en plus une problématique au niveau des devoirs et des responsabilités, car leur poids finit par engendrer une perte de joie de vivre. Comme la rate a pour fonction de produire les globules, cela correspond à se faire du “mauvais sang”. Est-ce que ça te parle, me demande Claude Vallières ?
– Il est vrai que l’accumulation des batailles à livrer a fait en sorte qu’au lieu de ressentir la propulsion liée à mes activités, j’ai fini par éprouver surtout de la fatigue. Au lieu d’être joyeux en faisant des choses que j’aimais, j’ai été submergé par la peur de ne pas y arriver et de ne pas être à la hauteur.
– Et tu as commencé à te dévaloriser au lieu d’apprécier ce que tu faisais. »
Comme je l’ai dit précédemment, les mois qui ont précédé mon cancer se succédaient sans se ressembler, mais à quel prix ! Un mois d’écriture, puis un mois de tournage à Montréal pour animer Guy Corneau en atelier5, mon émission de télévision, suivi d’un mois de tournées de conférences au Québec et à l’étranger — le stress était roi. Je passais d’une activité à l’autre sans trop de souci, mais avec la peur de flancher. Je restais concentré sans plage de décontraction. Je crois sincèrement que c’est cela qui m’a nui le plus : donner, mais sans veiller à me ressourcer. C’est comme si, en respirant, on ne faisait qu’expirer. À un point donné, il n’y a plus d’air. Forcément, on manque d’inspiration et on se rapproche de l’expiration réelle, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. J’ai tiré sur toutes les ficelles et, au bout du compte, je n’avais plus de réserves. Je tenais le cap d’une émission de télé qui employait seize personnes. Je pilotais mes tournées. Et mon écriture souffrait dans de telles conditions. Mon livre était affreusement en retard par rapport à la date limite et je paniquais. Je menais trois vies de front et il y en avait au moins une de trop. Heureusement, je n’étais pas seul. On me soutenait à tous les niveaux, tant du côté de mes producteurs à Point de mire, que de mes organisateurs de tournées et de mon assistante personnelle.
N’est-il pas étrange que l’accumulation de travaux qui vous passionnent et pour lesquels vous n’avez pas vraiment l’impression de travailler finisse tout de même par vous faire perdre l’élan qui vous a amené à les exécuter ? En quelques années, j’étais passé de la ferveur enthousiaste à la limite de l’épuisement. L’intérêt y était toujours, mais l’énergie faisait défaut. Et, bientôt, les tournées de conférences et de promotion de mon nouveau livre allaient débuter. À peine sorti de mes mains, le nouveau-né commencerait sa carrière publique. Je n’étais pas prêt et c’était pourtant mon livre le plus achevé, le plus maîtrisé, celui dont j’étais le plus fier. D’ailleurs, à ce jour, il continue à être une référence importante pour moi. Je le conseille souvent à des gens qui ne l’ont pas lu pour stimuler leur créativité et comprendre la place de celle-ci au sein de la psychologie et de la spiritualité.
De son côté, la médecine chinoise dit que les soucis vident la rate. Le travail intellectuel excessif, les préoccupations quotidiennes et toutes les pensées négatives finissent par nouer l’énergie et affaiblir le système digestif.
Sans aucun doute, l’une des réponses les plus appropriées que je pouvais donner à ma rate et à mon système immunitaire était d’arrêter le combat. C’est dans ce contexte que j’ai annulé ma tournée de conférences européenne et que je me suis mis en congé sabbatique. Il s’agit là d’un élément central dans ma trajectoire de guérison. Je pouvais arrêter de travailler pendant une année ou deux sans éprouver de difficultés financières. Ce n’est pas le cas de tout le monde. Par exemple, Yanna, qui était photographe, ne pouvait pas se permettre une telle chose. Elle continuait de faire fonctionner son studio malgré sa maladie. Cela ne lui permettait pas un ressourcement total. Il faut dire qu’elle avait encore deux enfants à charge. Pour ma part, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec pratiquement rien d’autre à faire que respirer ! C’était étrange et magnifique à la fois. J’étais comme Alice au Pays des merveilles. Je ne me rappelais même pas la dernière fois où j’avais pris de vraies vacances. Je jugeais que je n’en avais pas besoin puisque je n’avais pas l’impression de travailler.
Un tel arrêt de travail est si salutaire que je le prescrirais volontiers à tout un chacun, malade ou en bonne santé. La vie nous apparaît alors dans sa plénitude, généreuse de lumière, d’air et d’eau, d’amitié et de toutes sortes de choses que l’on a le temps de déguster. On se rend surtout compte que l’on peut exister sans avoir un devoir à remplir ou une bataille à mener. C’était tout nouveau et rafraîchissant pour moi. D’ailleurs, un jour, Radio-Canada a eu l’idée de me jumeler avec David Servan-Schreiber pour un entretien portant sur la maladie et les voies de guérison. Nous avançons dans l’entretien et David, à deux reprises, répond à mes commentaires en disant : « Oui, mais tu as arrêté de travailler ! » Il veut me faire réaliser combien cet espace de liberté sans souci et sans responsabilité a fait toute la différence.
Depuis, j’ai eu l’occasion de parler à plusieurs personnes qui ont dû cesser leur activité professionnelle en raison d’une épreuve de santé. Toutes sont unanimes pour dire que ce fut salutaire. La semaine dernière encore, un médecin, qu’une épaule fracassée a obligé à un arrêt de trois mois, me racontait comment cela lui a permis de redécouvrir la vie, la nature, les amitiés et l’amour de sa femme. Surtout, on a le temps de s’accueillir, de se comprendre, de renouer avec soi-même. Ce bien s’avère des plus précieux, car, je prends la peine de le redire, il est l’élément essentiel de la guérison intérieure.
Les deux ou trois semaines de vacances statutaires en Amérique du Nord n’offrent pas vraiment l’opportunité de reprendre le fil de l’intimité avec soi. Par contre, dès qu’un arrêt dure un peu, on a l’occasion de se détendre et d’oublier en partie le temps qui passe. La vie nous apparaît alors bien différemment. On se rend compte que l’on n’est pas sur Terre pour travailler. La dégustation d’instant en instant du cours de l’existence nous permet d’échapper au fil des jours. On se rattache au grand courant de fond de l’existence et la pure joie d’exister sans mission et sans mandat vient nous prendre pour nous apaiser et nous guérir.
Il faut sans doute avoir une certaine dose de sécurité pour s’abandonner ainsi à l’intemporel. À certaines personnes, cela semble même intolérable. Elles doivent continuer à travailler, car le sens de leur propre valeur leur vient essentiellement de leur activité professionnelle. Elles y trouvent la confirmation qu’elles existent. Et puis, il faut pouvoir se le permettre financièrement. Je dirai tout de même que toutes les fois où cela semble possible, il faut tenter de cesser toute activité pour se consacrer à des retrouvailles avec la vie. Cet arrêt des activités pour renouer avec ce qui est vivant en soi et autour de soi peut d’ailleurs se faire à l’occasion d’une période de méditation quotidienne. J’en parlerai plus loin. Car c’est la vie et sa beauté qui nous interpellent à travers la maladie, ce n’est pas la mort. Et c’est le goût de vivre qui influence notre guérison.
Ce que disent mes poumons
Au niveau des poumons, à ce jour, on note encore une cinquantaine de lésions microscopiques que l’on croyait et que l’on croit toujours de nature métastatique, c’est-à-dire liée au cancer, car leur nature réelle n’a pas pu être élucidée. Elles ont été présentes tout au long de la traversée, ont peu répondu à la chimiothérapie, n’ont pas disparu, n’ont pas proliféré, ont manifesté un peu d’inflammation à quelques reprises et le font encore. Bref, elles demeurent une énigme médicale. À plusieurs reprises, au cours des trois dernières années, j’ai entendu mon oncologue dire :
« Je donnerais cher pour avoir une radiographie de ces poumons-là avant le cancer !
– Moi aussi, car je voudrais bien que les examens de contrôle cessent. »
Au tout début des traitements, la biopsie n’a rien révélé, car le médecin a raté ces cibles microscopiques, créant un pneumothorax au passage. Cette introduction d’air dans la plèvre du poumon est des plus douloureuses et prend du temps à guérir. J’avais l’impression que l’on avait coulé du béton dans l’un de mes organes de respiration. Si bien qu’en accord avec mon médecin traitant, nous avons décidé que nous irions à nouveau prélever du tissu de la muqueuse pulmonaire, sous forme de chirurgie cette fois, uniquement s’il y avait inflammation majeure.
À l’été 2009, soit deux ans après le diagnostic, j’ai pu faire analyser tous les scanners pris depuis le début par les Drs Pascal Lacombe et Sophie Chagnon du service de radiologie de l’Hôpital Ambroise-Paré à Paris. Ils m’ont reçu avec une extrême gentillesse et ont conclu sous toute réserve à un lymphome de bas grade, mal organisé, donc un cancer. Il est cependant permis d’en douter raisonnablement. Il se peut qu’il s’agisse de cicatrices d’une maladie antérieure qui serait passée inaperçue. Pour ma part, je penche de plus en plus pour cette version des choses puisque mes poumons vont bien. Cependant, la présence de ces intrigantes lésions empêche le Dr Yelle d’écrire « rémission complète » dans mon dossier et me ramène tous les deux mois sous l’œil des scanners, sans parler des procédures médicales qui y sont reliées.
Cette incertitude a peut-être à voir avec le fait que je ne me reconnais pas dans les suggestions de Claude Vallières en ce qui concerne les poumons.
« Ceux-ci sont le siège du premier et du dernier souffle, ils ont à voir avec la peur de vivre et de mourir. Il se produit souvent une sorte de prolifération de lésions sous le coup du diagnostic, car il fait monter une angoisse de mort d’un seul coup, me dit-il.
– Je ne dirais pas que cette bouffée d’angoisse m’a été évitée. Toutefois, la peur de mourir n’est pas ce qui m’effraie le plus dans l’existence. Vieillir me fait beaucoup plus peur ! »
Je suis déjà passé près de la mort. Je me suis rendu si près du seuil du départ que j’en suis revenu avec l’assurance d’une vie au-delà de la vie. Je suis entré dans de tels états d’union sans pour autant perdre la sensation de ma propre individualité que j’en ai conclu que l’âme et l’esprit survivent au-delà de la perte du corps physique. Ce n’est qu’un avis basé sur une expérience personnelle. Toutefois, l’impression qu’elle a laissée en moi demeure assez forte pour me sécuriser encore vingt ans plus tard. Je ne suis pas en train de dire que la pensée de l’issue fatale ne me fait pas frémir, mais à la limite je dirais que j’ai plus peur de vivre que de mourir. Remarquez que pour vivre véritablement, il faut accepter de mourir au connu à chaque instant. C’est sans équivoque ce que le cancer m’a appris à faire. Il est indéniable que je m’engage dans les différentes sphères de mon existence plus complètement qu’auparavant.
Pour tenter d’expliquer ce qui oppresse mes poumons, car cancéreuses ou non, il y a des lésions, je porte alors mon regard du côté de la médecine chinoise. Celle-ci relie les poumons à la tristesse. Chagrin, mélancolie et regret épuisent les poumons en dissipant l’énergie. Ces émotions font partie de la vie et ne causent pas de problème si elles sont acceptées et reconnues. Mais si, à l’inverse, le chagrin est retenu et que la situation qui le cause se prolonge, l’énergie sera perdue, menant fort souvent à des pneumonies, des bronchites ou des maladies respiratoires telles que l’asthme. Il est vrai que je suis sujet aux bronchites et que la tristesse habite mon souffle depuis ma plus tendre enfance. Plus jeune, je devenais facilement mélancolique. Comme me l’ont fait remarquer mes amis, même en entonnant des chansons exprimant une joie profonde, je garde souvent un air nostalgique. Le poète Aragon, mis en chanson par Jean Ferrat, ne dit-il pas : « Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes/N’est-ce pas un sanglot que la déconvenue ? » Chez moi, cette désillusion a plusieurs causes. L’aspect difficile de ma propre existence et de l’existence humaine en général me touche depuis toujours. Derrière l’effervescence que l’on reconnaît en moi, il y a aussi celui qui est las d’exister.
Assez tôt, il me semble que j’ai perdu contact avec l’enfant rieur. Même si j’avais travaillé toute ma vie au théâtre, j’aurais parlé de cela. La recherche passionnée du sens de la souffrance humaine est une quête fort importante pour moi. La maladie a permis à deux reprises déjà que je lève une partie du voile. À chaque fois, mes conceptions de l’existence se sont élargies. Il n’en reste pas moins que je conçois comme un devoir quotidien la prise de contact avec l’enfant joyeux que je porte et qui demande à naître et renaître encore et encore. Une troisième vie m’est donnée, pour ainsi dire, et j’entends bien que son souffle soit plus léger et réjoui que tout ce qui a précédé.
Quelques suggestions
Quatre séances bien nourries avec Claude Sabbah et Claude Vallières m’ont suffi pour me lancer et faire un grand bout de chemin par moi-même. Toutefois, je suis un patient très averti, pour ainsi dire. Si je devais vous conseiller par rapport à une démarche psychothérapeutique, je vous dirais de trouver un thérapeute en qui vous avez confiance et qui s’intéresse à la psychosomatique, c’est-à-dire aux liens entre les blocages émotifs et leur manifestation dans le corps. Qu’il connaisse ou non le décodage biologique ne me semble pas être le point central. Vous ouvrir aux messages des différentes parties de votre corps et vous mettre en mouvement sur le plan des révélations psychologiques l’est. Bien que l’angoisse puisse vous couper de vous-même et vous jeter à la merci de thérapeutes et de guides de toutes sortes, tentez de résister aux promesses spectaculaires et de garder un point de vue critique. Au contraire, acceptez ce qui résonne en vous et ce qui a du sens pour vous. Ne vous souciez pas du reste. Ce n’est pas que ce n’est pas juste, c’est que ce n’est pas juste maintenant pour vous. Les lectures peuvent aussi vous servir adéquatement. Je cite quelques livres en cours de route qui sont susceptibles de vous aider. Il y a aussi une bibliographie thématique à la fin.
Rappelez-vous qu’il n’y a pas de sauveur ni de formule magique. La guérison émergera de votre propre compréhension des choses, stimulée bien entendu par tout l’environnement aidant que vous aurez su mettre en place. Vous sentirez cette compréhension. Elle ne se limitera pas à une simple pensée mentale. Je veux dire qu’elle changera votre sensation de vous-même et qu’elle sera accompagnée d’émotions. Voilà le genre de déclic que vous souhaitez. Plus la révélation sera profonde et transformatrice, plus elle apportera libération et légèreté. Gardez en tête également que la personne ou la technique qui a si bien fonctionné pour un ou une amie ne fonctionnera pas nécessairement de la même façon pour vous. Si votre thérapeute s’affiche comme étant très dogmatique, vous déconseillant ou vous interdisant la chimiothérapie ou l’accès à d’autres formes de médecine, n’hésitez pas à changer. Ces décisions vous appartiennent. Il peut vous conseiller. Il ne peut en aucun cas décider à votre place. Son rôle est de vous accompagner dans votre démarche et de permettre l’intégration des révélations psychologiques à un rythme qui vous convient. Autrement dit, demeurez le maître ou la maîtresse du jeu. Après tout, c’est de votre vie qu’il s’agit et c’est vous qui payez.
N’oubliez surtout pas de parler avec votre esprit, de converser avec vos organes, de leur demander de vous renseigner sur votre être véritable. Demeurez à l’écoute des intuitions et des rêves qui ne manqueront pas de venir, souvent dans des moments inattendus. L’enjeu principal demeure l’établissement d’un dialogue fécond avec celui ou celle que vous êtes, avec vos goûts et vos talents, peu importe ce que vous avez ou non déjà accompli dans votre vie. Ce que vous croyez être sera nécessairement remis en question. Il ne peut en être autrement. Sinon, vous n’auriez pas le cancer, vous auriez un rhume… Acceptez de vous détacher le plus rapidement possible de ce que vous prétendez être. Tout cela vous nuit sur votre trajectoire de renaissance.
_______________
1. Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Que sont les hommes devenus ?, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 1989, 2003/Paris, J’ai Lu, 2009.
2. Pierre Légaré s’en est ouvert à l’émission du Dr Georges Lévesque, Une pilule, une petite granule, diffusée sur les ondes de Télé-Québec, le 26 février 2009.
3. Psychiatre et psychanalyste, attaché à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal et professeur à l’Université de Montréal, Jean-Charles Crombez est l’inventeur de la méthode ECHO, une méthode d’intervention multidisciplinaire pour les personnes en choc de vie. Voir Jean-Charles Crombez, La personne en ECHO. Cheminer dans la guérison, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 2006.
4. Claude Sabbah (éd.) et Isabelle de Laminne, Le décodage biologique, tome III, Villeneuve-lès-Maguelone (France), 2002, p. 530. Le livre n’est pas offert dans le commerce. Voir aussi le site : www.biologie-totale.org
5. Le meilleur de soi. Guy Corneau en atelier. Treize documentaires d’une heure réalisés par les Productions Point de mire à partir d’ateliers animés par Guy Corneau et diffusés sur la chaîne Canal Vie, Montréal, Point de mire, Canal Vie et Les Éditions de l’Homme, 2008. Ce coffret de trois DVD comprend la dernière saison de l’émission. Pour le moment, il est offert au Québec uniquement.