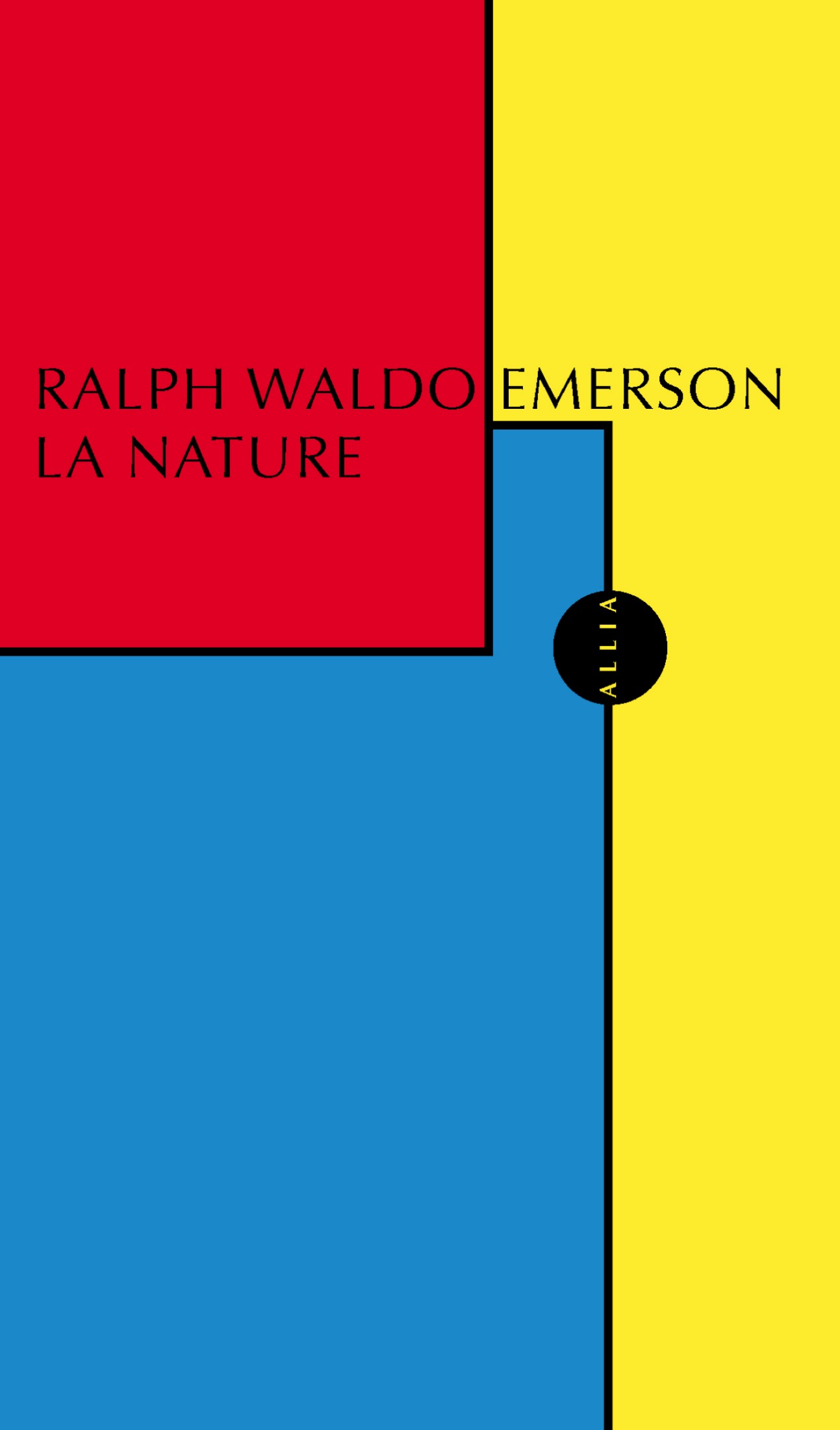
Titre
RALPH WALDO EMERSON
La Nature
Traduit de l'américain par
PATRICE OLIETE LOSCOS

Introduction
INTRODUCTION
Une chaîne subtile de maillons innombrables
Mène du proche au plus lointain ;
Où qu'il se pose, l'œil aperçoit des présages,
Et la rose parle tous les langages
– Et luttant âprement pour être un homme, le ver
S'élève le long des spirales de la forme.
NOTRE époque regarde vers le passé. Elle bâtit le tombeau des ancêtres. Elle fait de l'histoire, de la critique, elle écrit des biographies. Les générations passées regardaient Dieu et la nature face à face ; nous, à travers leurs yeux. Pourquoi ne pourrions-nous pas nous aussi entretenir une relation originale avec l'univers ? Pourquoi n'aurions-nous pas une poésie et une philosophie puisées en nous-mêmes et non dans la tradition, une religion reposant sur une révélation qui nous soit propre et non sur l'histoire de la leur. Accueillis pour une courte saison au sein de la nature, dont les flots de vie coulent autour et à travers nous et nous invitent, par les pouvoirs qu'ils donnent, à agir conformément à celle-ci, pourquoi devrions-nous tâtonner parmi les ossements blanchis du passé ou attifer les générations vivantes de ses oripeaux fanés ? Le soleil est aussi brillant aujourd'hui qu'hier. Il y a davantage de laine et de lin dans les champs. Il existe de nouvelles terres, de nouveaux hommes, de nouvelles pensées. Exigeons nos propres œuvres, des lois et un culte qui soient les nôtres.
Il est hors de doute que nous n'avons pas de questions à poser qui n'aient pas de réponse. Nous devons avoir foi dans la perfection de la création au point de croire que, quelle que soit la curiosité que l'ordre des choses a éveillée dans notre esprit, l'ordre des choses peut la satisfaire. La condition de chaque homme est la solution sous forme de hiéroglyphes de toute recherche qu'il voudrait mener. Il la vit comme vie avant de la concevoir comme vérité. De même, la nature contient déjà dans ses formes et ses tendances la description de son propre dessein. Interrogeons la grande apparition qui resplendit si calmement autour de nous. Demandons-nous à quelle fin la nature existe. Toute science possède un but, à savoir l'élaboration d'une théorie de la nature. Nous avons des théories sur les races et les fonctions, mais c'est à peine si nous nous faisons une très lointaine idée de la création. Nous sommes à présent si éloignés du chemin de la vérité que les professeurs de religion se disputent et se haïssent les uns les autres, et que les hommes de pensée sont jugés insanes et frivoles. Mais pour un jugement sain, la vérité la plus abstraite est en même temps la plus pratique. Toutes les fois qu'une théorie véridique apparaît, elle est à elle-même sa propre preuve. Le critère de sa validité est qu'elle est à même d'expliquer tous les phénomènes. Aujourd'hui, il en est de nombreux qui sont jugés non seulement inexpliqués mais encore inexplicables, comme le langage, le sommeil, la folie, les rêves, les bêtes, le sexe.
Considéré d'un point de vue philosophique, l'univers est composé de Nature et d'Âme. Par conséquent, tout ce qui, à strictement parler, est séparé de nous, tout ce que la philosophie distingue comme étant le NON-MOI, c'est-à-dire à la fois la nature et l'art, les autres hommes et mon propre corps, doit être rangé sous le nom de NATURE. En énumérant les valeurs de la nature et en en faisant la somme, j'utiliserai le mot dans les deux sens, dans son acception tant commune que philosophique. Dans une recherche aussi générale que celle qui nous occupe ici, le manque d'exactitude n'est pas essentiel et ne doit entraîner aucune confusion de pensée. La nature, dans son sens courant, fait référence à des essences non changées par l'homme : l'espace, l'air, la rivière, la feuille. L'art s'applique au mélange de la volonté humaine avec les mêmes objets, comme dans une maison, un canal, une statue, un tableau. Mais ces opérations prises ensemble sont si insignifiantes – un peu couper, un peu cuire, un peu rapiécer, un peu laver –, qu'au regard d'une impression aussi vaste que celle que le monde produit sur notre esprit, elles ne changent rien au résultat.

I. Nature
I. NATURE
POUR se retirer dans la solitude, on a autant besoin de quitter sa chambre que la société. Je ne suis pas seul tandis que je lis ou écris, bien que personne ne soit avec moi. Mais si un homme veut être seul, qu'il regarde les étoiles. Les rayons qui tombent de ces mondes célestes le sépareront de ce qui l'environne. Il est permis de penser que l'atmosphère a été créée transparente dans le seul but de donner à l'homme, par l'intermédiaire des corps célestes, le sentiment de la présence constante du sublime. Vues à travers les rues des villes, comme les étoiles paraissent grandioses ! Si elles ne devaient apparaître qu'une seule nuit tous les mille ans, combien les hommes croiraient et adoreraient et conserveraient le souvenir de la cité de Dieu qui leur aurait été montrée. Mais c'est chaque nuit que se montrent ces ambassadrices de la beauté et qu'elles illuminent l'univers de leur souriante exhortation.
Les étoiles éveillent une certaine vénération, car bien que toujours présentes, elles demeurent inaccessibles. Mais tous les objets naturels suscitent une impression analogue lorsque l'esprit est ouvert à leur influence. La nature ne revêt jamais une forme mesquine. Et l'homme le plus sage ne lui ravit pas son secret, pas plus qu'il n'épuise sa curiosité en en découvrant toute la perfection. Jamais la nature ne fut un jouet aux yeux du sage. Les fleurs, les animaux, les montagnes reflètent la sagesse de ses heures les meilleures, de même qu'ils ont enchanté la simplicité de son enfance.
Lorsque nous parlons de la nature de cette manière, nous avons à l'esprit un sentiment particulier, quoique des plus poétiques. Nous voulons parler de l'unité d'impression provoquée par la diversité des objets naturels. C'est cela qui distingue le morceau de bois du bûcheron de l'arbre du poète. Le paysage charmant que je contemple ce matin est indubitablement composé de vingt ou trente fermes. Miller possède ce champ, Locke celui-là, et Manning le bois situé au-delà. Mais aucun d'eux ne possède le paysage. Il est une propriété à l'horizon que personne ne possède, sauf celui dont l'œil est capable d'intégrer toutes les parties, c'est-à-dire le poète. C'est la meilleure part de la ferme de ces hommes, quoique leur titre de propriété n'y donne aucun droit.
À vrai dire, peu d'adultes sont capables de voir la nature. La plupart des gens ne voient pas le soleil. Du moins en ont-ils une vision très superficielle. Le soleil ne fait qu'éclairer l'œil de l'homme, alors qu'il brille à la fois dans l'œil et dans le cœur de l'enfant. L'amoureux de la nature est celui dont les sens internes et externes sont encore réellement ajustés les uns aux autres et qui a gardé l'esprit d'enfance jusque dans l'âge adulte. Son commerce avec le ciel et la terre devient une part de sa nourriture quotidienne. En présence de la nature, une joie sauvage parcourt cet homme, en dépit des chagrins réels. La nature dit : “Il est ma créature, et malgré l'insolence de son affliction il sera heureux avec moi.” Ce n'est pas le soleil ou l'été seulement, mais chaque heure, chaque saison qui apporte son lot de plaisir ; car chaque heure et chaque changement correspondent, en même temps qu'ils le permettent, à un état d'esprit différent, de midi où ne circule pas le moindre souffle d'air jusqu'au minuit le plus noir. La nature est un décor qui convient aussi bien pour jouer une pièce triste que comique. Lorsqu'on est en bonne santé, l'air est un cordial d'une incroyable efficacité. Traversant au crépuscule, sous un ciel nuageux, un terrain dénudé parsemé de plaques de neige boueuse sans avoir présente à l'esprit l'idée d'une bonne fortune particulière, j'ai joui d'un sentiment d'allégresse parfaite. J'éprouvai une joie qui touchait à l'angoisse. Dans les bois aussi, un homme se débarrasse de ses années comme le serpent de son ancienne peau – et à quelque période de la vie qu'il soit, il est toujours un enfant. Dans les bois se trouve la jeunesse éternelle. Parmi ces plantations de Dieu règnent la grandeur et le sacré, une fête éternelle est apprêtée, et l'invité ne voit pas comment il pourrait s'en lasser en un millier d'années. Dans les bois, nous revenons à la raison et à la foi. Là, je sens que rien ne peut m'arriver dans la vie, ni disgrâce, ni calamité (mes yeux m'étant laissés) que la nature ne puisse réparer. Debout sur le sol nu, la tête baignée par l'air joyeux et soulevée dans l'espace infini, tous nos petits égoïsmes s'évanouissent. Je deviens une pupille transparente ; je ne suis rien, je vois tout ; les courants de l'Être universel circulent à travers moi ; je suis une partie ou une parcelle de Dieu. Le nom de l'ami le plus cher sonne alors comme étranger et fortuit : être frère ou ami, maître ou serviteur apparaît comme un embarras et un détail sans valeur. Je suis l'amant de la beauté immortelle et sans entraves. Dans la nature sauvage, je trouve quelque chose de plus cher et de plus primordial que dans les rues ou les villages. À travers la tranquillité du paysage, et spécialement sur la ligne lointaine de l'horizon, l'homme contemple quelque chose d'aussi magnifique que sa propre nature.
Le plus grand plaisir que procurent les champs et les bois est la secrète relation qu'ils suggèrent entre l'homme et les végétaux. Je ne suis pas seul et inconnu. Ils me font signe, et moi de même. Le balancement des branches dans la tempête est nouveau pour moi et ancien. Cela me prend par surprise et pourtant ne m'est pas inconnu. Ses effets sont semblables au sentiment qui me submerge d'une pensée plus haute ou d'un sentiment meilleur lorsque j'estime que j'ai bien agi ou pensé avec justesse.
Cependant, il est certain que la faculté de produire ce plaisir ne réside pas dans la nature mais dans l'homme, ou dans une harmonie des deux. Il est nécessaire de pratiquer ces plaisirs avec une grande modération. Car la nature n'est pas toujours revêtue de ses habits de fête, et la même scène qui hier encore embaumait les parfums et scintillait comme pour le bal des nymphes, se recouvre aujourd'hui de mélancolie. La nature arbore toujours les couleurs de l'esprit. Pour l'homme qui se traîne sous le poids du malheur, la chaleur de son propre feu recèle une tristesse en elle. D'ailleurs, il existe une sorte de mépris pour le paysage chez celui qui vient de perdre un être cher. Le ciel perd de sa grandeur lorsqu'il se referme sur une communauté de semblables qui a perdu de sa valeur.

II. Commodité
II. COMMODITÉ
QUICONQUE considère la cause finale du monde discernera une multitude d'usages qui participent à ce résultat. Ils admettent tous d'être rangés dans l'une des classes suivantes : la commodité, la beauté, le langage et la discipline. Sous l'appellation générale de commodité, je range tous ces avantages que nos sens doivent à la nature. Il s'agit bien sûr d'un bénéfice temporaire et secondaire, non fondamental, comme le service rendu à l'âme. Cependant, bien qu'inférieur, il est parfait en son genre et représente le seul usage de la nature que tous les hommes comprennent. La misère de l'homme ressemble au mauvais caractère d'un enfant quand on examine avec quelle constance et quelle prodigalité il a été pourvu à ses besoins et à son plaisir sur cette boule verte qui le porte en flottant à travers les cieux. Quels anges inventèrent ces splendides ornements, ces riches commodités, cet océan d'air au-dessus, cet océan d'eau au-dessous, ce firmament de terre au milieu ? Ce zodiaque de lumières, ce dais de nuages retombants, ce manteau rayé de climats, cette année à quadruple pli ? Les bêtes, le feu, l'eau, les pierres et la graine le servent. Le champ est tout à la fois son sol, son lieu de travail, son terrain de jeu, son jardin et son lit.
L'homme a plus de serviteurs
Qu'il n'y prend garde.
La nature, dans son ministère auprès de l'homme, est non seulement la matière, mais aussi le processus et le résultat. Toutes les parties travaillent incessamment main dans
la main pour son plus grand profit. Le vent sème la graine ; le soleil évapore la mer ; le vent souffle la vapeur sur le champ ; la glace, de l'autre côté de la terre, condense la pluie sur celui-ci ; la pluie nourrit la plante ; la plante nourrit l'animal ; et ainsi la circulation sans fin de la charité divine nourrit l'homme.
Les arts utiles sont la reproduction ou la combinaison par l'esprit ingénieux de l'homme des mêmes bienfaiteurs naturels. Il n'attend plus après les brises favorables, mais par le moyen de la vapeur il réalise la fable de l'outre d'Éole et transporte les trente-deux vents dans la chaudière de son bateau. Pour diminuer le frottement, il pave la route de barres d'acier, et remplissant une voiture d'une pleine cargaison d'hommes, d'animaux et de marchandises, il s'élance à travers la campagne, de ville en ville, tel un aigle ou une hirondelle fendant les airs. Par l'accumulation de ces aides, combien la face de la terre a changé entre l'époque de Noé et celle de Napoléon ! Le simple citoyen a des cités, des bateaux, des canaux, des ponts construits pour lui. Il se rend à la poste, et c'est l'humanité qui fait ses commissions ; à la librairie, et pour lui l'humanité lit et écrit au sujet de tout ce qui se passe ; au tribunal, et les nations réparent les torts qu'il a subis. Il pose sa maison au bord de la route, et l'humanité passe devant chaque matin et balaie la neige et lui fraye un chemin.
Mais il est inutile de préciser les cas particuliers dans cette classe d'usages. Le catalogue en est sans fin et les exemples si évidents que je les abandonne à la réflexion du lecteur, avec cette remarque générale que ce bénéfice mercenaire est un de ceux qui se rapportent à un bien plus lointain. Un homme est nourri non pas afin d'être nourri, mais afin qu'il puisse travailler

III. Beauté
III. BEAUTÉ
IL est un besoin plus noble que satisfait la nature, à savoir l'amour de la beauté.
Les anciens appelaient le monde “cosmos” : beauté. La constitution de toutes choses est telle, ou tel le pouvoir plastique de l'œil humain, que les formes primaires, le ciel, la montagne, l'arbre, l'animal, nous procurent du plaisir en et pour elles-mêmes ; un plaisir naissant de la ligne, de la couleur, du mouvement et de l'ordre. Ceci semble dû en partie à l'œil lui-même. L'œil est le plus grand des artistes. Par l'action conjuguée de sa structure et des lois de la lumière se produit la perspective, qui intègre chaque masse d'objets, de quelque caractère que ce soit, en une sphère colorée et nuancée, si bien que là où les objets particuliers sont pauvres et indifférents, le paysage qu'ils composent est rond et symétrique. Et de même que l'œil est le meilleur des agenceurs, la lumière est le premier des peintres. Il n'existe pas d'objet si répugnant qu'une lumière intense ne puisse rendre beau. L'excitation qu'elle provoque sur le sens de la vue et une sorte d'infinité qui est en elle, comme l'espace et le temps, rend gaie toute matière. Même un cadavre possède sa propre beauté. Mais à côté de cette grâce générale répandue sur toute la nature, presque toutes les formes individuelles sont agréables à l'œil, comme le montrent nos imitations de quelques-unes d'entre elles : le gland, la vigne, la pomme de pin, l'épi de blé, l'œuf, les ailes et la forme de nombre d'oiseaux, la griffe du lion, le serpent, le papillon, les coquillages, la flamme, les nuages, les bourgeons, les feuilles et les formes de beaucoup d'arbres, tel que le palmier par exemple.
Pour un examen plus attentif, nous pouvons diviser les aspects de la nature en trois points.
1. Tout d'abord, la simple perception des formes naturelles est un plaisir. L'influence des formes et des actions de la nature est si essentielle pour l'homme que dans ses fonctions les plus basses elle semble se tenir sur les confins de la commodité et de la beauté. Pour l'esprit et le corps qu'un travail nuisible ou une compagnie pernicieuse ont racornis, la nature est bienfaisante et restaure leur santé. Le commerçant ou l'avocat s'arrache au vacarme et au manège de la rue pour contempler le ciel et les bois, et il se sent de nouveau un homme. Dans leur calme éternel, il se retrouve lui-même. La bonne santé de l'œil semble réclamer l'horizon. Nous ne sommes jamais las, tant que nous pouvons voir assez loin.
Mais à d'autres heures, la nature nous comble par son charme adorable et sans aucun mélange de bénéfice physique. Je contemple le spectacle du matin depuis le sommet de la colline qui jouxte ma maison, de la pointe du jour jusqu'au lever du soleil, empli d'une émotion qu'un ange pourrait partager. De longues barres minces de nuages flottent comme des poissons dans un océan de lumière cramoisie. Depuis la terre, comme d'un rivage, je plonge mes regards dans cette mer silencieuse. Il me semble participer à ses transformations rapides ; l'envoûtant sortilège atteint ma poussière et je me dilate et m'unis au vent du matin. Comme la nature sait nous rendre pareils aux dieux avec quelques éléments communs ! Donnez-moi la santé et le jour et je rendrai la pompe des empereurs ridicule. L'aube est mon Assyrie ; le coucher du soleil et le lever de la lune ma Paphos et les royaumes inouïs de la féerie ; le vaste midi sera mon Angleterre des sens et de l'entendement, et la nuit mon Allemagne de la philosophie mystique et des rêves.
Non moins remarquable, mise à part notre moindre sensibilité l'après-midi, était le charme hier soir d'un coucher de soleil de janvier. Les nuages de l'ouest se divisaient et se subdivisaient en flocons roses qui se nuançaient de teintes d'une indicible délicatesse, et l'air était animé d'une telle vie et d'une telle douceur que rentrer à l'intérieur des murs était une souffrance. Qu'était-ce au juste que la nature voulait dire ? N'y avait-il aucun sens dans le vivant repos de la vallée derrière le moulin, que ni Homère ni Shakespeare ne pourraient recréer avec des mots pour moi ? Au crépuscule, les arbres dépourvus de feuilles deviennent des lances de flammes sur le fond bleu de l'orient, et le calice en étoile des fleurs mortes, et chaque tige, chaque chaume fané poudré de givre apportent quelque chose à cette musique muette.
Les habitants des villes s'imaginent que le paysage de la campagne est agréable seulement une moitié de l'année. Je me plais aux grâces du spectacle de l'hiver et je crois que nous sommes tout autant touchés par elles que par les influences vivifiantes de l'été. Pour un œil attentif, chaque moment de l'année a sa beauté propre et montre dans le même champ une image qui n'a jamais été vue auparavant et qui ne le sera plus jamais après. Les cieux changent à chaque instant et reflètent leur gloire ou leurs ténèbres sur la plaine au-dessous. Le degré de maturité des récoltes dans les fermes alentour modifie le visage de la terre de semaine en semaine. La succession des plantes indigènes dans les prés et au bord des routes, qui est comme l'horloge silencieuse par laquelle le temps épelle les heures de l'été, rend sensibles jusqu'aux divisions du jour pour un observateur averti. Les tribus d'oiseaux et d'insectes, aussi ponctuels dans leur venue au monde que les plantes, se succèdent les unes les autres et l'année offre un espace à chacune. Le long des cours d'eau, la variété est encore plus grande. En juillet, la pondétérie bleue, ou herbe à brochet, fleurit de ses vastes tapis les parties peu profondes de notre aimable rivière, toute frémissante de papillons jaunes en perpétuel mouvement. L'art ne peut rivaliser avec cette débauche de pourpre et d'or. En réalité, la rivière est une fête continuelle qui se pare tous les mois d'un nouveau décor.
Mais cette beauté de la nature, vue et ressentie comme telle, en est la partie la moins importante. Les prestiges du jour, la rosée du matin, l'arc-en-ciel, les montagnes, les vergers en fleurs, les étoiles, le clair de lune, les reflets sur une eau calme et toutes choses semblables, si elles sont trop ardemment pourchassées, deviennent de simples spectacles et se jouent de nous par leur irréalité. Quittez votre maison pour aller voir la lune et ce n'est que clinquant ; elle n'aura pas l'agrément qu'elle offre lorsque sa lumière brille sur un voyage commandé par la nécessité. La beauté qui luit doucement par les jaunes après-midi d'octobre, qui pourra jamais la saisir ? Avancez-vous pour l'attraper et elle s'est envolée, ce n'est qu'un mirage aperçu par la fenêtre de la diligence.
2. La présence d'un élément plus spirituel est, à proprement parler, essentielle à la perfection de la beauté. La haute et divine beauté qui peut être aimée sans mollesse excessive est celle qui se trouve combinée avec la volonté humaine. La beauté est la marque que Dieu appose sur la vertu. Toute action naturelle est pleine de grâce. Tout acte héroïque est également approprié et fait resplendir le lieu et la compagnie. Les grandes actions nous apprennent que l'univers est la propriété de chacun des individus qui le composent. Tout être rationnel reçoit la nature entière en dot pour son établissement. Elle est sienne, s'il le souhaite. Il peut y renoncer, il peut se traîner dans son coin et abdiquer son royaume, ainsi que le font la plupart des hommes, mais il possède un droit sur le monde par sa constitution. À proportion de la force de sa pensée et de sa volonté, il porte en lui-même le monde entier. Pour Salluste, “tout ce pour quoi l'homme laboure, bâtit, navigue est commandé par la vertu”. “Les vents et les vagues se tiennent toujours du côté des marins les plus habiles”, déclare Gibbon. Ainsi en va-t-il également du soleil, de la lune et de toutes les étoiles du ciel. Lorsqu'une noble action est accomplie – avec de la chance sur un théâtre d'une grande beauté naturelle –, quand Léonidas et ses trois cents hoplites mettent une journée entière à mourir, le soleil et la lune les éclairant successivement au fond de l'abrupt défilé des Thermopyles ; quand Arnold Winkelried, sur les hauteurs des Alpes et sous la menace de l'avalanche, dirige sur lui le faisceau des lances autrichiennes pour forcer les lignes et secourir ses camarades – ces héros ne sont-ils pas en droit d'ajouter la beauté du cadre à la beauté de l'acte ? Et quand le bateau de Christophe Colomb approche des rivages de l'Amérique – avec devant lui la plage couverte de sauvages sortant en courant de leurs huttes de roseaux, la mer derrière et les montagnes pourpres de l'archipel des Caraïbes tout autour –, pouvons-nous séparer l'homme de son milieu vivant ? Le Nouveau Monde n'enveloppe-t-il pas sa silhouette de ses bouquets de palmiers et de ses savanes comme d'un vêtement taillé sur mesure ? Ainsi toujours la beauté s'insinue-t-elle comme l'air pour entourer les grandes actions. Lorsque Sir Harry Vane fut hissé au sommet de Tower Hill assis sur un bard pour subir la peine de mort en tant que champion des lois anglaises, quelqu'un lui cria du milieu de la foule : “Tu n'as jamais été assis sur un siège plus glorieux !” Charles ii, dans le but d'intimider le peuple de Londres, fit traîner le patriote Lord Russell, en route pour l'échafaud, dans une voiture découverte à travers les principales rues de la ville. “Mais, nous dit son biographe, la foule s'imaginait voir la liberté et la vertu assises à ses côtés.” En un lieu privé, parmi des objets sordides, une action vraie ou héroïque semble immédiatement faire descendre le ciel sur elle pour en faire son temple et paraît transformer le soleil en flambeau. Que les pensées de l'homme soient d'une grandeur équivalente à la sienne et la nature lui ouvre grand ses bras pour l'embrasser. Elle couvrira généreusement ses pas de roses et de violettes et courbera la noblesse et la grâce de ses lignes pour en orner son enfant chéri. Que ses pensées soient seulement d'une étendue comparable et le tableau trouvera le cadre qui lui convient. Un homme vertueux est à l'unisson des œuvres de la nature et forme la figure centrale de la sphère visible. Homère, Pindare, Socrate, Phocion sont naturellement associés dans notre souvenir au climat et à la géographie de la Grèce. Les cieux visibles et la terre sont en accord avec la personne de Jésus. Et quiconque, dans la vie ordinaire, a rencontré un homme à la personnalité puissante et possédant un heureux génie, aura remarqué combien aisément il entraîne toutes choses à sa suite : les personnes, les opinions, le jour et la nature devenant les serviteurs d'un homme.
3. Il est encore un autre aspect sous lequel la beauté de la nature peut être envisagée, à savoir en tant qu'objet intellectuel. Outre la relation des choses avec la vertu, il y a celle qu'elles entretiennent avec la pensée. L'intellect cherche à découvrir l'ordre absolu des choses tel qu'il repose dans l'esprit de Dieu, en dehors de toute nuance affective. Le pouvoir de l'intellect et le pouvoir de l'action semblent se succéder l'un l'autre, et l'activité exclusive de l'un engendre l'activité exclusive de l'autre. Il y a en chacun quelque chose d'inamical pour l'autre, mais qui ressemble aux périodes alternées de réfection et de travail chez l'animal : chacun prépare la venue de l'autre. Par conséquent, la beauté qui, en relation avec la vertu, comme nous l'avons montré, vient sans avoir été cherchée et parce qu'elle n'a pas été cherchée, demeure en vue de l'appréhension et de la poursuite de l'intelligence, de même qu'elle demeure en vue de l'action lorsque vient le tour de celle-ci. Rien de divin ne meurt. Tout bien est éternellement reproductible. La beauté de la nature se reforme elle-même dans l'esprit, non pour une contemplation stérile, mais pour une nouvelle création.
Tous les hommes sont dans une certaine mesure impressionnés par l'aspect du monde, quelques-uns même jusqu'à en éprouver du plaisir. Cet amour de la beauté, c'est le Goût. D'autres ressentent cet amour à un degré tel que, non contents d'admirer seulement, ils cherchent à l'incarner dans de nouvelles formes. Créer la beauté, c'est l'Art.
La production d'une œuvre d'art jette une lumière sur le mystère de l'homme. Une œuvre d'art est un condensé ou un résumé du monde. Elle est en miniature le résultat ou l'expression de la nature. Car bien que les œuvres de la nature soient innombrables et toutes différentes, le résultat de leur expression à toutes est un et identique. La nature est un océan de formes radicalement semblables et en même temps uniques. Une feuille, un rayon de soleil, un paysage, la mer ont un effet analogue sur l'esprit. Ce qui leur est commun à tous – cette perfection, cette harmonie –, c'est la beauté. Le critère de la beauté est représenté par la panoplie entière des formes naturelles, par la nature dans sa totalité ; ce que les Italiens expriment en définissant la beauté comme il più nell'uno. Rien n'est tout à fait beau tout seul, rien n'est beau que dans le tout. Un objet isolé n'est beau que dans la mesure où il suggère cette grâce universelle. Le poète, le peintre, le sculpteur, le musicien, l'architecte s'efforcent chacun de concentrer ce rayonnement du monde en un point unique, et chacun dans son propre domaine cherche à satisfaire cet amour de la beauté qui le pousse à créer. Ainsi l'art n'est-il rien d'autre que la nature distillée dans l'alambic de l'homme. Ainsi, dans l'art, la nature est au travail à travers la volonté de l'homme empli de la beauté de ses œuvres les plus hautes.
Pour l'âme, le monde existe donc dans le but de satisfaire son désir de beauté. Ce point, je lui donne le nom de cause finale. Nulle raison ne peut être cherchée ou avancée pour savoir pourquoi l'âme recherche la beauté. La beauté, dans son sens le plus large et le plus profond, est une expression de l'univers. Dieu est toute bonté. La vérité, la bonté et la beauté ne sont que des aspects différents du même Tout. Mais la beauté dans la nature n'est pas la beauté ultime. Elle est le héraut de la beauté intérieure et éternelle, et n'est pas à elle seule un bien solide et satisfaisant. Elle doit être tenue pour une partie et non comme la dernière ou la plus haute expression de la cause finale de la nature.

IV. Langage
IV. LANGAGE
LE langage est la troisième fonction dont la nature a doté l'homme. La nature est le véhicule de la pensée, et cela à un simple, double et triple degré.
1. Les mots sont les signes de faits naturels.
2. Les faits naturels particuliers sont les symboles de faits spirituels particuliers.
3. La nature est le symbole de l'esprit.
1. Les mots sont les signes de faits naturels. L'utilité de l'histoire naturelle est de nous venir en aide dans l'histoire surnaturelle, l'utilité du monde extérieur, de nous doter d'un langage pour exprimer les objets et les changements du monde intérieur. Chaque mot employé pour exprimer un fait intellectuel ou moral s'avère, si l'on remonte jusqu'à sa racine, tiré de quelque apparence matérielle. En anglais, vrai (right) signifie droit, faux (wrong) signifie tordu. Esprit veut dire souffle à l'origine ; transgression, le franchissement d'une ligne ; sourcilleux, le fait de froncer les sourcils. Nous disons le cœur pour exprimer l'émotion, la tête pour signifier la pensée ; et pensée et émotion sont eux-mêmes des mots empruntés au domaine des choses sensibles et appliqués finalement au monde spirituel. Du fait qu'il remonte au lointain passé où le langage s'est élaboré, l'essentiel du processus par lequel cette transformation s'accomplit nous demeure inconnu ; mais la même tendance peut s'observer quotidiennement chez les enfants. Les enfants et les sauvages emploient uniquement des noms de choses, qu'ils transforment en verbes et qu'ils étendent par analogie à des actes mentaux.
2. Mais cette origine de tous les mots porteurs d'une signification spirituelle – fait si remarquable dans l'histoire du langage – est notre moindre dette à l'égard de la nature. Ce ne sont pas les mots seulement qui sont emblématiques : ce sont les choses elles-mêmes qui le sont. Tout phénomène naturel est le symbole de quelque phénomène spirituel. Toute apparence sensible dans la nature correspond à quelque état d'esprit, et cet état d'esprit ne peut être décrit qu'en présentant cette apparence naturelle comme son image. Un homme en colère est un lion, un homme rusé, un renard ; un homme plein de fermeté est un roc, un homme instruit, un flambeau. L'agneau est le symbole de l'innocence, le serpent, de l'habileté maligne ; les fleurs expriment à nos yeux les sentiments délicats. La lumière et l'obscurité sont notre façon familière de représenter le savoir et l'ignorance, et la chaleur notre manière de signifier l'amour. L'espace visible devant et derrière nous est respectivement l'image de l'espoir et du souvenir.
Qui peut regarder une rivière pendant une heure de méditation et ne pas se rappeler l'écoulement de toutes choses ? Jetez une pierre dans le courant et les cercles qui se propagent sont le symbole magnifique de toute influence. L'homme a la conscience d'une âme universelle se tenant à l'intérieur ou derrière son existence individuelle, où, comme au firmament, se lèvent et resplendissent les catégories de la Justice, de la Vérité, de l'Amour et de la Liberté. Cette âme universelle, il l'appelle Raison : elle ne m'appartient pas, ni à toi, ni à lui, mais nous, nous lui appartenons ; nous sommes sa propriété et ses serviteurs. Et l'azur sous lequel la terre humble est ensevelie, l'azur avec son calme éternel et ses orbes infinis, est le symbole de la raison. Ce que d'un point de vue intellectuel nous appelons raison, considéré en relation avec la nature, nous l'appelons Esprit. L'Esprit est le Créateur. L'Esprit contient en lui la vie. Et l'homme de tous les temps et de tous les pays le figure dans son langage sous le nom de Père.
On voit qu'il n'est rien de hasardeux ou de capricieux dans ces analogies, mais qu'elles sont constantes et qu'elles imprègnent la nature. Ce ne sont pas les rêves de quelques poètes, ici ou là, mais l'homme est par nature analogiste et étudie les relations entre tous les objets. Placé au centre des êtres, la lueur d'un rapport se reflète sur lui à partir de chacun d'eux. Et l'homme ne saurait être compris sans ces objets, pas plus que ces objets ne pourraient l'être sans l'homme. Tous les faits de l'histoire naturelle pris en eux-mêmes sont sans valeur ; ils sont aussi stériles qu'un sexe isolé. Mais mariez-les à l'histoire humaine et ils s'avèrent pleins de vie. Tous les herbiers, tous les volumes de Linné et de Buffon ne sont que de secs catalogues de faits ; mais le plus trivial d'entre eux, la croissance d'une plante, les organes, le travail ou le bruit d'un insecte, appliqué à l'illustration d'un fait dans le domaine de la philosophie ou associé d'une façon ou d'une autre à la nature humaine, nous touche de la manière la plus vivante et la plus agréable. Prenez la graine d'une plante, par exemple. À quelles émouvantes correspondances avec la nature humaine ce petit fruit n'a-t-il pas servi dans toutes sortes de discours ? Jusqu'à la voix de saint Paul qui donne au cadavre de l'homme le nom de graine : “Semé comme un corps naturel, s'élevant comme un corps spirituel.” La rotation de la terre autour de son axe et autour du soleil commande le jour et l'année. Ces derniers ne sont qu'une certaine quantité de lumière et de chaleur brutes. Mais n'y a-t-il aucun rapport d'analogie entre la vie humaine et les saisons ? Et les saisons ne tirent-elles aucune grandeur ni aucune qualité d'émotion de ce rapport ? Les instincts de la fourmi sont sans intérêt en tant que tels, mais dès qu'une certaine relation peut être établie entre celle-ci et l'homme, l'humble tâcheronne se révèle un guide, un petit être au cœur puissant, dont toutes les habitudes, même cette découverte faite récemment qu'elle ne dort jamais, deviennent d'un coup sublimes.
À cause de cette correspondance absolue entre les choses visibles et la pensée humaine, les sauvages, qui ne possèdent que le nécessaire, s'expriment par images. À mesure que nous remontons dans le temps, le langage devient plus pittoresque, jusqu'à atteindre sa petite enfance, où il est tout entier poésie, ou bien encore où tous les faits spirituels sont représentés par des symboles naturels. Ce sont les mêmes symboles que l'on trouve comme éléments à l'origine de toutes les langues. Il a d'ailleurs été observé que les idiotismes de chacune d'entre elles se rapprochent les uns des autres dans les passages empreints de l'élo-quence et de la force la plus grande. Et puisque c'est cela le langage premier, c'en est en même temps l'expression dernière. Cette dépendance immédiate du langage par rapport à la nature, cette transformation d'un phénomène extérieur en quelque chose ayant un sens pour la vie humaine, ne manque jamais de faire son effet et de nous émouvoir. C'est là ce qui donne son sel à la conversation – où chacun trouve du plaisir – du fermier ou du coureur des bois doués d'un naturel généreux.
La capacité d'un homme à faire coïncider sa pensée avec son symbole adéquat, et donc de l'exprimer, dépend de la simplicité de son caractère, c'est-à-dire de son amour pour la vérité et de son désir de la faire connaître sans rien omettre. La corruption de l'homme est suivie par la corruption du langage. Quand la simplicité du caractère et la souveraineté des idées sont rompues par la prédominance des désirs secondaires – désir de la richesse, du plaisir, du pouvoir et des louanges –, et que la duplicité et le mensonge prennent la place de la simplicité et de la vérité, le pouvoir exercé sur la nature en tant qu'interprète de la volonté est perdu jusqu'à un certain point ; on cesse de créer de nouvelles images, et les mots anciens sont détournés pour représenter des choses qui ne le sont pas ; on se met à employer de la monnaie de papier quand il n'y a plus d'or ni d'argent dans les coffres. À son heure, la chose deviendra manifeste et les mots auront perdu tout pouvoir de stimuler l'esprit ou les sentiments. C'est par centaines que, dans tout pays ayant un long passé de civilisation, l'on peut trouver des auteurs qui, pour une courte période, croient et font croire aux autres qu'ils voient et qu'ils énoncent des vérités, alors qu'ils sont incapables par eux-mêmes d'habiller une pensée de son vêtement naturel, mais se nourrissent inconsciemment de la langue créée par les premiers écrivains de leur pays, ceux précisément qui s'en tinrent primitivement à la nature.
Mais les hommes avisés percent à jour ce style corrompu et rattachent de nouveau fermement les mots aux choses visibles ; si bien que ce langage pittoresque est d'emblée la garantie absolue que celui qui l'emploie est un homme qui se tient du côté de Dieu et de la vérité. Dès l'instant où notre discours s'élève au-dessus de la ligne d'horizon des faits ordinaires et s'enflamme de passion ou s'exalte par la pensée, il se revêt lui-même d'images. Un homme qui discute sérieusement, s'il examine ses processus intellectuels, découvrira qu'une image matérielle plus ou moins lumineuse, accompagnant chacune de ses idées, s'élève dans son esprit, fournissant son vêtement à la pensée. C'est pourquoi les bons écrits et les discours brillants sont d'éternelles allégories. Ces images sont spontanées. Elles sont le mélange de l'expérience et de l'action présente de l'esprit. Il s'agit proprement d'une création. C'est le travail de la cause originelle à travers les instruments qu'elle a déjà élaborés.
Ces faits peuvent suggérer combien la vie à la campagne possède d'avantages, pour un cerveau puissant, sur la vie artificielle et amoindrie des villes. Nous en apprenons plus de la nature que nous ne pouvons le communiquer à notre gré. Sa lumière s'écoule à jamais dans notre esprit et nous oublions sa présence. Le poète, l'orateur ayant grandi dans les bois et dont les sens se sont nourris de leurs pures et sereines variations, année après année, sans but et sans souci, n'en oubliera jamais tout à fait la leçon dans le tumulte des villes et la fièvre de la politique. Longtemps après, au milieu de l'agitation et de l'effroi des grandes assemblées de la nation – à l'heure des révolutions –, ces images solennelles ressurgiront dans leur éclat matinal, comme les symboles et les mots qui conviennent aux pensées que les événements auront éveillées. À l'appel d'un noble sentiment, les bois se mettent de nouveau à onduler, les pins à murmurer, la rivière à rouler ses eaux brillantes et le bétail à mugir dans la montagne, exactement comme il les voyait et les entendait dans son enfance. Et grâce à ces images, les secrets de la persuasion, les clefs du pouvoir sont remis entre ses mains.
3. C'est ainsi que les objets naturels nous assistent dans l'expression de significations particulières. Mais quelle grandeur dans le langage pour exprimer des choses aussi banales ! Était-il besoin d'aussi nobles races de créatures, de cette profusion de formes, de cette multitude de sphères dans le ciel pour fournir à l'homme le dictionnaire et la grammaire de ses discours à la municipalité ? Tandis que nous nous servons de cette grande écriture chiffrée pour expédier nos affaires courantes, nous sentons que nous n'en avons pas encore vraiment fait usage, pas plus que nous n'en sommes capables. Nous ressemblons à des voyageurs qui se serviraient des cendres d'un volcan pour faire cuire un œuf. Alors que nous voyons bien qu'ils se tiennent toujours prêts pour habiller ce que nous voulons dire, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si les caractères de cette écriture n'ont pas de signification par eux-mêmes. Les montagnes, les vagues et les cieux n'ont-ils d'autre sens que celui que nous leur donnons quand nous les employons comme symboles de nos idées ? Le monde est symbolique. Une grande part du discours est métaphorique, parce que la totalité de la nature est une métaphore de l'esprit humain. Les lois de la nature morale et celles de la nature physique se répondent comme dans un miroir. “Le monde visible et le rapport entre ses parties est le cadran solaire du monde invisible.” Les axiomes de la physique traduisent les lois de l'éthique. Ainsi, “le tout est plus grand que la partie”, “la réaction est équivalente à l'action”, “le plus petit poids peut servir à soulever le plus grand, la différence de poids étant compensée par le temps”, et bien d'autres propositions du même genre, ont aussi bien une signification morale que physique. Ces propositions ont un sens beaucoup plus étendu et universel lorsqu'elles sont appliquées à la vie humaine que quand elles restent cantonnées à un usage technique.
De même, les paroles célèbres de l'histoire et les proverbes des nations consistent habituellement en un fait naturel choisi comme image ou comme parabole d'une vérité morale. Par exemple : pierre qui roule n'amasse pas mousse ; un infirme dans le bon chemin vaut mieux qu'un homme alerte dans le mauvais ; fais ton foin tant que le soleil brille ; il est difficile de tenir droit une tasse pleine ; le vinaigre est le fils du vin ; la dernière once brise les reins du chameau ; les vieux arbres font leurs racines en premier… et ainsi de suite. Dans leur sens primitif, ce sont des faits banals, mais nous les répétons pour la valeur de leur contenu analogique. Ce qui est vrai des proverbes l'est aussi de toutes les fables, paraboles et allégories.
Ce lien entre l'esprit et la matière n'est pas
le fruit de l'imagination de quelque poète, mais repose dans les desseins de Dieu, et de ce fait il est possible à tous les hommes de le connaître. Il se manifeste à eux ou non. Quand dans nos meilleures heures nous examinons ce miracle avec soin, le sage, lui, se demande si à tout autre moment il n'est pas aveugle et sourd :
De telles choses peuvent-elles exister
Et nous accabler comme un nuage d'été
Sans nous frapper du plus grand étonnement ?
Car l'univers devient alors transparent et la lumière de lois plus hautes que les siennes brille à travers lui. C'est la question éternelle qui a suscité l'émerveillement et l'étude de tous les grands génies depuis que le monde existe, depuis l'époque des Égyptiens et des Brahmanes jusqu'à celle de Pythagore, de Platon, de Bacon, de Leibniz et de Swedenborg. C'est là que le Sphinx se tient assis au bord de la route et que, de siècle en siècle, chaque nouveau prophète qui vient à passer essaie de résoudre l'énigme. Il semble qu'il y ait une nécessité inhérente à l'esprit de se manifester à travers les formes matérielles ; et le jour et la nuit, la rivière et l'orage, bêtes et oiseaux, acide et alcali préexistent en tant qu'idées nécessaires dans l'esprit de Dieu et sont ce qu'ils sont en vertu d'attributs antérieurs dans le monde de l'esprit. Un fait est la fin ou l'ultime avatar de l'esprit. Le monde visible est le point d'aboutissement ou la circonférence du monde invisible. “Les objets matériels, a dit un philosophe français, sont nécessairement des sortes de scories de la substance des pensées du Créateur, qui doivent toujours conserver une relation exacte avec leur origine première ; en d'autres termes, la nature visible doit posséder une face morale et spirituelle.”
Cette doctrine est obscure, et quoique les images de “vêtement”, “scories”, “miroir”, etc. puissent stimuler l'imagination, il nous faut faire appel à des interprètes plus subtils et plus essentiels pour la rendre claire. “Tout écrit doit être interprété dans l'esprit dans lequel il a été énoncé” : tel est le principe fondamental de la critique. Une vie en harmonie avec la nature, l'amour de la vérité et de la vertu purifieront le regard au point de le rendre apte à en comprendre le texte. Nous pouvons parvenir à saisir par degrés le sens des objets permanents de la nature, jusqu'à ce que le monde nous soit comme un livre ouvert et chaque forme révélatrice de sa vie cachée et de sa fin.
Un intérêt nouveau s'empare de nous lorsque, à partir du point de vue que nous suggérons à présent, nous contemplons l'étendue et la quantité effrayante des objets ; car “tout objet correctement perçu libère une nouvelle faculté de l'âme”. Ce qui était vérité inconsciente devient, une fois interprété et défini dans un objet, une part du domaine de la connaissance – une nouvelle arme dans le magasin de la puissance.

V. Discipline
V. DISCIPLINE
EN vue de dégager la signification de la nature, nous en arrivons tout de suite à un fait nouveau, à savoir que la nature est une discipline. Cette manière d'envisager le monde englobe les fonctions précédentes en tant que parties d'elle-même.
L'espace, le temps, la société, le travail, le climat, les moyens de se déplacer, la nourriture, la force mécanique nous délivrent chaque jour l'enseignement le plus authentique, enseignement dont la portée est sans limites. Ils éduquent à la fois l'entendement et la raison. Chaque propriété de la matière est une école pour l'entendement : ainsi de sa solidité ou de sa résistance, de son inertie, de son étendue, de sa forme, de sa divisibilité. L'entendement ajoute, divise, combine, mesure, et trouve sur cette noble scène la nourriture et l'occasion nécessaires à son activité. En même temps, la raison fait passer tout cet enseignement dans la sphère propre de la pensée, par la perception qu'elle a de l'analogie grâce à laquelle l'esprit et la matière s'épousent.
1. La nature est une discipline de l'entende-ment dans le domaine des vérités intellectuelles. Notre commerce avec les objets sensibles est un exercice continuel pour le nécessaire apprentissage de la différence et de la similitude, de l'ordre, de l'être et du paraître, de l'adaptation progressive, de l'ascension qui mène du particulier au général, de l'alliance de forces multiples en vue d'une fin unique. Le soin extrême avec lequel il est pourvu à son éducation, soin qui ne s'interrompt en aucun cas, est proportionnel à l'importance de l'organe qu'il faut former. Quel infini et fastidieux exercice, jour après jour, année après année, pour former le sens commun, quelle sempiternelle reproduction d'ennuis, de difficultés, de dilemmes, quelle occasion pour les médiocres de se réjouir à nos dépens, combien de disputes sur les prix, de calculs d'intérêt – tout cela afin que l'esprit se fasse la main – pour nous apprendre que “les bonnes idées ne valent pas mieux que les beaux rêves, à moins d'être réalisées” !
Les mêmes bons offices sont remplis par la propriété et le système de la dette et du crédit qui en découle. La dette, la dette torturante, dont la face d'airain est redoutée et haïe à la fois par la veuve et l'orphelin comme par les fils du génie ; la dette, qui consume une part si importante du temps, qui rend un grand esprit infirme et sans courage sous le poids accablant de soucis qui paraissent si mesquins, est un maître dont les leçons ne peuvent être rejetées et dont ceux qui en souffrent le plus ont le plus besoin. D'ailleurs, la propriété – que l'on a justement comparée à la neige, qui “si elle tombe de manière égale aujourd'hui, le vent demain en aura fait congères” – est l'action apparente du mécanisme interne, comme l'aiguille sur le cadran de l'horloge. Tandis qu'elle ne représente, pour le présent, que la gymnastique de l'intelligence, elle fait provision, dans la prévoyance de l'esprit, de l'expérience de lois plus profondes.
La totalité du caractère et du destin d'un individu se ressent des moindres défauts dans la culture de son intelligence, par exemple dans la perception des différences. C'est pourquoi l'espace et le temps existent, afin que l'homme sache que les choses ne sont pas indifféremment entassées au hasard, mais qu'elles sont individuelles et distinctes. Une cloche et une charrue ont chacune leur fonction, et aucune ne peut tenir le rôle de l'autre. L'eau est faite pour boire, le charbon pour brûler, la laine pour être portée ; mais la laine ne peut être bue, ni l'eau filée, ni le charbon mangé. Le sage manifeste sa sagesse dans sa capacité à séparer, à graduer, et son échelle des êtres et des mérites est aussi large que celle de la nature. L'insensé ne connaît aucun ordre dans son échelle des valeurs, et pour lui chaque homme est comme tous les autres hommes. Ce qui n'est pas bon, il le nomme très mauvais, et ce qui n'est pas détestable, il l'appelle excellent.
De même, quel pouvoir d'attention la nature façonne-t-elle en nous ! Elle ne pardonne aucune erreur. Quand elle dit oui, c'est oui ; quand elle dit non, c'est non.
Les premiers pas de l'agriculture, de l'astronomie, de la zoologie (ces premiers pas accomplis par le fermier, le chasseur et le marin) nous apprennent que les dés de la nature sont toujours pipés, que ses masses informes et ses déchets recèlent des résultats certains et profitables.
De quelle façon calme et chaleureuse l'esprit découvre l'une après l'autre les lois de la physique ! Quelles nobles émotions s'emparent des mortels lorsqu'ils pénètrent dans les conseils secrets de la création et que cette connaissance leur fait éprouver le privilège d'ÊTRE ! Son pouvoir de pénétration purifie l'homme.
La beauté de la nature resplendit dans sa propre poitrine. Il est d'autant plus grand qu'il peut voir cela, tandis que l'univers en devient d'autant plus petit, parce que les relations de temps et d'espace s'évanouissent à mesure que les lois sont connues.
Une fois encore, nous sommes impressionnés et même accablés par l'immensité de l'univers
à explorer. “Ce que nous savons n'est qu'un point au regard de ce que nous ignorons.” Ouvrez n'importe quel journal scientifique récent et soupesez les problèmes que soulèvent les questions de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, du magnétisme, de la physiologie, de la géologie, et jugez si l'intérêt des sciences naturelles est près d'être bientôt épuisé.
Passant en revue les nombreuses particularités de la discipline de la nature, il en est deux qu'il ne faut pas oublier d'indiquer.
L'exercice de la volonté, ou la leçon du pouvoir, est contenu dans chaque événement. Depuis la prise de possession progressive par l'enfant de ses divers sens jusqu'à l'heure où il s'écrie : “Que ta volonté soit faite !”, il apprend ce secret qu'il peut plier sous sa volonté non seulement tels événements particuliers, mais encore de grandes séries, sinon l'ensemble des événements, et par là mettre la totalité des choses en conformité avec son caractère. La nature n'est rien d'autre qu'un intermédiaire. Elle est faite pour servir. Elle accepte la domination de l'homme aussi humblement que l'âne sur lequel était juché le Sauveur. Elle lui offre tous ses royaumes comme l'argile grossière avec laquelle il peut façonner ce qui lui est utile. L'homme n'est jamais las de cet ouvrage. Il se sert de l'air subtil et délicat pour le transformer en paroles sages et mélodieuses, auxquelles il donne des ailes comme à des anges de persuasion et d'autorité. L'une après l'autre, sa pensée vient à bout de toutes choses et les réduit à sa merci, jusqu'à ce qu'à la fin le monde ne soit plus qu'une volonté réalisée, la réplique exacte de l'homme.
2. Les objets sensibles se conforment aux intuitions de la raison et reflètent la conscience. Il n'est rien qui ne soit moral, et dans leurs transformations illimitées, les choses entretiennent un rapport incessant avec le versant spirituel de la nature. Par conséquent, la nature se montre éclatante dans ses formes, ses couleurs et ses mouvements, afin que chaque globe au fond du ciel le plus lointain, chaque transformation chimique, depuis le cristal le plus grossier jusqu'aux lois du vivant, chaque évolution dans le monde végétal, du principe premier de la croissance à l'œuvre dans le bourgeon jusqu'aux forêts tropicales et aux mines de charbon antédiluviennes, chaque fonction animale, depuis l'éponge jusqu'à Hercule, suggèrent et proclament à l'homme les lois qui régissent le bien et le mal, et fassent entendre en écho chacun des Dix Commandements. C'est pourquoi la nature est toujours l'alliée de la religion, prêtant toute sa gloire et sa richesse au sentiment religieux. Le prophète et le prêtre, David, Isaïe, Jésus ont profondément puisé à cette source. Cette qualité éthique imprègne si bien la nature jusque dans ses os et sa moelle que celle-ci ne semble avoir été créée qu'à cette seule fin. Quel que soit le caractère personnel du projet poursuivi par l'un de ses membres ou l'une de ses parties, telle est sa fonction générale et universelle, laquelle n'est jamais négligée. Rien dans la nature ne s'épuise dès le premier usage. Lorsqu'une chose a servi un but jusqu'au bout, elle reste complètement neuve pour servir un but ultérieur. Pour Dieu, toute fin se change en moyens nouveaux. Ainsi, l'intérêt du bien-être est en soi petit et misérable. Mais pour l'esprit, c'est une initiation à la doctrine de l'utile, à savoir qu'une chose n'est bonne qu'autant qu'elle sert et que le concours des parties et des efforts nécessaires à la production d'une fin est essentiel à tout être quel qu'il soit. La première manifestation grossière de cette vérité est l'inévitable et détesté apprentissage des valeurs et des besoins, notre lutte pour le pain et la viande.
Il a déjà été démontré que tout processus naturel est la traduction d'une loi morale. La loi morale gît au centre de la nature et rayonne vers sa circonférence. Elle est le sang et la moelle de toute substance, de tout rapport et de tout processus. Toutes les choses auxquelles nous avons affaire nous prêchent. Qu'est-ce qu'une ferme, sinon un évangile muet ? La balle et le grain, les mauvaises herbes et les plantes, les maladies, la pluie, les insectes, le soleil – tout cela constitue un emblème sacré, depuis les premiers labours au printemps jusqu'à la dernière meule que la neige recouvre en hiver. Mais le marin, le berger, le mineur, le marchand font chacun dans leur domaine respectif une expérience du même ordre et conduisant à la même conclusion, qui est que toutes les formes d'organisation sont radicalement semblables. Et on ne peut douter que ce sentiment moral qui parfume ainsi les airs, qui croît avec la plante et qui imprègne l'ensemble des eaux du monde, ne soit saisi par l'homme et ne s'absorbe profondément en son âme. L'influence morale de la nature sur chaque individu est cette profusion de vérités qu'elle illustre pour lui.
Qui en dira jamais tout le prix ? Qui saura deviner ce que le courage du pêcheur doit au rocher battu par la mer, combien la paix intérieure de l'homme s'inspire du ciel azuré, dans les profondeurs immaculées duquel les vents pourchassent sans relâche les noirs troupeaux des nuées d'orage, le laissant sans ride ni tache, ou jusqu'à quel point nous avons emprunté notre industrie, notre prévoyance et nos affections à la contemplation des bêtes sauvages ? Enfin, quel prêcheur éloquent de la maîtrise de soi que le spectacle varié de la Santé !
Ici, nous atteignons tout particulièrement l'unité de la nature – l'unité dans la variété –, qui partout vient à notre rencontre. Toute la variété infinie des choses produit une impression identique. Xénophane se plaignait sur ses vieux jours de ce que, où qu'il regardât, toutes les choses s'en retournaient en hâte vers l'Unité. Il était las d'apercevoir la même entité à travers la variété monotone des formes. La fable de Protée contient une vérité réconfortante. Une feuille, une goutte, un cristal, un morceau du temps sont reliés au tout et participent de la perfection du tout. Chaque particule est un microcosme et restitue fidèlement l'apparence du monde.
Non seulement des ressemblances existent entre des choses dont le rapport est évident, comme quand nous découvrons le modèle de la main humaine dans la nageoire d'un saurien fossile, mais également entre des objets présentant une grande différence apparente. Ainsi Goethe et madame de Staël appellent-ils l'architecture une “musique de pierre”. Vitruve pensait qu'un architecte se devait d'être musicien. “Une église gothique, a dit Coleridge, est une religion pétrifiée.” Michel-Ange soutenait que pour un architecte la connaissance de l'anatomie est essentielle. Dans les oratorios de Haydn, les notes suggèrent non seulement des idées de mouvement, tel celui du serpent, du cerf ou de l'éléphant, mais aussi des couleurs, comme celle de l'herbe verte par exemple. La loi qui régit l'harmonie des sons ressurgit dans l'harmonie des couleurs. Le granit ne varie dans ses lois que par le plus ou moins grand degré de chaleur de la rivière qui l'érode. L'écoulement de la rivière ressemble au flux de l'air au-dessus d'elle ; l'air ressemble à la lumière qui le traverse de ses courants plus subtils ; la lumière ressemble à la chaleur avec qui elle chevauche à travers l'espace. Chaque créature n'est que la modification d'une autre ; leur ressemblance est plus grande que leur différence, et la loi qui les régit fondamentalement est une et semblable. Les règles d'un art donné ou les lois d'un organisme particulier restent valables d'un bout à l'autre de la nature. Cette unité est si intime qu'il est facile de voir qu'elle gît sous le vêtement le plus secret de la nature et qu'elle trouve sa source dans l'esprit universel. Car elle imprègne aussi la pensée. Toute vérité universelle que nous exprimons par des mots implique ou suppose toutes les autres vérités. Omne verum vero consonat. Elle est comme un grand cercle sur une sphère qui comprendrait tous les cercles possibles, lesquels cependant peuvent être dessinés et la comprendre de la même manière. N'importe quelle vérité du même ordre est l'être absolu vu par un de ses côtés. Toutefois, il a d'innombrables côtés.
Cette unité centrale est encore plus évidente dans les actions. Les mots sont les organes finis de l'esprit infini. Ils ne peuvent embrasser la totalité de ce qui est contenu dans la vérité. Ils la brisent, la fragmentent et l'appauvrissent. L'action est la promulgation et la perfection
de la pensée. Une action juste semble combler l'œil et se rattacher à la nature tout entière. “Le sage, en faisant une chose, les fait toutes ; ou dans cette chose qu'il fait bien, il aperçoit l'équivalent de tout ce qui est bien fait.”
Les mots et les actes ne sont pas les attributs de la nature brute. Ils nous font accéder à la forme de l'homme, dont toutes les autres formes d'organisation nous apparaissent comme des dégradations. Quand elle apparaît au milieu de tant d'autres qui l'entourent, l'esprit la choisit de préférence à toutes les autres. Il dit : “De celle-ci, j'ai retiré joie et savoir ; en elle, je me suis trouvé et je me suis vu ; je lui parle ; elle peut me répondre ; elle peut m'apporter des pensées déjà formées et vivantes.” En fait, l'œil – l'esprit – est toujours accompagné de ces formes humaines, hommes ou femmes, qui sont de loin les informations les plus riches que l'on ait sur l'ordre et la force qui règnent au cœur des choses. Malheureusement, chacune d'elles porte comme la marque d'une blessure ancienne, paraît défigurée et extérieurement déficiente. Néanmoins, bien différentes en cela de la nature sourde et muette qui les entoure, elles reposent semblables à des becs de fontaine sur l'océan insondable de la pensée, et de tous les êtres, elles seules sont les entrées qui mènent à la vertu.
Ce serait une étude charmante que de suivre dans le détail leur rôle dans notre éducation. Mais où cela s'arrêterait-il ? Nous nous lions durant notre adolescence et notre âge adulte avec quelques amis qui, comme les cieux et les eaux, partagent notre largeur de vues ; qui, répondant chacun à une certaine disposition de notre âme, comblent nos désirs de ce côté-là, et à l'égard desquels nous fait défaut la force de les placer à la distance qui nous permettrait de les améliorer ou même de les analyser. Nous n'avons d'autre choix que de les aimer. Quand un long commerce avec un ami nous a fourni un étalon du mérite et a accru notre respect pour les ressources de Dieu, qui nous envoie ainsi une personne réelle pour surpasser notre idéal ; quand de plus il est devenu un objet de réflexion et que sa fréquentation, tant que sa personnalité conserve son effet inconscient, se convertit dans notre esprit en une douce et solide sagesse – alors, tout cela est pour nous le signe que son office est révolu, et la plupart du temps il disparaît rapidement de notre vue.

VI. Idéalisme
VI. IDÉALISME
TELLE est la signification, indicible mais en même temps intelligible et pratique, que le monde offre à l'homme, cet apprenti immortel, à travers tout objet des sens. À cette unique fin d'éducation, toutes les parties de la nature conspirent.
Un noble doute s'insinue constamment en nous : cette fin ne serait-elle pas la cause finale de l'univers et la nature existe-t-elle en dehors de nous ? C'est une raison suffisante de cette apparence que nous appelons le monde que Dieu daigne enseigner l'esprit humain et faire ainsi de lui le dépositaire d'un certain nombre de sensations appropriées, que nous nommons lune et soleil, homme et femme, foyer et commerce. Dans ma totale impuissance à vérifier l'authenticité du témoignage de mes sens, quelle différence cela fait-il de savoir si l'impression qu'ils font sur moi correspond aux objets extérieurs, si Orion se trouve bien tout là-haut dans le ciel ou si quelque dieu en peint seulement l'image au firmament de mon âme ? Les relations entre les parties et la fin du tout demeurant les mêmes, quelle différence de savoir si la terre et la mer s'influencent réciproquement et si les mondes innombrables gravitent et se mêlent sans fin – abîme insondable après abîme insondable, galaxies faisant pendant à d'autres galaxies à travers l'espace infini –, ou si, en dehors des relations d'espace et de temps, ces mêmes apparences sont inscrites dans la foi inébranlable de l'homme ? Que la nature bénéficie d'une existence concrète ou qu'elle ne soit qu'une vision de l'esprit, c'est tout aussi bon pour moi et tout aussi vénérable. Qu'elle soit ce qu'on veut : pour moi, elle est l'idéal aussi longtemps que je ne pourrai pas vérifier l'exactitude de mes sens.
Les esprits frivoles se gaussent de la théorie de l'idéal, comme si ses résultats étaient ridicules, comme si elle affectait la stabilité de la nature. Ce qui n'est certainement pas le cas. Dieu ne se joue jamais de nous et ne veut pas compromettre la fin de la nature en autorisant la plus petite inconséquence dans son déroulement. Un quelconque doute concernant la permanence de ses lois paralyserait les facultés de l'homme. Leur constance est respectée de manière sacrée et sa foi en elles est parfaite. Les rouages et les ressorts de l'homme reposent entièrement sur l'hypothèse de la permanence de la nature. Nous ne sommes pas construits comme un navire pour être roulés en tous sens, mais comme une maison solidement établie. La conséquence naturelle de ce fait est que, aussi longtemps que l'action l'emporte sur la réflexion, nous rejetons avec indignation toute insinuation selon laquelle la nature serait moins durable ou plus instable que l'esprit. L'homme d'affaires, le charron, le charpentier, l'employé de l'octroi sont très mécontents à cette idée.
Mais tandis que nous adhérons entièrement au principe de la permanence des lois naturelles, la question de l'existence absolue de la nature demeure ouverte. C'est un effet constant de la culture sur l'esprit humain de ne pas ébranler notre foi dans la stabilité des phénomènes particuliers, comme ceux de la chaleur, de l'eau, de l'azote, mais de nous conduire à envisager la nature en tant que phénomène et non en tant que substance, d'attribuer une existence nécessaire à l'esprit, de juger la nature comme un accident et un effet.
Une sorte de croyance instinctive dans l'exis-tence absolue de la nature est attachée aux sens, ainsi qu'à l'entendement qui n'a pas été régénéré. Pour ces derniers, l'homme et la nature sont indissolublement liés. Les choses sont à elles-mêmes leur propre fin et ne s'étendent jamais au-delà de leur sphère. L'existence de la raison ruine cette croyance. Le premier effort de la réflexion tend à faire se relâcher cette tyrannie des sens qui nous enchaîne à la nature comme si nous étions une partie d'elle-même, et nous la montre à distance et, pour ainsi dire, en suspension. Jusqu'à ce que cet agent plus noble entre en scène, l'œil animal perçoit, avec une merveilleuse acuité, de vifs contours et des surfaces colorées. Quand l'œil de la raison s'entrouvre, aux surfaces et aux contours viennent immédiatement s'ajouter la grâce et l'expression. Celles-ci proviennent de l'imagination et de la sensibilité, et retirent quelque chose de leur anguleuse netteté aux objets. Si la raison est entraînée vers des visions plus graves et sérieuses, les lignes et les surfaces deviennent transparentes et ne sont plus perçues : les principes et les causes se font jour à travers elles. Les meilleurs moments de la vie sont ces délicieux réveils de nos facultés les plus hautes et la déférente retraite de la nature devant son dieu.
Poursuivons en indiquant les effets de la culture.
1. Notre premier établissement dans la philosophie de l'Idéal nous est suggéré par la nature elle-même.
La nature est faite pour s'associer avec l'esprit en vue de notre émancipation. Certains changements dans nos habitudes, une altération légère de notre situation bornée nous font prendre conscience d'une dualité. Nous sommes étrangement émus de voir le rivage depuis le pont d'un bateau en mouvement, du haut d'un ballon ou à travers les teintes d'un ciel inaccoutumé. Le moindre changement de point de vue donne au monde entier l'aspect d'une peinture. Il suffit à un homme qui voyage rarement de prendre la diligence et de traverser sa propre ville pour voir les rues se transformer en spectacle de marionnettes. Les hommes, les femmes – parlant, cousant, trafiquant, se battant –, l'artisan consciencieux, le paresseux, le mendiant, les petits garçons, les chiens sont complètement irréels ou, du moins, absolument coupés de tout rapport avec l'observateur, et sont perçus non comme des essences, mais comme des apparences. Quelles pensées toutes nouvelles s'offrent à nous au spectacle d'un paysage familier aperçu à travers le rapide déplacement d'un wagon de train ! Bien mieux, les objets les plus usés, après un changement très léger de l'angle de vision, sont ceux qui nous plaisent le plus. Vues dans une chambre noire, la carriole du boucher et la silhouette d'une personne de notre famille nous divertissent. De même, le portrait d'un visage bien connu nous enchante. Penchez votre tête en avant jusqu'à la placer entre vos jambes et, dans cette position, regardez le paysage : vous verrez comme l'image en est plaisante, bien que vous l'ayez eue à toute heure devant les yeux depuis vingt ans !
Ces exemples suggèrent par des moyens artificiels qu'il existe une différence entre l'observateur et le spectacle observé – entre l'homme et la nature. Il en ressort un sentiment de plaisir mêlé d'effroi, comme si, pourrait-on dire, l'on ressentait une forme inférieure du sublime, provenant sans doute du fait que l'homme prend alors conscience que tandis que le monde est un spectacle, quelque chose en lui demeure inchangé.
2. Bien que d'une manière plus haute, c'est le même genre de plaisir que procure le poète. Par quelques touches, il dessine, comme dans les airs, le soleil, la montagne, le camp, la ville, le héros, la jeune fille, non pas différents de ce que nous les connaissons, mais simplement détachés du sol et flottant devant nos yeux. Il dénoue les amarres du ciel et de la terre, les fait mouvoir autour du pivot de sa pensée principale, puis les remet à leur place. Lui-même en proie à une passion héroïque, il se sert de la matière comme symbole de celle-ci. L'homme sensuel conforme ses pensées aux choses, le poète conforme les choses à ses pensées. L'un voit la nature fixe et immuable, l'autre comme quelque chose de fluide sur lequel il imprime la marque de son être. Pour lui, ce qu'il y a de résistant dans le monde se fait souple et docile ; il dote d'humanité la poussière et les pierres pour en faire les messagers de la raison. L'imagination peut être définie comme l'usage que la raison fait du monde matériel. Shakespeare, par-dessus tous les autres poètes, possède ce pouvoir de soumettre la nature à des fins d'expression. Sa muse souveraine fait sauter la création d'une main dans l'autre comme un hochet, et se sert d'elle pour donner corps à n'importe quelle fantaisie née dans les plus hautes régions de son esprit. Les recoins les plus reculés de la nature sont visités, et les choses les plus éloignées sont rapprochées par un subtil lien spirituel. Il nous fait prendre conscience que l'ampleur des choses matérielles est relative, et tous les objets sont rapetissés ou agrandis dans le seul but de servir la passion du poète. Ainsi, dans ses sonnets, le chant des oiseaux, le parfum et la couleur des fleurs sont-ils l'ombre de sa bien-aimée, le temps qui la garde éloignée de lui, son coffret précieux, et le soupçon qu'elle a éveillé, sa parure :
L'ornement de la beauté, c'est le soupçon,
Noir corbeau glissant dans l'air le plus doux des cieux.
Son amour n'est pas le fruit du hasard, mais s'enfle, jusqu'à la ville et au pays.
Non, il fut bâti loin des atteintes du sort ;
Il ne souffre pas parmi la pompe méprisante,
Ni ne s'incline, servile, sous l'œil du déplaisir,
Il ne craint pas la politique, cette hérétique
Qui n'œuvre que pour un temps bien court,
Mais il est à lui seul une haute politique.
Comparées à la force de sa constance, les pyramides lui semblent récentes et provisoires. La fraîcheur de la jeunesse et de l'amour le frappe par sa ressemblance avec le matin.
Éloignez ces lèvres
Si tendrement parjures
Et ces yeux, tout pareils à la naissance du jour,
Lumières qui font s'égarer l'aurore.
Au passage, j'ajouterai qu'il n'est pas facile de trouver d'équivalent à la sauvage beauté de cette hyperbole dans toute la littérature.
Cette transfiguration que la passion du poète fait subir à tous les objets matériels, ce pouvoir par lequel il rabaisse le grand et exalte le petit, je pourrais l'illustrer par des milliers d'exemples tirés de ses pièces. J'ai devant moi La Tempête, dont je ne citerai que ces quelques vers :
ARIEL. J'ai ébranlé le promontoire
À la base si solide, et avec son éperon j'ai arraché
Le pin et le cèdre.
Prospero demande de la musique pour apaiser la folie d'Alonzo et de ses compagnons.
Qu'un air solennel, le meilleur réconfort
D'une âme hors de ses gonds, guérisse tes esprits
À présent inutiles, bouillant dessous ton crâne.
Et aussi :
Le charme se dissipe rapidement,
Et de même que le matin succède à la nuit,
Dispersant les ténèbres, leurs sens s'éveillent peu à peu
Et commencent à chasser les fumées aveuglantes
Qui enveloppaient leur clair jugement.
Leur conscience se met
À s'enfler de nouveau : et la marée qui approche
Va bientôt recouvrir les rives de leur intelligence,
Qui gît à présent sous la fange et la boue.
La perception d'affinités réelles entre les événements (c'est-à-dire d'affinités idéales, puisqu'elles seules sont réelles) rend le poète à même de se libérer des phénomènes et des formes par trop imposants du monde et d'affir-mer la suprématie de l'âme.
3. Tandis que le poète peuple ainsi la nature de ses propres pensées, il ne diffère du philosophe que dans la mesure où la fin principale qu'il se propose est la beauté, tandis que celle du philosophe est la vérité. Mais le philosophe, non moins que le poète, soumet l'ordre apparent des choses et leurs relations à l'empire de la pensée. “Le problème de la philosophie”, selon Platon, “est de trouver, pour tout ce qui existe de manière contingente, un fondement non contingent et absolu.” Cela procède de la foi dans le fait que tout phénomène est déterminé par une loi, laquelle une fois connue permet de prévoir le phénomène. Cette loi, dans le cadre de l'esprit humain, s'appelle une idée. Sa beauté est infinie. Le vrai philosophe et le vrai poète ne font qu'un, et la beauté, qui est vérité, et la vérité, qui est beauté, sont le but qu'ils partagent en commun. Le charme d'une définition de Platon ou d'Aristote n'est-il pas tout à fait semblable à celui de l'Antigone de Sophocle ? Dans les deux cas, une vie spirituelle a été insufflée à la nature, la masse apparemment solide de la matière a été envahie et dissoute par une pensée, le faible être humain a pénétré les vastes masses de la nature de son âme ordonnatrice et s'est reconnu dans leur harmonie, c'est-à-dire en a saisi les lois. En physique, quand ce but est atteint, la mémoire se décharge de ses encombrants catalogues de faits particuliers et fait tenir des siècles d'observation dans une simple formule.
Ainsi, même dans les sciences exactes, la dimension matérielle s'efface devant la dimension spirituelle. L'astronome, le géomètre ont foi en leurs irréfutables analyses et dédaignent les résultats de l'observation. La sublime remarque d'Euler au sujet de sa loi sur les courbes, qui affirme : “On la trouvera contraire à toute expérience, et pourtant elle est vraie”, a déjà transféré la nature dans le domaine de l'esprit et abandonné la matière comme une dépouille inutile.
4. Il a été observé que le savoir intellectuel engendrait invariablement le doute sur l'exis-tence de la matière. Turgot disait que “celui qui n'a jamais douté de l'existence de la matière peut être assuré qu'il n'a aucune aptitude pour les questions métaphysiques”. Elle fixe l'attention sur des catégories immortelles, nécessairement incréées, autrement dit les Idées ; et en leur présence, nous sentons que les circonstances externes ne sont que des rêves et des ombres. Tant que nous demeurons sur cet Olympe des dieux, nous regardons la nature comme un appendice de l'âme. Nous nous élevons jusqu'aux régions qu'habitent les idées et comprenons qu'elles sont les pensées de l'Être suprême. “Celles-ci furent établies de toute éternité, depuis le commencement, avant que la terre existe. Quand il apprêtait les cieux, elles étaient là ; quand il mit les nuages au-dessus, quand il fit s'enfler les sources de l'abîme. Elles étaient alors auprès de lui, comme ayant grandi avec lui. Et d'elles, il prenait conseil.”
Leur influence est variable. En tant qu'objets de science, elles sont accessibles à peu de personnes. Cependant, tous les hommes sont capables d'être soulevés à leur hauteur par la piété ou la passion. Et nul n'approche ces essences divines sans devenir divin lui-même jusqu'à un certain point. Comme une âme nouvelle, elles régénèrent les corps. Nous devenons physiquement alertes et légers, nous marchons dans les airs ; la vie cesse de nous accabler, et nous pensons qu'il en sera toujours ainsi. Nul ne redoute l'âge, le malheur ou la mort en leur sereine compagnie, car il se sent transporté hors du royaume de la tribulation. En même temps que nous contemplons la nature de la vérité et de la justice dans sa nudité, nous apprenons la différence qui sépare l'absolu du contingent ou du relatif. Nous appréhendons l'absolu. En quelque sorte, nous existons pour la première fois. Nous devenons immortels, car nous apprenons que le temps et l'espace sont des relations de la matière, et qu'ils n'ont aucun rapport avec la perception de la vérité ou le désir de la vertu.
5. Finalement, la religion et la morale, qui peuvent être appelées à juste titre la pratique des idées ou l'introduction des idées dans la vie, ont un effet en commun avec toute culture moins élevée, celui de rabaisser la nature et de suggérer sa dépendance vis-à-vis de l'esprit. Elles diffèrent en ce que leur doctrine du devoir puise son origine dans l'homme chez l'une et en Dieu chez l'autre. La religion inclut la personne de Dieu, la morale non. Mais elles ne font qu'un au regard de ce qui nous occupe ici, car toutes deux foulent aux pieds la nature. Le premier et le dernier mot de la religion est : “Ce que l'on voit est temporel, ce que l'on ne voit pas est éternel.” C'est un affront fait à la nature. La religion agit vis-à-vis des incultes comme la philosophie vis-à-vis de Berkeley et de Viasa. Le langage uniforme qui s'entend dans les églises des sectes les plus ignares se résume à ceci : “Détournez-vous des frivoles spectacles du monde ; ils ne sont que vanité et rêve, ombres et chimères ; recherchez les vérités de la religion.” Le dévot n'a que mépris pour la nature. Quelques théosophes en sont arrivés à montrer une certaine forme d'hostilité et de révolte à l'égard de la matière, comme Plotin et les manichéens. Ils craignaient pour eux-mêmes quelque regard en arrière vers la vie dorée de l'Égypte. Plotin avait honte de son corps. Bref, ils auraient tous pu dire de la matière ce que Michel-Ange disait de la beauté visible : “C'est l'enveloppe fragile et fatiguée dont Dieu habille les âmes qu'il a fait naître au temps.”
Il semble que le mouvement, la poésie, les sciences physiques et abstraites, la religion, tout cela tende à affecter nos certitudes quant à la réalité du monde extérieur. Mais j'avoue qu'il y a quelque chose de déplaisant à développer trop scrupuleusement et en détail les termes de la proposition générale selon laquelle toute culture tend à nous imprégner d'idéalisme. Je n'ai pas d'hostilité envers la nature, mais plutôt l'amour d'un enfant. Parlons-lui gentiment. Je vis et m'épanouis dans la tiédeur du jour comme le blé ou le melon. Je ne souhaite pas jeter des pierres à mon admirable mère, ni souiller mon tendre nid. Je veux seulement indiquer la véritable position de la nature vis-à-vis de l'homme, là où toute véritable éducation tend à l'établir ; la poursuite de ce but, c'est-à-dire l'union de l'homme avec la nature étant l'objet même de la vie humaine. La culture renverse la vision que le vulgaire se fait de la nature et amène l'esprit à appeler apparent ce qu'il a coutume d'appeler réel, et réel ce qu'il est habitué à appeler chimérique. Les enfants, il est vrai, croient au monde extérieur. La conviction selon laquelle il n'est qu'apparent est une réflexion après coup, mais avec la culture cette foi s'élèvera dans l'esprit aussi sûrement que le fit la première.
L'avantage de la théorie idéaliste sur la croyance populaire est qu'elle présente précisément le monde du point de vue qui est le plus souhaitable pour l'esprit. C'est en fait le point de vue que la raison à la fois spéculative et pratique, c'est-à-dire la philosophie et la vertu, adopte. Car considéré à la lumière de la pensée, le monde est toujours phénoménal, et la vertu le subordonne à l'esprit. L'idéalisme voit le monde en Dieu. Il parcourt le cercle entier des personnes et des choses, des actions et des événements, des pays et des religions, non comme quelque chose de péniblement entassé, atome après atome, acte après acte, en un lointain passé décrépi, mais comme un seul immense tableau que Dieu peint dans une éternité immédiate pour la contemplation de l'âme. C'est pourquoi l'âme se tient elle-même à l'écart d'une étude trop minutieuse et détaillée des tablettes universelles. Elle respecte trop la fin pour se plonger dans les moyens. Elle voit quelque chose de plus important dans le christianisme que les scandales de l'histoire ecclésiastique ou les minuties de la critique ; et totalement indifférente à l'égard des personnes et des miracles, nullement perturbée par le défaut de preuves historiques, elle accepte de Dieu le phénomène comme il se présente, comme la forme pure et magnifique de la religion en ce monde. Elle n'est ni ardente ni passionnée à l'aspect de ce qu'on appelle sa bonne ou sa mauvaise fortune, non plus que devant l'accord ou le désaccord d'autrui. Aucun homme n'est son ennemi. Elle accepte tout ce qui arrive comme faisant partie de la leçon. Elle est un témoin plutôt qu'un acteur, et elle n'est active qu'afin de pouvoir mieux regarder.

VII. Esprit
VII. ESPRIT
IL est essentiel à une théorie vraie sur la nature et sur l'homme qu'elle contienne un élément de progrès. Des usages qui sont épuisés ou qui peuvent l'être, et des faits qui se limitent à leur exposé ne peuvent être tout ce qui est vrai de cette noble demeure où l'homme est abrité, et où toutes ses facultés trouvent à s'exercer d'une manière appropriée et ininterrompue. Et tous les usages de la nature admettent d'être résumés en un seul, qui fournit à l'activité de l'homme un champ infini. À travers tous ses royaumes, jusqu'à la banlieue et à la lisière des choses, elle reste fidèle à la cause d'où elle tire son origine. Toujours, elle parle de l'esprit. Elle suggère l'absolu. Elle est un effet perpétuel. Elle est une grande ombre indiquant toujours le soleil derrière nous.
L'aspect de la nature est pieux. Comme la figure de Jésus, elle se tient la tête penchée et les mains repliées sur la poitrine. L'homme le plus heureux est celui qui tire de la nature une leçon d'adoration.
De cette essence ineffable que nous appelons esprit, celui qui pense le plus en dira le moins. Nous pouvons pressentir Dieu dans le grossier et pour ainsi dire lointain phénomène de la matière, mais quand nous essayons de le définir et de le décrire lui-même, à la fois la pensée et les mots se dérobent, et nous sommes aussi impuissants que les idiots et les sauvages. Cette essence se refuse à être enregistrée sous forme de propositions ; mais quand l'homme l'a adorée intellectuellement, le plus noble ministère de la nature est de se présenter comme la manifestation apparente de Dieu. Elle est l'organe à travers lequel l'esprit universel parle à l'individu et s'efforce de le ramener à lui.
Quand nous considérons l'esprit, nous voyons que les vues déjà exposées ne couvrent pas toute la circonférence de l'homme. Nous devons ajouter quelques pensées qui s'y rattachent.
La nature pose trois problèmes à l'esprit : Qu'est-ce que la matière ? D'où vient-elle ? Dans quel but existe-t-elle ? La théorie de l'idéal ne répond qu'à la première de ces questions seulement. L'idéalisme dit : la matière est un phénomène, non une substance. L'idéalisme nous instruit de la différence absolue qu'il y a entre l'évidence de notre être propre et l'évidence de l'être du monde. L'un est parfait, l'autre incapable de la moindre certitude ; l'esprit est une partie de la nature des choses ; le monde est un rêve divin, dont nous pouvons tout à l'heure nous éveiller pour la gloire et la certitude du jour. L'idéalisme est une hypothèse destinée à rendre compte de la nature par d'autres principes que ceux de la chimie et de la charpenterie. Cependant, s'il ne fait que nier l'existence de la matière, il ne satisfait pas les besoins de l'esprit. Il laisse Dieu à l'extérieur du moi. Il me laisse errer sans fin dans le splendide labyrinthe de mes perceptions. Alors le cœur lui résiste, car il entrave l'émotion en refusant aux hommes et aux femmes l'existence d'un être en soi. La nature est à ce point imprégnée de vie humaine que l'on retrouve un peu d'humanité aussi bien dans le tout que dans chaque détail. Mais cette théorie me rend la nature étrangère et ne tient pas compte de cette parenté que nous lui reconnaissons.
Tenons-la donc tout bonnement, dans l'état actuel de nos connaissances, pour une utile hypothèse de départ, nous servant à évaluer la différence éternelle qu'il y a entre l'âme et le monde. Mais quand emboîtant le pas invisible de la pensée, nous en venons à nous demander d'où vient que la matière existe, et dans quel but, de nombreuses vérités s'élèvent pour nous des replis de la conscience. Nous apprenons que ce qu'il y a de plus haut est présent dans l'âme de l'homme ; que la terrible essence universelle – qui n'est ni sagesse, ni amour, ni beauté, ni pouvoir, mais tout cela à la fois et chacun de ces éléments en totalité – est ce pour quoi toutes choses existent et ce par quoi elles sont ; que l'esprit est créateur ; que derrière la nature, à travers la nature, l'esprit est présent ; qu'un et sans mélange, il n'agit pas sur nous de l'extérieur, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace, mais spirituellement, ou à travers nous-mêmes ; et que par conséquent, cet esprit, c'est-à-dire l'Être suprême, n'édifie pas la nature autour de nous, mais lui donne naissance à travers nous, comme la vie de l'arbre fait jaillir de nouvelles pousses par les pores des branches et des feuilles anciennes. Telle une plante reposant sur le sol, ainsi en est-il de l'homme sur le sein de Dieu ; il s'abreuve à des fontaines intarissables et y puise à volonté une force sans fin. Qui peut assigner des limites aux possibilités de l'homme ? Qu'une seule fois nous respirions l'air supérieur, étant admis à contempler la nature absolue de la justice et de la vérité, et nous apprendrons que l'homme a accès à l'esprit du Créateur en son entier, qu'il est lui-même un créateur dans l'espace du fini. Cette vision, qui me rappelle où se trouvent les sources de la sagesse et de la puissance, et me montre la vertu comme
La clef d'or
Qui ouvre les palais de l'éternité,
porte en elle le plus haut certificat de vérité, parce qu'elle m'incite à créer mon propre monde par l'entremise de la purification de mon âme.
Le monde procède du même esprit que le corps de l'homme. C'est une incarnation de Dieu plus ancienne et inférieure, une projection de Dieu dans le non-conscient. Mais il diffère du corps en un point important. Il n'est pas, comme ce dernier, assujetti à la volonté humaine. Son ordre serein nous demeure inviolable. Par conséquent, il est pour nous le commentaire actuel de l'esprit divin. C'est un point fixe grâce auquel nous pouvons mesurer le chemin parcouru. À mesure que nous dégénérons, le contraste entre nous et notre demeure se fait plus évident. Nous sommes aussi extérieurs à la nature que nous sommes étrangers à Dieu. Nous ne comprenons pas le chant des oiseaux. Le renard et le daim s'enfuient à notre vue ; l'ours et le tigre nous mettent en pièces. Nous ne connaissons l'usage que de quelques plantes, telles que le blé et la pomme, la pomme de terre et la vigne. Le paysage, dont chaque aperçu a sa propre grandeur, n'est-il pas un aspect de lui ? Cependant, cela nous montre peut-être quel désaccord il existe entre l'homme et la nature, car il n'est pas possible d'admirer librement un noble paysage si des journaliers sont en train de bêcher le champ d'à côté. Le poète trouve quelque chose de ridicule à son extase tant qu'il est à portée de regard des hommes.

VIII. Perspectives
VIII. PERSPECTIVES
DANS les questions qui concernent les lois du monde et l'ordre des choses, la raison la plus élevée est toujours la plus juste. Ce qui semble à peine possible, tant cela est délicat, est souvent vague et obscur, car siégeant au plus profond de l'esprit parmi les vérités éternelles. La science empirique est de nature à obscurcir la vue et, par la connaissance même des fonctions et des processus, capable de priver l'élève de la virile contemplation du tout. Le savant perd le sens de la poésie. Mais le naturaliste le plus érudit, qui prête une fidèle et totale attention à la vérité, verra qu'il lui reste beaucoup à apprendre de sa relation au monde, et qu'il n'est pas possible de le faire par une quelconque addition ou soustraction ou comparaison de quantités connues, mais que l'on y parvient par des saillies de l'esprit qui ne s'apprennent pas, par une constante maîtrise de soi et par une complète humilité. Il s'apercevra qu'il est chez l'étudiant des qualités bien plus précieuses que la précision et l'infaillibilité ; qu'une supposition est souvent plus féconde qu'une affirmation qui ne souffre pas la discussion, et qu'un rêve peut nous conduire plus profond dans le secret de la nature que cent expériences calculées.
Car les problèmes qu'il y a à résoudre sont précisément ceux que le physiologiste et le naturaliste oublient de poser. Il est moins à propos pour l'homme de connaître toutes les espèces particulières du règne animal que de savoir d'où vient et vers quoi tend cette despotique unité de sa composition, qui sépare et classe éternellement les choses, s'efforçant de réduire ce qu'il y a de plus divers à une forme unique. Quand je contemple un riche paysage, mon affaire n'est pas tant de réciter correctement l'ordre et la superposition des couches, que de savoir pourquoi toute idée de multiplicité s'abolit en un paisible sentiment d'unité. Je ne puis guère rendre hommage à l'esprit de minutie dans les détails, tant qu'il n'existera aucun aperçu pour expliquer la relation entre les pensées et les choses, et qu'aucune lumière n'aura été jetée sur la métaphysique de la conchyologie, de la botanique et des arts, pour décrire les relations de forme des fleurs, des coquillages, des animaux et de l'architecture avec l'esprit, et fonder la science sur des idées. Dans un cabinet d'histoire naturelle, nous ressentons une sorte de reconnaissance et de sympathie secrètes à l'égard des formes les plus gauches et les plus excentriques de bêtes, de poissons et d'insectes. L'Américain, qui est condamné dans son propre pays à ne voir que des bâtiments dessinés d'après des modèles étrangers, est tout surpris en pénétrant dans la cathédrale d'York ou dans Saint-Pierre de Rome par le sentiment que ces structures sont elles aussi des imitations, de pâles copies d'un original invisible. Et la science ne possède pas un caractère d'humanité suffisant, aussi longtemps que le naturaliste dédaigne de voir la merveilleuse conformité qui existe entre l'homme et le monde. Monde dont il est le seigneur, non parce qu'il en est le plus subtil habitant, mais parce qu'il en est la tête et le cœur, et qu'il retrouve une part de lui-même dans chaque chose, petite ou grande, dans chaque couche de la montagne, chaque nouvelle loi de la couleur, chaque fait astronomique ou influence atmosphérique que l'observation ou l'analyse révèle. Une certaine idée de ce mystère inspire la muse de George Herbert, le magnifique auteur de psaumes du dix-septième siècle. Les vers suivants sont tirés de son poème sur l'Homme.
L'homme est tout symétrie,
Chaque membre avec l'autre bien proportionné,
Comme tous le sont avec le monde entier.
Chaque partie peut nommer sœur la plus lointaine ;
Car la tête et le pied ont des affinités cachées,
Et tous deux avec la lune et les marées.
Jamais rien n'est si loin allé
Que l'homme, comme sa proie, ne l'ait saisi et gardé
Ses yeux font s'incliner les plus hautes étoiles :
Il est en petit la sphère tout entière.
Les simples avec joie guérissent notre chair,
Car ils trouvent là une terre familière.
Pour nous soufflent les vents,
La terre se repose, les cieux se meuvent et les fontaines
coulent ;
Tout ce que nous voyons signifie notre bien,
De même que notre joie ou bien notre trésor ;
Le tout est notre armoire à provisions
Ou notre cabinet de plaisir.
Les étoiles nous montrent notre couche :
La nuit tire les rideaux que le soleil écarte.
Musique et lumière font cortège à notre tête.
Toutes choses sont douces à notre chair
Dans leur origine et dans leur être ; à notre esprit,
Dans leur élévation et dans leur cause.
L'homme a plus de serviteurs
Qu'il n'y prend garde. Dans chaque sentier,
Il foule ce qui lui porte secours
Lorsque la maladie le laisse pâle et blême.
Ô puissant Amour ! L'homme est un monde
Auquel un autre fait escorte.
L'intuition de ce type de vérités est l'élément qui attire les hommes vers la science, mais la fin est perdue au profit des moyens. Étant donné cette semi-clairvoyance de la science, nous souscrivons à l'opinion de Platon, pour qui “la poésie s'approche plus près de la vérité que l'histoire”. Toute hypothèse et vaticination de l'esprit ont droit à un certain respect, et nous apprenons à préférer des théories imparfaites et des maximes qui contiennent des aperçus de la vérité à des systèmes aboutis n'ayant pas la moindre valeur suggestive. Un sage auteur sent que les fins de son étude ou de sa composition sont remplies au mieux lorsqu'il annonce la découverte de régions inexplorées de la pensée et qu'il insuffle ainsi, à travers l'espoir éveillé, une nouvelle activité à l'esprit engourdi.
Je conclurai donc cet essai en rapportant quelques traditions sur l'homme et la nature qu'un certain poète me chanta autrefois, et qui, du fait qu'elles ont toujours existé en ce monde et font peut-être leur réapparition avec chaque poète, peuvent être considérées à la fois comme historiques et prophétiques.
“Les fondements de l'homme ne sont pas dans la matière, mais dans l'esprit. Mais l'élément de l'esprit, c'est l'éternité. Pour lui, donc, les séries d'événements les plus longues, les périodes les plus reculées sont jeunes et récentes. Dans le cycle de l'homme universel, duquel procèdent les individus distincts, les siècles sont des points et l'histoire tout entière n'est que l'époque d'une seule et même décadence.
“Nous nous méfions de notre sympathie à l'égard de la nature et la renions intérieurement. Tour à tour, nous reconnaissons et désavouons notre relation avec elle. Nous sommes pareils à Nabuchodonosor lorsque, ayant perdu son trône et la raison, il mangeait de l'herbe comme un bœuf. Mais qui peut assigner des limites à la puissance curative de l'esprit ?
“L'homme est un dieu en ruines. Quand les hommes seront purs et innocents, la vie sera plus longue et glissera dans l'éternité aussi doucement que l'on s'éveille d'un rêve. Or, le monde deviendrait fou furieux si ces dérèglements devaient durer des centaines d'années. Ce qui fait échec à cela, c'est la mort et l'enfance. L'enfance est l'éternel Messie qui vient dans les bras des hommes faillis pour plaider auprès d'eux qu'ils s'en retournent au paradis.
“L'homme est le nain de lui-même. Jadis, il fut pénétré et dissous par l'esprit. Il emplit alors la nature de ses flots débordants. De lui jaillirent le soleil et la lune : le soleil de l'homme et la lune de la femme. Les lois de son esprit, les phases de ses actions se matérialisèrent dans le jour et la nuit, les saisons et l'année. Mais s'étant construit cette gigantesque coquille, ses eaux se retirèrent, il cessa d'en remplir les veines et les veinules et se rétrécit à la taille d'une goutte. Il voit que la structure s'ajuste toujours à lui, mais s'y ajuste de manière colossale. Ou plutôt qu'autrefois elle s'ajustait à lui et qu'aujourd'hui elle lui correspond de loin et de haut. Il adore timidement son œuvre. À présent, c'est l'homme qui suit le soleil et la femme la lune. Cependant, il sursaute parfois dans son sommeil et s'étonne de lui-même et de sa demeure et se prend à rêver étrangement à la ressemblance qui existe entre elle et lui. Il s'aperçoit que si sa loi est toujours souveraine, si son pouvoir reste essentiel et si sa parole a toujours cours dans la nature, ce n'est pas un pouvoir conscient, ce n'est pas inférieur, mais supérieur à sa volonté. Il s'agit de l'instinct.” Tel était le chant de mon poète orphique.
Aujourd'hui, l'homme ne consacre pas à la nature la moitié de ses forces. Il agit sur le monde avec sa seule intelligence. Il vit dans le monde et dirige ce dernier avec étroitesse d'esprit, et celui qui y travaille le plus n'est qu'une moitié d'homme : tandis que ses bras sont forts et que sa digestion est bonne, son esprit est abruti et lui-même n'est qu'un sauvage égoïste. Sa relation avec la nature, son pouvoir sur elle passent par son intelligence autant que par le fumier, l'utilisation économique du feu, du vent, de l'eau et de l'aiguille du marin, le charbon, l'agriculture chimique, les réparations du corps accomplies par le dentiste et le chirurgien. C'est une reconquête du pouvoir comparable à ce que serait celle d'un roi banni qui devrait racheter ses territoires pouce par pouce au lieu de sauter tout de suite sur son trône. En attendant, dans les ténèbres épaisses, des lueurs annonciatrices d'une plus grande lumière ne manquent pas – ces exemples çà et là de l'action de l'homme sur la nature à l'aide de toutes ses forces, avec sa raison aussi bien qu'avec son intelligence. Il en existe des manifestations depuis la plus haute antiquité dans les traditions de miracles de toutes les nations : dans l'histoire de Jésus-Christ ; à travers la réalisation d'un principe, comme dans les révolutions politiques et religieuses et l'abolition de l'esclavage ; dans les prodiges de l'enthousiasme, tels ceux que l'on rapporte au sujet de Swedenborg, de Hohenlohe et des Shakers ; dans maints faits obscurs et toujours débattus, que l'on range aujourd'hui sous le nom de magnétisme animal ; dans la prière, l'éloquence, les guérisons spontanées et la sagesse des enfants. Tous ces exemples témoignent de la prise en main momentanée du sceptre par la raison, de l'exercice d'une puissance qui n'existe pas dans le temps ou l'espace, mais qui est une force causale instantanée jaillissant intérieurement. La différence entre la force idéale de l'homme et sa force effective est heureusement exprimée par les scolastiques quand ils disent que la connaissance de l'homme est une connaissance du soir (vespertina cognitio), mais que celle de Dieu est une connaissance du matin (matutina cognitio).
Le problème de rendre au monde sa beauté originelle et éternelle trouve sa solution dans le rachat de l'âme. La ruine ou le vide que nous voyons dans la nature est dans notre œil. L'axe de la vision ne coïncide pas avec l'axe des choses, si bien qu'elles n'apparaissent pas transparentes mais opaques. La raison pour laquelle le monde manque d'unité et gît brisé et en morceaux, c'est que l'homme est séparé d'avec lui-même. Il ne peut étudier la nature tant qu'il ne satisfait pas à toutes les exigences de l'esprit. L'amour lui est aussi nécessaire que la faculté de percevoir. En fait, aucun des deux ne peut atteindre la perfection sans l'autre. Au plein sens du terme, la pensée est ferveur et la ferveur est pensée. La profondeur appelle la profondeur. Mais dans la vie réelle, le mariage n'est point célébré. Il existe des hommes simples qui adorent Dieu d'après les traditions de leurs pères, mais leur sens du devoir ne s'est pas étendu jusqu'ici à l'utilisation de toutes leurs facultés. Il existe des naturalistes patients, mais dont le sujet se change en glace à la lumière hivernale de leur intelligence. La prière n'est-elle pas aussi une étude de la vérité, un saut de l'âme dans l'infini insondable ? Jamais un homme n'a prié de tout son cœur sans avoir appris quelque chose. Mais lorsqu'un penseur sincère, décidé à détacher chaque objet de toute relation personnelle et à l'envisager à la seule lumière de la pensée, allumera en même temps la science au brasier des plus saintes affections, Dieu se mettra de nouveau en marche au sein de la création.
Il n'y aura nul besoin, quand l'esprit sera préparé à cette étude, de lui chercher des objets. La marque constante de la sagesse est de voir le miraculeux dans le banal. Qu'est-ce qu'un jour ? Qu'est-ce qu'une année ? Qu'est-ce que l'été ? Qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce qu'un enfant ? Qu'est-ce que le sommeil ? À nos yeux aveugles, ces choses paraissent sans intérêt. Nous créons des fables pour dissimuler la platitude du fait et le conformer, comme on dit, à la loi plus haute de l'esprit. Mais quand le fait est vu à la lumière d'une idée, le somptueux mensonge perd ses couleurs et se ratatine. Nous contemplons alors la véritable loi supérieure. Pour le sage, par conséquent, un fait représente la vraie poésie et la plus magnifique des fables. Ces merveilles sont à notre porte. Vous aussi, vous êtes un homme. L'homme, la femme et leur existence sociale, la pauvreté, le travail, le sommeil, la peur, la fortune sont connus de vous. Apprenez qu'aucune de ces choses n'est superficielle, mais que chaque phénomène plonge ses racines dans les facultés et les qualités de l'esprit. Tandis que votre esprit est occupé à une question abstraite, la nature la transporte dans le domaine du concret pour être résolue par vos mains. Ce serait une recherche des plus judicieuses de comparer point par point, et spécialement au moment des grandes crises de la vie, notre histoire journalière avec la naissance et le progrès des idées dans notre esprit.
Ainsi parviendrons-nous à regarder le monde avec des yeux neufs. Il doit répondre à l'interrogation sans fin de l'intellect (qu'est-ce que la vérité ?) et des sentiments (qu'est-ce que le bien ?), en se soumettant lui-même à la volonté éclairée. Il arrivera alors ce que disait mon poète : “La nature n'est pas figée, mais fluide. L'esprit la modifie, la modèle et l'accomplit. L'immobilité de la nature et son caractère brut marquent l'absence d'esprit ; pour le pur esprit, elle est fluide, elle est docile. Chaque esprit se construit pour lui-même une maison, et par-delà sa maison un monde, et par-delà son monde un ciel. C'est pour vous que le phénomène est parfait. Il n'est rien que nous puissions voir, sinon ce que nous sommes. Tout ce qu'Adam possédait, tout ce que César pouvait, vous l'avez et le pouvez. Adam appelait sa maison ciel et terre, César appelait la sienne Rome ; peut-être donnez-vous à la vôtre le nom d'échoppe de cordonnier, de cent acres de terre labourée ou de mansarde d'étudiant. Pourtant, ligne pour ligne et pouce pour pouce, votre domaine est aussi vaste que le leur, quoique ne portant pas un aussi joli nom. Bâtissez-vous par conséquent votre propre monde. À mesure que vous conformerez votre vie à la pure idée de votre esprit, il déploiera ses vastes dimensions. Une révolution correspondante accompagnera le flot de l'esprit. Dans la même mesure, les apparences désagréables, les pourceaux, les araignées, les serpents, les fléaux, les asiles d'aliénés, les prisons, les ennemis disparaîtront : ils sont provisoires et ne doivent plus être revus. La boue et les immondices de la nature, le soleil les séchera et le vent les dispersera. De même que lorsque l'été remonte du sud, les amas de neige se mettent à fondre et que la surface de la terre redevient verte à son approche, l'esprit en marche sèmera d'ornements les bords de son chemin et apportera avec lui la beauté qu'il visite et la chanson qui l'enchante ; il entraînera après lui les beaux visages, les cœurs généreux, les sages discours et les actions héroïques tout au long de sa route, jusqu'à ce que le mal ne soit plus visible. Le règne de l'homme sur la nature, ce royaume que l'observation ne saurait faire advenir – un domaine tel qu'il est à présent au-delà de son rêve de Dieu –, l'homme y entrera sans plus d'étonnement que n'en ressent un aveugle recouvrant peu à peu une vue parfaite.”

Notice
NOTICE
RALPH WALDO EMERSON voit le jour à Boston le 25 mai 1803. Descendant d'une famille établie de longue date en Nouvelle-Angleterre, qui compte de nombreux ministres protestants parmi ses membres – dont son propre père, qui meurt alors qu'il n'a que huit ans –, il embrasse lui-même une carrière de pasteur unitarien en 1826. Trois ans plus tard, il épouse Ellen Tucker, avec qui il connaît une union des plus heureuses, mais dont la mort, survenue après un an et demi de mariage, laisse Emerson profondément désemparé. À la suite de ce drame, il se détourne peu à peu de la religion, pour finalement renoncer définitivement à son ministère en 1832. Au retour d'un voyage en Europe, il s'installe à Concord, tranquille petite bourgade voisine de Boston, et se lance dans une fructueuse carrière de conférencier.
En 1836 paraît sa première œuvre, La Nature (si l'on excepte, toutefois, son Journal, peut-être son chef-d'œuvre, commencé à dix-sept ans et dont il poursuivra la rédaction toute sa vie), où sont vigoureusement exposés les grands thèmes de l'idéalisme philosophique qu'il n'aura de cesse de développer : critique du matérialisme et du formalisme religieux, foi en la toute-puissance de l'individu, communion avec la nature, croyance en l'existence d'un principe mystique (over-soul) gouvernant le monde. Bien que mal accueilli par la très grande majorité du public, dont il semblait heurter à plaisir la routine intellectuelle, ce premier essai pose d'emblée Emerson comme le maître à penser et le chef de file du mouvement transcendentaliste. C'est encore vers cette époque qu'outre son remariage avec une jeune fille de Plymouth, Lydia Jackson, il fait la connaissance d'un singulier jeune homme natif de Concord, Henry David Thoreau, qui deviendra tout à la fois un ami fidèle, son disciple le plus génial, et même à l'occasion, au fil d'une longue et complexe relation de plus de vingt ans, l'un de ses adversaires. Quelques années plus tard paraît Essais, première série (1841), suivi d'Essais, deuxième série (1847), ensemble de textes où il précise et approfondit l'orientation de sa pensée et qui correspond en même temps à la période la plus riche et la plus inspirée de sa carrière d'écrivain et de penseur. Sa réputation ne cesse dès lors de grandir, notamment en Angleterre, où il se rend de nouveau en 1847, année qui voit également la publication de son recueil Poèmes.
Au cours de la décennie suivante, Emerson s'implique de plus en plus dans le combat politique, et en premier lieu dans la lutte contre l'esclavage. Parallèlement à cette activité militante, il publie une série d'ouvrages – Hommes représentatifs (1850), L'Âme anglaise (1856), La Conduite de la vie (1860) –, à travers lesquels, sans rien renier de l'idéalisme de ses débuts, transparaissent un souci et un goût nettement plus accusés du réel. Après la guerre de Sécession, il continue à donner des conférences et à écrire, mais les livres qui voient le jour durant cette période, Société et Solitude (1870) ou Lettres et Buts sociaux (1876), semblent manquer désormais de l'enthousiasme et de la force de ses premières œuvres. Toutefois, quand Emerson, qui souffre à présent de pertes de mémoire et doit recourir de plus en plus à l'aide de ses proches, s'éteint le 27 avril 1882 à près de soixante-dix-neuf ans, c'est avec lui une figure majeure – et quasiment la première en date – de la pensée et de la littérature américaines qui disparaît, une sorte de père fondateur de l'histoire et de l'identité culturelles de son pays, sans lequel ni Hawthorne, ni Thoreau, ni Melville, ni Whitman ne seraient sans doute jamais devenus tout à fait ce qu'ils sont.

-
About & Around La Nature

Titre original et crédits
TITRE ORIGINAL
Nature
La Nature a paru pour la première fois en 1836.
© Éditions Allia, Paris, 2004, 2014, pour la traduction française.

Achevé de numériser
La Nature de Ralph Waldo Emerson
a paru aux éditions Allia en janvier 2004.
ISBN :
978-2-84485-932-7
ISBN de la présente version électronique :
978-2-84485-933-4
Éditions Allia
16, rue Charlemagne
75 004 Paris
