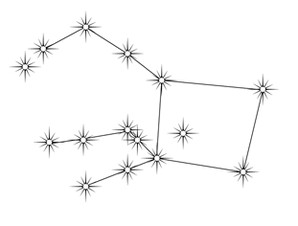CHAPITRE 1 - MASAMI KURUMADA, UN AUTEUR À SANG CHAUD
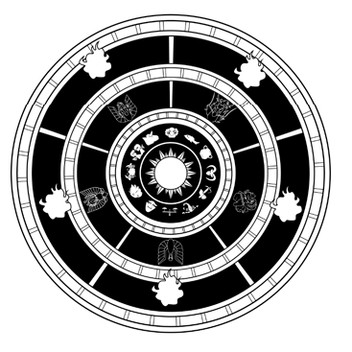
TROIS DÉCENNIES n’ont pas suffi à dissiper son aura, et pourtant bien des choses entourant la genèse du mythe Saint Seiya jusqu’à sa consécration restent encore dissimulées dans l’ombre de l’histoire officielle. Pour Masami Kurumada, né un 6 décembre sous la bienveillance de la constellation du Sagittaire, la flèche du centaure devint un guide précieux en 1985 lorsque son manga fit ses débuts dans les pages du Weekly Shônen jump. Mais l’histoire de sa création commence en réalité onze ans plus tôt, alors que l’auteur en devenir faisait encore ses premiers pas d’apprenti mangaka sans savoir jusqu’où sa route le mènerait.
Il y a tant à apprendre de la vingtaine d’œuvres imaginées par Kurumada en marge de Saint Seiya qu’il serait regrettable de ne pas sacrifier un peu de notre précieux temps à la redécouverte de ces histoires, pour la plupart restées inédites en Occident. Même en ne les abordant que dans l’optique d’y déceler les prémices de la création de Saint Seiya, elles ont déjà beaucoup à nous révéler sur leur auteur et son cheminement créatif. Comprendre d’où tout est issu et quelles furent les étapes clefs du parcours de Masami Kurumada en tant que mangaka, avant et après Saint Seiya, constituera donc le point de départ de notre analyse. Car le canevas de chacune de ces histoires forme bel et bien un tout. L’attachement sincère de l’auteur pour Ring ni Kakero, sa première œuvre au long cours, et son rôle dans la reprise de l’anime Saint Seiya seize ans après avoir été mis en pause, illustre on ne peut mieux cette nécessité de garder un point de vue global sur l’ensemble des créations de Kurumada.
Indissociable de l’impact de la série à l’international, l’adaptation animée semble avoir elle aussi une histoire à raconter, avec ses hommes de l’ombre auxquels il nous faudra bien évidemment rendre hommage. Derrière le succès de Saint Seiya se cachent en effet de nombreux autres passionnés parmi lesquels une nouvelle génération de mangaka respectueux du travail de Kurumada au point d’oser reprendre le flambeau que celui-ci leur a légué dans l’espoir que sa flamme ne s’éteigne jamais. C’est en compagnie de ces derniers que nous terminerons ce voyage créatif avant d’aller plus loin dans notre décodage du mythe.
Ne connaissant généralement de Masami Kurumada que Saint Seiya, l’œuvre qui l’a révélé à travers le monde, le public occidental ne sait pas forcément que l’ensemble de ses travaux s’articule pourtant autour de plus d’une vingtaine de titres imaginés entre 1974 et aujourd’hui. Dans le meilleur des cas, ses fans citeront peut-être les mangas Ring ni Kakero, Fûma no Kojirô ou B’t X. Mais parce que la grande majorité de ses créations n’a jamais été publiée en dehors du Japon, les lecteurs européens ignorent l’existence de la plupart d’entre elles. C’est pourtant bien en remontant le fil de toutes ces œuvres de jeunesse que l’on peut réellement commencer à appréhender le parcours de Kurumada en tant qu’auteur, tant celles-ci sont révélatrices du caractère du mangaka à ses débuts. C’est la raison pour laquelle nous nous attacherons à cerner la teneur de l’ensemble des œuvres non traduites signées de sa main, y compris les plus mineures, dans le but de ne pas perdre de vue le parallèle reliant la vie et l’œuvre de celui qui semble si proche de ces individus à sang chaud qu’il aime à dépeindre.
FERVEUR NEKKETSU
À l’image de nombre de ses contemporains, Masami Kurumada dut faire preuve d’une persévérance significative avant de connaître la consécration dans le milieu professionnel qu’il s’était choisi. D’une série à l’autre ou au gré d’histoires plus courtes, l’auteur apprit à s’affirmer sans renoncer à ses valeurs. Plus précisément, Kurumada apparaît aujourd’hui comme l’un des mangaka les plus représentatifs du style nekketsu, une sous-catégorie du shônen manga (mangas destinés à un jeune lectorat masculin) qui lui colle à la peau. Signifiant littéralement « sang bouillonnant », le terme nekketsu illustre sans équivoque la vigueur et la détermination des protagonistes qui peuplent ce genre d’histoires dans lesquelles nul ne sort victorieux sans aller au-delà de l’extrême limite de ses forces. Ces héros, qui se relèvent inexorablement en dépit des épreuves qu’ils endurent, sont devenus les idoles des amateurs de lectures shônen, qui se passionnent pour les destinées de Son Goku (Dragon Ball), Luffy (One Piece) et tant d’autres. Reconnaissable également à travers la récurrence de certaines ficelles narratives immuables, tel le fait d’y trouver un héros orphelin confronté à la dureté du monde et résolu à atteindre un but illusoire, le nekketsu ne justifie l’accomplissement de ses objectifs que dans l’union des forces de ses protagonistes. Généralement seul au début du récit, le personnage central ne peut gagner en maturité qu’au contact de rivaux appelés à devenir ses compagnons de route, la force de l’amitié surpassant nécessairement tous les obstacles susceptibles de les éloigner de leur quête. Cette volonté sans limites qui permet à l’individu de se relever quoi qu’il arrive n’est jamais innée, elle résulte de l’envie de se surpasser pour ne pas laisser l’injustice triompher, surtout lorsque la vie d’autrui est en danger.
Bien que ces règles du jeu puissent sembler un brin désuètes aux yeux des lecteurs d’aujourd’hui, ce sont pourtant bien elles qui ont permis au genre shônen de devenir si populaire au Japon et ailleurs, rares étant les lecteurs de mangas à ne pas s’être passionnés d’abord pour des titres aux valeurs nekketsu avant de s’intéresser à d’autres formes de créations.
UNE JEUNESSE REBELLE
Au-delà du fait que Saint Seiya reste encore aujourd’hui l’un des représentants les plus évidents de cette catégorie, il est intéressant de relever que son auteur lui-même apparaît comme viscéralement attaché aux valeurs fondamentales du nekketsu. Comme on peut le deviner au fil de ses interviews, et plus encore en parcourant ses œuvres de jeunesse, Masami Kurumada est un homme « à sang chaud ». Lycéen rebelle sauvé par ses talents émergents de dessinateur, il a évolué dans un contexte qu’il convient de resituer si l’on veut comprendre l’origine des premiers récits qui l’ont inspiré.
Né le 6 décembre 1953 dans le quartier Chûô-kû, à Tokyo, Masami Kurumada grandit, fils unique, sur l’île artificielle de Tsukishima, non loin du marché aux poissons de Tsukiji. Appréciée des touristes, Tsukishima est encore aujourd’hui surtout réputée pour sa spécialité culinaire locale : le monjayaki. Cette crêpe salée, généreusement fourrée aux légumes, aux crustacés, aux nouilles et à la viande, est à griller soi-même sur une plancha. Considéré comme un dérivé de l’okonomiyaki, l’un des plats japonais les plus incontournables dans les environs d’Osaka et de Hiroshima, le monjayaki est volontiers mentionné dans les interviews de Masami Kurumada, qui recommande de le déguster accompagné d’un dashi, un bouillon de poisson utilisé dans la plupart des plats de la cuisine traditionnelle japonaise.
Qualifié par ses professeurs de fauteur de troubles et se décrivant lui-même comme un adolescent peu recommandable durant toute la période où il fréquenta le lycée public de Nihonbashi, le jeune Masami fuyait les cours pour aller fumer dans les toilettes ou respirer du dissolvant. Dans une interview donnée en 1979 dans le quotidien Asahi Shinbun et relayée sur le site encyclopédique SaintSeiyapedia.com, Kurumada explique cette période d’insouciance par l’absence de but précis dans sa vie de lycéen. En dehors de son intérêt latent pour le dessin, le jeune homme occupait son temps de manière superficielle en multipliant les bagarres au sein d’une bande de délinquants dont il rêvait de devenir le chef. Dans une interview plus tardive publiée dans le databook Cosmo Special de 1988, Kurumada précisera que cette réputation de délinquant reste tout de même assez éloignée de la vérité, car librement amplifiée par son responsable éditorial de l’époque, même s’il reconnaît avoir joué au dur pendant ses années de lycée. Son intérêt pour l’art du combat, il le développe dès l’âge de quinze ans à travers l’apprentissage du judo, qu’il pratique en club durant plusieurs années.
Comme il le raconte indirectement dans son manga semi-autobiographique romancé Ai no Jidai : Ichigo Ichie, dont les chapitres ont été publiés en 2015 dans le magazine Shônen Champion, les yakuzas exerçaient alors une véritable fascination sur la plupart des jeunes des années 1970. Délinquants et hors-la-loi étaient perçus comme des héros et largement idéalisés, pour la simple raison qu’ils avaient l’audace de s’opposer aux autorités. Ce court manga donne le sentiment que Masami Kurumada regrette a posteriori de n’avoir pas pris conscience plus tôt de ce que faisaient réellement ces individus, et d’avoir peut-être, à travers ses premières œuvres, encouragé la jeunesse nippone à compromettre son avenir en empruntant des voies peu recommandables. L’attachement que l’auteur met dans ce manga à désacraliser ces faux héros, dépeints pour ce qu’ils sont, à savoir des êtres malhonnêtes et méprisables, ne laisse que peu de doutes sur la sincérité de son repentir.
Ai no Jidai : Ichigo Ichie révèle aussi les doutes qui n’ont eu de cesse de tourmenter l’auteur quant à sa légitimité en tant que mangaka. Conscient qu’il n’était pas doté de facultés innées en dessin, cette voie-là n’en représentait pas moins à ses yeux le meilleur moyen de rattraper ses errements de jeunesse pour aspirer à une vie honnête et saine. Faire carrière dans le manga quelles que soient les difficultés, n’était-ce pas un défi à la hauteur de ce fervent défenseur des valeurs nekketsu ?
BANCHO SUKEBAN, PHENOMENE CULTUREL ET SOCIAL
C’est ici qu’il convient de resituer le contexte de cette époque mouvementée dans laquelle l’auteur a évolué, la décennie 1960-1970 étant fortement marquée au Japon par l’avènement des fameux banchô. Ces gangs de délinquants masculins qui nourrirent l’imaginaire de Kurumada durant toute sa carrière de mangaka, il les idéalisait vraisemblablement, évoquant avec nostalgie une adolescence où tous les jeunes aspiraient à se rebeller. Dans l’imagerie populaire nippone, l’uniforme noir à casquette, caractéristique des banchô, contribua très certainement à l’effet « cool » (le terme kakkoii japonais, que l’on peut aussi traduire par « stylé ») dégagé par ces individus violents, toujours prompts à s’affronter entre gangs rivaux. Sur ce sujet, Kurumada précise : « Il serait exagéré de dire que j’étais un banchô. Pendant les cours je lançais des œufs crus sur le professeur pendant qu’il regardait le tableau, j’envoyais des avions en papier après y avoir mis le feu, bref je faisais juste de mauvaises blagues. Mais je n’allais pas en cours la plupart du temps. Je passais plutôt mes journées à jouer au mah-jong. »
Dès lors, comment s’étonner des thèmes de prédilection retenus par cet aspirant mangaka pour percer dans le registre des sagas de banchô, alors très en vogue à cette période-là ? Dans le sillage d’Hiroshi Motomiya (Salaryman Kintarô, Je ne suis pas mort) dont il avait lu le manga Otoko Ippiki Gaki Daishô durant ses années de lycée, Kurumada comprend qu’il peut s’inspirer de ses expériences personnelles pour imaginer des histoires en phase avec son temps. Mettant à l’honneur de véritables stéréotypes de virilité masculine exagérément combatifs et n’ayant pas peur des coups, la vague des héros de banchô dans les pages des mangas shônen traduisait peut-être, aux yeux des jeunes lecteurs rebelles de l’époque, une manière de sortir du lot dans la vie réelle. Forts d’un héroïsme tout relatif, ces durs à cuire œuvrant au nom de la justice redressaient les torts par la violence, le plus souvent dans une mare de sang, et les premiers protagonistes imaginés par Kurumada ne font pas exception.
La première histoire qu’il réalise dans le cadre d’un concours pour aspirants mangaka lors de sa dernière année de lycée lui ouvre les portes du milieu en tant qu’assistant. Lorsque l’auteur revient sur cet événement via une interview publiée dans les pages du databook Cosmo Special de 1988, il tient à démentir certaines rumeurs prétendant qu’il serait entré de force au département d’édition du Weekly Shônen Jump pour exiger un retour sur le manga qu’il leur avait envoyé ! En réalité, si le jeune Kurumada était exagérément confiant quant au potentiel de ses travaux réalisés dans le cadre du concours Hop Step (l’ancêtre du prix Young Jump), il raconte s’être simplement rendu sur place afin de savoir pourquoi il n’avait pas été retenu ni obtenu de mention à titre honorifique. Reçu par un éditeur, il apprit ainsi que la Shûeisha était justement en quête d’assistants pour la réalisation des chapitres du manga Samurai Giants, ce qui lui permit de débuter son apprentissage sur le terrain aux côtés de Maître Koo Inoue avant même la fin de sa dernière année de lycée.
Masami Kurumada se lance ensuite seul dans les pages du déjà célèbre magazine de prépublication Weekly Shônen Jump avec une première série publiée entre 1974 et 1975 : Sukeban Arashi. Cette fois, ce ne sont pas les banchô qui sont à l’honneur, mais leur équivalent féminin, défini par le terme sukeban qui désigne des gangs de jeunes délinquantes. N’ayant pas leur place dans le milieu sexiste et hiérarchisé des banchô, les adolescentes au sang chaud commencèrent, dès la décennie 1970-1980, à se regrouper sous la bannière des sukeban. Même si l’on peut y déceler une amorce de l’émancipation de la femme au Japon, ces jeunes femmes rebelles n’en affichaient pas moins les mêmes travers que leurs homologues masculins. Soumises à des règles strictes et à des punitions corporelles sévères en cas de manquement à leurs codes, les membres de ces clans entretenaient une image de femmes indomptables et violentes que la jeunesse pouvait parfois idéaliser.
Avec son manga Sukeban Arashi (que l’on pourrait se hasarder à traduire par Tempête délinquante), Masami Kurumada dévoile sa propre conception de l’adolescente rebelle, à travers le personnage de Rei Kôjin’yama. Plus prompte à répondre à coups de nunchaku qu’à entamer des pourparlers avec ses interlocuteurs, cette jeune fille issue d’une famille modeste voit son quotidien bouleversé par l’arrivée d’une certaine Shizuka Ayakôji dans son entourage scolaire. Tout les oppose, le sérieux et la sérénité de Shizuka contrastant avec la fougue souvent mal contrôlée de Rei, dont la fâcheuse tendance à s’endormir en cours en a depuis longtemps fait le cancre de la classe. Véritable alter ego physique de celui qui deviendra plus tard Tatsumi, majordome de la famille Kido dans Saint Seiya, le colosse Tôdô sert les quatre volontés de l’héritière des Ayakôji et envoie des gangs de banchô et de sukeban donner une leçon à Rei chaque fois que sa maîtresse le lui commande. L’attitude de Shizuka elle-même rappelle d’ailleurs beaucoup le comportement de Saori enfant lorsqu’elle prenait de haut tous ces jeunes chevaliers censés servir ses quatre volontés. À bien y regarder, il semble y avoir aussi quelque chose du caractère provocateur de Rei dans le personnage de Seiya tel que l’imaginera Kurumada au début de la série, même si cet aspect sera légèrement atténué dans la version animée.
Sur le ton de la comédie, Sukeban Arashi dérape pourtant à plusieurs reprises sur les rails glissants de la violence gratuite, comme si le jeune Masami Kurumada, du haut de ses vingt et un ans, ne savait pas encore sur quel pied danser. Son trait rond et caricatural, qui confère au manga un cachet old school un peu naïf, dessert ainsi toute tentative de dramaturgie, la simplicité du scénario ne permettant jamais non plus de prendre ces péripéties extrascolaires au sérieux. Les rares scènes un peu gores semblent même totalement hors de propos, rien ne justifiant par exemple la mise à mort d’un inoffensif petit chiot, broyé entre les mâchoires d’un molosse au détour d’une case sanglante, ni les tentatives de meurtre fomentées par Shizuka à l’encontre de sa rivale Rei. On a le sentiment que l’auteur ne parvient pas à trouver de prétextes valables à la confrontation entre les deux jeunes filles, leurs différends se réglant finalement lors d’un match de foot improbable, rollers aux pieds ! Au fil des chapitres, on note tout de même avec intérêt l’évocation de techniques spéciales de combat que l’auteur prend déjà la peine de baptiser, ce qui deviendra un élément indissociable de ses œuvres à venir. Afin de surpasser le « Jumping Jack Flash » qui voit son adversaire interrompre sa chute dans les airs avant de retomber violemment, Rei doit par exemple apprendre à maîtriser le « Miracle Over Head Kick ». Dans le manga, cette technique légendaire est décrite comme une invention du roi Pelé, le célèbre joueur de foot brésilien.
Faute de succès, la série sera rapidement stoppée, ne s’étalant en définitive que sur dix-sept chapitres, qui n’auront guère convaincu les lecteurs du Jump, en dépit de quelques sursauts de popularité auprès d’un lectorat déjà mixte. Concernant l’arrêt de Sukeban Arashi, Kurumada met surtout en cause le contexte économique de l’époque fortement bouleversé par le premier choc pétrolier de 1973. Le papier étant devenu difficile à se procurer, le magazine fut contraint, comme beaucoup d’autres, à revoir à la baisse son nombre de pages, sacrifiant au passage plusieurs séries. On devine facilement l’amertume extrême ressentie alors par le jeune auteur, qui n’envisageait certainement pas l’avenir de cette première œuvre de cette manière-là.
À l’occasion de la publication de Sukeban Arashi en volumes reliés, trois ans plus tard, Masami Kurumada s’exprime en ces termes sur le rabat de couverture du premier tankôbon (livre au format poche) édité dans la collection « Jump Super Comics » : « J’ai débuté dans le monde du manga avec ce titre, Sukeban Arashi, l’été de mes vingt ans. À cette époque-là, je n’avais encore derrière moi qu’une expérience de simple assistant. Lorsque j’ai pris entre mes mains le fruit du premier boulot de ma vie, à savoir ce livre, je l’ai lu dans un restaurant, puis dans un bar, et dans mon minuscule appartement de quatre tatamis et demi (7,45 m2...) qui était si sombre et qui sentait le renfermé. Je l’ai lu tant et tant de fois... ah... quelle satisfaction ! » Puis, en ouverture du second tankôbon : « Lorsque j’ai appris que mon œuvre Sukeban Arashi allait être publiée en volumes reliés, j’ai eu l’impression de recevoir le coup de pied d’un gymnaste en pleine figure. Bien que seulement trois ans se soient écoulés, quand je revois ce manga maintenant, je me dis : quel vieux coup de crayon, quelle histoire vieillotte ! Ah, peu importe ! » Il est amusant de constater que la réaction de l’auteur est autant mêlée de fierté, pour être parvenu à publier si jeune un manga en volumes reliés, que de gêne, constatant probablement déjà que son titre pouvait paraître démodé une fois sorti du contexte bien particulier de l’époque.
Phénomène social et culturel, la vague des banchô et sukeban aura inspiré bien d’autres artistes japonais durant ces années-là et par la suite. Parmi les exemples les plus parlants pour le public occidental, on retiendra notamment le personnage de Kyôko Honda, la mère de l’héroïne de Fruits Basket (de Natsuki Takaya), surnommée « le Papillon Rouge » en raison de la traînée lumineuse que les phares de sa moto laissaient sur son sillage. Ou encore Sayaka Ryûjin, la fille d’un chef de gang dans les pages de City Hunter (Tsukasa Hôjô). Bien d’autres exemples pourraient également être relevés dans des mangas plus récents tels Enfer et Paradis (Oh ! Great), Ikki Tôsen (Yûji Shiozaki) ou encore Beelzebub (Ryûhei Tamura). Au-delà du manga, le magistral Shenmue de SEGA, chef-d’œuvre du jeu vidéo signé Yû Suzuki, voyait aussi son héros Ryô Hazuki aux prises avec des sukeban dans un règlement de comptes mineur.
Une fois le dernier chapitre de Sukeban Arashi terminé, l’aventure Weekly Shônen Jump ne s’interrompt pas et Kurumada propose immédiatement une histoire courte, intitulée Mikereko Rock, qui se voit éditée dans le magazine de prépublication en 1975. Placé lui aussi sous le signe de la comédie d’action, Mikereko Rock dépeint en quelques pages la persévérance d’une jeune fille au caractère bien trempé qui ressemble beaucoup à l’héroïne de Sukeban Arashi, toutes deux étant promptes à réagir à chaud par l’intermédiaire de leur nunchaku. La promesse faite au jeune fils d’un fermier malmené par des motards de laisser de côté son deux-roues pour l’aider à labourer son champ révèle rapidement le caractère nekketsu de la jeune fille qui travaille la terre sans relâche. L’histoire se termine par une confrontation musclée à moto contre le chef du gang dans le soleil couchant...
DANS LE SILLACE DE JOE YABUKI
À partir de l’année 1968, tout un pan de la jeunesse nippone s’enflamme pour le destin hors-norme de Joe Yabuki, le héros boxeur du manga Ashita no Joe. Réalisé par Tetsuya Chiba et Asao Takamori, cette œuvre coup de poing, prépubliée jusqu’en 1973 dans le Weekly Shônen Magazine des éditions Kôdansha, obtint rapidement le statut de référence et d’incontournable, avec un impact significatif sur les mentalités de l’époque. Portant en lui la flamme de la rébellion, Joe Yabuki prend sa revanche sur la vie en traçant son destin sur le ring, son ascension en tant que boxeur lui permettant d’acquérir la maturité qui lui faisait défaut à ses débuts, alors qu’il n’était encore qu’un orphelin bagarreur et violent, sans foi ni loi. Pilier de l’évolution du shônen manga, Ashita no Joe est surtout parvenu à dresser un pont entre l’esprit nekketsu des séries pour adolescents et le style gekiga destiné à un public d’adultes. Caractérisés par leur teneur réaliste souvent dramatique, les mangas de type gekiga étaient particulièrement en vogue au Japon durant la décennie 1960-1970, s’efforçant de pointer du doigt de manière crue les inégalités sociales et autres thèmes sujets à polémiques. Takao Saitô, l’auteur de Golgo 13, en fut l’un des principaux représentants, et Masami Kurumada ne cache pas avoir été profondément influencé par ce courant-là, tout autant que par les œuvres de Mitsuteru Yokoyama (Iga no Kagemaru, Giant Robo, Babel II, Sangohushî) ou Sanpei Shirato (Kamui Den), et bien sûr Osamu Tezuka dont il lisait les aventures d’Astro (Tetsuwan Atom en version originale) à l’école primaire.
S’il ne cite pas systématiquement Tetsuya Chiba et Asao Takamori comme source d’inspiration, il est évident que Kurumada n’a pas été épargné par l’onde de choc qui s’est propagée lors de la prépublication du manga Ashita no Joe, la recevant même de plein fouet au point de tenter de se réapproprier ses fondamentaux. La lecture de sa propre série de boxe Ring ni Kakero, lancée en 1977 dans le Weekly Shônen Jump, révèle ainsi nombre de similitudes frappantes entre les deux œuvres. À l’aide d’un coup de crayon plus incisif et moderne que celui de son modèle, bien que sensiblement plus maladroit, Masami Kurumada trace l’ascension d’un autre adolescent issu d’un milieu social défavorisé qui trouve sa raison de vivre dans la boxe. Dans Ring ni Kakero tout comme dans Ashita no Joe, l’apprentissage des techniques de combat passe nécessairement par un intermédiaire plus âgé qui dispense au compte-gouttes son savoir à son élève. Derrière les barreaux de sa cellule, Joe Yabuki guette chaque jour avec empressement l’arrivée des précieuses lettres que lui envoie le vétéran Danpei Tange au centre d’éducation spécialisé, tandis que l’éventail de coups de Ryûji Takane s’étoffe suivant le bon vouloir de sa sœur Kiku, qui lui prodigue l’enseignement légué par leur père, un ancien boxeur professionnel décédé. Dans les deux cas, l’apprentissage est on ne peut plus sporadique, mais les progrès se révèlent d’autant plus significatifs que les aspirants boxeurs font preuve d’une motivation sans limites, comme l’exige le dépassement de soi caractéristique du shônen nekketsu. La fin tragique et mémorable des protagonistes ainsi que l’évocation récurrente de grands noms du monde de la boxe comptent également parmi les points communs les plus évidents qui relient Ashita no Joe à Ring ni Kakero. Dans une interview donnée à Fuji TV en 2003, Kurumada estime qu’il est tout simplement « impossible de surpasser Ashita no Joe quand il s’agit de véritable boxe ». Il trouvera donc les moyens d’exprimer son propre style en imaginant des techniques spéciales surréalistes qui deviendront indissociables de ses mangas.
Jusqu’en 1983, Masami Kurumada noircira les pages de ce qu’il considère aujourd’hui comme sa création favorite, le succès de Ring ni Kakero auprès du public japonais lui ayant ouvert les portes de la notoriété bien avant les débuts de Saint Seiya. Couvrant pas moins de vingt-cinq tankôbon (volumes reliés) et occupant une place essentielle dans la carrière de l’auteur, cette série reste, hélas, injustement méconnue en dehors du Japon, seule la première saison de la version animée, qui n’adapte, du reste, qu’une brève partie de l’histoire du manga, ayant été éditée en France.
Ring ni Kakero reste pourtant la création la plus révélatrice de l’évolution du style de l’auteur en regard de ses premiers essais en tant que mangaka. La redécouvrir aujourd’hui permet d’apprécier le cheminement personnel d’un auteur qui se cherche, ne sachant pas encore très bien quelle forme donner à une série qui prend son temps avant de parvenir à maturité, oscillant parfois du registre de la comédie à celui d’une dramaturgie vaguement inspirée des œuvres de gekiga. Gorgée d’un investissement personnel évident de la part de Kurumada, la réalisation de Ring ni Kakero explique, bien plus qu’on ne l’imagine au départ, la forme que prendront l’ensemble de ses mangas ultérieurs. Son décryptage nous semble donc primordial pour mieux comprendre certains aspects fondamentaux de l’origine de Saint Seiya.
RING NI KAKERO : UNE EBAUCHE POUR SAINT SEIYA ?
Encore fortement imprégnés des thématiques déjà évoquées dans Sukeban Arashi et Mikereko Rock, décidément révélatrices des préoccupations de l’auteur en 1977, les premiers chapitres de Ring ni Kakero déstabiliseraient quiconque s’attendrait à y déceler les traces de la genèse de Saint Seiya. Car avant d’arborer la forme d’un véritable manga d’action, la série de boxe de Kurumada emprunte d’abord plus volontiers le ton de la comédie. Plutôt bavard et relatant les péripéties de deux enfants confrontés à un beau-père violent qui fuguent en direction de la capitale vers un avenir incertain, le manga s’articule autour de protagonistes encore très jeunes (Ryûji Takane est en primaire, sa sœur Kiku est au collège), qui tentent de s’extirper d’un milieu social défavorisé.
Quasiment inexistante dans ces premiers chapitres, l’action survient brutalement par l’intermédiaire d’un match improvisé aux allures de règlement de comptes entre Ryûji et son futur rival Jun Kenzaki, jeune prodige de la boxe. À mesure que son héros prend ses marques sur le ring, l’auteur lui-même installe les prémices de son style, délaissant de plus en plus les épisodes cartoonesques au profit de la violence des matchs. Mais au lieu de s’aventurer sur le terrain glissant du réalisme, le mangaka préfère au contraire accentuer la démesure des combats, faisant du ring un lieu d’expérimentation idéal pour dépeindre des techniques spéciales de plus en plus fantaisistes. Très tôt, la silhouette d’animaux sauvages ou fantastiques se dessine en arrière-plan des attaques, exactement comme les futures constellations des chevaliers du zodiaque. La relation de maître à élève entre la sœur aînée et le frère cadet est également tout à fait comparable à celle qui liera Marine à son disciple Pégase tout au long de Saint Seiya.
Dès les premiers volumes, Ring ni Kakero regorge ainsi d’éléments qui seront repris et approfondis des années plus tard dans l’œuvre maîtresse de Kurumada. On y trouve par exemple l’origine des fameux échanges de coups portés trop rapidement pour qu’un œil non exercé ne parvienne à les suivre à vitesse réelle. Ainsi, lors du troisième match opposant Ryûji à Jun en finale de la compétition individuelle du tournoi de Tokyo, les commentateurs sont déjà contraints de faire appel au ralenti pour distinguer les frappes portées par les deux boxeurs. L’auteur dit alors s’inspirer d’une légende chinoise relatant le combat entre un tigre et un dragon qui n’eut jamais de témoins tant sa vitesse le rendait invisible aux yeux des simples mortels.
À l’approche du tournoi mondial, l’auteur écarte subitement l’idée d’un héros unique pour dresser les profils des cinq membres de l’équipe junior japonaise. Ryûji Takane et son rival Jun Kenzaki avancent désormais vers un même objectif aux côtés de trois autres fortes personnalités : Katori Ishimatsu, Kazuki Shinatora et Takeshi Kawai. Si le raccourci consistant à voir en chacun d’entre eux un alter ego des chevaliers de bronze nous semble un peu précipité, la comparaison reste néanmoins révélatrice d’une volonté de proposer des individualités très marquées. Parce qu’ils ne se ressemblent en rien et que leurs motivations profondes divergent, les membres de l’équipe japonaise apportent à l’auteur l’inspiration nécessaire pour renouveler les matchs sur le ring. Si, pour les oreilles averties du pianiste Takeshi Kawai, le style de chaque adversaire dessine une mélodie bien spécifique, ces duels sont pour l’héritier de la famille Shinatora l’occasion d’appliquer à la boxe des techniques proches de celles du kendô (« la voie du sabre »). Même le cliché du guerrier solitaire ivre de haine trouvera sa place dans les pages de Ring ni Kakero par l’intermédiaire de Sôsui, leader du clan Shadow condamné à vivre dans les ténèbres. Frère caché de Jun Kenzaki, écarté à la naissance par une famille ne pouvant reconnaître deux héritiers jumeaux, Sôsui ne serait-il pas déjà l’ébauche d’Ikki, chevalier du Phénix revenu de l’enfer pour se venger dans Saint Seiya ?
Ce genre d’archétypes étant légion, même à l’époque de la prépublication de Ring ni Kakero, le succès du manga auprès du public japonais trouve sans doute davantage son explication dans le character design novateur propre à Kurumada. Le jeune auteur ose en effet imprégner la plupart de ces figures typiques des mangas shônen d’une beauté androgyne réservée jusque-là aux lectures shôjo (pour jeunes filles). Les visages fins, les chevelures longues et les attitudes dignes contrastent avec la virilité un brin machiste de ses autres héros plus volontiers tournés en dérision. Le design de certains d’entre eux s’avère parfois si ambigu que le doute serait presque permis quant à leur genre s’il n’y avait dans leur regard cette dureté teintée de détermination absolue. Ce character design propre à Kurumada contribue d’ailleurs à rendre chacune de ses œuvres immédiatement identifiables, expliquant en partie l’attrait de ses séries pour un lectorat autant masculin que féminin. En contrepartie, il faut bien admettre que les individus se ressemblent beaucoup d’un manga à l’autre. Ils peuvent même paraître disproportionnés selon les angles de vue choisis lorsque leurs corps sont dessinés dans leur intégralité, les jambes étant la plupart du temps trop courtes, comme le reconnaîtra plus tard l’auteur, une fois confronté à ces mêmes personnages dans leur version retravaillée par les animateurs.
L’OCCIDENT VU PAR LE PRISME D’UN AUTEUR JAPONAIS
Lors de la création de Ring ni Kakero, Masami Kurumada n’avait à l’évidence pas projeté l’éventualité d’une publication de sa série à l’international, tant il écorche violemment les nations opposées au Japon durant le tournoi mondial de boxe junior. Aucun pays n’est épargné et chacun en prend pour son grade, les compétiteurs choisis pour représenter chaque nation versant à ce point dans le cliché et la caricature qu’il faut réellement prendre de la distance pour apprécier à sa juste valeur la lecture de cet arc majeur du manga.
Bien qu’ils soient appelés à décrocher une victoire totale systématique sur leurs adversaires, les Japonais sont surveillés de près par l’équipe allemande, qui affiche ouvertement ses ambitions dominatrices, véhiculant au passage toute l’imagerie de l’idéologie nazie. Croix gammée, uniformes militaires et emblèmes de l’aigle réduisent à ce qu’il y a de pire les redoutables boxeurs allemands qui héritent de noms tels que Führer Skorpion, Himmler, Goering ou Goebbels. Si Masami Kurumada n’est pas allé chercher très loin les patronymes de ces personnages fictifs, qui n’ont heureusement pas grand-chose à voir avec les hommes d’Hitler éponymes, il est évident que l’auteur ne cautionne pas l’idéologie nazie. Les Allemands sont avant tout les adversaires du Japon dans le cadre du tournoi mondial et Ryûji refuse catégoriquement l’alliance proposée par ces derniers. Malgré tout, l’utilisation de tels codes paraît aujourd’hui bien maladroite. La Seconde Guerre mondiale semble bel et bien avoir laissé des traces, comme en témoigne cette vision d’une Allemagne crainte de tous les autres pays, Japon inclus.
Guère mieux lotie, l’Italie ne semble être perçue par l’auteur que comme un sinistre repaire de mafieux ! Les dandys siciliens sont décrits dans Ring ni Kakero comme prêts à tout pour liquider les gêneurs potentiels, menaçant et neutralisant l’ensemble de leurs adversaires avant les matchs pour enchaîner les victoires par abandon. Pour leur leader, Don Juliano, la boxe n’est pas un sport, mais un prétexte à la violence sous toutes ses formes. Une vision que partage assez l’équipe américaine, composée des pires criminels de l’Ouest, venus non pas pour boxer, mais pour écraser le Japon. Si le recours à un truand, un travesti et un condamné à mort frôle déjà la limite, l’évocation d’un descendant du fondateur du Ku Klux Klan semble avoir posé davantage de problèmes aux responsables de l’anime qui feront le choix de réduire ce personnage à une superstar imbue de sa personne. Dans la version manga de Ring ni Kakero, Black Shaft, le leader de l’équipe américaine, compte pourtant sur la haine raciale de cet individu pour massacrer les boxeurs japonais. Le moins que l’on puisse dire est qu’aucun de ces représentants américains n’a la moindre chance de faire de l’ombre à Ryûji et ses compagnons en s’attirant la sympathie du lecteur.
Symbole du romantisme profondément ancré dans l’esprit des contemporains de Masami Kurumada depuis la consécration du manga Versailles no Bara (La Rose de Versailles ou Lady Oscar en version française) de Riyoko Ikeda en 1972, la France fait elle aussi l’objet d’éternels clichés dans Ring ni Kakero. Fantasmée et idéalisée, elle se réduit à une élite vivant dans un manoir digne du château de Versailles. Et, comme s’il ne pouvait en être autrement, la famille Valois n’est composée que de jeunes éphèbes androgynes dont le design renvoie immanquablement à celui d’Oscar François de Jarjayes, l’héroïne travestie du manga d’Ikeda. Napoléon Valois et ses frères, Félista, Tiphanie, Sylvie et Claudine, arborent tous le même design caricatural reconnaissable à ses prunelles bleues, ses longues boucles blondes et ses uniformes d’apparat, sans oublier la petite rose dans la bouche et le verre de vin rouge à la main... et tant pis si les noms qu’ils portent ne sont pas franchement masculins !
Patriotisme oblige, le Japon obtient une victoire sans appel contre chacun de ses opposants, traçant vaillamment sa route jusqu’en finale où le pays est contraint d’affronter la Grèce, patrie des dieux et berceau de l’esprit olympique. En toute logique, les membres de l’équipe grecque sont affublés de toges blanches et héritent de patronymes dignes de leur stature divine. Apollon, Thésée, Icare, Ulysse et Orphée semblent ainsi posséder des pouvoirs interdits aux simples mortels, car ils sont la réincarnation des divinités de l’Olympe. En somme, cet arc de Ring ni Kakero dévoile déjà clairement l’envie de l’auteur de faire intervenir la mythologie grecque dans un contexte qui pourtant ne s’y prête pas vraiment. La transition vers Saint Seiya est d’ailleurs d’autant plus perceptible que les deux séries partagent par ailleurs bien d’autres thèmes communs, notamment la boîte de Pandore et les vertus du Misopethamenos qui seront au cœur de l’arc Hadès dans Saint Seiya.
LE SACRIFICE DE SOI COMME SEULE CONCLUSION POSSIBLE ?
En 1973, la fin de la prépublication du manga Ashita no Joe au Japon laissa d’innombrables lecteurs meurtris par le destin tragique de deux de ses acteurs principaux. Rival d’exception de l’indomptable Joe, érigé sur un piédestal par le héros lui-même, le boxeur Tôru Rikiishi était allé jusqu’à s’amaigrir de manière extrême pour descendre en catégorie de poids afin d’affronter Joe Yabuki sur le ring. Sa force de volonté n’ayant d’égale que ses talents sportifs exceptionnels, Rikiishi s’écroula juste après sa victoire, conséquence inévitable de ses privations inhumaines et des frappes ravageuses de son adversaire. Point culminant du récit, le décès de Rikiishi voit aussi Yabuki sombrer dans une démence telle qu’il n’est alors plus que l’ombre de lui-même, culpabilisant pour la mort de celui qu’il respectait le plus et qui le prive désormais de toute raison de vivre. Joe se relèvera finalement au prix de terribles épreuves... pour faire ses adieux sur le ring quelques volumes plus tard, terrassé d’épuisement, mais enfin en paix avec lui-même. Cette image du protagoniste, à la fois mort et souriant, qui semble s’effacer et disparaître dans la blancheur de la page, hantera les lecteurs d’Ashita no Joe autant qu’elle marquera les nouvelles générations de mangaka. L’anecdote raconte qu’à la mort de Rikiishi, l’éditeur Kôdansha croula sous les lettres de fans inconsolables, au point d’organiser des funérailles réelles réunissant plusieurs centaines de personnes pour ce boxeur fictif qui avait tant marqué son époque.
Nul doute que Masami Kurumada, lui aussi, sortit changé de cette tragédie. Car, à la fin du tournoi mondial, seule la mort semble en mesure d’offrir une fin digne de la détermination à toute épreuve des membres de l’équipe japonaise de Ring ni Kakero. Confrontés à leurs adversaires grecs dotés de capacités divines, Shinatora, Kawai, Ishimatsu, Kenzaki et Takane ne décrochent la victoire qu’au prix de leur sacrifice. Ils ne meurent pas parce qu’ils ont subi trop de blessures. Ils sont détruits par leurs propres attaques ultimes, tels des kamikazes japonais. Ils se battent avec leur propre vie et c’est elle qui leur permet de vaincre même les dieux. Cette hécatombe mémorable deviendra par la suite un ressort narratif récurrent dans les œuvres de Masami Kurumada, tout particulièrement dans Saint Seiya où les chevaliers de bronze n’hésiteront pas non plus à se consumer durant leurs combats face aux chevaliers d’or.
On sent bien, par ailleurs, que le ring ne suffit plus à l’auteur pour exprimer la puissance et la démesure des combats qu’il aspire à mettre en scène. Lors du match entre Kenzaki et Thésée, la surface du ring est littéralement brûlée et lacérée suite à la collision frontale des deux techniques, l’impact étant décrit comme ressemblant à celui d’une bombe atomique heurtant une bombe à hydrogène ! Aux antipodes du réalisme des matchs d’Ashita no Joe, les affrontements de Ring ni Kakero font des boxeurs de véritables surhommes dotés de coups spéciaux toujours plus fantaisistes. Inspiré par la technique du boxeur réel Kid McCoy en 1896, et popularisé notamment par l’intermédiaire du jeu vidéo Street Fighter III à travers le personnage de Dudley, le « Corkscrew Blow » est présenté par Kurumada comme étant un coup de poing légendaire à double tranchant. Son effet tire-bouchon emmagasine en effet l’énergie contenue dans le bras pour décupler la puissance des poings, mais endommage sérieusement le corps de son utilisateur, en l’occurrence celui de Ryûji. Avec des attaques aussi surréalistes que le Hurricane Bolt, le Special Rolling Thunder ou le Galactica Magnum, les échanges de coups de Ring ni Kakero trahissent le désir de l’auteur de s’affranchir des contraintes trop restrictives du ring. C’est encore un pas de plus vers les confrontations prodigieuses à venir dans Saint Seiya.
MYTHOLOGIES ET RELIGIONS
À ce stade de son développement, l’histoire de Ring ni Kakero revêt des airs de grand final pouvant laisser présager de l’arrêt imminent de la série. Mais dans une interview donnée au magazine Animec de juin 1981, Kurumada précise que, si son intention première était de clore le récit à l’issue du tournoi mondial, la popularité croissante du manga l’incita finalement à prolonger ce dernier au travers d’un arc narratif supplémentaire, inédit en anime. À l’aide d’une pirouette scénaristique potentiellement acceptable aux yeux des lecteurs de shônen manga, l’auteur orchestre donc rapidement la renaissance de ses protagonistes qu’il venait tout juste de supprimer. De par sa nature divine, Apollon aurait fait usage des pouvoirs du Misopethamenos pour plonger les héros dans une mort apparente censée les maintenir en sommeil pour l’éternité. Mais au son de la lyre d’Orphée, Ryûji et ses compagnons reprennent conscience, prêts à se dresser contre leurs nouveaux adversaires. Car, en remportant une victoire absolue sur l’équipe de Grèce, les Japonais se sont attiré le courroux des dieux. Ce nouvel arc narratif les voit ainsi défier Zeus, Poséidon, Hadès et sept autres divinités grecques avec l’aide de leurs anciens rivaux venus d’Europe.
Dans sa dernière ligne droite, Ring ni Kakero emprunte volontiers à d’autres formes de mythologies pour étoffer ses enjeux belliqueux, piochant d’abord dans les croyances hindoues à travers le défi lancé par le clan des Asuras. Inspirés par le caractère démoniaque des entités que l’on oppose habituellement aux divinités hindoues, ces nouveaux ennemis n’ont certes pas le charisme des antagonistes précédents, mais le franchissement des neuf portes des Asuras pose déjà les jalons de ce qui deviendra l’arc majeur de Saint Seiya : la traversée des douze maisons du zodiaque. Ici déjà, les héros doivent outrepasser les limites de leurs forces pour terrasser des gardiens (les membres du clan Asura/les chevaliers d’or) afin de franchir une série de points de passage (les neuf portes/les douze maisons), quitte à se sacrifier pour permettre au héros (Ryûji/Seiya) d’aller jusqu’au bout. Et de même que les armures des chevaliers leur permettront d’exprimer leur plein potentiel, les Kaiser Knuckles (artefacts aux allures de poings américains) sont ici l’atout maître de Ryûji, désigné par les dieux comme seul digne de les porter.
À l’évidence, l’intégration d’éléments quasi fantastiques nous éloigne de plus en plus du thème d’origine de Ring ni Kakero et les héros n’ont plus rien des simples boxeurs qu’ils étaient au départ. Surtout, le fait que les combats s’enchaînent à vitesse grand V sans beaucoup d’imagination trahit un essoufflement manifeste de la part de l’auteur qui ne prolongera son histoire que sur une douzaine de chapitres additionnels. En dépit de leurs exploits, Jun Kenzaki et Ryûji Takane n’avaient pas encore fait leur entrée dans le monde de la boxe professionnelle. Il est temps de réparer cet oubli. Bien qu’effondré par la mort de sa mère, Ryûji accepte de poursuivre son rêve de devenir pro en se préparant à combattre dans la catégorie poids coq, catégorie sur laquelle règnent les disciples d’un certain Jésus... baptisé ainsi en raison de son poids identique à celui du Christ. Le match opposant Kenzaki au fameux Jésus, qui boxe tout en récitant les versets de la Bible, n’est pourtant que le prélude à la seule rencontre qui vaille véritablement la peine aux yeux des deux éternels rivaux. Ryûji et Jun savent que, quelle qu’en soit l’issue, ils se retireront du monde de la boxe dès la fin du match, conscients que leurs corps sont parvenus depuis longtemps à saturation. À l’image de Joe et Rikiishi, les deux stars de Ring ni Kakero s’apprêtent à connaître un destin funeste. Au quatrième round, leurs techniques se brisent l’une contre l’autre et le double K.-O. entraîne la mort de Ryûji qui succombe juste après avoir été reconnu vainqueur. L’ombre d’Ashita no Joe plane toujours sur la série de Kurumada qui s’en inspire une dernière fois pour refermer son histoire sur le visage spectral, mais souriant, de celui qui l’a aidé à faire vivre son manga pendant près de cinq ans.
ROUND 2 !
En février 1993, dix ans après la fin de la publication de Ring ni Kakero, Masami Kurumada est amené à s’exprimer sur sa série de cœur avec le recul de la décennie écoulée. Les vingt-cinq volumes du manga viennent tout juste d’être condensés par Shûeisha en une quinzaine de tomes dans la collection « Jump Comics Selection », cette deuxième édition étant l’occasion pour l’auteur de livrer son ressenti après relecture de cette œuvre de jeunesse. En postface du dernier volume, Kurumada explique ainsi que, bien qu’il ne considère pas ce manga comme ayant mal vieilli, il s’est néanmoins senti terriblement gêné par certaines maladresses qu’il a souhaité corriger à l’occasion de cette seconde édition. Plusieurs ajustements ont donc été effectués par l’auteur qui semble mesurer déjà le talent croissant des nouvelles générations de mangaka et vouloir tout faire pour ne pas laisser Ring ni Kakero se laisser distancer. Près de quinze ans après sa création, cette histoire qui symbolise, selon ses dires, « une jeunesse pleine de flammes », occupe toujours une place privilégiée dans l’inconscient créatif de Kurumada, convaincu qu’elle pourrait encore être en mesure de l’inspirer.
Il faut cependant préciser que, si le thème de la boxe était particulièrement en vogue aux alentours des années 1980, porté bien sûr par le succès d’Ashita no Joe, mais aussi par l’engouement généré dans le sillage de la saga cinématographique Rocky avec Sylvester Stallone, la situation n’est plus vraiment la même à l’approche du XXIe siècle. Au Japon comme ailleurs, les jeunes ne perçoivent plus la boxe comme l’un des sports les plus attractifs de leur époque, et Masami Kurumada sait qu’il doit se renouveler, publiant de nombreuses histoires courtes durant la période séparant Ring ni Kakero de Saint Seiya. Pourtant, aussi tenace que son rêve de voir un jour son manga transposé en animation, le désir de reprendre et de moderniser sa série favorite ne le lâche pas. En 1999, Kurumada s’attellera donc à l’inéluctable suite de Ring ni Kakero, ne pouvant décidément pas laisser s’éteindre l’étincelle qui l’avait porté à ses débuts. En préface du premier volume de Ring ni Kakero 2, publié en 2000 aux éditions Shûeisha, l’auteur ne cache pas sa fébrilité : « Faut-il la recommencer ? L’histoire de ces jeunes gens... C’est ce que j’avais écrit dans l’édition bunko de Ring ni Kakero. Qui aurait cru que je leur donnerais vraiment une seconde chance ? Physiquement et moralement, j’ignore jusqu’où je peux aller. Mais je veux faire brûler une nouvelle fois la flamme de la jeunesse. » Dans un volume ultérieur, il expliquera que le fait de reprendre Ring ni Kakero plus de vingt ans après les débuts de la série, alors qu’il n’en avait pas du tout l’intention quelques années plus tôt, revêt un sens tout particulier pour lui. Dans une postface de Ring ni Kakero 2, l’auteur précise en effet que ce manga constitue le symbole de sa propre transition vers le nouveau siècle. C’est la raison pour laquelle il place beaucoup d’espoirs en lui et espère toucher autant les anciens lecteurs que ceux qui le découvrent aujourd’hui.
Située chronologiquement une vingtaine d’années après la fin du tournoi mondial qui constituait le point d’orgue de la première série, Ring ni Kakero 2 déroule son histoire à travers les yeux de Rindô Kenzaki. Il est le fils de Jun Kenzaki qui, fidèle à la promesse faite à son unique rival, a épousé la sœur de Ryûji peu après la disparition tragique de ce dernier. Les anciens membres de l’équipe junior du Japon encore en vie voient en lui la force de Jun Kenzaki et la douceur du frère de sa mère. Pourtant, le jeune homme est un impertinent et un indépendant qui n’apprécie guère que l’on convoque les fantômes du passé, désirant tracer sa propre voie sans se soucier de ceux qui l’ont précédé dans le monde de la boxe. Disciple du fringant Ishimatsu et héritier du « Galactica Magnum », la technique dévastatrice de son père, Rindô est un protagoniste difficile à cerner qui ne se bat que dans le but de devenir plus fort et certainement pas pour des questions d’honneur. Son parcours vers la reconnaissance de ses pairs le mènera à la rencontre des anciennes gloires du passé qui boxaient aux côtés de Jun et Ryûji, mais aussi de celles de leurs fils. Car Ring ni Kakero 2 est avant tout l’histoire d’un passage de relais entre l’ancienne et la nouvelle génération, chaque figure marquante de la première série ayant au moins un descendant doté des mêmes aptitudes innées pour le combat. En cela, Ring ni Kakero 2 se révèle nettement plus intéressant à découvrir pour ceux qui ont déjà en tête les temps forts du manga initial que pour les néophytes, ses ficelles narratives reposant principalement sur le fait d’apprendre ce que sont devenus tous ces héros que l’on connaissait. Le pianiste Takeshi Kawai, par exemple, n’est plus que l’ombre de lui-même, sa conscience s’étant évaporée brutalement au point de rendre le boxeur totalement hermétique au monde qui l’entoure. Atteint d’une fragilité du cœur, son neveu Kyô refuse le don d’organe que son oncle semble prêt à faire pour lui au mépris de sa propre vie, choisissant de mener son existence sans garde-fou, aussi courte dût-elle s’avérer. Kazuki Shinatora révèle, lui, la même inflexibilité que son père, se montrant intransigeant envers son fils Iori, mais aussi envers Rindô qu’il oblige à surmonter la terrible épreuve qui lui avait jadis coûté un bras : parvenir à saisir une balle entre les pales tranchantes d’un ventilateur.
Pour des raisons totalement divergentes, cette nouvelle génération de boxeurs se retrouve unie au sein d’une équipe junior du Japon renouvelée dans le cadre d’un tournoi allemand. L’auteur semble avoir toutefois bien du mal à se départir de l’influence de la première série, les jeunes boxeurs apparaissant presque toujours calqués sur leurs paternels, aussi bien sur le plan physique que psychologique. Mais le récit regagne en intérêt dès lors qu’il s’éloigne du cadre des sempiternels tournois pour marcher sur les traces des descendants des équipes européennes. Le charme de cette France toujours bloquée à l’époque des clichés historiques de Versailles - avec son palais fastueux, sa guillotine et son labyrinthe de roses - apporte ainsi un renouvellement salvateur à l’atmosphère du manga. La compétition grecque voit ensuite de toutes nouvelles nations se hisser sur le ring, inspirant à l’auteur des matchs des airs de tauromachie (pour l’Espagne) ou basculant dans le surnaturel via la malédiction pharaonique du représentant égyptien. S’il est vrai que cette marmelade d’idées égare parfois l’attention du lecteur, jusqu’au bras de fer si prévisible entre le Japon et les nouveaux dieux grecs, ce prolongement de Ring ni Kakero permet à l’auteur de boucler la boucle en terminant son histoire par un match symbolique entre Rindô Kenzaki et un certain Ryûdô, sosie du regretté Ryûji Takane.
L’ANIME TANT CONVOITE
Publiée jusqu’en 2009, l’histoire de Ring ni Kakero 2 compte pas moins de vingt-six volumes, qui, cumulés à ceux de la première série, dépassent largement le nombre de l’ensemble des tomes de Saint Seiya signés de la main de Kurumada. Si cette suite reste encore inédite en animation, ce n’est pas le cas des premiers volumes de Ring ni Kakero qui, conformément au souhait de l’auteur, finiront par être transposés en anime à partir de l’année 2004. Depuis le lancement du manga dans les pages du Weekly Shônen Jump en 1977, Kurumada n’avait jamais caché son envie réelle de voir s’animer son œuvre sur le petit écran, mais il lui fallut pourtant batailler longuement avant d’avoir gain de cause. En échange de la reprise de l’adaptation de Saint Seiya centrée sur la partie Hadès, le studio Tôei Animation acceptera finalement de prendre en charge la version animée des premiers arcs de Ring ni Kakero en plusieurs étapes successives, vingt-sept ans après la création du manga.
Suite à la validation d’un pilote de cinq minutes empruntant les musiques de la série Saint Seiya, le feu vert est ainsi donné à la réalisation de deux saisons de douze épisodes, diffusées respectivement en 2004 et 2006 sur TV Asahi. Baptisée Ring ni Kakero 1 - Carnival Champion Hen, la saison une met l’accent sur la rivalité entre Ryûji Takane et Jun Kenzaki dans le cadre du tournoi national visant à réunir l’élite de la boxe junior japonaise. La deuxième saison, Ring ni Kakero 1 - Nichibei Kessen Hen, voit les membres de cette nouvelle équipe mettre leurs différends de côté afin de donner une leçon aux boxeurs venus des États-Unis pour mettre le Japon hors course avant le début du tournoi mondial.
En 2010, une troisième saison plus courte, baptisée Ring ni Kakero 1 - Kage-dô Hen, résume en six OAV (Original Animation Video) la partie du manga centrée sur l’éveil du clan Shadow. Elle relate la confrontation entre la boxe réglementaire et le courant déviant de la boxe japonaise que certains avaient tenté d’enterrer dans les ténèbres, à l’image de leur leader Sôsui, frère jumeau de Jun écarté à la naissance parce que la famille Kenzaki ne pouvait tolérer deux héritiers. Enfin, en 2011, la saison 4 : Ring ni Kakero 1 - Saki Taikai Hen, condense en six OAV les temps forts du championnat du monde jusqu’au sacrifice des boxeurs japonais face aux invincibles dieux grecs.
Grâce à la participation du célèbre duo d’animateurs Shingo Araki et Michi Himeno, déjà à l’œuvre sur Saint Seiya, l’adaptation animée de Ring ni Kakero ne démérite pas. Impeccable, le character design gomme les imperfections des traits parfois approximatifs de l’auteur, et le fait que l’histoire démarre alors que Ryûji s’est déjà débarrassé de ses peurs légitime plus facilement son statut de protagoniste principal. L’anime fait l’impasse sur les premiers chapitres dépourvus d’action pour laisser davantage de place aux boxeurs étrangers amenés à jouer un rôle majeur lors des tournois à venir. Des développements narratifs propres au passé douloureux de certains personnages sont même ajoutés afin d’accentuer la tension et le caractère dramatique de l’histoire tout en étoffant le background des boxeurs. Des matchs expédiés rapidement dans le manga sont aussi présentés de manière plus épique. Quant aux éléments les plus sujets à polémiques, telle l’allusion au boxeur américain lié au Ku Klux Klan, ils sont judicieusement passés sous silence. Plus inattendu, Kurumada lui-même fait une apparition furtive au début du tout premier épisode, doublant le personnage qui le représente, à savoir le chef du Shinwakai (nom qu’il donne durant cette période à son groupe d’assistants) venu vanter les mérites de Jun Kenzaki devant une foule médusée !
En stand-by depuis 2011, la série animée a toutefois peu de chances de couvrir davantage de chapitres du manga initial, aucune adaptation de Ring ni Kakero 2 n’ayant par ailleurs été évoquée. L’édition dans l’Hexagone de la première saison par Déclic Images reste ainsi la seule porte d’entrée à l’univers de Ring ni Kakero pour le public francophone. Car le peu d’engouement suscité par la série dans notre pays ne laisse que peu d’espoirs de voir un jour le manga et sa suite édités dans notre langue.
KURUMADA FANFARONNE
Grâce au succès naissant de Ring ni Kakero, Masami Kurumada, porté par sa passion de mangaka en pleine ascension, profite du soutien de son éditeur pour publier plusieurs histoires courtes entre 1977 et 1981. Parallèlement à sa série phare, l’auteur expérimente ainsi d’autres pistes du nekketsu à travers des récits d’une quarantaine de pages qui se verront regroupés en 1983 dans un tankôbon reprenant le titre de la première histoire : Mabudachi Jingi. Le recueil comprend également un deuxième récit, Shiro Obi Taishô, écrit en 1979, ainsi qu’une série de six chapitres de Sukeban Arashi qui n’avaient pas encore été publiés en volume relié.
Imaginé en 1978, Mabudachi Jingi s’interroge sur ce qui se passerait dans la tête d’un adolescent bagarreur un peu trop sûr de lui s’il devait choisir entre l’amour ou l’amitié. Calqué sur le profil de Katori Ishimatsu, le boxeur bravache de Ring ni Kakero, le personnage de Kintarô Oodera est de ceux sur qui l’on peut compter quoi qu’il arrive, toujours présent pour défendre son meilleur ami des agressions de délinquants plus âgés, aidé en cela par ses aptitudes innées pour le combat. Pourtant, lorsque Kintarô devient le compagnon officiel de Momoko Kinoshita, la nouvelle coqueluche du lycée, et fait le serment de ne plus recourir à la violence, le jeune homme se voit subitement confronté à un sérieux dilemme. Dorénavant perçu comme un lâche par ses anciens camarades, il faudra la mise en danger de son meilleur ami pour que Kintarô redevienne celui qu’il était et comprenne que l’amitié passe avant tout le reste, regagnant au passage l’affection de Momoko. Pour l’anecdote, l’histoire de Mabudachi Jingi comporte également une allusion directe au manga phare de Kurumada, le héros se plaignant de l’inefficacité des fameux « power wrists » censés renforcer sa puissance, à l’image de Ryûji dans Ring ni Kakero.
Dans la postface du recueil Mabudachi Jingi paru en 1983, Kurumada dit avoir été marqué par le personnage central du film japonais de 1937, Kira no Nikichi, qui perdait la vie en choisissant de combattre le frère de son épouse pour défendre ses amis. L’auteur ne prétend pas pour autant que cette réponse soit la plus pertinente face au dilemme posé, surtout dans une société qu’il sait profondément changée, mais il reconnaît avoir été saisi par la force de caractère d’un protagoniste aussi déterminé. Voilà le genre d’homme qui fascine vraiment Kurumada et que ce dernier souhaite donner en exemple à ses lecteurs. Selon lui, aussi grand et irréaliste puisse-t-il sembler dans la vie réelle, un rêve peut toujours se réaliser à travers les pages fictives d’un manga. Il va même plus loin en pointant du doigt les auteurs qui ne s’éloignent pas suffisamment des limites de la morne réalité, estimant que c’est essentiellement par le biais de leurs œuvres que les plus jeunes se forgent leurs idéaux. Kurumada précise d’ailleurs que ses premiers travaux inclus dans le recueil de Mabudachi Jingi ont tous été imaginés dans cet état d’esprit, même si son manque d’expérience d’alors ne lui a pas permis d’exprimer pleinement le message qu’il souhaitait faire passer.
Écrit en 1979 et constituant le deuxième chapitre du tankôbon de Mabudachi Jingi, le manga Shiro Obi Taishô s’étale lui aussi sur une petite quarantaine de pages pour évoquer cette fois l’évolution morale d’un garçon peu recommandable. Transféré dans un lycée où nul ne connaît sa réputation de judoka incompétent, Sanpei Sugata se fait passer pour le digne représentant de son ancien club alors qu’il n’a jamais dépassé le statut de simple remplaçant ni remporté le moindre match. Profitant insolemment de sa position privilégiée, le jeune homme compte prétexter une maladie imaginaire pour se défiler le jour du tournoi... avant de prendre subitement conscience de la foi que sa nouvelle équipe place en lui. La transformation qui s’opère alors en Sugata le pousse à surmonter ses peurs pour se prouver de quoi il est réellement capable, décrochant même une victoire inespérée contre le capitaine adverse. En contribuant à la réhabilitation de cette équipe victime de tous les quolibets, le protagoniste démontre que le mérite d’un judoka ne dépend pas de la couleur de sa ceinture, mais bien de son envie d’aller jusqu’au bout de lui-même.
Ces deux histoires courtes sont suivies de six chapitres inédits de Sukeban Arashi qui viennent clore ce recueil de jeunesse de manière pertinente en ramenant le lecteur à la toute première œuvre publiée par Kurumada. Entièrement indépendantes, ces péripéties illustrent une dernière fois le caractère tempétueux de cette jeune délinquante qui n’a de cesse de bouleverser le quotidien de son école en semant l’anarchie sur son passage, bien souvent à ses dépens.
À la sortie de cette compilation d’histoires courtes, en 1983, soit quasiment dix ans après ses premières ébauches en tant que mangaka, Masami Kurumada souligne que la publication de ces travaux revêt une vraie signification pour lui dans la mesure où, bien qu’il se dise embarrassé par le caractère démodé de certains aspects de ces œuvres de jeunesse, elles n’en symbolisent pas moins le point de départ de toute sa carrière professionnelle.
L’AUTOPARODIE EN CUISE D’EXUTOIRE
Commun à presque toutes les œuvres de Kurumada, le message prônant l’union des forces au sein d’un groupe d’amis soudés, capables de surmonter ensemble ce qu’un individu isolé ne saurait vaincre, trouve aussi sa place dans la propre vie de l’auteur. Sans avoir bien évidemment l’envergure de celle que l’on trouve au cœur de ses récits, la cohésion qui anime sa propre équipe de travail le conduit très tôt à tracer les contours d’un manga fort singulier, dont lui-même et ses assistants sont les personnages principaux. Démarré en 1979 et poursuivi jusqu’en 1983, le manga Jitsuroku ! Shinwakai compte un total de quatre histoires courtes qui trouvent leur origine dans la manie qu’avait l’auteur de caricaturer ses assistants pour apporter un peu de distraction à son équipe. Au regard des planches de ce manga autoparodique, on devine aisément que les cinq « lieutenants » du mangaka, subitement transformés en hommes de main d’un Kurumada grimé en yakuza inflexible, ont dû effectivement profiter de la réalisation sporadique de ce titre pour décompresser. La photo de couverture du tankôbon les présente posant tels des gangsters en costumes et lunettes noires, armés de pistolets et de katanas, visages grimaçants. Au centre, avec son air factice de dur à cuire, l’auteur trône tel un paon en nœud papillon et costume blanc, une main fermement vissée sur le fourreau de son sabre...
Imaginées dans le contexte de la publication au long cours de Ring ni Kakero, ces quatre histoires sont inévitablement imprégnées de l’influence de la série qui faisait alors la fierté de Kurumada et qui lui avait même permis de décrocher le prix des lecteurs du Jump. Le premier récit de Jitsuroku ! Shinwakai s’inspire justement de cet épisode clef en le parodiant de manière totalement absurde, l’auteur exprimant son inquiétude face à une concurrence redoutable qui compromet ses chances de remporter le prix, et donc de profiter du voyage en Europe offert au gagnant. Prêt à tout pour parvenir à ses fins, taclant sans complexe ses confrères du Jump et d’ailleurs, ce Kurumada fictif peu scrupuleux dote ses assistants d’un arsenal de tueurs ne laissant que peu de doutes sur la stratégie de ce groupe tout-puissant qui se fait appeler « Shinwakai ». Dans un fou rire sadique, le chef de cette bande de dessinateurs peu recommandables annonce qu’il dominera bientôt le monde du manga et se débarrasse de l’ensemble de ses concurrents dans des circonstances autrement plus délirantes que violentes. Même le vénérable Leiji Matsumoto (auteur de Captain Harlock - Albator en France - et Galaxy Express) subit les foudres de Kurumada en sombrant dans une démence sénile ! Et le chef du Shinwakai de décrocher le titre d’ennemi public numéro un du pays... À l’homme venu le raisonner en le suppliant de se battre non pas avec une arme mais avec son stylo, Kurumada réplique par un coup de couteau dans le ventre, juste avant d’annoncer froidement le nom de sa dernière cible : Hiroshi Motomiya, son maître à penser dans le monde réel ! Ce dernier lui donnera finalement une leçon de vie en lui tranchant le bras, condamnant à jamais la carrière de cet alter ego imaginaire qui espérait bâtir sa gloire dans un bain de sang... même si tout cela n’était qu’un cauchemar, comme nous l’assure l’auteur à la fin de son délire illustré. Sur la forme, il est assez amusant de constater que la version fantasmée du mangaka couturé de cicatrices tranche radicalement avec le Kurumada plus réaliste que l’on découvre en train de rêver, l’auteur se sachant très loin des standards physiques et moraux imaginés pour définir ses propres héros de fiction.
La deuxième histoire convoque directement les boxeurs de Ring ni Kakero dans un règlement de comptes insensé entre le créateur et sa création. La popularité de Ring ni Kakero ayant permis à l’éditeur Shûeisha d’agrandir ses installations, des fans, essentiellement féminins, se bousculent pour offrir des chocolats au prestigieux auteur du manga. Mais l’un des protagonistes de son histoire, le très sérieux Jun Kenzaki, se rend à la rédaction du magazine pour venir récupérer ces présents qui lui sont en réalité directement adressés. Furieux, l’auteur défie le champion sur le ring, ses assistants acceptant de le rejoindre dans cette épreuve pour former l’équipe de boxe du Shinwakai, prêts à mettre enjeu leur réputation. Bien entendu, non seulement ces derniers se ridiculisent lamentablement, mais ils y laissent leur vie dans une scène parodiant la mort valeureuse de Ryûji et ses compagnons.
Jitsuroku ! Shinwakai conserve cette tonalité décalée jusqu’au bout, le troisième chapitre se bornant à présenter un Kurumada galant mais naïf, surveillé de près par un responsable éditorial intraitable. Enfin, la dernière histoire voit l’auteur confronter ses valeurs à celles d’un mangaka convaincu de la suprématie des comédies romantiques sur les shônen de type nekketsu. L’occasion pour Kurumada de s’amuser à comparer la motivation sans faille de son équipe à celle de ses héros de fiction, le Shinwakai travaillant jusqu’aux limites de ses forces dans le plus grand dénuement pour donner vie à des récits conçus dans la sueur, le sang et les larmes. L’esprit indomptable des disciples du nekketsu l’emporte finalement sur les manigances d’un rival contraint de reconnaître la force de ces mangas qui, bien que manquant parfois de finesse, restent les seuls à même de rendre possible l’impossible. Aussi parodiques soient-elles, ces histoires reflètent, selon Masami Kurumada, de nombreuses facettes de lui-même, la conception de ce manga si singulier s’étant faite naturellement, sans intention particulière de la part de l’auteur.
UN PIED DANS LE FOLKLORE NINJA
La publication de la quatrième histoire de Jitsuroku ! Shinwakai nous ramène en 1983, alors que le deuxième manga à succès de Masami Kurumada est déjà en train de prendre son envol. Édité dans le Weekly Shônen Jump dès 1982 et couvrant pas moins de dix tankôbon (condensés en six volumes pour l’édition de luxe parue en 2000), Fûma no Kojirô connaîtra un succès significatif auprès des lecteurs japonais, sans pour autant concurrencer celui de Ring ni Kakero. L’ensemble des volumes du manga retrace trois segments narratifs successifs : la lutte à mort entre les membres des clans Yasha et Fûma, la guerre des épées sacrées orchestrée par Chaos, et enfin la rébellion du clan Fûma. L’auteur indiquera avoir notamment puisé son inspiration dans les ouvrages de l’écrivain Ryôtarô Shiba, essentiellement connu pour ses romans historiques relatifs à la période du Bakumatsu (fin du shogunat Tokugawa). Transposée en animation en 1989 suite au succès de l’anime Saint Seiya et licenciée en France par Kazé, la série Fûma no Kojirô sortira directement en vidéo, les douze OAV couvrant respectivement les deux premiers arcs de l’histoire. Il faudra cependant attendre la réalisation du film d’animation de 1992, Fuma no Kojirô - Fuma Hanran-hen (Fûma no Kojirô : La rébellion de Fûma) pour que les derniers chapitres constituant le troisième arc du manga bénéficient à leur tour d’une adaptation animée. Un drama - série live jouée par des acteurs réels - sera même lancé en 2007 sur les écrans de télévision japonais.
Ayant tiré les leçons de ses expériences passées sur le plan créatif, l’auteur décide, avec ce titre, de ne plus se laisser brider par les restrictions physiques de l’être humain. Il opte ainsi pour des individus dotés de facultés hors-norme, légitimées par leur appartenance à des clans shinobi (appellation généralement préférée au terme « ninja »). Plusieurs années avant le concept de chevaliers sacrés capables de pourfendre le ciel de leurs poings et d’entrouvrir le sol à coups de pied, Kurumada donne déjà des proportions épiques à l’une de ses créations. Ainsi peut-on lire au sujet des personnages principaux : « Les membres du clan Fûma sont tels le vent, insaisissables et invisibles aux yeux des hommes. On les dit rapides comme l’éclair et aussi impassibles que les arbres. Ils peuvent couvrir des milliers de kilomètres par jour et leur ouïe s’avère si fine qu’ils entendraient tomber une aiguille à dix kilomètres de distance. On les prétend même capables de traquer un ennemi éloigné de plus de cent kilomètres dans la plus noire des nuits. » À la vérité, si les attaques spéciales surnaturelles des shinobi de Fûma no Kojirô découlent en partie des pouvoirs de leurs bokutô (sabres en bois) et autres lames légendaires, ils n’en sont pas moins capables de recourir à des aptitudes d’ordre psychique ou de manipuler les forces élémentaires telles que le feu, la glace ou la foudre.
Les faits sont ancrés dans un Japon à la fois moderne et féodal, placé sous le signe de la rivalité entre des clans shinobi qui, si l’on en croit l’information tardive livrée à la fin de la série, seraient au nombre de plusieurs centaines à travers tout le pays. L’histoire commence alors que la prestigieuse académie sportive Hakuô vient quérir l’aide du mystérieux clan Fûma afin de protéger ses athlètes des agressions fomentées par l’école rivale de Seishikan. Pour des raisons initialement futiles, l’irrévérencieux Kojirô accepte de quitter ses montagnes sauvages pour éloigner les cent huit membres du clan Yasha résolus à enterrer définitivement le nom de l’institut Hakuô. Dans l’autre camp, mandaté par la princesse Yasha dans le but d’asseoir la domination de son école qui a déjà conquis les deux tiers du pays, l’électron libre Musashi Asuka se languit du moment où il sera confronté à Kojirô de Fûma dont il devine l’incroyable potentiel.
À travers le personnage de Musashi Asuka, l’auteur appuie sa vision de l’archétype du loup solitaire déjà esquissée dans Ring ni Kakero avec Jun Kenzaki et qui se trouvera confirmée dans Saint Seiya par l’intermédiaire d’Ikki du Phénix. L’incursion d’éléments tirés du folklore ninja passe dans un premier temps par le renvoi à de grands noms du Japon féodal. Ainsi, au même titre que Kojirô Sasaki et Musashi Miyamoto - les deux escrimeurs les plus admirables que le Japon ait connus et qui rythment notamment les pages du manga Vagabond de Takehiko Inoue et des romans dont il s’inspire, La Pierre et le Sabre et La Parfaite Lumière d’Eiji Yoshikawa -, Kojirô Fûma et Musashi Asuka sont d’éternels rivaux qui ne trouvent un sens à leur vie qu’à travers leurs inévitables duels. Mais l’emprunt de noms historiques ne s’arrête pas là : on retrouve l’experte en arts martiaux Ranko Yagyû, usant du même patronyme que le célèbre Jûbei Yagyû, samouraï de renom souvent représenté avec un cache-œil et ayant inspiré nombre de films, anime et jeux vidéo. Autre figure historique incontournable de l’époque Sengoku, le daimyo (gouverneur féodal japonais) Masamune Date est probablement à l’origine du nom de l’un des personnages clefs de la deuxième partie du manga, Sôshi Date, détenteur de l’épée Gurenken : « la fleur de lotus pourpre ». Enfin, popularisés, entre autres, à travers les pages du manga Rurôni Kenshin (Kenshin le Vagabond en France) de Nobuhiro Watsuki, les membres du Shinsengumi qui étaient censés maintenir l’ordre durant la période du Bakumatsu héritèrent, à cause de leurs actes répréhensibles allant à l’encontre du code du bushidô, du surnom de « Loups de Mibu ». Et l’on retrouve aussi cette appellation dans Fûma no Kojirô via le personnage de Kôsuke Mibu, représentant d’élite de l’école ennemie Seishikan. Notons cependant que toutes ces influences ne vont pas au-delà des patronymes, ni le caractère, ni le vécu de ces protagonistes n’ayant quoi que ce soit à voir avec ceux des figures historiques précitées.
Le thème de la rivalité entre les clans ninjas trouve quant à lui incontestablement sa source dans la lutte mythique qui vit s’entretuer les shinobi du clan Iga et ceux de Kôga, suivant les faits relatés dans l’ouvrage Kôga ninpô chô de Fûtarô Yamada, véritable classique de la littérature japonaise (paru en France sous le titre Shinobi). Ayant engendré d’innombrables adaptations, cette histoire violente et tragique fut immortalisée de manière flamboyante dans le manga et la série animée Basilisk de 2005. Le parallèle entre cette légende et celle de Fûma no Kojirô peut être établi dès le début, lorsque la confrontation mortelle entre les huit de Fûma et les huit de Yasha se voit scellée sur un rouleau de parchemin où sont inscrits les noms des guerriers de chaque clan. La différence majeure réside dans le fait que Kurumada tient à ce que son œuvre conserve malgré tout un pied dans la réalité avec un contexte résolument ancré dans le Japon des années 1970-1980. Contrairement à la version animée, le manga souligne en effet que l’école Hakuô n’enseigne pas seulement les arts martiaux, mais un grand nombre de disciplines sportives telles que le base-ball, le foot, le judo, le tennis, la boxe ou l’athlétisme. Et même si cet élément reste tout à fait anecdotique dans le développement du récit, il contribue à maintenir l’histoire de Fûma no Kojirô à la frontière entre le réel et le fantastique. Idée que l’on retrouvera plus tard dans Saint Seiya.
En comparaison avec les œuvres précédentes de l’auteur, il est intéressant de constater que les confrontations commencent enfin véritablement à ressembler à celles qui feront le succès des affrontements épiques de Saint Seiya. Ainsi, la technique du « Byakûjin » de Kô consistant à cerner l’adversaire d’un nuage de plumes dont la trajectoire dépend de sa couleur sera manifestement à l’origine des roses démoniaques d’Aphrodite, le chevalier des Poissons. Quant au caractère à la fois offensif et défensif de ces mêmes plumes, capables de se déployer autour d’une gigantesque toile, il évoque également les propriétés à venir de la chaîne nébulaire d’Andromède. Pas besoin d’aller plus loin pour comprendre que Saint Seiya doit beaucoup à Fûma no Kojirô sur ce plan-là, Kurumada ayant visiblement déjà trouvé, durant cette période, la manière de dramatiser les duels en allant au-delà des simples échanges de coups qui caractérisaient jusqu’alors ses mangas. D’un point de vue purement technique, l’auteur a de plus en plus recours aux doubles pages dans le but d’accentuer la démesure des combats et leur donner un maximum d’impact visuel en exagérant la solennité des scènes liées aux épées sacrées. Et lorsque Kurumada nous laisse croire que Kojirô tranche la tête de Musashi, alors que l’image de cette décapitation ne reflète pas ce qui se passe dans la réalité, l’auteur emploie pour la première fois une astuce qu’il développera à plusieurs reprises dans Saint Seiya, avec la même efficacité.
L’EMERGENCE DE NOUVELLES THEMATIQUES
Opérant un virage significatif avec l’entrée en scène des épées sacrées, l’histoire désigne subitement son héros comme l’héritier du légendaire sabre de bois Fûrinkazan. Pour le lectorat japonais, ce terme revêt une résonance particulière, s’écrivant à l’aide des quatre idéogrammes chinois qui désignent respectivement le vent (fû), la forêt (rin), le feu (ka) et la montagne (zan). Il s’agit des quatre mêmes kanji (idéogrammes) que le daimyo Shingen Takeda avait fait inscrire sur son étendard durant l’époque des provinces en guerre. Le message qu’il voulait faire passer à ses hommes était de se montrer « rapide comme le vent, silencieux comme la forêt, féroce comme le feu et inébranlable comme la montagne ». Une stratégie provenant à l’origine de préceptes tactiques énoncés ainsi dans L’Art de la guerre de Sun Tzu : « Qu’il règne dans votre camp une tranquillité semblable à celle qui règne au milieu des plus épaisses forêts [...]. S’il faut être ferme dans votre poste, soyez-y immobile comme une montagne ; s’il faut sortir pour aller au pillage, ayez l’activité du feu. » Les diverses traductions de ce traité de stratégie militaire, dont l’écriture remonte à plusieurs siècles avant J.-C., ont entraîné de nombreuses variantes, mais le message reste le même et l’on ne s’étonne pas que Masami Kurumada ait souhaité y faire référence dans ce manga où les confrontations meurtrières ne manquent pas.
Surtout, l’idée que les épées sacrées soient capables de choisir elles-mêmes leur propriétaire légitime rejoint totalement le concept des armures dotées d’une volonté propre qui apparaîtra un peu plus tard dans Saint Seiya. À l’issue du deuxième arc de Fûma no Kojirô, le sabre légendaire Fûrinkazan s’oppose délibérément aux autres épées et reste fidèle à son porteur, se craquelant pour renaître plus flamboyant que jamais, convainquant même les autres lames de protéger la vie de Kojirô.
Derrière l’opposition manichéenne symbolisée par les entités Cosmo et Chaos, on voit aussi déjà se dessiner les conflits aux proportions divines qui rythmeront les pages de Saint Seiya. Car la guerre séculaire entre ces deux êtres suprêmes se révèle tout à fait comparable à celle des dieux dans l’œuvre maîtresse de Kurumada qui naîtra seulement quelques années plus tard. Qui plus est, bien qu’il ne compte que deux membres originels du clan Fûma, le groupe final représentant les élus de Cosmo respecte aussi la règle d’or des cinq héros, chère à Kurumada. Déjà employée dans Ring ni Kakero, elle sera appelée à revenir de manière tout aussi symbolique dans Saint Seiya.
Ne pouvant décidément pas laisser ses héros savourer leur juste victoire dans la paix, l’auteur ne peut s’empêcher encore une fois de noircir les pages d’une bataille sans retour où se doivent de trépasser les braves. Même lorsqu’ils ne s’entre-tuent pas, les combattants qui, tel Musashi, sortent victorieux de leurs duels, disparaissent à leur tour dans les limbes. Sur le plan mythologique, le dénouement de ce deuxième arc fait directement référence au samsara, cycle de naissances, de morts et de réincarnations issu des croyances hindouistes. Pour mettre fin à une lutte entamée depuis quatre mille ans, Kojirô doit résister à l’appel de l’au-delà pour achever son combat contre Chaos s’il veut rompre le caractère cyclique du destin. En brisant la lame Hôôtenbu de son adversaire, le héros démontre qu’il est possible de déjouer la fatalité de cette guerre que tous croyaient inéluctable. Derrière ce final homérique se dessine déjà, dans l’imaginaire de l’auteur, l’idée d’une possibilité pour l’être humain d’aller à l’encontre du dessein imaginé par les dieux, quel que soit le châtiment encouru par le blasphémateur. Bien avant le chevalier Pégase, Kojirô provoque ainsi délibérément le courroux divin en détruisant les épées légendaires pour mettre un point final à une bataille depuis trop longtemps meurtrière. Un acte qui lui vaut la bienveillance de Cosmo, la déesse témoignant à tous ses défenseurs sa reconnaissance en leur offrant l’occasion de mener leur existence de simples mortels jusqu’au bout.
L’ultime segment qui s’ouvre dans les derniers chapitres du manga vient clore cette fresque ninja de manière surprenante en imaginant un conflit venu de l’intérieur même du clan Fûma. Les germes d’une rébellion se manifestent tandis que certains shinobi semblent prêts à éliminer leurs anciens frères d’armes pour imposer de nouveaux idéaux, sous couvert de prôner l’unification des clans à travers le pays. Le fait que les rebelles soient en réalité sous l’emprise du contrôle mental exercé par un seul individu ne peut manquer d’évoquer les ravages de l’illusion diabolique (« Genrô Maôken ») que le Grand Pope exercera plus tard sur le chevalier du Lion dans les pages de Saint Seiya, même si son pouvoir va ici jusqu’à pousser les victimes à se trancher la langue si elles trahissent le nom de celui qui les manipule.
DE LA SUITE DANS LES IDEES
Vingt ans plus tard, en 2003, Masami Kurumada exhumera les ninjas de Fûma dans un contexte bien particulier. À partir de décembre 2002, l’auteur supervise le développement du manga Saint Seiya : Episode G, un spin-off signé Megumu Okada, dans les pages du Champion RED de l’éditeur Akita Shoten. C’est dans ce même magazine de prépublication que débute Fûma no Kojirô : Yagyû Ansatsu Chô dont la réalisation est confiée à Satoshi Yuri, sous la houlette du maître. Interrompu à la fin du chapitre 17, alors que le retour annoncé de Musashi dans l’intrigue aurait potentiellement pu relancer cette dernière, le manga ne semble cependant guère avoir convaincu son public.
Il faut dire que, si le coup de crayon du dessinateur ne trahit pas l’esprit du mangaka original, la narration peine à captiver. L’histoire se déroule plusieurs années après la bataille des épées sacrées tandis que le monde des shinobi doit faire face à de nouveaux bouleversements. Ayant brûlé dans un incendie criminel, l’école Hakuô n’est plus qu’un tas de cendres. Ressuscités par la magie noire d’un clan de l’ombre, les anciens compagnons de Kojirô se retournent contre leur allié de toujours, alors que la vie de la prêtresse de Fûma est en passe d’être sacrifiée pour la résurrection d’Indra, le dieu de la guerre.
Au-delà du combat fratricide entre les anciens membres du clan, cette suite met l’accent sur les aspects fantastiques des nouveaux enjeux présentés en s’appuyant sur les mythes hindous déjà esquissés dans le dernier arc du manga original. On y retrouve les notions de transmigration des âmes et de prisons symboliques à franchir dans un contexte propice au dépassement de soi. En dépit de quelques flash-back amusants qui ont le mérite de nous dévoiler des bribes du passé de certains shinobi de Fûma, ces chapitres additionnels n’apportent pas grand-chose à l’œuvre initiale et les trois volumes publiés restent inédits en dehors du Japon.
QUARANTE ANS DE CARRIERE
Échelonnée sur deux années seulement, de 1982 à 1983, la prépublication rapide de Fûma no Kôjirô permet à son auteur de proposer deux autres titres avant le lancement de Saint Seiya en 1986 : Raimei no Zaji et Otoko Zaka. Démarrée dans les pages du magazine Fresh Jump en 1983, l’histoire de Raimei no Zaji trouvera sa conclusion en 1988 dans le Weekly Shônen Jump, sans pour autant dépasser le stade du one-shot. Ce manga en un seul volume, s’il reste largement méconnu, est révélateur de la volonté de Kurumada de mieux définir les contours de ses figures héroïques en imaginant pour la première fois un protagoniste aux allures de cyborg.
Bien qu’il ait, en apparence, tout d’un adolescent comme un autre, Zaji possède un caractère froid et distant qui ne facilite guère son intégration à l’académie Tôyô. Il faut dire que le jeune homme a bien d’autres préoccupations que celles des jeunes de son âge, conscient d’être la cible d’assassins résolus à le traquer sans relâche. Surnommé « Zaji du tonnerre » (raimei signifiant « tonnerre » en japonais), il trace sa route en solitaire, ne laissant derrière lui qu’un sillage de destruction. Sa puissance hors-norme, il la révèle par l’intermédiaire de cette cicatrice zébrée qui, telle la marque du dragon du chevalier Shiryû dans Saint Seiya, apparaît parfois dans son dos en signe d’une riposte imminente. Rappelant également, par son impassibilité extrême, le profil de Kenshirô - héros insondable du manga Hokuto no Ken (par Buronson et Tetsuo Hara) -, Zaji apparaît en décalage avec le reste de l’humanité, redoutant constamment de mettre en péril ceux qu’il aurait l’imprudence de côtoyer. Considéré comme un déserteur aux yeux de l’organisation Home, qu’il s’efforce de fuir, l’adolescent est la proie d’une implacable chasse à l’homme qui ne semble devoir se solder que par sa propre mort ou celle des assassins envoyés pour le tuer. Se servant de cobayes pour concevoir des cyborgs dotés de facultés surhumaines, l’organisation a toutefois commis l’imprudence de faire de Zaji un soldat de tout premier ordre, transformant son corps en acier. Dès lors, aucun des individus missionnés pour le neutraliser ne semble capable de le maîtriser, Zaji n’ayant aucune faiblesse en dehors de son attachement sans bornes à cette figure maternelle qu’il n’a jamais connue. Une motivation qui trouvera plus tard son écho dans le personnage de Hyôga, chevalier du Cygne de Saint Seiya obnubilé par sa mère disparue.
Si la brièveté de ce manga inachevé ne lui permet pas de convaincre au-delà de la singularité de son personnage principal, ces premiers chapitres ne laissent que peu de doutes sur la prédominance de duels à venir entre Zaji et les cyborgs envoyés par l’organisation. Avortée prématurément, l’histoire n’ira pas plus loin... jusqu’en 2014, date à laquelle Masami Kurumada tentera de lui donner une seconde chance en publiant un spin-off intitulé Raimei no Zaji Tokubetsu-hen - Haruka Kanata dans le magazine en ligne gratuit Champion Cross des éditions Akita Shoten. Ne comptant hélas que quelques pages, ce chapitre spécial voit Zaji s’éveiller au milieu des glaces, plus résolu que jamais à retrouver sa mère qu’il ne connaît qu’au travers de fugaces souvenirs imprimés dans son inconscient.
Sans aucun doute, l’envie de reprendre l’histoire de Raimei no Zaji résulte de la démarche entreprise en 2014 par l’auteur de relancer certaines de ses œuvres les plus méconnues, à l’occasion de ses quarante ans de carrière. Cette même année, Kurumada choisit également de dépoussiérer son manga Otoko Zaka qu’il avait imaginé juste après Raimei no Zaji, en 1984. Interrompu prématurément à l’issue du troisième volume, le manga original affichait en dernière page la mention limpide « inachevé » après seulement trente semaines de publication dans les pages du Weekly Shônen Jump. La reprise de Otoko Zaka à l’automne 2014 donne l’occasion à Kurumada de revenir sur le contexte de cette interruption, en postface du quatrième volume relié. L’auteur tient surtout à s’excuser auprès de ses lecteurs de ne pas avoir pu poursuivre son histoire lors de sa première publication en 1984, insistant sur les nombreuses lettres de protestation reçues à cette occasion. Ce sont bien elles, affirme-t-il, qui ont rendu possible la reprise du manga Otoko Zaka trente ans après son interruption, l’auteur reprenant son histoire au douzième chapitre, précisément là où elle s’était arrêtée. Couvrant les événements liés au recrutement de l’empereur du nord par le héros Jingi, cette suite illustre on ne peut mieux le message véhiculé par le titre de l’œuvre. Otoko Zaka (ou « la colline des hommes »), c’est avant tout l’image d’une pente à gravir pour les plus valeureux, un parcours initiatique qu’il faut surmonter coûte que coûte pour mériter le respect de ses pairs. Masami Kurumada profite également de cette renaissance inespérée pour exprimer toute sa gratitude à l’égard de ceux qui n’ont cessé de le soutenir durant ses quarante ans de carrière.
Inédit en français mais paru en italien dans un pays extrêmement friand des œuvres de Kurumada, Otoko Zaka aborde la thématique du jeune adolescent bagarreur d’un point de vue plus large que dans les précédents mangas de l’auteur. Si les premiers chapitres présentent Jingi Kikukawa, l’éternel stéréotype de l’adolescent cool et téméraire, s’imposer par la force dans un milieu scolaire gangrené par la délinquance, l’histoire tutoie bien vite des sphères plus ambitieuses. Confronté à un rival le plaçant pour la première fois en situation d’échec, Jingi décide de s’infliger un entraînement spartiate auprès de celui que l’on surnomme « l’ogre de la montagne ». Bien que cet enseignement draconien ne soit pas excessivement développé dans les pages du manga, on y trouve déjà de manière flagrante les prémices de l’enfer qu’endurera Ikki auprès de son maître sur l’île de Death Queen dans Saint Seiya. Sous la protection de ce que l’auteur décrit comme « l’étoile céleste du meneur », Jingi devient le leader d’une alliance japonaise destinée à contrer les invasions venues de l’étranger. Pour la première fois dans une œuvre de Kurumada, il est question de guerres de territoire à l’échelle mondiale, même si le protagoniste ne se bat pas à des fins de conquête, mais bien dans le but de renforcer son pays face aux agressions extérieures.
À l’issue des chapitres réalisés en 1984, Jingi commençait tout juste son voyage en quête d’alliés valeureux, défiant les combattants les plus réputés pour consolider ses effectifs. Avec la reprise de l’histoire en 2014, les lecteurs ont enfin l’occasion de voir le héros arpenter les terres du Nord pour convaincre le redoutable Ken Kamui de se ranger derrière son leadership. Écornant au passage les régimes ou politiques encore en cours dans des pays tels que la Corée, la Russie, la Chine ou les États-Unis, l’auteur réaffirme son patriotisme sur une vingtaine de nouveaux chapitres permettant à Otoko Zaka de connaître les honneurs d’un sixième volume. Toujours officiellement en cours de publication, le manga devait accueillir un septième tome, mais son avancée est au point mort depuis 2016, l’auteur devant mener de front d’autres travaux d’envergure, à l’image de Saint Seiya : Next Dimension.
SAINT SEIYA ET SES HORS-SERIES
Dans les années quatre-vingt, l’expérience Otoko Zaka laisse donc Masami Kurumada sur un sentiment d’inachevé qui le convainc très vite de la nécessité de mettre sur pied un projet un peu plus ambitieux. Dans une interview parue en mai 1987 dans le magazine June, l’auteur confiera avoir vécu l’échec de Otoko Zaka, interrompu seulement après une trentaine de chapitres, comme un véritable stimulant. Face à une concurrence de plus en plus inspirée, Kurumada sait qu’il doit aller beaucoup plus loin s’il veut se démarquer, et enfin produire ce qu’il pourrait lui-même considérer comme un manga majeur.
Il remet alors en question le trop grand conventionnalisme de ses derniers scénarios pour porter davantage l’attention sur les éléments fantastiques, choisissant de doter ses nouveaux héros d’attaques spéciales percutantes et de troquer leurs tenues de lycéens contre des armures sacrées qu’il baptise « Cloths ». Au moment de son lancement en janvier 1986, Saint Seiya déstabilise le lectorat du Weekly Shônen Jump qui a du mal à cerner les thèmes précis du manga, certains n’hésitant pas à le classer dans le registre de la science-fiction, ce qui n’a pourtant jamais été dans les intentions de l’auteur. Kurumada explique avoir simplement voulu rajouter une touche « fashion » à ce qu’il considère bel et bien comme un manga nekketsu dans le but d’interpeller l’imaginaire des jeunes lecteurs. En puisant autant dans la mythologie grecque que dans l’astrologie, l’auteur s’émancipe cette fois largement des contraintes du monde réel pour dépeindre des affrontements sublimés par le caractère sacré de ces chevaliers revêtus d’armures placées sous le signe des constellations.
Du 26 novembre 1985 au 6 novembre 1990, la prépublication de Saint Seiya rencontre un succès remarquable auprès des lecteurs japonais, à raison de vingt-huit tomes reliés qui ne laissent guère de temps à leur auteur pour développer d’autres projets. À la faveur de la popularité de l’adaptation animée, lancée dès le 11 octobre 1986 sur TV Asahi grâce aux soins de Tôei Animation et de sponsors désireux de sortir les fameuses Cloths sous forme de produits dérivés, Kurumada voit sa motivation décuplée. Convaincu que la viabilité d’un manga d’action ne réside pas uniquement dans ses combats mais d’abord dans sa narration, il s’attache à développer autant que possible le background de ses protagonistes en dépit des contraintes exigées par le magazine de prépublication. Au début de l’année 1987, alors que l’histoire s’apprête à accorder une place majeure aux charismatiques chevaliers d’or, il juge ainsi nécessaire de creuser le caractère torturé du personnage d’Ikki, pour justifier ses motivations, tout en introduisant le chevalier de la Vierge dont il sait qu’il aura un rôle majeur à jouer dans la bataille du Sanctuaire. Prenant justement pour titre le nom de ce chevalier d’or, l’histoire courte Shaka sera par la suite incorporée directement au sein des principaux chapitres du manga en volumes reliés, qui en accueilleront une deuxième en 1988. Avec ce second chapitre parallèle intitulé Koori no Kuni no Natassia (The Cygnus Story - Natassia du pays des glaces), l’auteur approfondira cette fois le profil de Hyôga, juste avant d’attaquer l’arc Poséidon qu’il envisage comme une simple transition entre le chapitre du Sanctuaire et celui du dieu Hadès.
Il n’y aura en réalité pas d’autre hors-série de ce type dans la suite du manga. Mais on peut tout de même évoquer ici l’existence de trois histoires originales baptisées Outside Stories qui paraîtront, durant cette période, dans les pages de la série d’artbooks Saint Seiya Anime Special - Jump Gold Selection. Il ne s’agit cependant pas de mangas signés de la main de Kurumada, mais de récits annexes imaginés, pour les deux premiers, par Takao Koyama, le scénariste principal de la série animée, puis par Yoshiyuki Suga pour le troisième. La première histoire est agrémentée d’illustrations de Nobuyoshi Sasakado, tandis que les deux suivantes bénéficient de visuels dessinés par les incontournables Shingo Araki et Michi Himeno. Bien que très courtes, et en dépit de quelques incohérences avec la chronologie du manga, elles ont le mérite de creuser un peu plus les relations entre certains personnages en leur donnant davantage d’aspérités ou de développer des événements passés esquissés un peu vite dans l’histoire originale.
La première Outside Story revient par exemple sur le lien fraternel entre Ikki et Shun, les deux chevaliers se recueillant sur la tombe de leur mère pour évoquer sa mémoire dans un moment de complicité rare. À l’image des propriétés de la chaîne d’Andromède, il semble que plus les deux frères souffrent, plus les liens qui les unissent se renforcent. Un nouveau combat contre les Black Saint renégats contribuera à les rapprocher, même si le Phénix ne pourra s’empêcher de reprendre sa route en solitaire.
Dans le deuxième récit, ce sont les circonstances de l’accès au trône de Grand Pope par Saga et la neutralisation du traître Aiolos par Shura au Sanctuaire qui font l’objet d’approfondissements. Mais, ajoutée aux contradictions déjà existantes entre le manga et l’anime, cette nouvelle version impliquant notamment le personnage d’Âres, propre à la série TV - frère cadet de l’ancien Pope Shion, dont Saga aurait pris l’identité après l’avoir assassiné -, ne fait qu’embrumer encore davantage cet épisode clef de l’intrigue de Saint Seiya.
Enfin, le dernier de ces récits inédits en version française s’efforce de faire la liaison entre la fin de l’arc des douze maisons et le début du chapitre Asgard, exclusif à la version animée, en mettant l’accent sur les sentiments de Saori. Difficile, cependant, de croire que les guerriers divins d’Asgard aient voulu profiter de la faiblesse des chevaliers de bronze encore convalescents pour tenter de se débarrasser d’eux, même si cela alimente forcément la rivalité à venir entre les deux camps.
Plébiscité immédiatement par les lecteurs, Saint Seiya fait, dès le mois d’octobre 1987, l’objet d’une adaptation enjeu vidéo sur Famicom (équivalent japonais de la NES), alors que le manga n’en est encore qu’à son sixième volume relié. La console 8 bits de Nintendo hérite alors d’un jeu d’action-aventure intitulé Saint Seiya : Ôgon Densetsu (Les Chevaliers du Zodiaque : La Légende d’Or en version française) développé par le studio TOSE. À l’occasion de la sortie du jeu, les responsables du guide officiel organiseront une interview avec l’auteur du manga qui confiera n’avoir que peu d’affinités avec les jeux vidéo. Kurumada avoue surtout craindre le caractère addictif de ce divertissement, l’emprise des Game and Watch (des jeux électroniques portables produits par Nintendo) l’ayant déjà conduit à négliger son travail par le passé. Un deuxième épisode, baptisé Saint Seiya : Ôgon Densetsu Kanketsu Hen, suivra en mai 1988, mais son orientation résolument RPG (jeu de rôle) lui fermera les portes du marché occidental qui devra patienter de nombreuses années avant de voir la série franchir à nouveau les frontières du Japon.
L’APRES-SAINT SEIYA : L’OISEAU BLEU ET LE FAUCON
Achevée en décembre 1990 avec la parution du vingt-huitième et dernier tankôbon, l’aventure Saint Seiya fait de Masami Kurumada un nouveau maître à penser dans le milieu du shônen manga. Mais en dépit de son expérience, l’auteur va pourtant se heurter à une difficulté de renouvellement manifeste qui se traduira par la publication éphémère de deux nouvelles séries rapidement avortées.
N’ayant, en dehors de son titre, aucun lien direct avec le mythe de l’oiseau bleu, né d’une pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck en 1908, dont l’histoire avait été popularisée au Japon par la touchante série animée de 1980, Aoi Tori no Shinwa : Blue Myth est un manga sportif imaginé par Kurumada entre 1991 et 1992. La quête de bonheur symbolisée au travers du mythique oiseau bleu se voit transposée ici à l’échelle d’un simple terrain de base-ball fréquenté par des collégiens. Le personnage principal, Aoi Tendo, choisit cet endroit précis pour défier le prodige Shingo Ôki dans le but de venger la défaite de son frère aîné décédé juste après leur match, convaincu que ce dernier avait été battu parce qu’il était déjà gravement malade. Mais pour avoir une chance de tenir tête à Ôki, Aoi a besoin d’un receveur capable d’intercepter sans fléchir ses lancers fulgurants. Et seul le fragile Ai Daichi semble répondre à ces critères, le jeune garçon étant en mesure de discerner très distinctement l’oiseau bleu porteur d’espoir qui guide les balles du lanceur. Naît alors un duo invincible prêt à contrer n’importe quel adversaire, y compris le déloyal Ryûgo Ôki, frère cadet du prodige Shingo.
Il ne s’agit là toutefois que du prologue à une histoire abandonnée prématurément au terme de deux chapitres d’une centaine de pages, le sous-titre Overture annonçant clairement le début de ce qui aurait dû constituer une nouvelle série. Difficile de déceler les raisons de l’échec de ce manga, sinon peut-être l’absence de tout élément fantastique en dehors de certains lancers assimilables à des attaques spéciales, telle la « Thunderball » qui déchire le ciel comme un éclair au mépris des lois de la physique.
Kurumada joue, dès l’année 1992, une toute nouvelle carte, par l’intermédiaire de Silent Knight Shô. Parfois orthographié Silent Knight Syow, ce manga en deux volumes qui ne compte qu’une petite dizaine de chapitres s’achève sur un « Never End » signifiant à nouveau l’interruption prématurée de la série. Comportant autant de similitudes avec Saint Seiya qu’avec B’t X, dont la création était alors imminente dans l’esprit de l’auteur, elle marque assez nettement la transition entre ces deux œuvres qui comptent parmi les plus significatives dans la carrière de Kurumada. Les personnages de Silent Knight Shô arborent par exemple des armures beaucoup plus organiques et recherchées que celles des chevaliers d’Athéna, leur design d’animal totem évoquant volontiers les destriers grandioses des protagonistes de B’t X. Baptisées « Shelter », les armures de Silent Knight Shô naissent de la chair de leur hôte et peuvent être détruites et régénérées à volonté, basculant de leur fonction protectrice à leur forme animale selon l’imminence du danger.
L’histoire est celle de Shô, un jeune karatéka orphelin qui voit son destin bouleversé le jour où une petite fée se manifeste à sa vue pour lui expliquer qu’il n’est pas un être ordinaire, mais un « Silent Knight » en qui sont enfouis les vestiges des origines de l’humanité. En tant que tel, sa tâche est de protéger la Terre contre les assauts des divinités de la Neo Society qui, sous l’apparence de créatures antédiluviennes, seraient l’incarnation d’hommes ayant évolué vers des formes préhistoriques. Pour espérer les vaincre, Shô lui-même doit éveiller son potentiel latent de guerrier pour faire régresser ses ennemis au stade de simples humains, ce qu’il ne parvient à faire qu’au prix du sacrifice de son faucon domestique. Dès lors, l’adolescent hérite des pouvoirs de son animal totem et devient une menace pour les divinités de la Neo Society qui projettent de détruire la planète sous prétexte de vouloir lui épargner son extinction programmée. Conséquence directe du désastre écologique causé par l’homme, la Terre serait en effet condamnée à très court terme, n’ayant plus que quatorze années de sursis. Cependant, il ne s’agit là que des soldats mineurs d’une société extrêmement hiérarchisée qui compte des individus autrement plus redoutables que les Silent Knights dont Shô fait désormais partie.
En dépit de quelques sursauts narratifs et de schémas d’armures impeccables, la brièveté du manga et la prédominance des combats font que le scénario passe à la trappe au profit d’un déferlement de puissance qui n’augure rien de bien novateur par rapport aux précédents travaux de l’auteur. En revanche, perçu comme une ébauche de B’t X aux contours encore flous, Silent Knight Shô devient intéressant à plus d’un titre, ne serait-ce que parce qu’il illustre bien le cheminement créatif d’un Kurumada en quête d’un nouveau succès.
B COMME B’T X : L’HOMME FACE AUX MACHINES
Lorsque Kurumada répond à la proposition de l’éditeur Kadokawa Shoten de publier sa nouvelle série dans les pages du mensuel Shônen Ace en 1994, il ne sait pas que celle-ci va solliciter toute son énergie durant près de sept ans. Parue jusqu’en 2000 et comptant pas moins de seize tankôbon, l’intégrale de B’t X (à prononcer « Beat Ex ») constitue la troisième œuvre la plus conséquente de l’auteur et donnera naissance à deux adaptations animées : une série télé de vingt-cinq épisodes en 1996 et quatorze OAV intitulées B’t X Neo l’année suivante. Mieux connu en France que Ring ni Kakero, car publié dès 1998 chez Pika Édition (après une tentative avortée chez Manga Player) tandis que IDP Home Video prenait en charge l’anime, B’t X est le reflet de la progression du mangaka après deux décennies composées aussi bien d’échecs que de succès. Comme l’auteur l’indiquera au travers des multiples préfaces et postfaces présentes sur les différents volumes reliés de la série, la vie de mangaka est constituée de hauts et de bas, de rires et de larmes, de rage et de détresse, mais aussi et surtout d’incertitudes. À ce moment précis, vingt ans après ses débuts, Kurumada s’interroge toujours sur le bien-fondé de sa démarche, doutant encore de sa légitimité en tant que créateur de mangas et insistant sur les efforts à fournir lorsqu’on ne bénéficie pas de prédispositions particulières dans le domaine que l’on s’est choisi.
Laissons d’ailleurs l’auteur nous présenter lui-même le concept de cette série pour le moins marginale dans sa production, car tutoyant des problématiques futuristes qui incitent à rapprocher B’t X du registre de la science-fiction. On y parle entre autres de manipulations génétiques et cybernétiques, de « radiance pentachromique » ou encore de « psychoclonage ». Si l’on en croit la postface du volume 3 signée de la main de Kurumada, le point de départ de ce manga résulte de son envie de s’approprier le thème des robots dans le but de proposer quelque chose de vraiment distinct de ses œuvres précédentes. Très attaché au titre même de la série, l’auteur insiste notamment sur la signification de cet intitulé, qu’il considère comme révélatrice des enjeux de B’t X. Conçus par le professeur Kotaro Takamiya, ingénieur en cybernétique, les B’t sont des machines pourvues d’une conscience humaine. Ces robots géants revêtant l’apparence d’animaux mythiques sont ainsi dotés d’un cerveau (le B de « brain ») et se lient au premier humain avec lequel ils entrent en contact, ponctionnant son sang pour l’utiliser comme source d’énergie (le B de « blood »). Si le donneur meurt, le B’t qui lui est associé est bon pour la ferraille, mais tant que celui-ci reste en selle, il partage ses facultés hors-norme avec lui, lui permettant par exemple de respirer sous l’eau ou de braver la lave en fusion. Le sens de la lettre B ne s’arrête pas là, Kurumada lui attribuant également des valeurs telles que le courage (« bravery »), l’opiniâtreté (« battler ») ou l’amitié (« buddy »). Il apparaît important aux yeux de l’auteur que les B’t ne soient pas de simples montures soumises à la volonté de leurs donneurs, mais bien des compagnons dévoués avec lesquels ils peuvent communiquer et partager les épreuves qu’ils endurent. Le message que véhicule cette nouvelle série tient justement dans la force de ce lien qui doit permettre à l’être humain de se forger des valeurs saines pour devenir capable de briller par lui-même, sans compter sur autrui. Ainsi, lorsque le héros confie sa propre vie à son B’t dans l’espoir que ce dernier retrouve son éclat de jadis, c’est bien la noblesse des actes du donneur qui permet à la grandeur du B’t de s’épanouir.
À l’issue de cinq longues années de séparation, le jeune Teppei Takamiya décide de se lancer à la recherche de son frère Kotaro, enlevé par la Mecanicae Imperium lors du congrès de Mechatopia pour devenir malgré lui l’instrument de la domination de l’empire des machines. Tandis que le génie en robotique se voit contraint de mettre son talent au service des agents de l’empereur dans le but de les aider à finaliser des robots conscients nommés B’t, Teppei se retrouve lui-même confronté à la manifestation de l’une de ces créatures à la fois organiques et mécaniques. Censé être éteint depuis des années, le légendaire X s’éveille alors par l’intermédiaire du jeune homme en qui coule le sang de Karen, qui est à la fois la donneuse originelle de X et la propre sœur de Teppei. En témoignage de sa gratitude envers celui qui a tenté de défendre la guerrière disparue contre l’Imperium, X accepte de reconnaître Teppei comme second donneur, et tous deux partent à la rencontre des quatre commandeurs cardinaux qui symbolisent les remparts de la Mecanicae Imperium.
Conformément aux mythes ésotériques chinois, chaque point cardinal est connu pour être gardé par un B’t dont l’apparence renvoie à l’un des quatre animaux légendaires suivants : le dragon azur (à l’est), la chimère Kirin (à l’ouest), le phénix vermillon (au sud) et la tortue noire (au nord). Pour être tout à fait précis, le Kirin devrait normalement constituer le cinquième gardien, habituellement placé au centre. Mais Kurumada a choisi ici de lui faire occuper la place du gardien légitime de l’ouest, le tigre blanc, pour des raisons narratives que l’on découvre seulement à la fin du manga. Ces quatre créatures légendaires ont d’ailleurs inspiré quantité d’auteurs japonais qui les regroupent habituellement sous l’appellation de Shijin (les quatre dieux) et les associent en général à leurs éléments naturels respectifs : le bois pour le dragon Seiryû, le métal pour le tigre Byakko, le feu pour l’oiseau Suzaku et l’eau pour la tortue Genbu. C’est l’animal fabuleux Kirin, tenant à la fois du cerf, du cheval et du dragon et associé à la couleur jaune, qui veille sur la terre, le cinquième élément. On retrouve notamment ces fameuses créatures dans le jeu vidéo Shenmue II de Yû Suzuki, paru en 2001 sur Dreamcast, sous la forme d’une énigme qui implique l’utilisation de quatre clefs à l’effigie des quatre Shijin.
Quoi qu’il en soit, s’il veut atteindre la base dans laquelle est emprisonné son frère, Teppei doit franchir un à un tous les postes de défense de l’empire et convaincre les commandeurs cardinaux des véritables intentions de leur leader. Car si ce dernier se place en rédempteur divin œuvrant pour le bien de l’humanité, il vise en réalité une sorte de dictature implicite dans laquelle chacun serait asservi par son emprise technologique. Un projet qui ne pourra aboutir qu’avec le concours de Kotaro, censé trouver un moyen de contrôler le B’t ultime Rafaelo avant que cette abomination n’engloutisse la planète tout entière pour assouvir son besoin de puissance en achevant sa hideuse métamorphose.
L’une des trouvailles les plus pertinentes de Kurumada concernant l’élaboration de l’intrigue de B’t X réside dans la nature ambivalente des agents de l’empereur mécanique. Au lieu d’imaginer un antagoniste prévisible dont l’apparence serait le reflet direct de sa malveillance, il met aux commandes de l’Imperium deux enfants jumeaux apparemment inoffensifs qui trônent ensemble au milieu des jouets. Profondément attaché à sa sœur Nascha, alitée depuis déjà un an et très affaiblie, le jeune Mischa apparaît comme un garçon torturé dont l’immense cruauté n’a d’égale que le sentiment d’angélisme qui se dessine faussement sur son visage. Considérant qu’il détient le pouvoir absolu de vie et de mort sur les êtres humains, Mischa agit en enfant gâté et capricieux, en droit de jouer avec l’existence d’autrui sur un simple coup de colère. En dehors du fait que la salle du trône rappelle quelque peu le planétarium construit par Mitsumasa Kido dans Saint Seiya, la question de la domination du monde par les machines rappelle surtout les thèmes chers au mangaka Leiji Matsumoto dans Captain Harlock (Albator en V.F.) avec ses légions d’humanoïdes, ou dans Galaxy Express à travers l’asservissement des humains par les androïdes.
Dans la seconde partie du manga, qui coïncide avec le début des OAV de B’t X Neo, l’auteur creuse davantage les profils des adversaires de Teppei en imaginant des hepta-généraux au passé douloureux, susceptibles d’émouvoir le lecteur. En plus de conférer au titre une substance qui lui aurait fait défaut s’il était resté confiné dans les limites d’un manga shônen aux affrontements sans conséquence, ce travail réalisé autour des membres de l’armée secrète de l’empereur donne l’occasion à Kurumada d’exploiter de nouvelles sources d’inspiration. Le commando-maître de l’ombre est ainsi composé de duos inspirés des monstres les plus meurtriers du bestiaire fantastique, à l’image de la méduse et de l’hydre à neuf têtes. L’intrigue se plaît également à faire intervenir un mystérieux Shadow X noir, considéré comme l’ombre du B’t de Teppei, autonome et incontrôlable. Quant aux interventions télépathiques de Nascha, elles ne peuvent manquer d’évoquer le rôle de soutien joué par la petite infirme Kiyoko (le cobaye « numéro 25 ») dans le déroulement narratif du manga Akira de Katsuhiro Ôtomo, pilier de la science-fiction japonaise ayant révolutionné le genre à partir de 1982. Autre source d’inspiration probable, le manga Hokuto no Ken (Ken le Survivant en version française) de Buronson et Tetsuo Hara, lancé en 1983 dans les pages du Shônen Jump. En effet, et bien que l’adaptation animée n’y fasse pas allusion, le manga B’t X dévoile la présence, dans le dos du gardien spirituel du nord - baptisé justement Hokuto - de sept marques que l’on ne peut manquer de comparer aux sept cicatrices de Kenshirô. Atteint d’une maladie incurable et ayant vu la bombe atomique emporter toute sa famille, Hokuto se définit toutefois comme un être pacifique qui occupe une place de stratège précieux au sein du groupe. Enfin, bien qu’aisée à anticiper, la découverte de la nature féminine du commandant Aramis nous incite à penser que l’auteur s’était peut-être également intéressé de près à la très belle série télé Anime Sanjûshi (Sous le signe des Mousquetaires en français), diffusée quelques années plus tôt entre 1987 et 1989 sur la chaîne NHK.
Il est regrettable que l’adaptation animée de cet arc narratif du manga soit aussi expéditive dans son traitement, occultant finalement quantité d’éléments pourtant très pertinents et s’achevant de manière bien différente. Cela s’explique par le fait que le réalisateur ne disposait pas encore du matériau nécessaire pour s’en inspirer, la série de quatorze OAV ayant été réalisée en 1997, bien avant la conclusion du manga en janvier 2000 ! Les derniers hepta-généraux passent ainsi littéralement à la trappe alors que la compréhension de leurs motivations profondes constitue justement tout l’intérêt de la fin de B’t X. C’est par exemple seulement à la lecture du manga que l’on peut saisir les raisons qui poussent le misérable Juggler à porter un masque, son grotesque faciès de clown ayant fait de sa vie un enfer. Ce dernier ne peut guère compter que sur la bienveillance de Nascha pour accepter de croire que « l’essentiel est invisible pour les yeux », comme le prétend Saint-Exupéry dans le passage du Petit Prince que la jeune fille aveugle lui demande de lire dans le but de mieux accepter sa condition.
Même s’il est évident que l’oeuvre originale surclasse sans difficulté sa déclinaison animée, il faut toutefois reconnaître que l’auteur n’a pas entièrement réussi son pari de proposer un titre capable de se détacher nettement du canevas de ses autres productions. Au-delà des références mythologiques et de l’analogie manifeste entre les B’t et les armures décrites comme quasi vivantes dans Saint Seiya, les similitudes restent nombreuses concernant la réutilisation de fondamentaux chers à l’auteur. Comme Marine avant elle, Karen incarne à nouveau cette figure de mentor à la fois maternelle et fraternelle sans laquelle le héros ne saurait aller de l’avant. D’autres comparaisons sautent aux yeux, telle la foi du prêtre chrétien Fhou qui rappelle celle du chevalier de la Vierge fidèle à ses principes bouddhistes. Ou encore la métamorphose de Rafaelo en quête de sa forme parfaite après cinq cents années de développement, préoccupation principale de Cell dans l’arc des humains artificiels du Dragon Ball de Toriyama. On y voit même un B’t capable de détruire l’ouïe de ses congénères, à l’image de la technique « Tenbu Hôrin » de Shaka qui prive l’adversaire de ses cinq sens. Baptisé « Je T’aime » en version originale en symbole de l’amour qui l’unit à son donneur, ce B’t illustre d’ailleurs assez bien les difficultés que l’auteur confie avoir rencontrées tout au long de sa carrière dans la recherche de patronymes. Prononcé « Jutem » dans la version française de la série animée pour atténuer l’étrangeté de cette dénomination, le B’t de Fhou est assez logiquement rebaptisé Skida dans l’édition française du manga, se rapprochant ainsi de la lecture du terme « suki da » qui signifie « je t’aime » en japonais. Si ce cas particulier peut sembler pour le moins amusant, Kurumada regrette malgré tout que l’inspiration lui fasse trop souvent défaut pour lui permettre de faire vivre ses idées. Il n’y a qu’à faire le tour des clichés employés par l’auteur dans l’attribution des noms des personnages de Ring ni Kakero (Napoléon, Himmler, Jésus...) pour cerner l’ampleur de la problématique. Mais, à l’aube de l’an 2000, l’inquiétude principale de Masami Kurumada demeure tout de même son appréhension grandissante à l’idée de se retrouver subitement confronté à un monde dont il ignore tout : celui de l’Internet et de l’infographie ! Ainsi confie-t-il en préface du volume 13 de B’tX : « Dès qu’on sera dans le XXIe siècle, je me dis que je ne serai définitivement plus de mon temps... Mais je dis une bêtise : je ne suis déjà plus de mon temps ! »
CHANGEMENT DE DECOR
Durant la publication de B’t X, Kurumada succombe également à l’attrait d’un contexte historique qui fascine bon nombre de ses contemporains : celui du Japon féodal de la fin de l’ère Edo. Il entreprend alors, dès 1995, la création d’un manga de sabre dont le titre, Akaneiro no Kaze, signifie « le vent couleur garance » et évoque le rouge caractéristique de la bannière du Shinsen Gumi. L’histoire est par conséquent centrée sur les membres de ce célèbre groupe de samouraïs, chargé de maintenir la paix à Kyôto sous les ordres du shogun Tokugawa durant le Bakumatsu, à la fin de l’ère Edo. Elle relate les principaux événements relatifs à cette période de troubles ayant suivi l’arrivée des navires noirs du commodore Matthew Perry dans la baie de Tokyo. L’action débute plus précisément dix ans plus tard, en 1863, dans la province de Tama, en se plaçant du point de vue de Sôji Okita, fine lame âgée de vingt ans, appelé à devenir le capitaine de la première division du Shinsen Gumi. En choisissant Okita comme acteur principal de son histoire, l’auteur cherche surtout à pointer du doigt la discutable réputation de ces représentants de la loi qui fut largement compromise par les agissements répréhensibles de certains de ses membres. Le jeune Sôji devient alors assez rapidement l’incarnation du redresseur de torts immaculé, en opposition avec ses camarades avides de destruction, seulement perçus comme les assassins du pouvoir en place. Surnommés les « Loups de Mibu », ces derniers abusèrent en effet de leur autorité pour soumettre les populations à leur volonté, au lieu d’appliquer le code d’honneur du bushidô que les samouraïs se devaient logiquement de suivre. Akaneiro no Kaze s’intéresse également de près au profil de Toshizô Hijikata ainsi qu’aux autres personnages clefs du Bakumatsu dans le but de balayer l’ensemble des clichés de cette période historique ayant inspiré bien des œuvres de fiction.
Kurumada en profite surtout pour reprendre à son compte tous les ingrédients symptomatiques du manga de sabre, le contexte étant prétexte à une profusion de duels sanglants mais néanmoins classiques qui tranchent avec le style habituel de l’auteur, plus versé dans les techniques spéciales hors du commun. On y trouve notamment plusieurs scènes totalement gratuites présentant des geishas dénudées et brutalisées qui semblent presque déplacées dans le contexte résolument shônen du manga. Sur l’ensemble des chapitres réalisés, aucune figure féminine n’apparaît autrement que comme simple faire-valoir des intervenants masculins. L’auteur ne nous épargne pas non plus l’évocation de katanas légendaires prétendument maudits tels le Kiku-ichimonji, forgé sept cents ans plus tôt durant l’ère Kamakura. Relevant lui aussi davantage du mythe que de l’Histoire, ce sabre revient régulièrement dans le domaine de la pop culture, apparaissant ainsi à maintes reprises dans la série de jeux vidéo Final Fantasy parmi les armes ultimes de la franchise. Dans le quatrième épisode, par exemple, il passe entre les mains du ninja Edge et constitue l’un des meilleurs katanas du jeu. Très tôt, Kurumada attribue également au très moral Okita la technique de la lame inversée, popularisée dans le manga Rurôni Kenshin (Kenshin le Vagabond) de Nobuhiro Watsuki, dont la publication avait démarré l’année précédente dans les pages du Weekly Shônen Jump. En frappant du revers de sa lame, Sôji montre qu’il se refuse à tuer inutilement ses adversaires, quelle que soit la haine qu’il éprouve à leur égard. Sous la bannière du drapeau rouge de la vérité, Okita et Hijikata feront finalement partie des treize guerriers d’élite choisis pour défendre le vice-amiral de Kyôto parmi les deux cent trente-quatre rônins (samouraïs sans maître) qui composaient initialement les rangs du Rôshi Gumi fondé par Hachirô Kiyokawa.
Contraint de stopper prématurément ce manga qui ne compte en définitive qu’un seul volume, Masami Kurumada ne semble pas être parvenu à s’approprier la flamboyance du contexte historique de manière aussi passionnée que n’avait su le faire Nobuhiro Watsuki avec Rurôni Kenshin durant cette même période. Le fait que les scénarios des différents chapitres soient trop indépendants pour consolider un fil rouge digne de ce nom joue clairement en sa défaveur et les rebondissements manquent cruellement à l’appel pour que l’on ait réellement envie de connaître la suite.
Plus brève encore sera l’aventure Evil Crusher Maya, publiée en 1996 chez Square Enix dans les pages du mensuel Shônen Gangan. Réalisé dans l’esprit d’une histoire courte à l’attention des lecteurs qui l’ont soutenu depuis déjà vingt-cinq ans, ce one-shot est le premier à embrasser des thématiques gothiques dans l’optique d’une lugubre chasse aux démons.
Tandis qu’une jeune fille est assaillie par ce qu’elle croit être de simples loups, un mystérieux guerrier nommé Maya met à jour la présence d’entités maléfiques envoyées depuis le pays de la nuit éternelle. Bien qu’il soit lui-même originaire de cet endroit connu pour être le berceau des démons, le jeune homme a soif de vengeance depuis qu’il a compris que ses parents humains avaient été assassinés par ces sinistres créatures. Élevé par une démone - dont le design apparaît calqué sur celui de dame Pandore qui intervient durant l’arc Hadès de Saint Seiya -, Maya a choisi de se ranger du côté des humains afin d’entreprendre une impitoyable chasse aux démons à l’aide des pouvoirs surnaturels qui l’habitent. Armé de fléchettes aux capacités purificatrices, le jeune guerrier a la particularité de ne dégager aucune chaleur humaine, mais aspire cependant à devenir un jour un être humain à part entière au contact des individus faits de chair et de sang. Lancé sur les traces d’un ancien démon supérieur camouflé sous l’identité d’un prétendu faiseur de miracles, Maya déjoue les maléfices des créatures de la nuit et délivre six jeunes vierges dont le sang devait servir à prolonger l’existence du seigneur des lieux de plusieurs milliers d’années.
En dépit de sa brièveté, ce manga a le mérite de se terminer de manière cohérente avec le triomphe d’un héros au profil sombre, partagé entre l’ombre et la lumière, que l’on imagine prêt à entamer de nouvelles péripéties si le public avait suivi. Paresseux en termes narratifs, Evil Crusher Maya se rattrape néanmoins sur le plan visuel avec des planches très fouillées lorsque l’auteur s’attelle au design des créatures inférieures. À l’inverse, d’autres adversaires plus conventionnels se contentent d’emprunter des pièces d’armures aux chevaliers de Saint Seiya et paraissent en décalage avec le contexte gothique du manga. On peut imaginer qu’un plus gros travail de l’auteur sur le passé et les motivations du protagoniste aurait peut-être permis à Evil Crusher Maya d’interpeller davantage le lectorat du Shônen Gangan. En l’état, l’histoire du chasseur de démons n’ira hélas pas plus loin.
BOUCLER LA BOUCLE
Prêt à rebondir immédiatement après la fin de la publication de B’t X, dans le courant de l’année 2000, Masami Kurumada consacre une bonne partie de la décennie suivante à développer les tenants et aboutissants de Ring ni Kakero 2 qui constitue le prolongement de son manga de cœur. En dépit de l’envergure que revêt cette nouvelle série qui couvre, rappelons-le, pas moins de vingt-six volumes publiés jusqu’en 2009, les travaux de l’auteur restent fortement influencés par la popularité de Saint Seiya dont le succès colossal dépasse désormais largement les rivages de l’archipel nippon. C’est la raison pour laquelle Kurumada prend la décision, dès 2002, d’adopter une démarche inédite en déléguant à des personnes de confiance la réalisation de quelques-uns de ses projets, démarche qu’il continuera d’adopter par la suite au gré des différents spin-off de Saint Seiya. Ainsi, tandis que le jeune mangaka Megumu Okada se charge de réinventer avec panache l’univers de la série dans Saint Seiya : Episode G, c’est à son disciple Satoshi Yuri que le maître choisit de confier l’élaboration de Fûma no Kojirô : Yagyû Ansatsu Chô dans les pages du Champion RED aux éditions Akita Shoten. Les circonstances, déjà évoquées, de l’annulation prématurée de cette tentative de suite, ont probablement permis à Kurumada de faire un constat pragmatique : un gouffre sépare manifestement le monstre sacré Saint Seiya de toutes ses autres œuvres en termes de popularité. Car, si la publication de Ring ni Kakero 2 lui permet de renouer avec une partie de son public, c’est bien aux commandes de Saint Seiya que ses lecteurs attendent désespérément son retour, et pas seulement dans un rôle de supervision.
Il faudra néanmoins patienter jusqu’en 2006 pour que, porté par l’engouement consécutif au succès des OAV centrées sur l’arc Hadès du manga, Masami Kurumada réponde enfin à l’appel de ses fans. L’auteur dévoile alors la mise en chantier de Saint Seiya : Next Dimension, parallèlement au lancement de Saint Seiya : The Lost Canvas, un nouveau spin-off dont il se contente de dresser les bases narratives pour en confier la réalisation à Shiori Teshirogi. Cependant, à l’inverse de Next Dimension dont l’histoire est qualifiée de canonique, cette nouvelle série est présentée comme une ramification alternative ne venant pas s’incorporer directement dans la chronologie officielle de Saint Seiya. Les deux projets n’en partagent pas moins plusieurs points d’ancrage intéressants, offrant chacun un regard inédit sur la précédente guerre sainte et ses acteurs clefs. À l’origine, les deux œuvres devaient réellement s’entrecroiser dans le but d’offrir deux points de vue distincts sur une même période de l’histoire, mais parce qu’elles en vinrent rapidement à livrer deux versions difficilement compatibles entre elles sur des points bien précis, Kurumada choisit finalement de n’en retenir qu’une seule dans le canon de Saint Seiya.
Si, depuis 2006, tous les yeux sont rivés sur l’évolution du manga Next Dimension, signé de la main du maître et intégralement colorisé, c’est aussi en raison de la double chronologie couverte par le récit qui joue sur deux époques à la fois. Combinées au gré des rebondissements de l’intrigue, ces timelines présentent à la fois l’avant et l’après-Saint Seiya, dressant déjà en une dizaine de volumes des pistes narratives bien plus complexes que le point de départ ne le laissait présager. Pourtant, le rythme de parution laborieux de Saint Seiya : Next Dimension semble trahir une certaine lassitude de la part de Kurumada qui, à l’occasion de ses quarante ans de carrière en 2014, saute sur l’occasion de reprendre certains de ses travaux de jeunesse avortés (Raimei no Zaji et Otoko Zaka), laissant temporairement de côté le destin de ces chevaliers qui l’accaparent depuis si longtemps.
En 2015, il se lance même dans un travail rétrospectif beaucoup plus personnel par le biais d’un manga autobiographique romancé intitulé Ai no Jidai : Ichigo Ichie. Publiés encore une fois dans le magazine Shônen Champion qui accueille, dans le même temps, l’histoire de Saint Seiya : Next Dimension, les huit chapitres de ce manga permettent à l’auteur de porter un regard à froid sur ses quarante ans de carrière. On y trouve l’expression des rêves épanouis et des destins brisés de l’entourage proche d’un certain Masami Higashida, à une époque où la jeunesse avait viscéralement soif de liberté et percevait les yakuzas comme des héros et des modèles à suivre. Contrairement à ce que laisse entendre ce manga, Kurumada n’est pas un pseudonyme mais bien le nom réel de l’auteur. Lors d’un entretien relayé en 2003 par la chaîne Fuji TV, bien avant la réalisation de Ai no Jidai, l’intéressé avait en effet indiqué que, bien qu’il n’aimât pas son prénom (Masami étant également un prénom féminin), il avait d’abord songé à prendre un alias plus viril tel que « Gô Saotome » ou « Jôji Samidare ». Mais il se ravisa en comprenant qu’il n’appartenait qu’à lui de faire briller le nom de Masami Kurumada. Quoi qu’il en soit, le personnage de Masami Higashida décrit dans Ai no Jidai reste révélateur du profil de l’auteur à travers le spectre de celui qui semble avoir toujours perçu la vie comme une lutte acharnée digne de figurer dans les pages d’un shônen nekketsu. L’adolescent tête brûlée qui pratiquait le judo et flirtait avec la petite délinquance trouve dans le dessin une voie de salut inespérée. Si Masami ne peut devenir le héros des histoires qui le fascinent tant, rien ne l’empêche de les créer lui-même. Mais la voie du mangaka est pavée d’embûches et de moments de doutes pour qui n’est pas doté de facilités, et le jeune homme doit surmonter toutes ces difficultés à force de travail et de persévérance. Ai no Jidai revient tout particulièrement sur l’impact ressenti par Kurumada à la lecture de l’oeuvre d’Hiroshi Motomiya, Otoko Ippiki Gaki Daishô, qu’il découvre dans les pages du Weekly Shônen Jump durant sa première année de lycée et qui le conduit à s’inspirer de ses expériences personnelles pour relater des histoires en phase avec son époque. Soutenu par un entourage plus confiant que lui-même en ses propres capacités, l’aspirant mangaka se lance alors, trois ans plus tard, dans la création d’une première histoire courte dont il apportera en personne les planches à la rédaction du Weekly Shônen Jump. Enfin en immersion dans un monde dont il a encore tout à apprendre, il découvre la réalité du métier, les difficultés à percer, mais aussi la reconnaissance d’un public aux retours aussi fluctuants qu’imprévisibles. Plus que le reflet véritable du parcours de Masami Kurumada, Ai no Jidai : Ichigo Ichie véhicule surtout un message d’espoir que l’auteur souhaite adresser à tous ceux qui désespèrent de voir un jour leurs projets aboutir.