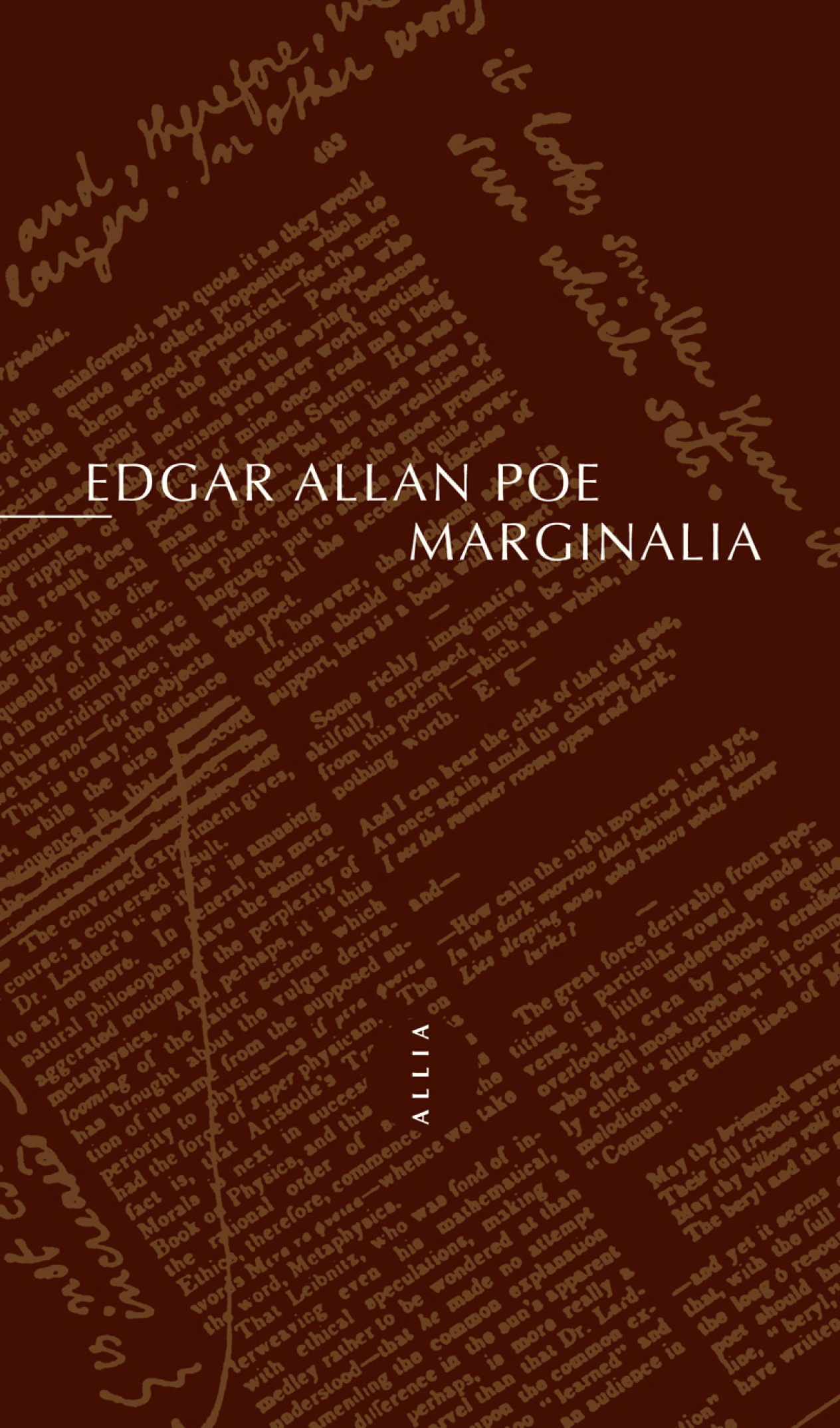
Titre
EDGAR ALLAN POE
Marginalia et autres fragments
Textes choisis, présentés et raduits de l'anglais par
LIONEL MENASCHÉ

Marginalia
MARGINALIA
(novembre 1844 - septembre 1849)
EN achetant mes livres, j'ai toujours attaché de l'importance à ce qu'ils soient pourvus d'amples marges. Non par goût de la chose en elle-même – qui n'est d'ailleurs pas sans attraits – mais pour la facilité que j'y trouve à crayonner les pensées qui me viennent en lisant, mon approbation, mon désaccord ou, plus généralement, quelques brefs commentaires critiques 1. Lorsque mes notes sont trop longues pour pouvoir s'inscrire dans un cadre si restreint, je les confie à une feuille de papier que je glisse entre les pages, tout en ayant soin de la fixer à l'aide d'un imperceptible morceau de gomme. Il se peut que ce soit là un pur caprice de ma part, une pratique très banale et aussi très vaine, dans laquelle je persiste malgré tout. Mais j'en éprouve du plaisir, qui est une manière de profit, quoi qu'en pensent M. Bentham et M. Mill de surcroît 2.
Ces notes ne constituent pourtant en aucune façon de simples memoranda, une pareille habitude ayant des inconvénients certains. “Ce que je mets sur papier, dit Bernardin de Saint-Pierre, je le remets de ma mémoire, et par conséquent je l'oublie” 3. En vérité, si vous voulez dans l'instant même oublier une chose, vous n'avez qu'à écrire quelque part qu'il faut vous en souvenir.
Or, des annotations purement marginales qu'on ne destine pas à l'usage de la mémoire ont un caractère particulier ; et non seulement leur but diffère du reste, mais il se peut qu'elles n'en aient aucun. Voilà ce qui fait tout leur prix. Elles ont un peu plus de valeur que des cancans littéraires, hasardeux et décousus, car il n'est pas rare que ces derniers se limitent au seul plaisir de parler, de la façon la plus irréfléchie ; tandis que les marginalia sont écrits avec le recul nécessaire, afin que l'esprit du lecteur soit déchargé d'une pensée, fût-elle légère, naïve ou triviale, mais une pensée tout de même, et non quelque chose qui aurait pu le devenir, avec l'aide du temps et de circonstances plus favorables.
Dans les marginalia, aussi, nous ne devisons qu'avec nous-mêmes, et, par conséquent, nous causons franchement, librement, originalement, avec abandon, sans aucune vanité, bien dans la manière de Jeremy Taylor, de Sir Thomas Browne, de Sir William Temple, de l'anatomique Burton et de ce grand expert en analogies, Joseph Butler 4, ainsi que de quelques autres auteurs anciens, qui étaient trop pleins de leur sujet pour avoir souci de leur forme, laquelle, sans qu'ils y accordassent beaucoup d'attention, devenait forme par excellence, un modèle de forme, avec cet aspect profusément marginal.
La limitation de l'espace, pour ces crayonnés, présente en elle-même un peu plus d'atouts que d'inconvénients. Elle nous contraint, quel que soit le vague et le diffus de notre pensée secrètement conçue, à faire du Montesquieu, du Tacite (en exceptant toute la dernière partie de ses Annales) et même du Carlyle – chose à ne pas confondre, me dit-on, avec l'affectation et l'incorrection grammaticale ordinaires. Je dis “l'incorrection grammaticale” par pur entêtement, parce que les grammairiens, qui devraient mieux s'y entendre, insistent pour que je m'exprime autrement. Mais la grammaire n'est pas ce que ces grammairiens voudraient qu'elle soit. Et celle-ci n'étant que l'analyse du langage, ainsi que le résultat de cette même analyse, elle n'est correcte ou incorrecte qu'en raison de la sagesse ou de la sottise de l'analyste.
Mais revenons à nos moutons. Dernièrement, par une après-midi pluvieuse, comme j'étais d'une humeur trop indolente pour pouvoir me livrer à quelque travail suivi, je parvins à tromper mon ennui en fouillant, çà et là, parmi les volumes de ma bibliothèque, qui n'est, certes, pas très considérable mais suffisamment variée, et formée, ce dont je me flatte, avec beaucoup de soin. Peut-être était-ce en raison de ce que les Allemands nomment l'humeur dispersive du moment, quoi qu'il en soit, tandis que mon attention se portait sur ces nombreux coups de crayon à l'allure pittoresque, le désordre incohérent de ces commentaires parvint à m'amuser. À la longue, j'en arrivais même à souhaiter qu'une autre main que la mienne eût ainsi maltraité ces livres et à m'imaginer que, dans cette hypothèse, je n'aurais pas tiré un mince plaisir à les feuilleter. L'idée qui me vint assez naturellement fut alors que, même dans mes propres griffonnages, il y aurait peut-être des observations susceptibles d'intéresser autrui, par simple goût du griffonnage.
La principale difficulté consistait dans la manière d'extraire ces notes des volumes qui les contenaient, de séparer le texte du contexte et de ne point détériorer la trame d'intelligibilité si fragile de l'ensemble. Déjà, avec toutes les informations nécessaires et les pages imprimées en regard, ces commentaires apparaissaient trop souvent pareils aux oracles de Dodone, à ceux de Lycophron le Ténébreux 5 – ou encore, aux essais des disciples du pédant de Quintilien, qui étaient “nécessairement excellents, puisque le pédant lui-même les trouvait incompréhensibles”. Qu'adviendrait-il alors de ce texte, une fois transposé ou déplacé ?
Je résolus enfin d'avoir confiance en la perspicacité et l'imagination du lecteur, et posai ceci en règle générale. Mais dans certains cas, où la foi même ne pouvait déplacer des montagnes, il n'y eut pas de meilleure stratégie que de remanier mon commentaire, afin de communiquer au moins l'ombre de l'idée dont il était question. Là où le texte était absolument nécessaire pour donner à voir cette idée, je n'avais qu'à le citer ; et là où le titre du livre faisant l'objet d'un commentaire était indispensable, il me suffisait de l'indiquer. Bref, tel un personnage de roman face à un dilemme, je pris le parti “de me laisser guider par les circonstances”, à défaut de plus satisfaisantes règles de conduite.
Quant aux nombreuses opinions exprimées dans l'amas confus qui va suivre, quant à mon adhésion présente à leur ensemble ou à mon désaccord avec certaines d'entre elles, quant à la possibilité d'avoir, dans certains cas, changé d'avis, ou à l'impossibilité de n'en avoir pas changé souvent, ce sont là des choses à propos desquelles je ne dirai rien, car il n'y a rien d'intéressant à en dire. Il serait toutefois bon d'observer que, si la qualité du vrai calembour est en proportion directe de son caractère intolérable, de même le non-sens est la raison d'être essentielle de la note marginale.
N'était la honte, la plupart de ces prétendus apophtegmes seraient démasqués comme étant de pures épigrammes. Ils ont ceci de commun avec les fleurets utilisés dans les salles d'armes qu'on ne peut en faire usage d'aucune partie, excepté la pointe. Encore qu'on ne le puisse pas vraiment, à cause du vernis de profondeur dont leur extrémité paraît mouchetée.
Quand la musique nous émeut jusqu'aux larmes, sans raison apparente, nous ne pleurons pas, comme Gravina 6 le suppose, par “excès de plaisir” mais par l'excès d'une tristesse impatiente, irritée, face à l'incapacité où nous sommes, en tant que simples mortels, à jouir de ces extases surnaturelles, dont la musique ne nous laisse entrevoir qu'un vague et suggestif aperçu.
Les théoriciens du Gouvernement, qui prétendent toujours commencer par le commencement, prennent pour point de départ l'Homme dans ce qu'ils appellent son état naturel : le sauvage. Mais de quel droit supposent-ils que c'est là son état naturel ? La principale idiosyncrasie de l'Homme étant la raison, il s'ensuit que sa condition sauvage – la condition dans laquelle il est privé de la raison – n'est pas naturelle. Plus il raisonne, plus il s'approche de la position vers laquelle sa principale idiosyncrasie le conduit irrésistiblement. Et tant qu'il n'aura pas trouvé cette position – tant que sa raison ne se sera pas épuisée en vue d'une amélioration de l'Homme – tant qu'il n'aura pas posé son pied sur le plus haut degré de la civilisation, son état naturel ne sera pas ultimement atteint, ni entièrement déterminé.
Aucun des traités de Bridgewater 7 n'a relevé la grande idiosyncrasie du système divin d'adaptation – cette idiosyncrasie qui est le sceau divin de l'adaptation, par opposition à l'œuvre d'une constructivité purement humaine. Je veux parler de la complète réciprocité de l'adaptation 8. Par exemple : dans les constructions humaines, une cause particulière a un effet particulier – une intention particulière produit un résultat particulier, mais nous ne voyons pas de réciprocité. L'effet n'agit pas en retour sur la cause – l'objet ne change pas son rapport avec l'intention. Dans les constructions divines, l'objet est tour à tour objet et intention, selon le point de vue que nous adoptons, tandis que l'intention est soit intention soit objet ; si bien que nous ne pouvons jamais (abstraitement, sans concrétisation, ni référence à des faits du moment) distinguer l'un de l'autre. Prenons un exemple d'ordre second : dans les climats polaires, l'organisme humain, pour maintenir sa chaleur vitale, et pour la combustion stomacale, réclame l'alimentation la plus riche en ammoniaque, telle que le thran. D'autre part, nous voyons que dans les climats polaires, l'huile de phoques et de baleines qui s'y trouvent en abondance, est la seule nourriture offerte à l'homme. Et maintenant, dirons-nous que l'huile est mise à la portée de l'homme parce qu'elle est impérieusement réclamée ? ou bien qu'elle est la seule chose réclamée parce qu'elle est la seule chose qu'on puisse obtenir ? Il est impossible de le savoir. Il y a une absolue réciprocité d'adaptation que nous chercherions en vain parmi les œuvres de l'homme.
Les auteurs des traités de Bridgewater ont peut-être omis ce point, en raison de sa tendance apparente à nier l'idée de cause en général, et conséquemment l'idée d'une Cause Première : l'idée de Dieu. Mais il est plus probable qu'ils n'aient pas su reconnaître ce que personne, à ma connaissance, n'avait encore perçu.
Le plaisir que nous tirons de toute application de l'ingéniosité humaine est en rapport direct du plus ou moins de ressemblance avec cette forme de réciprocité, entre la cause et l'effet. Ainsi, dans la construction d'une intrigue littéraire, nous devrions nous efforcer d'arranger les éléments ou les incidents de telle façon qu'il fût impossible de décider, à propos d'aucun d'entre eux, si tel élément découle de tel autre ou l'implique. En ce sens, bien sûr, la perfection de l'intrigue ne saurait être atteinte dans les faits, parce que c'est l'homme qui la construit. Les intrigues de Dieu sont parfaites. L'Univers est une intrigue de Dieu.
D'une manière générale, on ne devrait pas trop chercher à faire de belles phrases, lorsqu'il s'agit de clouer un imbécile au pilori. Allez-y franchement ! Ou vous risqueriez de ne pas être compris par l'intéressé. Faut-il le pendre ? Alors qu'il soit pendu, et vite ! Mais laissez donc les courbettes si vous n'entendez pas saluer, et dispensez-vous de la délicatesse comique du bouffon, dans la pièce de Shakespeare : “Veuillez, Monsieur, avoir l'amabilité de vous lever et d'être mis à mort 9.” Ce principe est le seul valable en ce qui concerne les hommes. S'agissant du beau sexe, le critique ne paraît devoir suivre qu'une ligne de conduite : parlez si vous pouvez louer, sinon veillez à ne rien dire. Car vous ne ferez jamais admettre à une femme qu'il n'y ait pas d'identité entre elle et son livre ; or, comme le dit justement cet excellent moraliste anglais, James Puckle, dans son Gray Cap for a Green Head, “un homme bien élevé ne prendra jamais la liberté de dire du mal des femmes”.
Le sentiment d'une haute naissance est une force morale que les démocrates, bien qu'ils aient des mathématiques plein la tête, ne seront jamais en état de calculer. Pour savoir ce qu'est Dieu, dit le baron de Bielfeld, il faut être Dieu même 10.
J'ai vu beaucoup d'estimations relatives au plus haut degré d'érudition qui puisse être atteint par un individu au cours d'une vie, mais toutes reposaient sur des erreurs et demeuraient infiniment en deçà de la vérité. Il est exact que, d'une façon générale, nous ne retenons, nous ne mémorisons à des fins utiles qu'un centième de ce que nous lisons. Cependant, il y a des cerveaux qui touchent non seulement toutes les recettes, mais qui les conservent aussi à intérêts composés pour toujours. Bien entendu, si quelqu'un était censé lire à haute voix, il ne pourrait lire effectivement que très peu de chose, même en un demi-siècle parce que, dans ce cas, chaque mot pris individuellement devrait l'arrêter à un certain degré. Mais, lorsque nous lisons pour nous-mêmes, à la vitesse courante de ce qui s'appelle une lecture de divertissement, nous n'effleurons du regard qu'à peine un mot sur dix. Et, même considérée sous un angle physique, la connaissance attire la connaissance comme l'argent va à l'argent, car celui qui lit vraiment beaucoup voit augmenter sa capacité de lecture selon une progression géométrique. Le lecteur virtuose se contentera de jeter un coup d'œil sur une page, tandis que celle-ci retiendra un lecteur ordinaire pendant plusieurs minutes ; et la différence en lecture absolue (son utilisation étant prise en compte) sera à l'avantage du virtuose qui aura moissonné tout le sujet dont le novice arrivera difficilement à séparer le bon grain de l'ivraie. Une habitude de la lecture profondément enracinée et rigoureusement continue aura comme effet, pour une certaine catégorie d'intellects, une appréciation instinctive et apparemment magnétique de la chose écrite. Si bien qu'un étudiant peut lire des pages entières, là où d'autres en sont à ne lire que des mots. Dans un grand nombre d'années, grâce à une analyse détaillée du processus mental, cette sorte d'appréciation pourra même devenir une chose répandue. Elle sera enseignée dans les écoles de nos descendants de la dixième ou de la vingtième génération ; et pourra devenir la méthode des foules de la onzième ou de la vingt-et-unième génération. Et ce genre de questionnements devrait-il s'abîmer dans le passé – comme cela adviendra – il n'y aura pas plus de raison de s'en étonner que nous n'en trouvons, aujourd'hui, dans la merveille que, syllabe après syllabe, des hommes comprennent ce que je suis en train de tracer sur cette page, une lettre après l'autre.
N'y a-t-il pas une loi selon laquelle le besoin tend à engendrer la chose nécessaire ?
Voici une erreur qui a de graves conséquences : le postulat selon lequel, étant des hommes, nous exprimons généralement le vrai d'une manière réfléchie. La plus grande partie de la vérité est émise de façon impulsive, aussi la plus grande partie de la vérité est-elle parlée et non écrite. Mais, dans notre examen des données historiques, nous perdons de vue ces considérations. Nous raffolons des documents qui, dans l'ensemble, sont mensongers ; tandis que nous négligeons la Cabale qui, lorsqu'elle est bien interprétée, ne ment pas.
“Sous un certain angle d'incidence, la lumière frappant l'une des pyramides d'Égypte produit un son.” J'ai rencontré quelque part cette assertion, formulée ainsi, probablement dans une des notes sur Apollonius de Tyane 11.
J'imagine que cela n'a pas de sens, mais parler hâtivement n'est pas de mise. Le rayon orange du spectre et le bourdonnement du moucheron (qui ne monte jamais au-dessus d'un certain diapason) produisent en moi des sensations très similaires. Si j'entends un moucheron, je perçois la couleur. Si je perçois la couleur, il me semble que j'entends le moucheron. Les vibrations du tympan provoquées par les ailes de l'insecte induisent peut-être, de l'intérieur, des vibrations anormales de la rétine qui sont similaires à celles que déclenche normalement, de l'extérieur, un rayon orange. Par similaires je ne veux pas dire d'une rapidité égale – ce serait absurde ; mais, par exemple, chaque millionième ondulation de la rétine peut s'accorder avec une ondulation du tympan, et je me demande si cela ne suffirait pas à produire l'effet dont je parle.
Combien de livres excellents sont dédaignés, en raison de la faiblesse de leur début ! Mieux vaut commencer de façon irrégulière, sans méthode, plutôt que de manquer d'arrêter l'attention ; mais ces deux qualités peuvent toujours s'associer : la méthode et la vigueur. À tout hasard, mettons d'abord quelques phrases énergiques, un peu comme la sonnerie électrique annonce le télégraphe.
Je suis bien plus qu'à moitié sérieux dans tout ce que j'ai pu dire à propos de la capacité de l'écriture manuscrite à nous renseigner sur le caractère de la personne 12. Cette proposition générale ne fait aucun doute : les qualités mentales auront tendance à laisser une empreinte sur le manuscrit. La difficulté réside dans la part qu'il faut faire entre cette tendance, en tant que force mathématique, et la force des divers éléments perturbateurs ressortissant aux simples circonstances. Mais, étant donné la biographie purement physique d'un individu, sa biographie morale peut être déduite à l'aide d'un manuscrit.
La véritable extension pratique à laquelle ces idées sont applicables est insuffisamment comprise. Pour ma part, je ne me cache aucunement d'agir, quand il le faut, selon des estimations du caractère découlant de la chirographie. Cependant, les estimations que je prends en compte sont principalement négatives. Par exemple, un homme ne possédera pas forcément du génie, du goût, de la rigueur ou n'importe quelle autre qualité, parce qu'il écrit de telle ou telle façon ; mais, en revanche, il est des écritures qu'aucun homme de rigueur, de goût ou de génie, n'a tracées, ne tracera, ni n'est seulement susceptible de tracer.
Il existe une certaine écriture – qui ne manque d'ailleurs pas d'élégance, bien que j'hésite à la décrire, parce qu'elle est utilisée par deux ou trois milliers de mes amis personnels – une certaine écriture, dis-je, qui semble appartenir, comme par droit de prescription, aux imbéciles ; et qui a été employée par n'importe quel âne, depuis l'époque de Cadmos 13 ; et qui a été tracée par n'importe quel jars, depuis que la première oie grise a cédé l'une de ses plumes. Or, si quelqu'un était amené à m'adresser une lettre utilisant cette graphie, pour me demander de m'engager, avec son inscripteur, dans n'importe quelle affaire du moment comportant des risques, ce serait uniquement en raison de la civilité la plus élémentaire que je condescendrais à lui répondre.
Nous n'avons conscience du temps que par les seuls événements. C'est la raison pour laquelle nous définissons le temps (de façon quelque peu impropre) comme une succession d'événements ; mais le fait lui-même que les événements soient le seul moyen que nous ayons d'appréhender le temps a tendance à engendrer l'idée erronée selon laquelle les événements sont le temps ; que plus les événements sont nombreux plus long est le temps, et inversement. Cette idée erronée, il est certain que nous en subirions l'influence à chaque fois, n'étaient les moyens pratiques dont nous disposons pour corriger notre impression – tels que les montres et les mouvements des corps célestes, dont nous ne faisons qu'admettre après tout que les révolutions sont régulières. L'espace est rigoureusement analogue au temps. C'est seulement par les objets que nous avons conscience de l'espace, et nous pourrions avec autant de raison le définir comme une succession d'objets. Mais, comme nous venons de le voir, le fait que nous n'avons pas d'autre moyen d'appréhender l'espace que les objets tend à engendrer l'idée selon laquelle les objets sont l'espace ; que plus les objets sont nombreux plus l'espace est grand, et inversement. Et cette impression erronée serait entretenue dans tous les cas, n'étaient nos moyens pratiques de la corriger – tels que les mesures en yards, et autres mesures conventionnelles qui se réduisent, en fin de compte, à de certains critères naturels comme la fraction de pouce, dont nous ne faisons qu'admettre après tout qu'ils sont réguliers.
L'esprit peut former une conception de la distance – aussi vaste soit-elle – entre le soleil et Uranus, parce que dix objets viennent mentalement s'y placer : les planètes Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Cérès, Vesta, Junon, Pallas, Jupiter et Saturne. Ces objets jouent pour l'esprit le rôle de bornes ; cependant l'esprit s'égare complètement lorsqu'il tente de parvenir à une notion de l'intervalle qui sépare Uranus de Sirius. Il s'égare, dis-je, non pas bien sûr en raison de la distance (car, pourquoi ne pourrions-nous pas concevoir l'idée abstraite d'une distance de deux milles, aussi facilement qu'une distance d'un mille ?) mais, tout simplement, parce que nous savons qu'entre Uranus et Sirius règne le vide. Et, de ce que j'ai avancé, il suit que cette vacuité – cette absence d'objets intermédiaires – obligera toute conception que nous essaierons de former à demeurer en deçà de la vérité. En réalité, dès qu'on excède les limites pratiques de mesure grâce à des objets intermédiaires, toute idée de la distance se résout en une seule idée ; il n'y a plus de variation. Ainsi, nous nous faisons exactement la même idée de l'intervalle qui sépare Uranus et Sirius que de celui qui existe entre Saturne et Uranus, ou entre n'importe quelle planète et sa voisine immédiate. Nous avons, en effet, l'illusion d'arriver à des conceptions différentes des différentes distances, mais nous confondons la connaissance mathématique de la distance et la notion de la distance elle-même.
C'est le principe que je défends ici qui conduit instinctivement l'artiste à introduire une succession d'objets entre l'horizon et le premier plan, lorsqu'il peint ce qui s'appelle dans son langage technique des lointains. Sur ce point, on dira que son intention est de permettre une comparaison de la taille des objets par la perspective. Par exemple, on peint plusieurs hommes l'un derrière l'autre et c'est par la diminution de leur taille apparente qu'est rendue l'idée de la distance ; j'ai dit qu'on affirmait cela. Mais ce n'est qu'une confusion des deux notions de distance abstraite et de distance relative. Par ce procédé de diminution des figures, il est vrai, nous avons la sensation que l'une est plus éloignée que l'autre, mais l'idée que nous retirons de la distance abstraite est entièrement imputable à la succession des figures, indépendamment de la grandeur. Pour le prouver, il n'y aura qu'à remplacer ces hommes par des rochers. Un rocher peut être de n'importe quelle taille. Il est possible que le plus éloigné d'entre eux soit, pour autant que nous le sachions, le plus petit dans la réalité et non seulement du point de vue optique. L'effet de la distance absolue restera inchangé et le seul résultat obtenu sera une confusion d'idée quant à la distance relative entre chaque rocher. Mais une chose est claire : si l'intention de l'artiste est vraiment, comme nous l'avons supposé, de créer la notion d'une grande distance grâce à la comparaison de la taille des hommes à des intervalles différents, d'après la perspective, nous devons concéder, pour le moins, qu'il se donne inutilement du mal en multipliant ses personnages. Deux hommes suffiraient à remplir ces attentes aussi bien que le font deux fois mille hommes – l'un au premier plan qui sert d'échelle, et l'autre à l'arrière-plan d'une taille correspondant à la conception que se fait l'artiste de la distance.
Que “la réalité dépasse la fiction” est un adage inlassablement répété par les ignorants, qui le citent comme ils citeraient n'importe quel énoncé qui leur apparaîtrait paradoxal, uniquement par goût du paradoxe. Les gens qui lisent ne citent jamais ce dicton, parce que de simples truismes ne valent jamais la peine d'être cités. L'un de mes amis m'a fait un jour lecture d'un long poème sur la planète Saturne. C'était un homme de génie, mais ses vers ne valaient rien, car les réalités de la planète, décrites dans la langue la plus prosaïque, suffisaient à ravaler toutes les fantaisies accessoires du poète.
Les défenseurs de cette production pitoyable la soutiennent en raison de son grand réalisme. Or, compte tenu du sujet, un tel réalisme est du plus mauvais goût. C'est assurément une idée originale que de vanter la précision avec laquelle une pierre nous est lancée en pleine tête. Un peu moins de précision nous aurait probablement laissé plus de cervelle. Voici des critiques en train d'applaudir le réalisme qu'on voue à la restitution des choses déplaisantes ! Selon moi, si un artiste est amené à peindre des fromages en train de moisir, son mérite s'inscrira plutôt dans la manière de les faire ressembler le moins possible à des fromages en train de moisir.
L'épithète “pleureur” utilisée à propos d'un saule peut avoir deux justifications plausibles. Dans un cas, l'expression proviendrait de l'aspect pendant des longues branches, évoquant l'écoulement de la rosée ; dans l'autre, elle s'expliquerait par un phénomène d'histoire naturelle. Car cet arbre exhale, sans qu'on s'en aperçoive, une grande quantité de vapeur d'eau qui, lors d'un froid soudain, se condense et se précipite quelquefois en pluie fine. On pourrait ainsi déterminer avec beaucoup de précision la tendance et la valeur du sens de la causalité d'un homme, en observant laquelle de ces deux explications il adopte. La première est à coup sûr la bonne, parce que les qualificatifs communs et vulgaires sont universellement suggérés par des phénomènes communs et immédiatement observables, sans considération d'aucune rigueur pour l'exactitude de leur application. Mais la seconde serait avidement retenue par neuf philologues sur dix en raison de son épigrammatisme – autrement dit, de la précision avec laquelle le fait particulier semble ici s'accorder à la locution. Voici donc une source d'erreur subtile qu'a négligée Lord Bacon. C'est l'Idole de l'Esprit 14.
Je crois que les parfums ont ce pouvoir d'idiosyncrasie tout à fait particulier de nous affecter par des associations, pouvoir qui diffère essentiellement de celui qu'ont les objets qui s'adressent au toucher, au goût, à la vue ou à l'ouïe 15.
“Il est évident que le mal l'emporte sur le bien, quand on réfléchit qu'aucune personne âgée ne consentirait à revivre la vie qu'elle a déjà vécue.” Volney. L'idée en question ne ressort pas très clairement. Sans le contexte, on ne peut savoir si l'auteur a voulu dire simplement que toute personne âgée s'imagine qu'elle eût été plus heureuse dans une existence différente de celle qui lui est échue en réalité, et préférerait pour cette raison revivre une autre vie plutôt que la sienne ; ou si le sentiment décrit est que, le choix étant donné à n'importe quelle personne âgée, à sa dernière heure, entre la fin attendue et la possibilité de revivre à nouveau sa vie, cette personne opterait pour la mort. La première proposition, celle qui avance que le mal prédomine sur le bien, est peut-être vraie. En revanche, la seconde (quelle que soit l'interprétation adoptée) paraît non seulement douteuse du point de vue des faits, mais s'avère incapable, fût-elle juste, de soutenir l'hypothèse de départ. On suppose qu'un vieillard déciderait de ne pas recommencer sa vie, parce qu'il sait que le mal y prévaut sur le bien. L'erreur provient du verbe savoir, de la présomption que nous puissions jamais posséder, dans la réalité, cette connaissance à laquelle il est fait obscurément allusion.
Toutefois, il existe un semblant de connaissance – une connaissance fictive ; et c'est cette connaissance-là de ce que sa vie a été, qui empêche la personne de juger la chose en fonction de ses mérites. Elle déduit hasardeusement une notion du bonheur de son existence écoulée – une notion concernant la prédominance qu'y a le bien ou le mal – en partant de l'idée qu'elle se forme de sa seconde vie ou de sa vie supposée. Dans son appréciation, elle se borne à peser les événements et ne tient nullement compte de cet Espoir qui est à l'origine de toute chose. La vie réelle d'un homme est principalement heureuse parce qu'il s'attend toujours à ce qu'elle le soit bientôt. Mais lorsque nous envisageons cette seconde vie, nous nous représentons des espérances ardentes changées en froides certitudes, et des chagrins quadruplés par leur caractère prévisible. Or, puisque nous ne pouvons nous en défendre et soumettre nos facultés imaginatives à notre volonté ; puisque la chose est si difficile et qu'il est quasiment impossible de prétendre ignorer ce qui est connu, de considérer ce qui est fait comme n'étant pas encore ; et puisque nous préférons la mort à cette deuxième vie (en raison de notre incapacité à nous figurer tout cela), faut-il en conclure pour autant que le mal l'emporte sur le bien, dans l'existence réelle examinée de la façon adéquate ?
Pour que la personne âgée dont parle Volney fasse un juste calcul et, partant de cette estimation, forme un choix judicieux ; pour que de cette estimation, de ce choix, nous parvenions à une lucide comparaison des biens et des maux de l'existence humaine, il nous faudrait sur cette question avoir l'opinion d'une personne capable d'apprécier de façon précise les espoirs qu'elle est naturellement portée à écarter – mais qu'elle éprouverait, comme le veut la raison, avec autant de force qu'autrefois, si elle était amenée à revivre entièrement sa vie. D'autre part, cette personne doit aussi être en mesure d'éradiquer, dans son estimation, les peurs qu'elle éprouve en fait et qui lui font voir concrètement les souffrances auxquelles elle s'expose, peurs qu'elle ne rencontrerait pas, comme la raison nous l'assure, dans une seconde vie absolument recommencée. Mais quel mortel fut à même de remplir ces conditions et d'accomplir l'impossible en accordant leur juste poids à ces considérations ? Quel mortel, en conséquence, fut jamais capable de faire un choix infaillible ? Comment d'une décision hasardeuse pourrions-nous tirer des conclusions propres à nous guider avec certitude ? Et comment partant de l'erreur pourrions-nous édifier la vérité ?
En lisant certains livres, nous nous attachons essentiellement aux pensées de leur auteur ; tandis qu'avec d'autres, nous nous intéressons exclusivement à nos propres pensées. Le livre de Mercier 16, L'An 2440, appartient à cette dernière catégorie – c'est un livre suggestif. Mais les livres suggestifs se partagent en deux sortes : ceux qui le sont d'une manière positive et ceux qui le sont d'une manière négative. Les premiers suggèrent par ce qu'ils disent, les seconds par ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû dire. Tout compte fait, l'écart est assez mince ; car dans les deux cas, le livre atteint son véritable objectif.
Ceux qui raisonnent a priori sur la politique sont les individus les plus risibles qu'on puisse imaginer. Seule la trop grande subtilité de leurs arguments m'interdit de les croire assez stupides pour qu'ils en soient dupes. Et pourtant, ce n'est guère impossible ; car l'esprit humain peut être gâté par la vanité de la logique. Le vrai logicien finit par se laisser prendre à ses raisonnements, au point que l'univers, dans l'appréhension qu'il en a, ne se réduit plus qu'à un mot. Plus rien, concrètement, n'existe pour lui. Une fois qu'il a couché sur du papier un certain assemblage de syllabes, il s'imagine que le sens en est fixé par la magie de l'inscription. Je crois sérieusement que de tels processus intellectuels se produisent dans l'esprit du logicien expérimenté, quand il se met à consigner ses réflexions. Il n'a pas conscience de raisonner ainsi, mais il entretient cette pensée malgré lui. Les phrases qu'il met sur une feuille revêtent, à ses propres yeux, un caractère nouveau. Tant qu'elles ne faisaient que flotter dans son esprit, il aurait pu convenir que ces formules n'étaient que des expressions variables des diverses phases de sa pensée ; mais il ne pourra jamais l'admettre, une fois qu'il les a fixées sur du papier.
C'est le drame d'un certain type d'esprit de ne pouvoir se satisfaire de la conscience de sa capacité à faire quelque chose. Un esprit de ce type se satisfait encore moins de faire la chose. Il faut à la fois qu'il sache et qu'il expose comment la chose fut faite 17.
C'est une chose dont je ne puis m'empêcher de rire ; et cependant, je ris sans savoir pourquoi 18. Que l'incongruité soit à l'origine d'un rire sans aucune convulsion m'apparaît aussi clairement démontré que n'importe quel problème des Principia Mathematica 19. Mais ici, je ne parviens pas à mettre le doigt sur cette incongruité. Elle est pourtant là, je le sais ; et je n'arrive toujours pas à la voir. En attendant, laissez-moi rire !
Le style est si compliqué 20 qu'on ne peut s'empêcher d'y voir un défaut dans la construction. Si le but du langage est d'exprimer des idées, alors il est aussi grave que nos tournures aient l'air fautives, ou qu'elles le soient en effet. La grammaire d'un homme, tout comme la femme de César, doit être non seulement pure mais au-dessus de tout soupçon.
“Ce sourire doux et serein – ce sourire qui ne se voit jamais que sur le visage des agonisants et des morts” Ernest Maltravers. Bulwer n'est pas homme à regarder la dure réalité en face 21. Il préfère sentimentaliser à propos d'une erreur vulgaire, bien que pittoresque. Qui a réellement vu autre chose que de l'horreur dans le sourire des défunts ? Nous désirons trop ardemment nous le représenter comme “doux” – voilà d'où provient l'erreur, si toutefois il y eut jamais erreur en la matière.
M. Hawthorne est l'un des rares conteurs américains que le critique puisse louer avec la main sur le cœur. Il n'est pas toujours original dans son thème (je me demande même s'il n'a pas emprunté une ou deux idées à un monsieur que je connais fort bien, et qui s'honore de l'emprunt 22) mais, en revanche, son traitement fait preuve à chaque fois d'une grande innovation. Son style, bien qu'il ne soit jamais vigoureux, est la pureté même ; son imagination est riche ; son sens artistique est exquis et son habileté d'exécution remarquable. Il n'a que peu, si ce n'est aucune variété de ton. Il traite tous les sujets sur le même mode en demi-teinte, brumeux, rêveur, par la suggestion et l'allusion ; et bien que je le considère comme un authentique génie de notre littérature, je ne puis m'empêcher d'y voir le plus incorrigible maniériste de son époque.
Le goût le plus raffiné, la sensibilité la plus profonde lui ont prodigué leurs applaudissements enthousiastes. Jamais triomphe humain, dans tout ce qu'il a de plus délicieux, de plus exaltant, ne fut supérieur au sien – excepté celui de la Taglioni 23. Car, que sont les adulations arrachées de force, dont un conquérant fait son butin ? Que sont même les grands éloges décernés à un auteur populaire, sa lointaine renommée, sa vaste influence ou l'admiration la plus dévouée du public pour ses œuvres, à côté de l'approbation extasiée de la personne de cette femme ; cette ovation spontanée, immédiate, présente et palpable ; ces acclamations irrépressibles, ces soupirs éloquents et ces larmes que la Malibran 24, idolâtrée, voyait, entendait, et dont elle se sentait profondément digne ? Sa brève carrière fut un rêve magnifique, car même les nombreux chagrins qu'elle a traversés ne furent que poussière en comparaison de sa gloire. Dans ce livre 25, il est beaucoup question des raisons qui écourtèrent son existence ; et, telles qu'on les présente, il paraît se former autour d'elles un certain mystère que la noble mémorialiste essaie en vain d'élucider. Il semble en fait que toute la vérité lui échappe, qu'elle n'ait jamais songé que cette mort prématurée fut la condition d'une vie pleine d'ivresse. Aucun être sensé, entendant chanter la Malibran, n'eût pu douter qu'elle allait s'éteindre au printemps de sa vie. Elle ramassait en quelques heures la durée d'un siècle. Elle quitta ce monde à vingt-cinq ans, ayant vécu plusieurs milliers d'années.
S'il m'arrivait de placer tous ces ouvrages de Voltaire entre les mains d'un jeune ami, je ne pourrais, en conscience, les décrire autrement que par les mots de Saint Augustin, tirés du De Libris Manichaeis : “tam multi, tam grandes, tam pretiosi codices” ; et c'est la mort dans l'âme que je me devrais d'ajouter : “incendie omnes illas membranas”26.
Il y a une vingtaine d'années, la crédulité était le trait caractéristique de la populace, et l'incrédulité l'apanage des philosophes ; aujourd'hui, la tendance est inversée. Les sages se défient sagement de l'incroyance. Être sceptique n'est plus une preuve ni de culture, ni d'esprit.
Les hommes de génie sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. En réalité, savoir apprécier pleinement l'œuvre de ce qu'on nomme le génie, c'est avoir soi-même tout le génie qui a participé de la production de cette œuvre. Pour autant, quelqu'un qui sait l'apprécier peut s'avérer totalement incapable de faire la même chose ou de produire une œuvre semblable, uniquement par manque de ce qu'on pourrait appeler la capacité de construction – qualité indépendante de ce qu'on entend couramment par le terme génie. Sans doute, l'aptitude en question repose-t-elle largement sur la faculté d'analyse, qui permet à l'artiste d'avoir une vue globale du mécanisme de l'effet à produire et, par conséquent, de le faire opérer et de le doser à son gré. Mais les propriétés strictement morales jouent aussi pour beaucoup ; notamment la patience, la faculté de concentration ou capacité à maintenir une attention constante sur le but unique, l'indépendance et le mépris de toute opinion hasardeuse, et plus encore l'énergie ou l'industrie. Cette dernière est d'autant plus vitale qu'on peut se demander si jamais aucune œuvre dite de génie fût réalisée sans son concours ; et c'est essentiellement parce que cette qualité et le génie sont presque incompatibles que les œuvres géniales sont rares, tandis que les hommes de génie, comme je l'affirme, sont nombreux. Les Romains, qui nous étaient supérieurs dans la finesse de leurs observations, mais que nous dépassons sur le plan de l'induction, semblent avoir été si conscients du rapport étroit entre l'industrie et l'œuvre de génie, qu'ils ont pris à tort l'industrie, en grande partie, pour le génie lui-même. C'est un immense compliment, pour un Romain, que de dire d'une épopée ou de toute œuvre semblable, qu'elle fait preuve d'industria mirabili ou incredibili industria.
Tout homme sincère se réjouira de voir décliner ce déchaînement d'hostilité et de sarcasmes envers l'originalité, qui était à la mode il y a quelques années, parmi une catégorie de critiques microscopiques, et qui menaçait un temps d'abaisser toute la littérature américaine au niveau de l'art flamand. On a dit des calembours que ce sont les gens les moins capables d'en faire qui les détestent le plus ; mais à plus forte raison, on peut affirmer qu'il n'y a que des gens hypocrites et dépourvus d'imagination pour s'insurger face à l'originalité. Je dis hypocrites, parce que l'attrait de la nouveauté est un élément indiscutable de la nature morale de l'homme ; et, puisque faire preuve d'originalité revient purement et simplement à faire preuve de nouveauté, l'imbécile qui professe un manque de goût pour l'originalité, en littérature ou dans tout autre domaine, ne prouve nullement son aversion de la chose en tant que telle, mais trahit cette aigreur qui s'éveille toujours dans le cœur de l'homme envieux, quand il est confronté à une forme d'excellence à laquelle il ne saurait prétendre.
Quand je songe aux grotesques apartés et monologues en usage, dans le théâtre des nations civilisées, les expédients utilisés par les dramaturges chinois m'ont finalement l'air assez respectables. Sur une scène de Pékin ou de Canton, si un général reçoit l'ordre de partir en expédition, “il brandit un fouet, dit Davis, ou prend dans sa main une bride, et après avoir fait trois ou quatre fois le tour du plateau, au milieu d'un terrible fracas de gongs, de tambours et de trompettes, interrompt brusquement sa course, avant d'annoncer au public le nom de l'endroit où il est arrivé.” Dans un théâtre européen, les héros seraient parfois fort ennuyés s'ils devaient annoncer au public où ils sont arrivés. La plupart d'entre eux semblent avoir une conception très vague du lieu où ils se trouvent. Dans La Mort de César, par exemple, Voltaire nous montre une foule en pleine agitation qui s'exclame : “Courons au Capitole !” Pauvres gens, ils y étaient depuis le début ; car, dans son respect scrupuleux de l'unité du lieu, l'auteur ne les en avait même pas laissés sortir.
C'est assurément un fait remarquable que le mot tujch, Fortune n'apparaisse pas une fois dans toute l'Iliade, bien que le destin soit l'idée maîtresse de la tragédie grecque.
“Voici un érudit et un artiste, qui sait exactement par quels moyens tous les grands écrivains ont produit leurs effets, et qui a la ferme intention d'en user. Mais le cœur passe à travers toutes les trappes et tous les pièges qu'il nous tend, à travers ses stratagèmes soigneusement prémédités, pour se laisser prendre par un homme simple, aussi peu préparé à l'aventure que l'était son captif.” Lowell, Conversations 27. J'ai peut-être tort d'attribuer ces propos à la personne de Lowell – ils sont placés dans la bouche d'un de ses interlocuteurs ; mais peu importe qui les revendique, ce sont là de belles phrases et rien de plus. L'erreur banale est ici justement de séparer la pratique de la théorie qui l'inclut. En tout cas, quand la pratique échoue c'est que la théorie est imparfaite. Si le cœur de M. Lowell échappe au piège et à la trappe, alors le piège était mal amorcé et la trappe mal dissimulée. Celui qui possède quelque talent artistique peut savoir comment on fait une chose, il peut même savoir l'expliquer, et néanmoins s'avérer totalement incapable de l'exécuter. Or un homme de quelque talent artistique n'est pas un artiste. Celui-là seul est un artiste, qui sait appliquer heureusement ses préceptes les plus obscurs. Dire qu'un critique n'aurait pas pu lui-même écrire l'œuvre qu'il juge revient à émettre une contradiction dans les termes.
Nous pourrions élaborer une philosophie très poétique et suggestive, quoique peut-être assez difficile à soutenir, en supposant que les gens vertueux vivent dans l'au-delà, tandis que les méchants sont condamnés à l'annihilation ; et que le danger d'annihilation, proportionnel au péché, serait indiqué la nuit par le sommeil et quelquefois, d'une façon plus distincte, par un évanouissement. La probabilité d'annihilation de l'âme serait en raison de l'absence de rêves pendant le sommeil. De même, s'évanouir et se réveiller sans la moindre conscience du laps de temps écoulé durant la syncope prouverait que l'âme est dans une condition telle que, si la mort était survenue, elle aurait été annihilée. D'autre part, quand le réveil s'accompagne du souvenir de visions – comme cela arrive parfois – il faut alors considérer que l'âme est dans un état qui lui assurerait la survie après la mort corporelle, la félicité ou la misère de l'existence future étant indiquée par la nature des visions.
La devise des États-Unis – E pluribus unum – contient peut-être une fine allusion à la définition de la Beauté selon Pythagore : la réduction d'une multitude en un seul élément.
Les swedenborgiens me font part d'une découverte : tout ce que j'énonçais dans un article intitulé Révélation magnétique était absolument vrai, bien que dans un premier temps ils aient été enclins à douter de sa véracité – chose dont, en l'occurrence, je n'ai moi-même jamais rêvé de ne pas douter. L'histoire est fictive de bout en bout.
Le jour s'enfuit, et les ténèbres
Tombent des ailes de la nuit,
Comme une plume se détache
De l'aile d'un aigle dans son vol.
Longfellow, Waif.
Une seule plume illustre très imparfaitement la toute-puissance envahissante des ténèbres ; mais une objection plus particulière s'applique à la comparaison d'une plume avec la chute d'une autre plume. La nuit est personnifiée par un oiseau, et l'obscurité – qui est une plume de cet oiseau – tombe de son aile. Comment ? Comme une autre plume tombant d'un autre oiseau. Cela va de soi. La comparaison met en relation deux termes identiques, c'est-à-dire qu'elle est nulle. Elle n'a pas plus de force qu'une proposition identique en logique.
Le sentiment poétique entraîne une appréciation anormalement vive de l'excellence poétique, et une assimilation de celle-ci à l'entité poétique, si bien qu'un passage admiré, puis oublié, et finalement ressuscité à travers un tissu d'associations extrêmement obscur, est pris par le poète en train d'imiter pour une authentique invention de son esprit. Mais le monde peu charitable ne sera jamais en mesure de le comprendre, et le poète qui commet un plagiat est sinon fautif, au moins malchanceux ; quoi qu'il en soit, la justice de la critique exige que le droit de propriété soit ramené à sa source. Des deux personnes, l'une doit souffrir – peu importe quoi – et il ne peut y avoir d'hésitation quant à la personne que la souffrance doit élire.
Quand nous attacherons moins d'importance à l'autorité et plus d'attention aux principes, quand nous regarderons moins les mérites que les démérites (au lieu de faire l'inverse, comme certains le proposent), nous serons alors de meilleurs critiques qu'à l'heure actuelle. Il nous faut délaisser nos modèles et étudier nos capacités. Les apologies délirantes de ce qui, dans le domaine des lettres, a été occasionnellement réussi découlent d'une compréhension imparfaite de ce qu'il nous est possible de mieux faire. “Un homme qui n'a jamais vu le soleil, dit Calderon, ne saurait être blâmé s'il pense qu'aucune splendeur ne peut surpasser celle de la lune ; un homme qui n'a jamais vu ni le soleil ni la lune ne saurait être blâmé s'il est ébloui par l'incomparable éclat de l'étoile du matin.” Mais le rôle du critique est de s'élever suffisamment haut pour apercevoir le soleil, même si l'astre est alors situé bien au-dessous de l'horizon ordinaire.
L'augmentation, depuis ces dernières années, de la littérature de magazine ne doit en aucune façon être considérée comme une indication de ce que certains critiques pensent y déceler : une décadence du goût américain et des lettres américaines. Ce n'est rien d'autre qu'un signe des temps, l'indice d'une ère où les gens sont forcés de recourir à ce qui est bref, condensé, bien digéré au lieu de ce qui est volumineux – en un mot au journalisme plutôt qu'à la dissertation. Nous avons plus besoin, aujourd'hui, de l'artillerie légère que des pacificateurs de l'esprit. Je ne gagerais pas que les hommes d'à présent réfléchissent avec plus de profondeur qu'il y a cinquante ans, mais il est indubitable qu'ils pensent avec plus de rapidité, d'adresse, de tact, avec plus de méthode et moins d'excroissance de la pensée. En outre, ils bénéficient d'une vaste augmentation des sujets de réflexion ; plus de faits, plus de choses sont à méditer. C'est la raison pour laquelle ils s'efforcent d'assembler le plus grand nombre d'idées dans un moindre volume, et de les diffuser le plus rapidement possible. De là le journalisme de l'époque ; de là, en particulier, nos magazines. Nous ne saurions, en principe, en avoir trop, mais nous exigeons qu'ils aient des mérites suffisants pour que leur parution soit remarquée, et qu'ils vivent assez longtemps pour que nous puissions nous faire une juste appréciation de leur valeur.
L'effet qu'on peut obtenir grâce à la rime, lorsqu'elle est bien employée, demeure très imparfaitement compris 28. Par convention, la “rime” n'implique qu'une similarité de son placée à la fin des vers, et il est vraiment surprenant de constater que l'humanité s'est longtemps satisfaite d'une compréhension aussi limitée de ce concept. Ce qui nous plaît, avant tout et principalement, dans la rime peut se rattacher au sens ou à l'appréciation qu'ont les hommes de l'égalité. Nous pourrions démontrer sans peine qu'il s'agit là d'un élément commun à toute impression du bonheur suscité par la musique, en son sens le plus large, et, plus particulièrement, dans ses variations métriques et rythmiques. Si nous regardons un cristal, par exemple, nous nous intéressons immédiatement à l'égalité des côtés et des angles d'une de ses faces ; mais en observant une deuxième face, en tous points conforme à la première, notre plaisir semble élevé au carré ; en considérant une troisième face, il est élevé au cube et ainsi de suite. À vrai dire, je ne doute pas que la jouissance éprouvée, si on pouvait la mesurer, suivrait une progression mathématique exactement similaire – ou presque – à celle que je viens d'évoquer. Il en irait ainsi jusqu'à un certain point où elle diminuerait dans des proportions identiques. En dernière analyse, nous parvenons ici au sens de la simple égalité ou plutôt au plaisir dont cette sensation s'accompagne chez l'homme ; et ce fut bien plus par instinct que par une compréhension claire de cette jouissance érigée en principe que le poète s'efforça, tout d'abord, d'accroître l'effet découlant de la simple similarité entre deux sons, grâce à une seconde forme d'égalisation, en plaçant les rimes à des intervalles égaux, soit en fin de vers d'une longueur égale. Si bien que la rime et la terminaison des vers furent étroitement associées dans l'esprit de l'homme, à titre de convention, leur principe étant complètement oblitéré. Seule l'existence antérieure des vers pindariques, qui sont de longueur inégale, justifia que les rimes furent disposées, par la suite, à des distances variables. Ce fut pour cette raison, dis-je, et pour nulle autre raison plus profonde, qu'on en vint à considérer la rime comme appartenant de droit à la terminaison du vers. Nous déplorons que les choses en soient finalement restées là, car il est évident que bien d'autres facteurs auraient dû être pris en considération.
Jusque-là, le seul sens de l'égalité participait de l'effet ; et s'il y entrait une légère variation, celle-ci ne pouvait résulter que d'un accident, à savoir l'existence accidentelle des vers pindariques. On verra que les rimes étaient toujours anticipées. L'œil se portant à la fin d'un vers, qu'il fût long ou bref, s'attendait à ce que l'oreille fût frappée par la rime. Ce grand élément qu'est l'inattendu – la nouveauté ou l'originalité – demeurait impensé. “Mais, dit Bacon (avec quelle justesse !), il ne saurait y avoir de beauté exquise sans une légère étrangeté dans les proportions 29.” Ôtez cet élément d'étrangeté, d'inattendu, de nouveauté, d'originalité – appelez-le comme vous voudrez – vous perdez aussitôt tout ce qui fait le caractère éthéré de la beauté. Nous perdons, nous passons à côté de l'inconnu, du vague, de ce qui demeure incompris parce qu'il nous est offert avant même que nous ayons eu le temps de l'examiner et de le comprendre. Bref, nous manquons toute identification de la beauté de la terre à ce dont nous rêvons de la beauté des cieux.
La perfection de la rime ne peut s'obtenir qu'en combinant ces deux éléments : l'Égalité et l'Inattendu. Mais de même que le mal a besoin du bien pour exister, de même l'effet d'une chose inattendue doit provenir de ce qui est attendu. Nous ne saurions nous contenter d'une rime purement arbitraire. En premier lieu, il faut des rimes récurrentes à intervalles équidistants ou réguliers pour fournir une base, le caractère attendu ; et c'est à partir de cette base que doit surgir l'élément nouveau, par l'introduction de rimes non pas arbitraires, mais visant au plus haut degré d'inattendu. Par exemple, on ne doit pas les situer à de telles positions que le vers, dans son ensemble, soit un multiple du nombre de syllabes qui les précèdent. Si j'écris : And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain 30 – je produis assurément un effet supérieur, mais pas de beaucoup, à l'effet ordinaire des rimes régulièrement disposées en fin de vers. Car le nombre de syllabes composant le vers tout entier n'est qu'un multiple du nombre des syllabes qui précèdent la rime introduite au milieu ; et par conséquent, l'effet reste attendu à un certain degré. Ce qu'il y a d'inattendu s'adresse, en fait, à l'œil uniquement puisque l'oreille divise le vers en deux segments normaux, comme ceci :
And the silken, sad, uncertain
Rustling of each purple curtain.
J'obtiens, en revanche, un effet totalement inattendu lorsque j'écris :
Thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before 31.
N.B. : Une opinion très communément partagée veut que la rime, telle qu'elle existe aujourd'hui, dans sa forme ordinaire, soit une invention moderne – mais voyez Les Nuées d'Aristophane. Les vers hébreux, toutefois, n'incluent pas la rime ; là où elles sont les plus distinctes, les finales des vers ne comportent jamais rien qui y ressemble.
Quelque Français, peut-être Montaigne, a dit : “Les gens parlent de penser ; mais quant à moi, je ne pense jamais, sinon lorsque je m'assieds pour écrire 32.” C'est cette absence de pensée, à moins qu'on ne se soit installé pour écrire, qui est la cause de tant d'ouvrages indifférents. Cependant, l'observation de ce Français a peut-être plus de sens qu'il ne nous semble à première vue. Il est certain que le seul acte de rédiger participe hautement à rendre la pensée plus logique. Chaque fois qu'en raison de son vague, je ne suis pas pleinement satisfait d'une conception de mon esprit, je recours à la plume afin d'obtenir grâce à elle toute la forme, l'enchaînement et la précision nécessaires.
Quoi de plus fréquent que d'entendre dire, de telle ou telle pensée, qu'elle dépasse la sphère des mots ! Je ne crois pas qu'aucune pensée – aucune pensée vraiment digne de ce nom – puisse être hors de la portée du langage. J'estime plutôt que là où l'on rencontre une difficulté pour s'exprimer, il y a un défaut de réflexion ou de méthode chez celui qui la ressent. Pour ma part, je n'ai jamais eu la moindre pensée qu'il ne m'ait été possible de mettre en mots sans lui imprimer plus de netteté. Comme je l'ai déjà fait remarquer, la pensée devient plus logique à travers l'effort de son expression par écrit.
Il y a toutefois une classe de fantaisies d'une extrême délicatesse, qui ne sont point des pensées et pour lesquelles, jusqu'à présent, j'ai trouvé absolument impossible d'adapter le langage. J'emploie le mot fantaisies au hasard, et simplement parce qu'il faut employer quelque vocable ; mais l'idée couramment associée à ce terme n'est pas, même grossièrement, applicable aux ombres d'ombres dont il est ici question. Elles me paraissent plutôt psychiques qu'intellectuelles. Elles ne se produisent dans notre âme (hélas, combien rarement !) qu'aux périodes de la plus profonde tranquillité ; quand nous sommes en parfaite condition physique et mentale ; et seulement à ces points de la durée où les confins du monde onirique se mélangent avec ceux du monde de la veille. Je n'ai la notion de ces rêveries que lorsque je me trouve à la lisière du sommeil, tout en ayant conscience de mon état. J'ai pu vérifier que cette condition ne se produit qu'au cours d'une imperceptible fraction de temps, alors que pour avoir véritablement une pensée, un certain prolongement dans la durée demeure nécessaire ; mais cela n'empêche pas que ces “ombres d'ombres” y foisonnent.
Ces “fantaisies” s'accompagnent d'une extase délicieuse, aussi éloignée des plus grandes jouissances du monde de la veille ou des songes que le Ciel de la théologie nordique est éloigné de son Enfer. Je considère ces visions, alors même qu'elles se produisent, avec une sorte d'appréhension qui parvient, dans une certaine mesure, à modérer ou à calmer mon extase. Je les considère ainsi par la conviction (qui fait elle-même partie de mon extase) que cette jouissance est en soi d'un caractère supérieur à la nature humaine, qu'elle est comme un coup d'œil jeté sur le monde extérieur des esprits. Et j'arrive à cette conclusion – si toutefois ce terme est applicable à une intuition spontanée – parce que j'ai la perception, en éprouvant pareilles délices, d'un élément d'une absolue nouveauté. Je dis absolue car dans ces fantaisies – permettez-moi de les appeler maintenant impressions psychiques – on ne trouve vraiment rien qui ait, même approximativement, le caractère des impressions ordinaires. Tout se passe, en fait, comme si les cinq sens étaient supplantés par cinq myriades d'autres sens, étrangers à la condition mortelle.
Cependant ma foi dans la puissance de la parole 33 est si entière que j'ai cru, par moments, possible de fixer jusqu'à l'évanescence des fantaisies que je viens d'évoquer. Dans les expériences que j'ai faites en ce sens, je suis allé suffisamment loin, pourvu que ma santé physique et mentale fût satisfaisante, pour contrôler leur apparition ; c'est-à-dire que je puis désormais m'assurer, à moins d'être malade, que cette condition se produira si je le souhaite, au moment déjà décrit, tandis que naguère encore je ne pouvais jamais en être certain. J'entends par là que je puis être sûr, quand toutes les circonstances sont favorables, de la venue de cet état ; et que je me sens capable de la provoquer ou de la contraindre à se produire. Mais les circonstances favorables n'en sont pas moins rares, autrement j'aurais déjà contraint les cieux à descendre sur terre. Je me suis appliqué ensuite à empêcher le glissement du point dont j'ai parlé – le point de fusion entre le rêve et la veille – à empêcher, dis-je, selon mon gré, le glissement depuis cette zone frontière jusqu'à l'empire du sommeil. Non pas que je puisse prolonger cet état, ni faire de ce point quelque chose de plus qu'un point ; mais je puis à volonté rebondir de ce point à la veille ; et ainsi transporter ce point lui-même dans le royaume de la mémoire ; en recueillir les impressions – ou plus exactement, le souvenir de ces impressions – de manière à les examiner, quoique pendant un temps infime, avec l'œil de l'analyste.
C'est pourquoi, ayant accompli de tels progrès, je ne désespère pas de mettre en mots une part suffisante de ces fantaisies, afin de donner à certaines catégories d'intellects une vague idée de leur nature. De ce que j'avance, on ne doit pas conclure que les fantaisies ou les impressions psychiques auxquelles je me réfère n'appartiennent qu'à moi seul – bref, qu'elles ne sont pas communes à tous les mortels ; car sur ce point, il m'est absolument impossible de former une opinion. Mais on peut tenir pour certain qu'une notation, même partielle, de ces impressions bouleverserait l'intelligence universelle de l'humanité, par la suprême nouveauté de leur contenu et des suggestions qui en découleraient. En un mot, si je devais jamais écrire un article à ce sujet, le monde serait obligé de reconnaître qu'enfin j'ai fait une œuvre originale.
Dans la pratique médicale, l'utilisation des drogues me paraît découler de l'idée de pénitence qui hante l'humanité depuis l'aube des temps : l'idée que le fait d'endurer volontairement la souffrance constitue une expiation du péché. Encore y a-t-il en ceci, dans cette première phase de la folie, une certaine part de rationalité. L'homme fait offense à la divinité ; et de là s'ensuit la nécessité d'une rétribution ou, plus strictement, un désir de punir émanant de la divinité. S'infliger un châtiment soi-même semblait donc englober une reconnaissance de la faute, un zèle à anticiper la volonté de Dieu et une expiation de l'offense tout à la fois. Ainsi formulée, cette pensée, pour absurde qu'elle soit, ne va pas à l'encontre de la nature ; mais, le principe étant progressivement oublié, les hommes entretinrent l'idée brute que la souffrance humaine, en général, était agréable au Créateur ; d'où les derviches, les Simon, les robes de bure, les cailloux dans les chaussures, le puritanisme actuel et tout ce bavardage à propos de la “mortification de la chair”. À ce point, la vanité produisit un autre glissement ; la chimère a pris corps, selon laquelle dans le fait d'endurer le mal volontairement, il existe de façon abstraite une tendance au bien. Et ce fut uniquement pour ne pas contrevenir à ce fantasme que s'agissant de la maladie, on choisit les remèdes en fonction de la répugnance qu'ils nous inspirent. Sinon, comment expliquer le fait que, dans quatre-vingt-dix-neuf pourcent des cas, les articles de materia medica ont mauvais goût ?
L'originalité ne fait pas toujours défaut aux imitateurs, sauf en ce qui concerne les points précis sur lesquels porte l'imitation. M. Longfellow, sans doute le plus audacieux imitateur en Amérique 34, est remarquablement original ou, si l'on préfère, imaginatif ; et en raison de ce deuxième aspect, nombre de personnes ont eu le plus grand mal à comprendre, et partant, à croire en la véracité du premier. Une grande sensibilité d'appréciation – autrement dit le sentiment poétique, à ne pas confondre avec la puissance poétique – conduit presque inévitablement à l'imitation. Aussi tous les grands poètes se sont-ils montrés grands plagiaires. Mais ce serait néanmoins faire une fausse distribution du terme moyen d'inférer que tous les grands imitateurs sont des poètes.
“L'artiste appartient à son œuvre et non l'œuvre à l'artiste.” Novalis 35. Dans neuf cas sur dix, c'est une pure perte de temps que d'essayer d'arracher une signification quelconque à une maxime allemande ; ou plutôt, on peut faire dire à chacune d'entre elles tout et son contraire. Si dans la phrase citée plus haut, l'intention est d'affirmer que l'artiste est l'esclave de son thème et doit y subordonner ses pensées, je n'ai aucune foi en cette idée qui m'apparaît provenir d'une intelligence essentiellement prosaïque. Dans les mains du véritable artiste, le thème ou l'œuvre n'est qu'une motte d'argile à partir de laquelle n'importe quoi (selon les limites imposées par la masse et la qualité de l'argile) peut être façonné à volonté, suivant l'habileté de l'exécutant. L'argile est, en fait, l'esclave de l'artiste ; elle lui appartient. Son génie, sans doute, se manifeste très distinctement dans le choix de l'argile. Elle ne devrait être ni fine ni grossière, abstraitement ; mais juste assez fine ou assez rude – juste assez malléable ou assez rigide – pour au mieux répondre aux buts de la chose à accomplir, de l'idée à présenter ou de l'impression à produire. Il existe cependant des artistes qui ne rêvent que des matériaux les plus raffinés, et qui, en conséquence, ne produisent que des ouvrages raffinés. Ils sont en général fort transparents et d'une extrême fragilité.
Le vieil adage de la vérité au fond d'un puits est à double entente ; mais si l'on considère que la profondeur de la vérité est une de ses significations possibles, si l'on comprend comme un corollaire que des idées justes, à n'importe quel sujet, doivent être pêchées dans les plus grandes profondeurs, et que pour avoir du bon sens il faille être nécessairement abyssal ; si telle est la morale de cet adage, alors j'ai quelques objections à avancer sur ce point. La profondeur dont on parle tant gît bien plus souvent dans les endroits où on cherche la vérité que dans ceux où on la trouve. De même que les enseignes commerciales de dimensions moyennes sont plus adaptées à leur emploi que des enseignes à la Brobdingnag 36, de même dans au moins trois cas sur sept, un fait (mais plus particulièrement une raison) échappe à notre attention uniquement à cause de son évidence excessive. Il est également presque impossible de voir quelque chose que l'on a sous le nez 37.
Il est vraiment difficile d'imaginer quel a dû être l'état de morbidité de l'intellect ou du goût allemand, pour qu'il ait non seulement toléré mais encore admiré sincèrement et loué avec enthousiasme une aussi pauvre chose que Les Chagrins du jeune Werther. L'approbation des Allemands était assurément de bonne foi ; quant à la nôtre ou à celle des Anglais, c'était la quintessence de l'affectation. Et pourtant, nous fîmes du mieux que nous pûmes, comme le devoir nous y obligeait, pour nous placer dans l'état d'esprit adéquat. À ce propos, le titre est mal traduit : Leiden ne signifie pas chagrins mais souffrances.
Si besoin était, je n'éprouverais aucune difficulté à défendre un certain dogmatisme apparent, auquel je suis enclin, à propos de la versification. “Qu'est-ce que la Poésie ?” En dépit de l'absurde tentative de réponse apportée par Leigh Hunt 38, cette interrogation peut éventuellement, avec un grand soin et sous réserve d'un accord préalable sur la valeur exacte de certains concepts fondamentaux, être réglée à la satisfaction partielle de quelques esprits analytiques. Mais dans l'état actuel de la métaphysique, on ne saurait la résoudre à la satisfaction générale ; car c'est une question purement métaphysique et toute la métaphysique est à présent en plein chaos, du fait de notre incapacité à préciser la signification des mots que sa nature même nous contraint d'employer. Toutefois, s'agissant de la versification, la difficulté n'est que relative ; en effet, si l'on estime qu'un tiers du sujet relève de la métaphysique et peut ainsi donner lieu à des appréciations subjectives, il n'en demeure pas moins que les deux tiers restants sont indéniablement d'ordre mathématique. Les points couramment débattus avec tant de gravité, en matière de rythme, de mètre, etc., se prêtent donc à un règlement positif par la démonstration. Leurs lois ne sont qu'une partie des lois médiques 39 de la forme et de la quantité, autrement dit du rapport. Ainsi, relativement à ces questions banales qui font souvent l'objet de controverses stupides, au sein de la critique, le prosodiste ferait preuve d'une faiblesse d'esprit tout aussi grande, en déclarant que “telle ou telle proposition est probablement comme ceci, ou vraisemblablement comme cela”, que le mathématicien qui admettrait qu'à son humble avis, à moins qu'il ne se méprenne grandement, la somme de deux côtés d'un triangle est supérieure au troisième côté. J'ajouterai cependant, comme un palliatif aux discussions dont j'ai parlé, ainsi qu'aux objections présentées maintes fois, avec un certain mépris, à l'encontre des “théories particulières de la versification n'engageant que leur inventeur”, qu'il n'existe pas de prosodie raisonnée 40. Les prosodies des écoles ne sont qu'une collection de vagues lois, accompagnées d'exceptions plus vagues encore, qui ne se fondent sur aucun principe et sont tirées de la façon la plus spéculative des pratiques des anciens, lesquels n'avaient pas de règles hormis leurs propres oreilles et le compte sur le bout de leurs doigts. “Ces règles étaient bien suffisantes, objectera-t-on, puisque L'Iliade est, plus qu'aucune production des temps actuels, une œuvre harmonieuse et mélodieuse.” Soit, mais nous n'écrivons pas en grec et la capacité d'invention des temps modernes n'est pas encore épuisée. Une analyse étayée sur les lois naturelles que le barde de Chios ignorait nous indiquerait sans doute une quantité notable d'améliorations possibles, même dans le cas des meilleurs passages de L'Iliade. Par ailleurs, il ne s'ensuit nullement du fait supposé qu'Homère ait trouvé, à l'aide de son oreille et du compte sur le bout de ses doigts, un système de règles satisfaisant (fait que j'ai nié à l'instant), il ne s'ensuit nullement, dis-je, que les règles que nous déduisons, nous, des effets de la poésie homérique doivent supplanter les principes immuables du temps, de la quantité, etc. – en un mot, la mathématique de la musique – qui furent nécessairement les causes premières de ces effets, tandis que “les oreilles et les doigts” ne sont que les instruments des causes médiates.
Ce livre m'a laissé extrêmement perplexe 41, car tout en étant d'accord avec ses conclusions générales (sauf en ce qui concerne la prévision), je ne puis m'empêcher de voir des erreurs dans tous les raisonnements par lesquels ces conclusions sont amenées. Je tiens donc ce traité pour foncièrement illogique, de bout en bout. Voici, par exemple, comment l'idée de départ est présentée dans le chapitre d'introduction : “Il y a environ douze mois, je fus prié par des amis d'écrire un article contre le mesmérisme, et un ancien élève que j'estime beaucoup mit à ma disposition les documents nécessaires. Ceux-ci prouvaient incontestablement que, dans certaines circonstances, l'opérateur peut être dupé ; que des centaines de personnes éclairées peuvent également être dupées ; et que cette prétendue science n'est rien d'autre qu'une vaste imposture, un système de fraude et de jonglerie, où le jeu des apparences sert à fasciner l'imagination des gens crédules. Il se peut que j'aie adhéré à ces propositions dans un moment d'égarement, mais après réflexion, il m'apparut que les informations qui m'étaient fournies tendaient uniquement à prouver qu'on peut contrefaire certains phénomènes – tout comme la fausse monnaie prouve, en fait, qu'il existe un étalon d'or authentique ayant servi de modèle.”
L'erreur vient ici se loger dans une simple variation de ce qui s'appelle une “pétition de principe”. On prétend que la fausse monnaie prouve l'existence de la véritable. Bien entendu, ce n'est là qu'un truisme, selon lequel il ne peut y avoir de contrefaçon sans original, précisément comme il ne saurait y avoir de mal sans le bien, les deux termes étant purement relatifs. Mais parce qu'il ne peut exister de contrefaçon sans original, doit-il de quelque manière s'ensuivre qu'un original, nullement démontré, existe ? C'est par la comparaison de la fausse pièce avec celles qui sont admises comme authentiques que nous remarquons qu'elle est fausse. Maintenant, si aucune monnaie n'était reconnue comme authentique, comment devrions-nous faire état de la contrefaçon, et quel droit aurions-nous de parler de contrefaçon d'aucune sorte ? Ainsi, pour en revenir au mesmérisme, notre auteur ne fait qu'émettre une pétition de principe. En affirmant que l'existence du mesmérisme simulé prouve l'existence du véritable, il entend nous faire admettre la réalité de ce dernier. Si ce n'est pas là ce qu'il exige, alors son argument est totalement dénué de sens, car nous pouvons bien évidemment feindre ce qui n'est pas. Quelqu'un, par exemple, peut revêtir l'apparence d'un sphinx ou d'un griffon, mais cela ne démontrera jamais l'existence ni des sphinx, ni des griffons. Un seul mot, le mot “contrefaire”, a suffi pour induire M. Newnham 42 en erreur. On ne peut pas dire que des gens “contrefont” la prévision ou tout autre phénomène analogue, mais qu'ils les simulent.
L'argument de M. Newnham n'est bien sûr aucunement original sous sa plume, quoiqu'il semble s'en féliciter comme s'il l'était. Le Dr More écrit : “Que ce qui n'a jamais existé, n'existe, ni n'existera jamais, puisse acquérir une renommée et susciter une crainte aussi universelles, voilà, à mon avis, le plus grand de tous les prodiges. S'il n'y avait jamais eu de vrais miracles, à aucune époque, il n'aurait guère été si facile d'en imposer aux gens par de faux. L'alchimiste n'aurait jamais cherché à perfectionner les métaux, à les faire passer pour de l'or ou de l'argent, s'il n'existait sur terre de pareils éléments reconnus véritables.” L'idée qui est avancée est exactement la même que celle de Newnham ; elle relève de cette vaste catégorie d'argumentation qui n'est que dans la pointe, et qui tire tout son effet de l'épigrammatisme. Que la croyance aux fantômes, en une divinité, en une vie future ou dans n'importe quelle autre chose, crédible ou non – que de telles croyances soient universelles ne démontre rien de plus que ce qui n'a besoin d'aucune démonstration : l'unanimité entre les hommes, l'identité de la constitution du cerveau humain – identité dont la résultante inévitable sera, globalement, que des données semblables engendrent des déductions semblables.
Un point sur lequel je suis en désaccord complet avec l'auteur de ce livre est son dédain pour l'œuvre de Chauncey Hare Townshend 43, une œuvre qui sera un jour estimée à sa juste valeur.
Quels que soient, en général, les mérites ou les démérites de la littérature américaine publiée sous forme de magazines, on ne peut douter ni de son expansion ni de son influence. La revue littéraire est, par conséquent, un sujet qui a de l'importance – une importance qui augmentera, d'ici quelques années, selon une progression géométrique. Toute la tendance de cette époque est aux publications périodiques. Les revues trimestrielles ne furent jamais populaires. Elles sont non seulement trop guindées, attitude qui vise à conserver une certaine dignité qui leur est due, mais elles mettent un point d'honneur, avec la même intention, à ne discuter que des questions qui sont du caviar pour la masse 44 et qui, dans la plupart des cas, n'ont qu'un intérêt conventionnel pour un cercle restreint. Leurs thèmes aussi sont traités à de trop longs intervalles ; leurs sujets brûlants sont déjà refroidis avant qu'ils aient pu les servir. Bref, leur gravité est tout à fait incompatible avec la précipitation de notre époque. Ce qu'il nous faut maintenant c'est l'artillerie légère de l'esprit ; nous avons besoin du raccourci, du condensé, du pénétrant, de ce qu'on peut facilement diffuser, au lieu du verbeux, du détaillé, du volumineux, de l'inaccessible. D'un autre côté, la légèreté de l'artillerie ne doit pas dégénérer en tirs de pistolets à bouchons, terme applicable à la plus grande partie des journaux quotidiens, dont le seul but légitime est de présenter des choses éphémères sous un aspect éphémère. Quel que soit le talent qui se donne carrière dans notre presse quotidienne – et bien souvent ce talent est considérable – il n'en demeure pas moins que l'impérieuse nécessité de saisir chaque sujet au vol, sous les yeux du public, a pour effet d'en réduire matériellement la puissance. L'abondance et la périodicité des magazines mensuels semblent exactement répondre, sinon à toutes les exigences littéraires du moment, du moins à leur partie la plus large et la plus impérative, aussi bien que la plus conséquente.
Il est infiniment regrettable que les piteuses railleries de quelques objecteurs professionnels aient eu suffisamment d'influence pour retarder, ne fût-ce que d'un an, l'adoption d'un nom pour notre pays. À présent, nous n'en avons clairement aucun. Il devrait pourtant n'y avoir aucune hésitation sur celui d'Appalachie. Premièrement, il est caractéristique tandis que celui d'Amérique 45 ne l'est aucunement et ne le sera jamais. Nous pouvons, nous autres, légiférer autant qu'il nous plaira, et adopter pour notre pays quelque nom qui nous agrée ; mais, à notre avis, ce ne sera jamais un nom qui réponde à toutes les conditions nécessaires, à moins que ne nous laissent les en déposséder les régions qui l'utilisent en ce moment. L'Amérique du Sud est l'Amérique, et elle aura à cœur de le rester. Deuxièmement, le mot Appalachie est d'origine indigène et renvoie à l'un des aspects les plus magnifiques et les plus distinctifs du pays en tant que tel. Troisièmement, par l'emploi que nous ferions de ce vocable nous rendrions hommage aux aborigènes que, jusqu'ici, nous avons à tous égards spoliés, assassinés et déshonorés sans merci. Quatrièmement, ce nom a été proposé peut-être par le plus éminent d'entre tous les pionniers de la littérature américaine. Ce n'est que justice de laisser Washington Irving choisir un nom pour le pays où il s'en est tout d'abord fait un dans le domaine des Lettres. Enfin, la dernière chose, et de loin la plus importante, à prendre en considération, est la musique même du mot Appalachie. Quoi de plus sonore, de plus fluide et de plus ample que ce mot, dont l'étendue satisfait pleinement notre orgueil national ! On conçoit difficilement que le terme guttural d'Alleghanie puisse un seul instant lui être préféré. J'espère encore qu'Appalachie sera un jour adopté.
Celui-là n'est pas vraiment un brave qui a peur de paraître ou d'être, quand il lui sied, un lâche.
“Plus un écrit contient de choses excellentes, moins je m'étonne d'y trouver de grandes faiblesses. Lorsqu'on dit d'un livre qu'il a de nombreuses imperfections, rien n'est encore décidé et je ne puis savoir, partant de là, s'il est excellent ou bien exécrable. Mais si l'on dit de tel autre qu'il est sans défaut, à supposer que l'assertion se justifie, il ne pourra jamais être excellent.” Trublet 46. Le “jamais” est ici trop tranché. Bien qu'extraordinairement répandue, l'opinion de Trublet n'en est pas moins fausse. C'est tout simplement l'indolence du génie qui lui a donné cours. Il semble, en vérité, que le génie du plus haut rang subisse un état d'oscillation permanente, entre l'ambition et le mépris de cette dernière 47. L'ambition, chez les grands esprits, est au mieux négative. Ils luttent, travaillent et créent, non pas parce que l'excellence est une chose désirable en soi, mais parce qu'il est insupportable de se voir surpasser lorsqu'on a le sens de sa capacité à exceller. Aussi ne puis-je m'empêcher de croire que les plus grands esprits – parce qu'ils ont pleinement conscience de l'absurdité risible de l'ambition humaine – demeurent avec satisfaction “inglorieux et muets” 48. Quoi qu'il en soit, l'oscillation dont je viens de parler est le trait caractéristique du génie. Tantôt inspiré et tantôt découragé, ses inégalités d'humeur se font ressentir dans ses ouvrages. Telle est la réalité, en général ; or elle diffère sensiblement de l'assertion contenue dans le “jamais” de Trublet. Quand le génie obéit à une impulsion suffisamment durable, le résultat qui s'ensuit est fait d'harmonie, de proportion, de beauté, de perfection, autant de vocables qui, en l'occurrence, sont tous synonymes. On n'y pourra déceler nulle trace de ses irrégularités supposées “inévitables”. Car il est clair que l'aptitude à recevoir des impressions de la Beauté, aptitude qui constitue l'élément le plus important du génie, implique une sensibilité et une aversion tout aussi exquise envers la difformité. L'impulsion, qui doit être durable, n'est jusqu'ici que rarement échue au génie, mais je pourrais citer plusieurs compositions qui, “sans aucun défaut”, sont toutefois “excellentes” et le sont à un degré suprême. D'autre part, le monde est au seuil d'une époque où, avec l'aide d'une calme philosophie, de telles compositions deviendront l'apanage du génie véritable. L'une des premières étapes, afin que le seuil soit franchi, consistera à écarter du chemin cette idée émise par Trublet – cette idée intenable et paradoxale, de l'incompatibilité du génie et de l'art.
Tout ce que demande l'homme de génie pour s'exalter est une matière morale en mouvement. Peu importe la direction de ce mouvement – pour ou contre lui – et “ce qui fait l'objet de ce mouvement” n'a pas la moindre importance.
Plongé dans un ciel ardant et cuivré
Le soleil, à midi, comme du sang
Se trouvait juste à l'aplomb du mât,
Pas plus grand que la lune.49
Coleridge
Le diamètre apparent de la lune est, en fait, supérieur à celui du soleil. Le poète l'ignorerait-il ?
S'il prenait à un homme ambitieux l'envie de révolutionner, d'un seul coup, le monde entier de la pensée humaine, de l'opinion humaine et du sentiment humain, l'occasion lui est offerte, la voie de la renommée immortelle s'ouvre devant lui, droite et sans obstacle. Tout ce qui lui reste à faire est d'écrire et de publier un tout petit livre. Son titre devrait être simple, quelques mots ordinaires : “Mon cœur mis à nu”50. Mais ce petit livre devrait être fidèle à son titre.
Or, n'est-il pas vraiment singulier que, malgré la soif démente de notoriété qui distingue tant d'individus, tant d'individus qui se soucient comme d'une guigne de ce qu'on pensera d'eux après leur mort, il ne s'en soit pas trouvé un seul qui eût assez de hardiesse pour écrire ce petit livre. Je dis bien écrire. Il y a quantité d'hommes qui, une fois le livre écrit, seraient amusés par l'idée que sa publication de leur vivant puisse les déranger, et qui seraient même incapables de comprendre pourquoi ils devraient s'opposer à sa publication après leur mort. Mais l'écrire, voilà le hic 51. Personne n'ose l'écrire. Personne n'osera jamais l'écrire. Personne, à supposer que quelqu'un ose, ne pourrait l'écrire. Le papier se tordrait et s'embraserait à chaque touche de la plume enflammée.
Car toutes les règles du rhéteur
Ne lui enseignent rien qu'à nommer ses outils.
S. Butler, Hudibras 52
Ces lignes souvent citées nous montrent qu'une ineptie mise en vers fait plus rapidement son chemin, et dure aussi plus longtemps, qu'une ineptie dite en prose. Tel homme qui se gausserait ou écarquillerait les yeux, devant une proposition stupide énoncée crûment, admettra qu'elle “donne beaucoup à réfléchir”, du moment qu'il s'agit d'une épigramme assez piquante. Les règles du rhéteur – pour peu qu'il y ait des règles – ne lui enseignent pas seulement à nommer ses outils, mais aussi à les utiliser, à connaître leur capacité, leur extension, leurs limites. L'analyse de ces outils le pousse, en outre, à un examen minutieux et à une compréhension du matériau sur lequel ils sont employés. Et ainsi, ils donnent finalement naissance à de nouveaux matériaux pour de nouveaux outils.
Parmi les eidola de la caverne, de la tribu, du forum, du théâtre 53, etc., Bacon aurait fort bien pu ranger le grand eidolon du salon ou de l'esprit, comme je l'ai naguère appelé dans une de mes précédentes notes marginales ; l'idole dont le culte rend l'homme aveugle à la vérité en l'éblouissant par l'à-propos. Mais quel titre aurait-on pu inventer pour cette idole, qui a peut-être propagé plus d'erreurs grossières que toutes les autres idoles réunies ? J'entends celle qui exige de ses adeptes qu'ils confondent la cause et l'effet, qu'ils raisonnent en cercle, qu'ils s'élèvent du sol en tirant sur leur pantalon, et qu'ils se transportent eux-mêmes sur la tête, dans un panier, depuis Bersabée jusqu'à Dan 54. Toutes, absolument toutes les élucubrations que j'ai pu voir, concernant la nature de l'âme ou de la Divinité, ne me semblent rien que le culte de cette idole sans nom. Pour savoir ce qu'est Dieu, dit Bielfeld, quoique personne ne prête attention à cette vérité solennelle, il faut être Dieu même ; et vouloir en chercher la raison est, de toutes choses, la plus déraisonnable. Du moins, celui-là seul est qualifié pour débattre du sujet qui perçoit l'inanité de ce débat.
Que la ponctuation soit importante, personne ne le conteste ; mais combien sont rares ceux qui comprennent l'étendue de cette importance ! L'écrivain qui néglige la ponctuation ou qui ponctue de manière erronée s'expose à n'être pas bien compris ; telle est, selon l'entendement vulgaire, la somme des maux résultant de l'étourderie ou de l'ignorance. C'est un fait apparemment peu connu que, même quand le sens est parfaitement clair, une phrase peut perdre la moitié de sa force, de son esprit, de son intérêt, à cause d'une ponctuation défaillante. Par l'omission d'une simple virgule, il arrive souvent qu'un axiome prenne l'aspect d'un paradoxe ou qu'un sarcasme soit transformé en sermon.
Il n'existe aucun traité sur la question, et pourtant il n'y a pas de question pour laquelle un traité soit plus nécessaire. Beaucoup de gens estiment qu'il s'agit là d'une pure convention qu'on ne saurait inscrire dans les limites d'une règle intelligible et cohérente. Et cependant, à l'envisager de front, toute la ponctuation s'avère d'une telle simplicité que sa logique peut être immédiatement déchiffrée. Si je ne suis pas devancé, je pourrais m'attacher prochainement à l'écriture d'un article sur La Philosophie du point 55.
Mais pour l'heure, qu'il me soit permis de dire un mot ou deux à propos du tiret. Tout écrivain pour la presse qui possède un tant soit peu le sens de l'exactitude doit avoir été fréquemment mortifié et vexé par la déformation de ses propos qu'induit la substitution du tiret, dans son manuscrit, par les deux points ou la virgule, comme le font aujourd'hui généralement les imprimeurs. L'abandon complet, ou presque, du tiret provient de la répulsion consécutive à son emploi excessif, il y a vingt ans environ. Les poètes byroniens étaient tout tiret. John Neal, dans ses premiers romans, a poussé cet usage jusqu'à l'abus le plus grossier – quoique son erreur particulière s'explique par l'esprit philosophique et indépendant qui l'a toujours distingué, et qui lui permettra même, si je ne me trompe pas grandement sur sa personne, de produire pour la littérature de son pays une œuvre qu'il ne pourra pas, et ne voudra pas, “laisser dépérir”.
Sans entrer maintenant dans le pourquoi de la chose, je ferai remarquer que l'imprimeur peut toujours vérifier que le tiret du manuscrit est employé à bon escient, en gardant à l'esprit que cette marque indique une seconde pensée – un correctif. Je viens d'illustrer son usage en y ayant recours à l'instant. La proposition “un correctif” est, d'après la construction grammaticale, mise en apposition à la proposition “une seconde pensée”. Après avoir écrit ces derniers mots, je me suis demandé s'il n'était pas possible de rendre leur signification plus claire, à l'aide de certains autres mots. Or, au lieu d'effacer l'expression “une seconde pensée” qui est de quelque utilité – qui suggère partiellement l'idée à communiquer – qui me fait progresser d'un pas vers mon but – j'ai préféré la laisser, et placer tout simplement un tiret entre celle-ci et l'expression “un correctif”. Le tiret laisse au lecteur le choix entre deux, trois ou plusieurs expressions, dont une peut avoir plus de force qu'une autre, mais qui toutes viennent porter secours à l'idée. On peut le traduire généralement par ces mots : – “ou pour me montrer plus précis”. Voilà sa force – et cette force, le tiret ne la partage avec aucun autre signe de ponctuation, étant donné qu'ils ont tous des applications bien définies qui diffèrent sensiblement de celle-ci. On ne saurait, par conséquent, se passer du tiret.
Il possède ses phases – ses variations de degré ; mais ce principe unique – celui d'une seconde pensée ou d'un correctif – se trouvera être à la base de tous.
Après avoir lu tout ce qu'on a écrit et après avoir médité tout ce qui peut l'être, au sujet de Dieu et de l'âme, celui qui a le droit de dire qu'il pense un tant soit peu se trouvera devant la conclusion que, sur ces questions, la pensée la plus profonde est celle qui se distingue le moins facilement du sentiment le plus superficiel.
L'un des meilleurs exemples, à une petite échelle, de cette logique qui consiste à se transporter soi-même dans un panier, figure dans un hebdomadaire londonien appelé The Popular Record of Modern Science, a Journal of Philosophy and General Information. Cette publication largement diffusée jouit du respect d'hommes éminents. Dans le courant de novembre 1845, on y reproduisait, d'après le Columbian Magazine de New York, un de mes articles assez téméraire intitulé Révélation magnétique. On avait même eu l'impudence de prétendre en améliorer le titre, en l'appelant La Dernière conversation d'un somnambule, expression tout à fait hors de propos, puisque le personnage qui “converse” n'a rien d'un somnambule. C'est un dormeur éveillé et non pas quelqu'un qui marche dans son sommeil, mais je présume que le Record n'est pas à une lettre près 56. Quoi qu'il en soit, mon grief porte essentiellement sur la préface ajoutée par le rédacteur londonien : “L'article qui suit fut communiqué au Columbian Magazine, journal respectable et influent aux États-Unis, par M. Edgar A. Poe. Le texte contient la preuve interne de son authenticité !” Il n'est pas de sujet au monde qui prête à des idées plus comiques que celui de la preuve interne apportée par le texte lui-même. Notez que c'est par cette preuve-là que nous allons juger de l'esprit. Mais revenons au Record : à propos de mon Cas Valdemar, le journal le copie tout naturellement, et tout aussi naturellement il en améliore le titre, comme dans l'exemple qui précède 57. Toutefois, les commentaires de la rédaction ne manquent pas de profondeur. Les voici :
Le récit qu'on va lire a paru dans un numéro récent de l'American Magazine, périodique respecté aux États-Unis. Il nous vient, remarquons-le, du narrateur de La Dernière conversation d'un somnambule que le Record a donné dans son numéro du 29 novembre. Le Morning Post de lundi dernier choisit de rester prudent, à propos de ce cas, en observant : ‘‘Pour notre part, nous n'y croyons pas ; et plusieurs déclarations, en particulier s'agissant du mal dont est mort le patient, prouvent d'emblée que le récit est une pure fabrication ou qu'il est l'œuvre d'une personne qui connaît peu la phtisie. L'histoire est néanmoins stupéfiante, c'est pourquoi nous la livrons au public.'' Pourtant, le rédacteur n'indique pas précisément quelles sont ces affirmations qui s'accorderaient mal avec ce que nous savons des progrès de la phtisie, et comme peu de gens versés dans les sciences préféreraient s'adresser au Morning Post pour être instruits en pathologie ou en logique, il est à craindre que son avertissement ait peu de poids. La raison avancée par le Post pour la publication de ce rapport est curieuse. Elle s'appliquerait aussi bien à une aventure du Baron de Münchhausen : ‘‘l'histoire est stupéfiante, c'est pourquoi nous la livrons au public…'' Le cas dont il s'agit compte assurément parmi ceux qu'on ne peut admettre, tant qu'ils ne sont pas étayés par des témoignages irréfutables. Or, il est évident que les témoignages qui l'ont accompagné jusqu'ici ne présentent pas ce caractère. Les circonstances qui jouent en sa faveur se résument au fait qu'il semble avoir trouvé créance à New York, et que l'affaire s'est déroulée à quelques milles de cette cité où, par conséquent, tous les moyens qui permettaient d'en vérifier l'authenticité étaient à disposition. Les initiales des médecins et du jeune étudiant en médecine ont dû suffire à leur identification, dans les environs immédiats, d'autant que M. Valdemar était bien connu et que sa maladie dura assez longtemps pour qu'on ne puisse douter de la facilité qu'il y avait à s'assurer des noms des praticiens qui l'avaient soigné. De même, les infirmières et les domestiques qui ont dû avoir connaissance de cette histoire, pendant les sept mois qu'elle a duré, sont bien entendu exposés à toutes sortes de questions. Il apparaîtra donc que trop de gens étaient impliqués pour qu'il fût possible de dissimuler longtemps la chose. L'excitation véhémente et les diverses rumeurs qui, à la fin, ont rendu nécessaire une déclaration publique suffisent également à démontrer que quelque chose d'extraordinaire doit s'être produit. D'autre part, il n'y a pas d'argument valable pour que nous refusions d'y croire. Les faits, comme le dit le Post, sont ‘‘stupéfiants'' ; mais tous les faits qui parviennent pour la première fois à notre connaissance le sont, et, en matière de mesmérisme, tout est nouveau. On pourrait objecter que cet article a des airs de journalisme, M. Poe l'ayant de toute évidence écrit en vue d'un effet, dans le but d'exciter plutôt que d'apaiser le vague engouement pour le mystère et l'horrible qu'un pareil cas est sûr d'éveiller, en toutes circonstances. Mais, ceci mis à part, il n'y a rien qui doive empêcher un esprit philosophique de se livrer à de plus amples investigations à ce sujet. Dans le cas présent, toute l'affaire repose sur le témoignage. [En effet !] C'est dans cette optique que nous allons tâcher d'obtenir toutes les preuves disponibles, auprès de quelques-uns des habitants de New York parmi les plus intelligents et les plus influents. Aucun steamer ne quittera l'Angleterre pour l'Amérique avant le 3 février, mais nous avons la certitude qu'après quelques semaines, à compter de cette date, il nous sera possible de fournir aux lecteurs du Record des renseignements qui leur permettront d'aboutir à une conclusion plus précise.”
Nul doute qu'ils aboutirent, en fin de compte, à une conclusion très précise. Mais toutes ces inepties ressortissent à l'appréciation de ce que les gens nomment la “preuve interne”. Le Record est persuadé qu'il s'agit là d'une histoire vraie en raison d'un certain nombre de faits : “les initiales des médecins ont dû suffire à leur identification” ; “les infirmières ont dû être exposées à toutes sortes de questions” ; enfin, “l'excitation véhémente et les diverses rumeurs qui ont rendu nécessaire une déclaration publique suffisent à démontrer que quelque chose d'extraordinaire s'est produit”. Bien entendu ! L'histoire est prouvée par ces faits. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire est d'en prouver l'existence. Ah ! mais voilà ! ces faits sont prouvés réciproquement par l'histoire. Quant au Morning Post, il fait preuve de plus de faiblesse encore par sa méfiance que le Record par sa crédulité. Ce qu'il dit à propos des doutes suscités par l'inexactitude dans le détail des symptômes de la phtisie n'est qu'une astuce, pour faire croire à quelques rares enfants que le “canard” en question est beaucoup moins sot que ne le sont proverbialement ces oiseaux. Il en sait aussi long en pathologie qu'en grammaire anglaise, et j'espère bien qu'il ne se croira pas obligé de rougir du compliment. Certes, j'ai prêté à M. Valdemar des symptômes très sévères. J'ai choisi un cas extrême car il fallait éliminer dans l'esprit du lecteur toute hésitation quant à la certitude que la mort serait survenue sans l'aide du magnétiseur, mais de tels symptômes auraient pu se produire ; des symptômes identiques se sont déjà produits, et ne manqueront pas de se présenter encore à l'avenir. Si le Post avait été seulement à moitié aussi honnête qu'il est ignorant, il aurait avoué que sa défiance n'avait pas de raison plus profonde que celles qui poussent tous les imbéciles à se méfier ; il aurait avoué que la chose lui paraissait douteuse tout simplement parce qu'elle était “stupéfiante” et qu'elle n'avait encore jamais été imprimée dans un livre.
Il y a peu de cas où la simple popularité peut être envisagée comme un bon critère du mérite, toutefois il semblerait que l'art de la chanson appartienne à cette catégorie. Quand je dis l'art de la chanson, j'entends bien sûr la composition de courts poèmes écrits en vue de leur adaptation musicale, au sens courant du terme. C'est dans cette ultime destination de la chanson proprement dite que gît son essence, son génie. C'est la stricte référence à la musique, la dépendance envers l'expression modulée, qui confère à cette branche des lettres un caractère unique et qui la distingue aussi de la littérature ordinaire, dans une large mesure encore insuffisamment prise en compte. C'est cela qui lui donne son indépendance au regard des conventions ordinaires ; c'est cela qui autorise, qui exige même, une grande liberté quant à la règle ; et c'est encore cela qui requiert, de façon impérative, une extrême licence et une part d'indéfini que tout musicien reconnaîtra, s'il n'est pas un grossier violoneux, comme un aspect important de la philosophie de sa science et comme l'âme, en fait, des sensations qu'elle produit dans sa pratique, sensations qui émeuvent à mesure qu'elles ensorcellent et ne sauraient aussi bien nous ensorceler sans nous émouvoir autant.
Les sentiments qui proviennent de la simple conception d'un son agréable échappent à l'analyse, bien qu'ils puissent éventuellement se rapporter, en leur résultat final, à cette reconnaissance purement mathématique de l'égalité qui semble être à l'origine de toute Beauté. Nos impressions de l'harmonie et de la mélodie conjuguées sont plus facilement analysables ; mais ce qui est sûr, c'est que le plaisir sentimental éprouvé grâce à la musique est quasiment en proportion de son caractère indéfini. Donnez à la musique une décision indue, imprégnez-la d'un ton très déterminé et vous lui enlevez aussitôt tout ce qu'elle a d'éthéré, d'idéal, et, j'en suis intimement convaincu, tout ce qui fait son caractère essentiel, intrinsèque. Vous lui ôtez son luxe qui est comme dans un rêve, vous dissipez l'atmosphère de mystère à laquelle toute sa nature est liée, vous étouffez son souffle de fée. Elle n'est plus alors qu'une chose tangible et qu'on apprécie sans effort, une conception terrestre, de la terre. Elle n'en perdra certes pas entièrement son pouvoir de plaire, mais bien tout ce que j'estime être le caractère distinctif de ce pouvoir. Pour un talent cultivé à l'excès ou pour un esprit peu imaginatif, la suppression de son charme le plus délicat sera souvent jugée comme un avantage. On vise à une certaine détermination de l'expression – ainsi que le font des compositeurs qui devraient en savoir plus long – parce qu'on y voit de la beauté, au lieu de la rejeter comme un odieux sacrilège. Ainsi trouve-t-on, même chez des personnes faisant autorité, des tentatives d'imitation absolue par les sons musicaux. Qui peut oublier ou cesser de regretter les nombreuses erreurs de ce genre, dans lesquelles de grands esprits sont tombés, pour avoir surestimé les prouesses de l'habileté ? Qui peut s'empêcher de déplorer les Bataille de Prague 58 ? Quel homme de goût peut se retenir de rire ou de pleurer, à l'idée de ses “canons, tambours, trompettes, tromblons et tonnerres” ? “La musique vocale, dit l'abbé Gravina, devrait imiter le langage naturel des sentiments humains et des passions humaines, plutôt que le gazouillis des canaris que nos chanteurs affectent, aujourd'hui, de si bien contrefaire, avec leurs trémolos et leurs cadences tant vantées 59.” La chose n'est vraie qu'en ce qui concerne le “plutôt”. Si la musique doit imiter quoi que ce soit, il vaut assurément mieux que cette imitation s'en tienne aux limites que propose Gravina.
Ce caractère indéfini qui est, pour le moins, l'un des éléments essentiels de la vraie musique, doit bien entendu retenir l'attention de l'auteur de chansons ; et il faut toujours que le critique en tienne compte dans le jugement qu'il porte sur ces dernières. C'est de la conscience qu'a l'auteur – même si ce n'est parfois qu'une appréciation purement instinctive – de ce besoin d'indéfini que toutes les chansons bien conçues reçoivent ce ton libre, opulent et chaleureux, sans scrupules excessifs envers les raffinements de l'expression, qui ne saurait être mieux traduit que par le mot français très commun d'abandonnement, et qui est illustré de façon si frappante par les ballades, graves et joyeuses, et les chants de Noël de nos ancêtres anglais. Ce trait prévaut partout où des vers se marient étroitement à la musique. C'est l'essence même de toute chanson antique : c'est l'âme d'Homère, l'esprit d'Anacréon, le génie d'Eschyle. Plus près de nous, c'est le principe vital de Béranger. Aucun auteur de chansons auquel cette qualité fait défaut ne fut jamais vraiment populaire, et pour les raisons que j'ai dites, aucun auteur de chansons ne peut espérer l'être sans elle.
Voici une idée de nouvelle intéressante, pourvu qu'on s'y attelle : – Un hâbleur qui prétend s'élever à la connaissance universelle, un Crichton 60 de pacotille, accapare, pendant une heure ou deux, l'attention d'un large auditoire qui, dans l'ensemble, est profondément impressionné par l'étendue de son savoir. Il fait beaucoup d'esprit, en particulier aux dépens d'un modeste jeune homme qui ne s'aventure pas à lui répondre. Finalement, celui-ci quitte la salle comme s'il était dans un profond désarroi, tandis qu'avec la même arrogance, le conférencier salue son départ d'un grand éclat de rire. Mais il revient bientôt, suivi d'un valet chargé d'une brassée de livres, qui sont ensuite déposés sur une table. Puis, se référant à quelques notes crayonnées en secret, pendant que le pédant faisait étalage de son érudition, le jeune homme reprend, point par point, et réfute chacune des affirmations de ce dernier, citant à l'appui toutes les autorités convoquées par son prétentieux interlocuteur, dont l'incompétence à tous égards est désormais patente.
Je crois bien n'avoir jamais saisi toute la force du mot “insulte”, jusqu'au jour où un membre de la clique de la North American Review me donna à entendre que ce journal “était non seulement désireux, mais vraiment impatient de me rendre cette justice que la Revue Française et la Revue des Deux Mondes m'avaient déjà rendue” – mais qu'il en était retenu par mon “invincible esprit de contradiction”. Je souhaite que la North American Review n'exprime aucune opinion sur mon compte, car je n'en ai aucune à son sujet. Toutefois, m'apercevant qu'il n'y a pas de devise inscrite à sa première page, j'aimerais pouvoir lui en proposer une, tirée d'un livre de Sterne. La voici : “Tandis que nous chevauchions dans la vallée, nous vîmes un troupeau d'ânes sur le sommet d'une montagne : de quel œil sévère nous passaient-ils en revue ! 61”
Si jamais mortel “imposa ses pensées à l'expression” 62, ce fut Shelley. Si jamais poète chanta comme chante un oiseau, de façon ardente, impulsive, avec le plus pur abandon, pour lui seul et pour la seule joie contenue dans son chant, ce poète fut l'auteur de La Sensitive. Quant à l'Art, hormis ce que possède instinctivement le Génie, il en était peu doué ou le méprisait entièrement. Il méprisait réellement cette règle qui n'est qu'une émanation de la Loi, car son âme était en fait la Loi même. Ses rhapsodies se résument à de vagues notes, des annotations sténographiques de poèmes, qu'il se souciait peu de rédiger pour l'humanité, parce qu'elles suffisaient déjà amplement à son intelligence. On ne trouve dans ses œuvres aucune conception qui soit totalement achevée. Et pour cette raison il est le plus fatiguant des poètes. On lui reprocherait volontiers de ne pas en dire assez, plutôt que d'en dire trop. Ce qui passe, chez lui, pour être une idée diffuse s'avère un bref condensé d'une multitude d'entre elles ; et c'est cette sorte de condensé qui le rend si obscur. Pour un tel homme, il n'eût jamais été question d'imiter. Cela ne lui aurait été d'aucun avantage, puisqu'il ne s'adressait qu'à son âme, et que celle-ci n'eût jamais compris un langage qui lui fût étranger. Aussi était-il profondément original. Son étrangeté provient de la perception intuitive de cette vérité, dont seul Bacon donna une formulation claire : “Il ne saurait y avoir de beauté exquise sans une légère étrangeté dans les proportions.” Mais qu'on le juge obscur, original ou même étrange, Shelley était dépourvu de toute affectation. Il fut toujours sincère.
Des ruines de Shelley jaillit à la vie, dressant son front contre les cieux, une pagode fantastique et chancelante où les saillies, ornées des grelots tintinnabulants du bouffon, incarnaient les erreurs consubstantielles à l'original – erreurs qui n'en sont guère, d'après ses intentions, mais qui paraissent monstrueuses, si l'on considère que ses œuvres s'adressent à l'humanité. Une “école” a suivi – s'il faut encore employer ce terme absurde – une école, donc un système de règles, s'inspirant toutes de Shelley qui n'en avait point. D'innombrables jeunes gens, éblouis par la splendeur et stupéfaits par la bizarrerie de l'éclair qui déchirait les nuées d'Alastor, n'eurent somme toute aucun mal à assembler quelques flocons empruntés à leur modèle ; mais quant à l'éclair, ils furent obligés de se contenter du reflet, où la bizarrerie se montrait sans la flamme. Les esprits mûrs ne manquèrent pas non plus d'être impressionnés par la contemplation d'un autre esprit, plus grand et plus mûr. Ainsi, dans cette école de toute licence, d'obscurité, d'étrangeté et d'exagération, s'immiscèrent peu à peu le didactisme hors de propos de Wordsworth et la métaphysiquerie plus anormale encore de Coleridge. Les choses allèrent vite à la catastrophe ; puis, avec le temps, Tennyson porta l'inconsistance poétique à son comble. Mais ce fut précisément cet excès (car la plus grande erreur et la plus grande vérité se rejoignent toujours) qui, en suivant la loi des extrêmes, provoqua chez Tennyson un revirement naturel et inévitable, par lequel il fut amené tout d'abord à rejeter, puis à étudier sa première méthode, et à tirer finalement de ses éléments magnifiques le plus vrai et le plus pur de tous les styles poétiques. À ce point, toutefois, le processus est encore incomplet ; et c'est en partie pour cette raison, mais surtout à cause du caractère purement fortuit de cette combinaison morale et mentale qui, si jamais elle se réalise, devra unir en un seul être l'abandon de Shelley et le sens poétique de Tennyson, l'art le plus profond (étayé à la fois par l'analyse et l'instinct) et le plus ferme vouloir, capable de tout allier et de tout contrôler avec rigueur ; c'est principalement, dis-je, parce qu'une telle combinaison de choses en apparence antagonistes relèverait d'un “heureux hasard”, que le monde n'a pas encore vu le plus noble poème qui puisse, en toute hypothèse, être écrit.
Ci-gît un puits profond et scellé,
Caché sous la forêt verdoyante,
Dont les eaux mornes et solitaires gonflent
Ses bords, le froid et la tristesse parmi.63
Placer l'adjectif après le nom n'est qu'un gallicisme à peine excusable ; mais placer la préposition après le substantif est une tournure qui ne renvoie à aucun idiome, et qui déroge même à tous les principes du langage. De tels écarts trahissent habituellement la pauvreté des ressources du versificateur. Et quand il nous arrive de tomber sur une inversion de ce genre, nous songeons à part nous : “À cet endroit, le poète n'avait pas suffisamment d'habileté pour composer son vers sans altérer l'ordre naturel ou correct des mots.” En certaines occasions, il est vrai, cette erreur n'est pas tant due à un manque d'habileté qu'à un défaut beaucoup moins pardonnable, à savoir l'idée que de tels procédés appartiennent à l'essence de la poésie, qu'elle en a besoin pour se distinguer du reste, et, somme toute, qu'on est d'autant plus poète qu'on s'éloigne des usages de la prose. Même lorsqu'ils invoquent la “licence poétique” – expression qui est à l'origine de péchés innombrables – les tenants de cette opinion semblent vaguement convaincus que la licence implique la nécessité d'être adoptée. Le véritable artiste, en revanche, s'interdira toujours la moindre “licence”. Ce seul nom éveillera en lui du dégoût, car on peut le paraphraser ainsi : “Puisque vous semblez ne pouvoir vous passer de ces peccadilles, je suppose qu'il faudra bien vous les concéder ; et le monde, fermant à demi les yeux, s'efforcera de ne pas voir la maladresse qu'elles impriment à votre poème”. Peu de choses comme l'inversion sont susceptibles de rendre un vers faible et défectueux. Dans la plupart des cas, si l'on dit qu'un vers est “énergique”, cette qualité tient au caractère direct de l'expression. Une grande majorité des passages devenus banals à force de répétitions doivent leur popularité, soit à ce caractère direct, soit, plus généralement, au dédain de la “licence poétique”. Pour résumer, en ce qui concerne la construction verbale, plus un style poétique se rapproche de la prose meilleur il est. Par cette sorte de prosaïsme, Cowper, qui n'avait que de faibles dispositions poétiques, fut bien près de réussir à passer pour l'égal de Pope en son temps ; et les trois quarts de cet extraordinaire à-propos et de cette force qui distinguent Thomas Moore sont attribuables à la même cause 64. C'est à leur prosaïsme que ces deux auteurs doivent d'être si fréquemment cités.
L'imagination pure choisit exclusivement, au sein de la Beauté ou de la Difformité, les éléments les mieux faits pour s'unir et qui n'ont pas encore donné lieu à des combinaisons. En règle générale, le composé fait entrer dans son caractère une part de beauté ou de sublimité proportionnée à celles des éléments rassemblés, qui eux-mêmes apparaissent en leur état atomique, c'est-à-dire comme le fruit de combinaisons antérieures. Mais, de même que cela se produit souvent dans la chimie naturelle, il n'est pas rare que, dans cette chimie de l'intellect, le mélange de deux éléments donne naissance à un objet qui ne possède rien des qualités de l'un des deux composants, ni même d'aucun d'eux. Ainsi la palette de l'imagination est-elle sans limite. Ses matériaux se situent dans l'univers tout entier. Et même à partir de choses difformes, elle saura fabriquer cette Beauté qui est à la fois son unique objet et son incontournable critère. Mais, dans l'ensemble, la richesse ou la force des matières combinées, la faculté de découvrir de nouvelles associations qui méritent d'être tentées, et plus particulièrement la “combinaison chimique” absolue de la masse achevée, sont les points qu'il nous faut prendre en compte dans le jugement que nous portons sur l'imagination. C'est cette totale harmonie d'une œuvre imaginative qui conduit si souvent les gens irréfléchis à la sous-estimer, en raison du caractère d'évidence qu'elle revêt. En les découvrant, nous avons naturellement tendance à nous demander comment de telles combinaisons n'avaient jamais été inventées jusqu'alors.
Le pur diabolisme n'est que Folie absolue. Pour Lucifer, ce ne fut que malchance d'avoir été créé sans cervelle.
Lorsqu'un homme de génie parle de difficulté, il veut tout simplement dire l'impossible.
Nous autres, hommes du XIXe siècle, avons besoin pour nous régénérer d'un faiseur de miracles. Mais nous avons atteint une telle dégradation que le seul prophète, ou le seul prêcheur, capable d'un si grand bienfait serait le saint François qui convertissait les animaux.
Le nez de la foule, c'est son imagination ; c'est par ce nez-là qu'on pourra toujours facilement la conduire.
Les Romains vénéraient l'Aigle sur leurs enseignes. Notre enseigne à nous n'est que le dixième d'un aigle 65, un Dollar. Mais nous nous rattrapons en l'adorant avec une dévotion décuplée.
“Qui est né homme, dit Wieland 66, dans son Peregrinus Proteus, ne devrait ni ne saurait devenir autre chose de plus noble, de plus grand ou de meilleur qu'un homme.” Le fait est que, en nous efforçant de nous élever au-dessus de notre nature, nous tombons immanquablement au-dessous d'elle. Nos demi-dieux réformistes ne sont rien de moins que des démons travestis.
Il n'y a que l'œil de lynx du philosophe pour parvenir, à travers la brume d'indignité de la vie humaine, à percevoir encore la dignité de l'Homme.
Il n'y a rien d'irrationnel à supposer que, dans une vie future, ce que nous prenons pour notre existence présente nous apparaîtra comme un songe 67.
En cherchant par quel trait distinguer le peuple et la foule, on peut dire qu'un peuple entraîné à l'action est une foule, tandis qu'une foule s'efforçant de réfléchir retrouve le calme d'un peuple.
Dites à un coquin, trois ou quatre fois par jour, qu'il est un modèle de probité et vous ferez de lui, sans aucun doute, un monsieur parfaitement “respectable”. En revanche, si vous vous acharnez à traiter de crapule un homme honorable, vous ferez naître en lui l'ambition perverse de vous montrer que vous n'avez pas tout à fait tort.
À considérer le monde comme il est, ce serait folie de nier que le chemin le plus certain vers la réussite mondaine est celui de la méchanceté, plutôt que celui de la vertu. Ce “levain d'iniquité” 68 dont parlent les Écritures est en réalité un levain qui fait monter les hommes.
“Un peu de savoir”, dans le sens où le poète l'a écrit, est assurément “chose dangereuse” 69 ; mais, au regard de cette connaissance particulière qu'on appelle “connaissance du monde”, seul le peu de savoir n'est pas dangereux. Connaître entièrement le cœur humain, c'est prendre une ultime leçon dans le livre scellé d'acier du Désespoir 70.
Non seulement j'estime paradoxal de dire d'un homme de génie qu'il est personnellement détestable, mais je maintiens que le génie le plus élevé n'est rien de moins que la noblesse morale la plus haute.
La musique des sphères : cette formule que prisent tant nos poètes et encore plus nos orateurs provient d'une simple mésinterprétation du terme platonicien mousiké, lequel, chez les Athéniens, s'appliquait non seulement aux harmonies de ton et de temps, mais à la proportion sous toutes ses formes. Lorsqu'il recommandait l'étude de la “musique” comme “la meilleure éducation de l'âme”, Platon se référait à la culture du Goût par opposition à celle de la Raison pure. Par “musique des sphères” il entendait les accords, les adaptations, en un mot les proportions qui sont déployées dans les lois astronomiques. Il ne faisait nullement allusion à la musique, dans le sens que nous autres lui donnons. Le vocable “mosaïque” qui dérive de mousiké se rapporte également à la proportion, à l'harmonie de couleur observée – ou qui devrait l'être – au sein de la discipline artistique ainsi dénommée 71.
Un potiron a plus d'angles que C… et, j'ajouterai, également plus de jugeote. Il n'est remarquable qu'à un égard seulement, celui de n'être remarquable en rien.
Il est amusant de voir la facilité avec laquelle tout système philosophique peut être réfuté. Mais aussi, n'est-il pas désespérant de constater l'impossibilité d'imaginer qu'aucun système particulier soit vrai !
Si j'étais amené à définir, très brièvement, le mot “Art”, je l'appellerais “la reproduction de ce que les sens perçoivent dans la nature à travers le voile de l'âme”. La simple imitation, si précise soit-elle, de ce qui existe dans la nature ne donne aucunement le droit au titre d'Artiste. Denner 72 n'était pas un artiste. Les raisins de Zeuxis n'avaient rien d'artistique, si ce n'est pour les oiseaux ; et les rideaux de Parrhasios eux-mêmes n'auraient pu dissimuler son manque de génie 73. J'ai parlé du “voile de l'âme” car quelque chose de cet ordre apparaît indispensable pour l'Art. Nous pouvons, à tout moment, doubler la vraie beauté d'un paysage réel en fermant les yeux à demi, tandis que nous le contemplons. Quelquefois, nos sens par eux-mêmes voient trop peu, mais c'est toujours qu'ils voient trop.
“La Philosophie, dit Hegel, est absolument inutile et infructueuse, et c'est pour cette raison même qu'elle est la plus sublime de toutes les poursuites, qu'elle mérite le plus notre attention, et qu'elle est la plus digne de notre zèle 74.” À coup sûr, ce jargon fut suggéré par la phrase de Tertullien : “Mortuus est Dei filius ; credibile est quia ineptum – et sepultus resurrexit ; certum est quia impossibile 75.”
Je me suis plu parfois à tenter d'imaginer le sort d'un individu doué, ou plutôt accablé, d'une intelligence très nettement supérieure à celle de ses congénères. Bien entendu, il aurait conscience de sa supériorité et ne pourrait s'empêcher, s'il était par ailleurs constitué comme tout homme, de manifester cette conscience. Il se ferait ainsi des ennemis à tout propos. Et, puisque ses opinions et ses théories seraient profondément différentes de celles de l'humanité tout entière, il est évident qu'on ne manquerait pas de le tenir pour fou. Quel supplice affreux ! L'Enfer ne saurait inventer pire torture que de se voir imputer une faiblesse anormale en raison d'une puissance anormale. Il en irait de même incontestablement d'une âme fort généreuse et qui éprouverait, en réalité, ce que tous les autres ne font qu'avoir l'air d'éprouver. Chacune de ses actions serait inévitablement mal perçue ; chacune de ses intentions interprétée à tort. Et, tout comme la cime de l'intelligence passerait pour de la fatuité, un tel excès de noblesse apparaîtrait comme le dernier degré de la bassesse. La même loi s'appliquerait pour toutes les autres vertus. Voilà un sujet bien pénible à méditer. Nul doute que des individus se soient déjà élevés si remarquablement au-dessus du commun ; mais si nous voulons rechercher, à travers les âges, quelques vestiges de leur existence, il nous faut écarter d'emblée les biographies des “braves et honnêtes gens”, et nous attacher plutôt à l'examen minutieux des traces laissées par ces malheureux qui périrent en prison, à Bedlam 76 ou sur le gibet.
Il est des moments où, même aux yeux clairvoyants de la Raison, le monde de notre triste Humanité revêt l'apparence de l'Enfer ; mais l'Imagination de l'homme n'est pas une Carathis 77, pour explorer sans risque chacune de ses cavernes. Hélas ! on ne peut regarder la sinistre légion des terreurs sépulcrales comme entièrement fictive ; mais, tels les démons en compagnie desquels Afrasiab descendit l'Oxus 78, il faut qu'elles demeurent endormies, sans quoi elles nous dévoreront – il faut les condamner au sommeil, autrement c'en est fait de nous79.
Est-il rien de plus doux, à la fois pour l'orgueil et pour la conscience d'un homme, que la conviction d'avoir tiré vengeance des injustices que lui ont fait subir ses ennemis, en usant simplement de justice à leur égard 80 ?
Une infinité d'erreurs s'insinuent dans notre philosophie, du fait que l'Homme a coutume de se regarder comme citoyen d'un seul monde, d'une planète individuelle, au lieu de considérer, au moins par moments, que sa position est, au sens propre, cosmopolite, qu'elle est celle d'un habitant de l'univers.
Un argument efficace en faveur de la religion du Christ est celui-ci : que les offenses envers la Charité sont à peu près les seules que, sur son lit de mort, un homme peut être amené, non pas à juger, mais à ressentir comme un crime.
Percevoir distinctement tous les mécanismes, les rouages et les ficelles de n'importe quelle œuvre d'art constitue sans doute un plaisir en soi, mais c'est un plaisir dont nous ne pouvons jouir que dans la mesure où nous ne jouissons pas de l'effet légitimement voulu par l'artiste. Et, de fait, il arrive trop souvent qu'en réfléchissant de façon analytique à propos de l'art, nous réfléchissions à la manière des miroirs de Smyrne, qui ne renvoyaient les plus belles images qu'en les déformant.
Je ne puis m'empêcher de penser que les auteurs de romans gagneraient, de temps à autre, à prendre exemple sur les Chinois qui, bien qu'ils construisent leurs maisons à partir du toit, ont tout de même assez de discernement pour écrire leurs livres en commençant par la fin.
Dans le conte proprement dit – où il n'y a pas de place pour traiter les personnages dans le détail, ni pour introduire une grande profusion, une grande variété d'incidents – la pure construction est naturellement une exigence beaucoup plus impérative que dans le roman. Dans celui-ci, une intrigue défectueuse peut encore échapper à l'observation du lecteur, mais dans le conte jamais. La plupart de nos conteurs négligent pourtant cette distinction. On dirait qu'ils commencent leurs histoires sans savoir comment ils vont terminer ; et, en règle générale, leurs dénouements, comme autant de gouvernements à la Trinculo 81, paraissent avoir oublié leurs débuts.
Je crois que c'est Montaigne qui dit : “Les gens parlent de penser ; mais quant à moi, je ne pense jamais, sinon lorsque je m'assieds pour écrire.” Il eût été plus judicieux, dans son cas, de ne jamais s'asseoir pour écrire avant d'avoir terminé de penser.
Combien de critiques américains oublient, hélas ! cet excellent conseil de M. Timon : “que le Ministre de l'Instruction publique doit lui-même savoir parler français.82”
Calomnier un grand homme est le moyen le plus rapide par lequel des gens médiocres accèdent, à leur tour, à la grandeur. Le Cancer ne serait probablement jamais devenu une constellation, s'il n'avait pas fait montre d'audace en pinçant Hercule au talon.83

Marginalia supplémentaires
MARGINALIA SUPPLÉMENTAIRES
IL ne saurait faire de doute, à notre avis, pour aucun esprit sensé qu'un tiers au moins de la vénération et de l'affection avec lesquelles nous considérons les anciens poètes de la Grande-Bretagne soit à mettre au compte d'une chose qui, en elle-même, ne relève pas de la poésie : nous voulons dire le simple amour de l'antique ; et, de même, qu'un tiers du sentiment poétique proprement dit que nous inspirent ces écrits doive être attribué à un fait qui, bien qu'il soit en connexion étroite avec la poésie dans l'abstrait, ainsi qu'avec les poèmes particuliers dont il est question, ne peut être regardé comme un mérite appartenant aux auteurs de ces poèmes. À peu près tous les lecteurs passionnés des vieux bardes anglais, si vous leur demandez ce qu'ils pensent de leurs productions, vous parleront vaguement, mais en toute sincérité, d'un sentiment de délice rêveur, sauvage, indéfini, et peut-être même diront-ils, indéfinissable. Appelés à désigner la cause de ce plaisir si vague, ils seront capables d'évoquer certaine étrangeté dans la phraséologie et certain aspect grotesque du rythme. Or, comme nous avons essayé de le montrer ailleurs, cette étrangeté et cet aspect grotesque sont d'une grande force et, lorsqu'ils sont bien maniés, constituent des apports tout à fait recevables à l'idéalité. Mais, dans les cas auxquels nous faisons allusion, ils se produisent indépendamment de la volonté de l'auteur, et sont des éléments parfaitement étrangers à son intention.
L'énorme multiplication des livres, dans toutes les branches de la connaissance, est l'un des plus grands fléaux de cet âge ; car elle constitue l'un des plus sérieux obstacles à l'acquisition d'un savoir positif. Le lecteur voit sa route encombrée d'un véritable fatras, au milieu duquel il doit chercher, à tâtons, quelques bribes de matériaux utiles éparpillés au hasard.
Le pickpocket ordinaire se contente de voler une bourse, et il s'en tient là. Il ne se félicite pas ouvertement du larcin qu'il a commis, pas plus qu'il n'accuse la personne dérobée de lui avoir fait les poches. À cet égard, il est nettement moins odieux qu'un voleur en matière de propriété littéraire. Il est impossible, à notre avis, d'imaginer spectacle plus révoltant que celui du plagiaire qui s'en va la tête haute, et qui sent battre son cœur avec plus de fierté, pour s'être attiré des louanges qu'il sait devoir à un autre. C'est la pureté, la noblesse, la sublimité d'une renommée loyalement acquise ; c'est le contraste entre cette sublimité et l'indignité du délit de vol, qui fait apparaître un péché comme celui du plagiat sous un jour aussi détestable. Nous sommes saisis d'horreur quand nous voyons coexister, dans le même sein, cette soif de renommée qui élève l'âme et cette avilissante propension à chaparder. C'est l'anomalie, le désaccord, qui nous heurte à ce point.
“Les anges”, dit Madame Dudevant 84, une femme aimant à placer beaucoup de sentiments admirables, au milieu d'un chaos de fiction la plus éhontée et la plus critiquable, “les anges ne sont pas plus purs que le cœur d'un jeune homme qui aime en vérité 85 ”. Cette hyperbole n'est pas très loin de se vérifier. Elle serait pleinement justifiée si elle s'appliquait à l'amour d'un jeune homme qui est en même temps un poète. Car, de tous les sentiments humains, l'amour juvénile d'un poète est indéniablement celui qui parvient à réaliser de plus près nos rêves de chastes voluptés célestes.
Dans chaque allusion que fait l'auteur de Childe Harold à sa passion pour Mary Chaworth, il circule un air de tendresse et de pureté quasiment spirituelle, qui entre en fort contraste avec l'aspect grossièrement terrestre dont s'imprègnent, au point de les défigurer, ses poèmes d'amour ordinaires. “Le Rêve”, que Byron composa au moment où il allait entreprendre ses voyages, et dans lequel les incidents de leur séparation sont, d'après les dires de certains, relatés ou évoqués, n'a jamais été surpassé – du moins, il ne l'a jamais été par lui – dans ce mélange particulier de ferveur, de délicatesse, de vérité et d'élévation qui sublime et rehausse le poème. C'est pourquoi l'on peut douter qu'il ait jamais rien écrit d'aussi universellement populaire. Nous avons toutes les raisons de croire que son attachement envers cette Mary (nom qui semble avoir recelé pour lui un charme spécial) fut sincère et durable. Il y a de cela des preuves par centaines, disséminées dans ses poèmes et ses lettres, aussi bien que dans les mémoires de ses proches et de ses contemporains. Mais la sincérité et la durée de cet amour ne contredisent en rien l'idée que ce fut une passion (si l'on peut ici employer ce terme) d'un caractère éminemment romantique, vague et imaginatif. Elle naquit du moment, de la nécessité d'aimer propre à la jeunesse ; elle fut bercée par les eaux, les collines, les fleurs et les étoiles. Elle n'avait pas directement à voir avec la personne, le caractère ou l'affection réciproque de Mary Chaworth. N'importe quelle jeune fille, pour peu qu'elle n'eût pas été repoussante, eût gagné l'amour de l'adolescent Byron, dans les mêmes circonstances de vie commune et libre qu'illustrent les gravures à ce sujet. Ils se voyaient sans aucune restriction ni réserve. Ils batifolaient tous deux comme de simples enfants. La fille et le garçon lisaient dans les mêmes livres, chantaient les mêmes chansons, se promenaient main dans la main, à travers les champs de leurs domaines contigus. Il en résulta un amour non seulement naturel et prévisible, mais aussi inévitable que le Destin.
Dans de telles conditions, Miss Chaworth, qu'on nous dépeint comme une personne aussi belle que talentueuse, ne pouvait manquer d'inspirer l'amour du poète ; elle convenait parfaitement à incarner l'idéal dont l'imagination de Byron était hantée. Néanmoins, il valut peut-être mieux, pour le côté purement romanesque de leurs épisodes amoureux, que ces rapports aient été rompus dès le plus jeune âge, et qu'ils n'aient jamais pu renouer sans interruption dans les années qui suivirent. Toute la chaleur, toute la passion d'âme, la grâce authentique et essentiellement idyllique, que suscita cet amour d'enfance doit être entièrement attribuée au poète. Si Mary Chaworth ressentit quelque émoi, ce ne fut que par l'effet du magnétisme de sa présence à lui. Si elle répondit à ses avances, ce fut uniquement parce que ses paroles de feu l'ensorcelèrent et qu'elles l'exhortèrent à y répondre. Avec l'éloignement, le barde emporta tout au fond de lui les fantasmes qui constituaient l'essence de sa flamme – une flamme dont l'absence même ne fit qu'accroître la vigueur ; tandis que l'affection moins idéale et en même temps moins réellement substantielle de sa bien-aimée, s'évanouit, purement et simplement, avec la disparition de l'objet qui l'avait provoquée. Il ne représentait à ses yeux, pour le dire brièvement, qu'un jeune homme ni laid, ni méprisable, mais sans héritage, assez excentrique et même un peu boiteux. Elle fut pour lui l'Égérie de ses rêves, la Vénus Aphrodite qui jaillit, dans toute sa beauté surnaturelle, de l'écume brillante sur l'océan tempétueux et agité de ses pensées.
Il n'est pas donné à tout le monde de savoir agencer convenablement les parties d'une “belle œuvre”, bien qu'une fois la chose accomplie, vous rencontrerez peut-être une personne sur dix qui soit en même temps capable de la concevoir et de l'apprécier. Nous ne pouvons croire qu'il faille moins d'habileté pour composer un excellent récit de courte dimension que pour écrire un roman d'une longueur moyenne. Certes, l'écriture d'un roman nécessite ce qu'il est convenu d'appeler un effort soutenu, mais ce n'est qu'une affaire de persévérance et cela n'a de rapport avec le talent que de manière indirecte. En revanche, l'unité d'effet – cette qualité rarement appréciée ou comprise par les esprits ordinaires, cette exigence difficilement satisfaite même par ceux qui la conçoivent – est indispensable dans le cas d'un “écrit bref”, contrairement au roman. Ce dernier, s'il est admiré, ne l'est qu'à travers des fragments détachés, sans égard à l'œuvre en tant qu'ensemble et sans considération pour le plan général. D'ailleurs, à supposer qu'un tel plan existe, il n'aura pas beaucoup retenu l'attention du romancier, et il ne pourra pas, compte tenu de la longueur du récit, être embrassé d'un coup d'œil par le lecteur.
Certains phénomènes appartenant au registre des sciences naturelles ont une correspondance vraiment prodigieuse avec ceux du monde de la pensée. Et pour cette raison, ils semblent justifier le dogme rhétorique – d'ailleurs erroné – selon lequel la métaphore ou la comparaison peut servir à consolider une argumentation, tout comme elle embellit un passage descriptif. Par exemple, le principe de la force d'inertie proportionnelle au mouvement subi par un corps, semble de la même manière s'appliquer à la physique et à la métaphysique. Car, s'il est vrai qu'une masse importante est plus difficilement mise en branle qu'un objet d'un poids inférieur et que la vitesse acquise alors se rapporte à la résistance vaincue ; il est également vrai que les intellects ayant de grandes capacités, les intelligences plus vigoureuses, plus constantes et qui jouissent d'une amplitude de mouvement dépassant celle des autres, se remuent le moins aisément, étant plus embarrassées et plus hésitantes dans les tout premiers moments de leur impulsion.
Thomas Moore, le plus habile littérateur de son temps et peut-être bien de tous les temps, est la victime du malheur singulier et vraiment merveilleux de se trouver sous-estimé en raison de la profusion avec laquelle il a répandu tant de beautés alentour. La perfection de n'importe quelle page de Lalla Rookh aurait déjà suffi à établir sa renommée, qui, dans une grande mesure, s'est vue diminuer par l'éclat constellé du livre tout entier. Il semblerait que les lois horribles de l'économie politique n'épargnent pas même les gens inspirés ; et qu'une versification impeccable, un style vigoureux, une infatigable imagination, par l'abondance de leur emploi en arrivent à perdre toute valeur à nos yeux, de même que nous n'attachons guère de prix à l'eau que nous buvons, mais qui n'en reste pas moins nécessaire à la vie.
L'art de M. Dickens, bien que raffiné et considérable, paraît s'en tenir à une belle modification de la Nature. À cet égard, il diffère sensiblement de Bulwer, l'auteur de Nuit et Matin. Celui-ci, par un soin excessif et une réflexion patiente, aidée d'une grande science de la rhétorique et d'une vaste érudition, s'est rendu capable d'écrire des livres que quatre-vingt-dix-neuf lecteurs sur cent prendraient pour l'inspiration naturelle du génie. Celui-là, en subissant les exaltations du génie le plus authentique, a été amené à composer – évidemment sans effort – des œuvres au succès durable qui lui ont valu l'admiration populaire, en même temps qu'elles défient et qu'elles enchantent les critiques. M. Bulwer, par l'art, a pratiquement créé du génie ; M. Dickens, par le génie, a perfectionné un canon à partir duquel l'art lui-même déduira ses règles essentielles.
Defoe aurait largement mérité une gloire immortelle, même s'il n'avait pas écrit Robinson Crusoé ; mais bien qu'excellents, ses nombreux ouvrages ont perdu tout leur lustre, à côté du sublime éclat des aventures du marin d'York. Quelle meilleure réputation l'auteur aurait-il pu souhaiter pour son livre que celle dont il jouit déjà depuis longtemps ? Son roman est devenu le bien commun de toutes les familles de la chrétienté. Or, jamais l'admiration d'aucune œuvre, l'admiration universelle, ne fut accordée avec moins de compétence et de discernement. Il n'est pas une personne sur dix, que dis-je ! pas une personne sur cinq cents, à qui viendrait l'idée, en lisant Robinson Crusoé, qu'une once de génie ou même de talent moyen, ait participé à sa création ! Les gens ne le considèrent pas comme une prouesse littéraire. Defoe n'attire aucunement leurs pensées – Robinson les a toutes. Un voile obscur a recouvert la puissance dont cette merveille résulta, du fait, justement, du caractère éblouissant de cette merveille. Nous lisons, et pendant ce temps nous faisons totalement abstraction du reste, pour nous laisser captiver par cette intensité d'intérêt ; quand nous refermons le livre, nous nous flattons en imaginant qu'aussi bien nous eussions été capables de l'écrire nous-mêmes. Tout cela découle du pouvoir magique accordé à la vraisemblance. En effet, celui qui a écrit Robinson possédait nécessairement, plus que toute autre faculté, cette capacité d'identification, qui consiste à dominer son imagination par l'exercice de la volonté, et qui permet à l'esprit de s'abandonner pour laisser éclore une individualité fictive. La capacité d'abstraction, à son plus haut degré, occupe une large part de ce processus ; et cette clé nous permet en partie d'expliquer le charme mystérieux accolé de longue date au volume que nous avons présentement sous les yeux. Toutefois, n'allons pas croire que cela suffise à fournir une analyse exhaustive de l'intérêt que nous lui portons. Defoe doit beaucoup à son sujet même. L'idée d'un homme vivant dans un état d'isolement complet, quoique souvent émise auparavant, n'avait alors jamais été développée de manière aussi convaincante. La fréquence avec laquelle cette idée revenait dans les pensées des hommes attestait l'étendue de son influence et de la sympathie qu'elle pouvait susciter ; tandis que l'absence de tentative allant dans le sens d'une mise en forme de cette conception prouve à quel point l'entreprise était difficile. Enfin, l'histoire véritable de Selkirk 86, en 1711, et la profonde impression qu'elle laissa dans l'esprit du public insufflèrent à Defoe non seulement le courage nécessaire à l'accomplissement de son œuvre, mais aussi la confiance la plus entière dans le succès qu'elle devait rencontrer. Pour quel prodigieux résultat !
La moitié du plaisir éprouvé au théâtre découle de la communauté d'émotions du spectateur avec l'ensemble de l'auditoire, et, plus particulièrement, de l'idée que le reste du public est en sympathie avec lui. Le gentleman excentrique qui se trouva, il n'y a pas très longtemps, l'unique occupant des loges, du parterre et des galeries du théâtre du Park, n'aurait tiré que bien peu d'agrément de sa visite, s'il lui avait été permis de la prolonger. Ce fut un acte de charité que de l'en expulser. La vogue absurde, enragée, que rencontrent aujourd'hui les lectures publiques repose entièrement sur ce sentiment. Nous arrivons à tolérer et parfois, hélas ! à applaudir, à leur dixième ou leur vingtième répétition, des essais que nous ne lirions pas même en étant payés, sur des sujets si rebattus et traités avec tellement d'indigence que n'importe quelle encyclopédie de la chrétienté nous fournirait une meilleure information, uniquement à cause de l'influence exercée par cette sympathie pour la foule. De même, nous nous laissons conter une histoire avec d'autant plus d'enthousiasme que d'autres personnes l'écoutent avec nous. Sachant cela, des auteurs peu réfléchis tentèrent d'intégrer ce charme à leurs histoires, en y plaçant artificiellement un cercle d'auditeurs. À première vue, l'idée semble assez judicieuse. Mais, dans la vraie vie, il y a une sympathie effective, personnelle et palpable, qui passe par des regards, des gestes, des commentaires ; une sympathie entre des individus réels, qui suppose un attrait pour le même thème, et, à plus forte raison, l'intérêt de chacun envers tous. Dans le cas d'une œuvre d'imagination, nous sommes censés sympathiser tout seuls, dans notre cabinet de lecture, avec des auditeurs fictifs qui, loin d'être physiquement présents, sont aussi fréquemment bannis de nos pensées pendant deux ou trois cents pages. C'est une sympathie doublement atténuée : l'ombre d'une ombre. Est-il besoin de préciser qu'un tel dispositif manque invariablement son effet ?
En littérature, l'originalité des caractères – ou ce qu'on a coutume de désigner ainsi – ne peut être à bon escient louée par la critique que lorsqu'ils présentent des qualités reconnues dans la vraie vie mais qui n'ont pas encore été dépeintes, ce qui n'arrive pratiquement jamais ; ou bien, lorsqu'ils présentent des qualités morales et physiques, qui, bien qu'ignorées ou tenues pour hypothétiques, s'adaptent aux circonstances avec assez d'habileté pour que l'ensemble nous paraisse harmonieux. Et, tout en les sachant fictives, nous nous demandons alors pourquoi ces qualités n'existeraient pas dans les faits. Cette dernière sorte d'originalité appartient aux régions les plus élevées de l'Idéal.

Chapitre de suggestions
CHAPITRE DE SUGGESTIONS
(Décembre 1844)
DANS la vie de chaque homme, il survient au moins une époque où l'esprit semble un court moment se détacher du corps, et, s'élevant au-dessus des préoccupations mortelles, au point d'en avoir une vue compréhensive et générale, apporte en toutes circonstances une appréciation de son humanité, aussi exacte que possible, à cet esprit particulier. L'âme ici se sépare de sa propre idiosyncrasie ou individualité, et considère son être non plus comme sa possession exclusive, mais également comme une portion de l'être universel. Toutes les bonnes résolutions importantes que nous prenons – toutes les régénérations du caractère, marquées dans un sursaut – n'interviennent qu'à de telles crises de la vie. Et c'est ainsi notre sentiment du moi trop aigu qui nous rabaisse et nous conserve au rang d'êtres déchus 87.
La théorie de la chance ou, comme disent les mathématiciens, le calcul des probabilités a cette particularité remarquable que sa vérité en général est en proportion directe de son inexactitude en particulier 88.
On devrait pouvoir juger du degré d'abstraction d'un homme en train de méditer par la manière dont il réagit, lorsqu'on vient à l'interrompre. S'il est très surpris, sa rêverie n'était pas profonde, et inversement. Aussi, l'affectation de la cohorte des faux distraits n'est-elle plus un mystère. Ces gens-là s'éveillent brusquement de leurs songes avec un air de confusion, comme quand on sort naturellement des rêves ayant une forte semblance de réalité. Mais, de toute évidence, ils ignorent que les phénomènes oniriques diffèrent radicalement de ceux de la rêverie, dont la condition magnétique est l'extrême.
La plupart des penseurs constateront avec étonnement, en examinant rétrospectivement le monde de la pensée, que les impressions premières ou résultant d'une intuition, très souvent, furent les bonnes. Un poème, par exemple, nous ravit pendant notre enfance. À l'adolescence, nous lui trouvons quantité de défauts. Dans les premières années de l'âge adulte, nous le méprisons et le condamnons sans appel. Et ce n'est pas avant que la maturité n'ait donné le ton à nos sensations, élargi notre connaissance et parfait notre compréhension, que nous revenons au sentiment qui fut initialement le nôtre, ainsi qu'à notre admiration première, avec le plaisir supplémentaire découlant toujours du fait de savoir comment il nous avait plu jadis, et pourquoi nous l'admirons encore.
Qu'il y ait une injustice à ne pas considérer l'imagination comme la reine des facultés mentales, c'est ce que prouve la conscience aiguë qu'a l'homme imaginatif du fait que ladite faculté conduit souvent son âme jusqu'à l'aperçu de choses surnaturelles et éternelles – jusqu'à l'extrême limite des grands secrets. En effet, il arrive à sentir par moments les parfums diffus et à entendre les mélodies d'un monde plus heureux. Quelques-unes des connaissances les plus profondes – peut-être toutes les connaissances très profondes – ont été le fruit d'une imagination hautement stimulée. Les grands intellects devinent avec justesse. Les lois de Kepler ont été, de son propre aveu, devinées 89.
On pourrait écrire un excellent article au sujet des étapes successives à travers lesquelles n'importe quelle grande œuvre d'art, plus particulièrement d'art littéraire, parvient à son achèvement 90. Quelle vaste dissemblance il y a toujours entre le bourgeon et la fleur, entre l'œuvre faite et sa première conception ! Quelquefois, la conception originelle est abandonnée ou totalement perdue de vue. La plupart des auteurs s'installent pour écrire sans avoir de dessein bien arrêté, croyant à l'inspiration du moment ; il n'y a donc pas à s'étonner que la plupart des livres soient sans intérêt. La plume ne devrait jamais attaquer le papier sans qu'un but général et bien mûri n'ait été au moins défini. Dans la fiction, le dénouement – dans toute autre composition, l'effet recherché – devrait obligatoirement être examiné et fixé, avant d'écrire un seul mot. Et aucun mot ne devrait alors être écrit s'il ne tend pas, ou s'il ne participe pas d'une phrase qui tend au développement du dénouement et à la consolidation de l'effet. Là où l'intrigue constitue une partie de l'intérêt qu'on veut susciter, on ne saurait agir avec trop de précautions. L'intrigue est une chose très imparfaitement comprise et n'a jamais été convenablement définie. Beaucoup de gens la considèrent comme un pur enchevêtrement d'incidents. Dans son acception la plus stricte, elle est cette forme au sein de laquelle aucun atome qui la compose ne peut être enlevé, et dans laquelle aucun atome qui la compose ne peut être déplacé sans en détruire le tout. Et quoiqu'une assez bonne intrigue puisse être élaborée sans qu'on respecte cette définition dans toute sa rigueur, c'est malgré tout la définition que le véritable artiste devrait toujours avoir à l'esprit, et toujours s'efforcer d'accomplir dans ses ouvrages. Certains auteurs paraissent néanmoins totalement déficients du point de vue de la construction, et dès lors, même s'ils excellent en invention, échouent manifestement sur le plan de l'intrigue. Dickens appartient à cette catégorie ; son Barnaby Rudge 91 n'atteste aucune habileté dans l'adaptation. Godwin et Bulwer sont les meilleurs constructeurs d'intrigues de la littérature anglaise. Godwin a donné une préface à son Caleb Williams 92 où il dit que le roman a été écrit à rebours ; l'auteur ayant d'abord achevé son deuxième tome, au cours duquel le héros était engagé dans un labyrinthe de difficultés, puis recherché des causes suffisamment plausibles afin de justifier ces difficultés, d'où découlerait la matière du tome premier. Ce procédé ne peut assurément pas être recommandé, mais il prouve l'idiosyncrasie de l'esprit de Godwin. Le Pompéi de Bulwer est un exemple d'intrigue admirablement menée. Son Soir et Matin sacrifie à la pure intrigue des intérêts d'une bien plus grande importance.
Tous les hommes de génie ont leurs détracteurs ; mais ce serait faire une fausse distribution du terme moyen de déduire, partant de là, que tous ceux qui ont des détracteurs sont des hommes de génie. De toutes les choses méprisables, l'individu ayant coutume de persifler à propos de la vraie grandeur est, sans conteste, la plus vile. Quels sont les noms qui excitent, au sein de l'humanité, le plus indicible, le plus insupportable dégoût ? Les Dennis, les Fréron, les Desfontaines 93. Leur bassesse est mesurable à la grandeur de ceux qu'ils ont insultés. Et cependant, en face d'un principe aussi naturel et bien connu, il existera toujours une bande d'homoncules avides de se faire un nom par l'opiniâtreté avec laquelle ils jappent aux talons des êtres d'élite. Or cette avidité, qu'aucune leçon tirée de l'expérience du monde ne parvient à réprimer, relève moins souvent d'une incapacité à apprécier le génie, que d'une espèce d'antipathie à son encontre, comme il en existe entre chiens et chats.
La perception intuitive, apparemment fortuite, par laquelle nous accédons bien souvent à la connaissance, au moment où la raison faiblit, abdiquant tout effort, est assez semblable au coup d'œil jeté furtivement vers une étoile, par lequel nous la voyons plus clairement que si nous dirigions notre point de vue en plein sur elle ; ou, à la façon dont nous gardons les yeux mi-clos, à la vue d'un gazon, pour en apprécier plus pleinement la couleur 94.
Certains hommes, doués d'une sensibilité particulière qui constitue la racine du génie, ont manqué d'accroître notablement leur énergie mentale, dans leur jeunesse, en vivant trop vite. Et, des années après, ils sont pris d'une envie irrépressible de stimuler leur imagination jusqu'au point qu'elle aurait dû atteindre, en menant une vie ordinaire et normale – ou qui fût bien réglée. Aussi, cet appétit prononcé pour des états d'excitation artificielle qui, hélas ! a caractérisé tant de personnages éminents, doit être envisagé comme un besoin, une nécessité psychique, – un effort consistant à recouvrer ce qui a été perdu, – un conflit où l'âme cherche à s'arroger la position qui, dans d'autres circonstances, aurait légitimement dû être la sienne.
De la grande variété d'expression mélodique offerte par les touches d'un piano, des mains suffisamment compétentes devraient pouvoir faire le support d'un excellent conte de fées. Que le poète appuie posément son doigt sur chaque note, et la laisse enfoncée, tandis qu'il imagine toutes les séries d'ondulations prolongées que l'histoire, faite de joie ou de tristesse, racontée par un esprit bon ou maléfique y a enfermées. Il arrive que certaines notes relatent presque, d'elles-mêmes, d'authentiques et d'intelligibles histoires.
Un homme précis et clair, dans la conversation ou la composition, jouit conséquemment d'un très gros avantage, plus particulièrement en matière de logique. Lorsqu'il fait une démonstration, la personne à qui il s'adresse, puisqu'elle le comprend avec exactitude, pour cette raison et bien souvent pour cette raison seule, s'accorde avec lui. Peu d'esprits, en réalité, peuvent immédiatement saisir la distinction qui existe entre la compréhension d'une proposition et l'approbation raisonnée du contenu même de cette proposition. Étant satisfait d'avoir compris, nous nous en réjouissons couramment au point de trouver naturel d'acquiescer. Les auteurs limpides peuvent ainsi se livrer durablement à de purs sophismes, sans qu'on s'en aperçoive jamais. Macaulay 95 offre un remarquable exemple de cette sorte de mystification. Nous convenons trop souvent de ce qu'il écrit en raison de la manière extrêmement distincte avec laquelle nous percevons le sens de ce qu'il cherche à dire. Son essai sur Bacon a longtemps et à juste titre été admiré ; or, ses derniers chapitres – où il s'évertue à dénigrer le Novum Organum – quoique logiques à l'excès, sont au plus haut point irrationnels. Mais gardons-nous de toute affirmation gratuite, et voyons le compte rendu que fait ce grand essayiste de L'Histoire de la papauté de Leopold von Ranke. Il déploie toute son énergie à justifier le renforcement de l'Église romaine en soutenant que la théologie n'est pas une science progressive. “Les énigmes, dit-il en substance, qui confondent le théologien naturel 96 sont les mêmes à chaque époque, tandis que la Bible, où il nous est seulement donné de chercher la vérité révélée, fut toujours la Bible.” Ici, Macaulay confond la nature de cette preuve à partir de laquelle nous raisonnons sur la Terre, considérée comme l'habitat de l'Homme, avec celle en vertu de quoi nous raisonnons à propos de la même Terre, envisagée cette fois comme une partie de l'Univers. Dans le premier cas, la donnée étant palpable, la preuve est directe, alors que dans le second cas elle repose entièrement sur l'analogie. Si les indications que nous tirons de la science, sur la nature et les intentions de la Divinité, et par conséquent, sur la destinée de l'homme – si ces indications étaient prouvées directement, il est parfaitement exact qu'aucune avancée dans les sciences ne les consoliderait davantage ; car, comme le fait justement observer Macaulay, “on ne saurait rien ajouter à la force d'un argument que l'esprit retrouve partout, dans chaque animal, dans chaque oiseau, dans chaque fleur”. Mais, puisque ces indications sont strictement analogiques, chaque étape de la connaissance humaine, chaque découverte astronomique, en particulier, apporte un éclairage additionnel sur cette question majeure en accroissant le champ de l'analogie. Il est monstrueusement absurde d'alléguer que nous n'en savons pas plus qu'il y a seulement douze ans sur la nature de la Divinité, sur ses desseins, et partant sur la nature de l'Homme lui-même. “Si la Physique, dit un plus grand esprit que Macaulay, doit continuer à se développer dans ses multiples domaines, les bornes de la philosophie morale elles aussi reculeront.” Ces paroles prophétiques de Newton sont, d'ores et déjà, ressenties comme vraies – et elles se réaliseront.

Cinquante suggestions
CINQUANTE SUGGESTIONS
(mai-juin 1849)
À mon sens, “aimer nos ennemis”97 implique que nous détestions nos amis.
D'une grande partie de notre architecture campagnarde, je crois que l'on peut avancer avec certitude – rendant justice à une noble intention – qu'elle eût été gothique, si elle n'avait pas cru de son devoir de paraître hollandaise 98.
Ces bourses effroyablement longues, pareilles à des concombres géants, qui sont à la mode chez nos belles, n'ont pas, comme beaucoup se plaisent à le croire, une origine parisienne ; elles sont strictement indigènes. Le fait est qu'une telle mode apparaîtrait fort déplacée à Paris, où une femme ne tient dans sa bourse que de l'argent. Alors que le porte-monnaie d'une Américaine doit être assez spacieux, pour contenir non seulement tout l'argent, mais aussi toute l'âme de sa propriétaire 99.
Les enfants ne sont jamais trop délicats pour qu'on les fouette. Comme ces biftecks un peu fermes, plus on les bat plus ils sont tendres.
Que les poètes (ce terme étant employé dans son acception la plus large, incluant les artistes en général) soient une race irritable 100, voilà une chose entendue ; mais le pourquoi ne semble pas si généralement compris. Un artiste n'est un artiste qu'en raison de son sens exquis du Beau – sens qui lui procure des jouissances enivrantes, mais qui en même temps implique ou entraîne un sens tout aussi exquis de la difformité, de la disproportion. C'est pourquoi un tort, une injustice faite à un poète vraiment digne de ce nom, l'excite à un point qui paraîtra disproportionné au jugement ordinaire. Les poètes voient l'injustice – jamais là où elle n'existe pas – mais bien souvent là où un regard non poétique n'en voit pas du tout. L'irritabilité des poètes n'a donc pas de rapport avec le tempérament pris dans son sens vulgaire, mais avec une clairvoyance hors du commun à l'endroit de ce qui est faux et injuste – cette clairvoyance n'étant rien d'autre qu'un corollaire de la vive perception du vrai, de la justice, de la proportion, en un mot du Beau. Mais une chose est claire, c'est que l'homme qui n'est pas, au jugement du commun, irritable n'a rien d'un poète.
Qu'un homme parvienne à disposer du génie le plus évident, le plus démontrable, sous plusieurs de ses différents aspects, et l'envie de la critique tombera d'accord avec l'opinion du peuple pour lui refuser plus que du talent dans aucun. Aussi, un poète ayant su composer quelque grand poème (j'entends par là un poème efficace) devrait-il avoir soin de ne jamais s'illustrer dans un autre domaine. En particulier, qu'il ne s'avise point de faire d'effort dans les sciences 101 – si ce n'est en gardant l'anonymat ou avec l'intention d'attendre patiemment le jugement de la postérité. Comme on n'a que rarement, si ce n'est jamais connu de génies universels ou même diversement habiles, c'est donc qu'il ne pourra jamais en exister ; ainsi pense le monde, avec qui ce genre de donc est rédhibitoire. Mais quels sont les faits, d'après ce que nous enseigne une analyse des forces mentales ? Simplement, que le génie le plus élevé – le génie que tous les hommes reconnaissent immédiatement pour tel – celui qui agit sur les individus comme sur les foules, par une espèce de magnétisme incompréhensible et, en dépit de cela, littéralement irrésistible – que ce génie qui s'exprime dans le plus simple geste ou même en l'absence de tout geste – le génie qui parle sans voix, qui brille même sous une paupière encore fermée – n'est que le résultat d'une grande puissance mentale uniformément répartie, à l'état de proportion absolue, de manière à ce qu'aucune faculté ne l'emporte sur les autres. Le faux génie – le “génie” au sens courant – qui n'est que la manifestation de la prédominance anormale d'une faculté sur toutes les autres, au détriment de celles-ci, résulte d'un déséquilibre mental ou plutôt d'une difformité de l'organe de la pensée. Cela et rien de plus. Non seulement un tel génie échouera, s'il est détourné du chemin que lui trace cette faculté maîtresse, mais même en suivant sa voie, lorsqu'il s'adonnera aux exercices pour lesquels son penchant devrait lui assurer le succès, il montrera des signes incontestables de défectuosité, quant à la conformation globale de son esprit. D'où provient, en effet, la justesse de cette assertion : Un grand esprit touche de près à la folie 102. Je parle de justesse car un grand esprit, dans ce cas, désigne exactement sous la plume de Dryden le pseudo-génie dont il vient d'être question. Le vrai génie, en revanche, s'il n'est universel dans ses manifestations, est nécessairement capable d'universalité ; et si, parmi toutes ses tentatives, il a plus de succès dans certaines que dans d'autres, ce n'est qu'en raison d'une inclination particulière, par laquelle son goût l'amène à suivre préférablement telle voie plutôt que telle autre. Avec un zèle égal, il réussirait tout aussi bien dans chacune.
Pour conclure notre examen de cette question fort simple et, néanmoins, souvent débattue : ce que l'on nomme génie est un état de déséquilibre mental causé par la prédominance néfaste d'une faculté quelconque sur les autres. Les ouvrages de ce type de génie ne sont jamais sains, et ils trahissent toujours le défaut de constitution général de cet esprit. La juste proportion des facultés mentales, quand leur puissance n'est pas extrême, produit ce que nous appelons le talent. Celui-ci est plus ou moins grand, selon que la capacité mentale est plus ou moins importante, et selon que les facultés mises en jeu s'équilibrent à un degré plus ou moins absolu. La proportion des facultés mentales, quand la puissance en est extrême, donne ce que nous appelons le vrai génie – bien qu'il soit rarement reconnu comme tel, en raison du caractère harmonieux et de l'apparente simplicité de ses œuvres. Ce génie est plus ou moins grand, selon que ses capacités mentales sont plus ou moins extraordinaires, et selon que les facultés mises en jeu s'équilibrent à un degré plus ou moins absolu.
On objectera que la plus grande démesure dans la puissance mentale, même bien proportionnée, ne semble pas satisfaire à notre idée du génie, à moins que ne vienne s'y greffer la sensibilité, la passion, l'énergie. Or, l'absolue proportion dont nous venons de parler, lorsqu'elle s'applique à des capacités extrêmes induit, de fait, l'amour du Beau et la répulsion pour la Difformité que nous nommons sensibilité ; de même que cette vitalité intense, suggérée par les termes d'Énergie ou de Passion.
Le monde est infesté actuellement par une nouvelle secte de philosophes, qui ne se savent pas encore former une secte, et qui, en conséquence, n'ont adopté aucun nom. Ce sont les Croyants en toute Bizarrerie. Leur Grand Prêtre, dans l'Est, est Charles Fourier – dans l'Ouest, Horace Greeley 103 ; et grands prêtres, ils le sont à dessein. Le seul trait commun parmi leur secte est la Crédulité : appelons cela Démence, et n'en parlons plus. Demandez à n'importe lequel d'entre eux pourquoi il croit ceci ou cela, et s'il est consciencieux (les ignorants le sont généralement), il vous fera une réponse très semblable à celle de Talleyrand, lorsqu'on lui demanda pourquoi il croyait à la Bible. “J'y crois, déclara-t-il, premièrement parce que je suis évêque d'Autun ; et ensuite, parce que je n'y entends absolument rien.” Ce que ces philosophes nomment argument est une manière qu'ils ont “de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas 104”.
Il est à peine plus assuré qu'une cause engendre un effet que de constater qu'en morale la répétition d'un effet tend à la génération d'une cause. C'est là le principe que ce que nous nommons si vaguement l'habitude.
En louant la Beauté, le Génie ne fait qu'exprimer de l'amour filial. Au Génie, la Beauté donne la vie et, bien souvent, quelque gratification dans l'Immortalité.
Aimer, dit Spenser, c'est : “Flatter, s'infléchir, attendre, chevaucher, courir, – Dépenser, donner, vouloir, se perdre 105.” La portée philosophique de ces vers pourrait être accrue grâce à la simple omission d'une virgule. L'aveuglement consenti, la folie volontaire de l'amour sont des choses connues de tous. C'est ce que nous exprimons en modifiant la ponctuation de la sorte : Dépenser, donner – vouloir se perdre. Bref, ici, l'on marque un point en oubliant justement d'en mettre un.
Je commence à penser comme Horsley 106 que le peuple n'a rien à faire avec les lois, si ce n'est de leur obéir.

Notice
NOTICE
LE corpus des fragments d'Edgar Poe a été établi de façon complète et définitive par Burton R. Pollin, dans le volume intitulé The Brevities : Pinakidia, Marginalia, and Other Works, Gordian Press de New York, en 1985 ; c'est à cette édition que nous nous sommes référé pour effectuer notre choix. Les Marginalia dont nous proposons une sélection, qui ne retient que quatre-vingt-dix-sept entrées sur deux cent quatre-vingt-onze, ont été publiés en dix-sept livraisons, dans plusieurs revues américaines de 1844 à 1849, soit pendant les dernières années de la vie d'Edgar Poe. À ceux-ci s'ajoutent quelques marginalia supplémentaires, réunis après la mort de leur auteur. Le début de cette période est également marqué par la publication d'un ensemble assez bref, A Chapter of Suggestions, donné ici pour la première fois en français ; sa fin, par les Fifty Suggestions, à l'intérieur desquelles nous opérons un choix qui n'en conserve qu'un cinquième. Ces textes ont essentiellement intéressé Baudelaire – qui en cite quelques passages dans les Notes nouvelles sur Edgar Poe, et s'en est inspiré pour ses projets d'écrits intimes – puis Valéry, traducteur d'un petit nombre d'entre eux. Bien que l'idée de constituer un volume à partir des marginalia ne lui fût pas étrangère, pas plus que les autres recueils, en français, des contes ou poésies d'Edgar Poe, cet assemblage d'extraits ne résulte d'une élaboration de leur auteur. Au moins l'ordre chronologique est-il respecté ; mais, chose importante à noter, le choix des textes traduits ne s'autorise scientifiquement que des préférences qui sont les nôtres. Beaucoup de passages ont été écartés en raison de leur caractère trop anecdotique, et, parfois, les développements les plus longs furent abrégés pour n'en garder que la partie la plus dense.
Les fragments réunis dans ce volume peuvent être groupés en quelques catégories, nullement exhaustives. Ce sont des notes de lectures, des analyses sur l'art de la fiction, la philosophie, la morale, les sciences, le langage, les difficultés que rencontre l'artiste – et plus encore le “génie” – dans une société où il n'a pas sa place et qui s'accommode assez mal de sa pitoyable existence. Ainsi, passant de la louange à l'insulte, de la théorie littéraire au sarcasme et de l'aveu à la provocation, Edgar Poe traite un grand nombre de sujets d'une manière piquante et, dans bien des cas, lumineuse. On a dit que certains textes étaient des réécritures, voire des citations de passages d'articles ou de nouvelles antérieurs, pour insister sur la difficile condition d'un écrivain payé à la copie. Or, s'il est vrai qu'Edgar Poe fut amené, par la nécessité, à faire ponctuellement du remplissage, il faut avant tout rappeler la qualité de ces extraits. Sa façon d'isoler quelques phrases, afin de les mettre en valeur dans un contexte où se révèlerait d'autant mieux leur éclat, prouve au moins l'importance que Poe y accordait. À ce titre, découvrir les marginalia nous invite à passer derrière le rideau des histoires extraordinaires, en étant mieux informés sur les circonstances, assez tourmentées, de leur écriture.
Nul doute que Poe, de son vivant, ait souffert d'un grand manque de reconnaissance. La réception des contes aux États-Unis fut globalement décevante, pour ne rien dire de celle des poésies. Certaines pages proposées ici au lecteur lui permettront de s'en faire indirectement une idée. Toutefois, la renommée acquise aujourd'hui par quelques aspects de son œuvre en a peut-être occulté la véritable richesse. Peu de gens sont capables de citer le contenu des Histoires grotesques et sérieuses ; et plus rares encore sont ceux qui connaissent Eurêka, chef-d'œuvre où la réflexion menée par Poe, sur le rapport entre la poésie et l'univers, atteint sa forme définitive. On aurait tort d'assimiler Poe à un seul genre littéraire, dont il n'a d'ailleurs cessé de ridiculiser les clichés : la nouvelle horrifique. Car son imagination culmine à des places extrêmement éloignées les unes des autres. Il suffit pour s'en convaincre de voir la multiplicité des voies empruntées par ses successeurs. De Valéry à Borges, de Jules Verne à Julien Gracq, de Stevenson à Conan Doyle et de Mallarmé à Debord, ceux qui en ont tiré le plus grand profit n'ont pas lu les mêmes textes.
Dans un tel livre, rien n'est fait pour encourager la paresse du lecteur. En premier lieu parce qu'Edgar Poe fut un grand sceptique et un redoutable mystificateur ; ensuite parce qu'on ne saisit pas toujours l'unité de ces pages décousues, de ces annotations disparates ou désordonnées, qui sont autant de suggestions – dans tous les sens du terme – et dont l'essentiel pour chacun reste à imaginer. On peut bien entendu être en désaccord avec les opinions, les arguments qu'avance Edgar Poe, – ne pas le rejoindre dans une certaine propension à l'idéalisme, – et par moments, lui reprocher de faire des épigrammes alors qu'il fustige impitoyablement ce travers chez tant d'autres. En dépit de ces réserves, ce qui frappe immédiatement c'est cette intelligence en éveil ; cet esprit analytique et soucieux d'exactitude qui va souvent à l'encontre des idées reçues ; cette position unique entre la poésie et les mathématiques, qui rend l'œuvre de Poe étonnamment complexe et novatrice. Dès lors, tout est mis en œuvre pour dénoncer les formules creuses, les petites et les grandes impostures, les erreurs d'interprétations, les fautes de goût et les talents usurpés qui traduisent le manque de discernement du public. Voilà comment, non sans ironie, se mêle un art du trait, de la remarque incisive, à une imagination ardente et un sens aigu de la critique. Mais l'écrivain est aussi journaliste, et si le format exigé par la presse ne lui permet pas de faire des marginalia l'exposé le plus approfondi de sa poétique, on ne saurait trop insister sur l'étendue de la palette que ces textes nous offrent.
Les fragments d'Edgar Poe donnent un très bon aperçu des goûts, des lectures, des jugements philosophiques ou artistiques qui furent les siens, sans omettre également tous les concepts fondamentaux de sa théorie littéraire : composition, brièveté, unité d'effet, réciprocité d'adaptation. On observera son souci permanent d'originalité ; son besoin de justification, qui est la contrepartie d'une “poétique de l'effet” plaçant la volonté au centre du système, fût-elle perverse ; et la mélancolie avec laquelle, aux pires heures de son existence, il dresse un portrait du “génie” censé satisfaire son orgueil. Il y a, chez Poe, une conception arithmétique, exponentielle de l'infini, en relation avec l'accroissement des facultés mentales, l'augmentation des connaissances, le perfectionnement moral de l'Homme et l'affinement des procédés qui concourent à la plus haute forme de jouissance esthétique. Toutes choses qui relèvent à la fois du scientisme et du spiritualisme associés à son idée de la musique. Telles sont les ambivalences d'un rationaliste rêveur, dont l'espérance est encore tournée vers une autre vie, éternelle. Le lecteur avisé ne manquera pas d'y reconnaître un signe des temps, et d'y accorder toute l'attention qu'il mérite. Ce paradoxe à renverser, à remettre sur ses pieds, garde une importance historique à peu près décisive, si l'on pense que d'autres auteurs, ayant puisé leur inspiration chez Poe, sauront justement rendre ses droits à la matière.
LIONEL MENASCHÉ

Du même auteur
Du même auteur aux éditions Allia
About & Around Marginalia

Crédits
© Éditions Allia, Paris, 2007, 2016, pour la traduction française.

Achevé de numériser
Marginalia de Edgar Allan Poe
a paru aux éditions Allia en février 2007.
ISBN :
979-10-304-0449-4
ISBN de la présente version électronique :
979-10-304-0447-0
Éditions Allia
16, rue Charlemagne
75 004 Paris

Notes
NOTES
1. Malgré les apparences, cette introduction n'a rien d'un témoignage authentique : Poe avait pour habitude de ne presque jamais annoter ses ouvrages.
2. Jeremy Bentham (1748-1832), philosophe et jurisconsulte anglais, fondateur de l'utilitarisme moral ; James Mill (1773-1836), historien, philosophe et économiste anglais, père de John Stuart Mill et disciple de Bentham.
3. La citation exacte est tirée des Études de Bernardin de Saint-Pierre (ch. 14) : “J'ai éprouvé bien des fois que l'on oublie ce qu'on écrit. Ce que je mets sur le papier, je l'ôte de ma mémoire, et bientôt de mon souvenir”.
4. Jeremy Taylor (1613-1667), théologien anglais ; Sir Thomas Brown (1605-1682), écrivain et médecin anglais ; Sir William Temple (1628-1699), historien et philosophe anglais ; Robert Burton (1577-1640), essayiste anglais, auteur de l'Anatomie de la mélancolie ; Joseph Butler (1692-1752), prédicateur et théologien anglais, auteur de l'Analogie de la religion naturelle et révélée avec la constitution et le cours de la nature.
5. Lycophron, dit le Ténébreux (~ 285– ~ 247), poète tragique dont le seul poème qui nous soit parvenu, Alexandra, est réputé pour son obscurité.
6. L'abbé Giovanni Vincenzo Gravina (1664-1718), jurisconsulte et écrivain italien. Cette même idée sera développée par Poe dans Le Principe poétique.
7. Recueils d'essais théologiques, publiés entre 1833 et 1840.
8. Ce sera l'idée maîtresse d'Eurêka.
9. Allusion à Mesure pour mesure, où le bouffon déclare (IV, 3) : “You must be so good, sir, to rise and be put to death.”
10. Le baron Jacob de Bielfeld (1717-1770) est un auteur allemand d'expression française. Cette citation, empruntée aux Premiers Traits de l'érudition universelle (1767), reviendra souvent sous la plume d'Edgar Poe. Dans la version originale, il est écrit : “Nous ne connaissons rien de la nature ou de l'essence de Dieu ; – pour savoir ce qu'il est, il faut être Dieu même”.
11. La source originale de ce passage est probablement la biographie du philosophe Apollonius de Tyane (1er siècle ap. J.-C.) par Philostrate, au IIIe siècle. D'autre part, ce n'est pas une pyramide mais une des fameuses statues d'Aménophis III, situées à Thèbes, qui produit un son résultant de la dilatation du quartzite sous l'effet des premiers rayons du soleil.
12. Voir les articles “Autography” et “A Chapter on Autography” portant sur le même sujet.
13. Roi légendaire, fondateur de Thèbes et connu pour avoir introduit l'alphabet phénicien en Grèce.
14. Référence au Novum Organum (1620) de Francis Bacon sur les causes de l'erreur humaine.
15. Cette idée figure aussi dans le Colloque entre Monos et Una.
16. Louis Sébastien Mercier (1740-1814), dramaturge, essayiste et romancier français.
17. Cette remarque est cruciale pour saisir le rapport existant, chez Poe, entre Le Démon de la perversité et La Genèse d'un poème.
18. À propos du Livre de Jonas, traduit en hexamètres allemands par J.G.A. Müller. Publié dans les Memorabilien von Paulus. (N.d.A.)
19. Référence à Isaac Newton.
20. À propos de Nuit et Matin, de Bulwer Lytton. (N.d.A.)
21. Edward Bulwer-Lytton (1803-1873), écrivain anglais.
22. Dans sa première version de L'Art du conte, Poe accusait injustement Hawthorne d'avoir plagié William Wilson.
23. Maria Taglioni (1804-1884), danseuse de ballet italienne, adulée à travers toute l'Europe jusqu'à la fin de sa carrière, en 1847.
24. Maria Felicia Malibran (1808-1836), célèbre cantatrice française d'origine espagnole, dont la mort prématurée inspira des Stances à Alfred de Musset.
25. Mémoires et lettres de Mme Malibran, par la comtesse de Merlin. (N.d.A.)
26. “De ces livres si nombreux, si grands, si précieux – brûle toutes les pages”.
27. James Russell Lowell (1819-1891), écrivain et diplomate abolitionniste américain. Ses Conversations furent publiées en 1844.
28. Voir sur cette question l'essai d'Edgar Poe intitulé The Rationale of Verse.
29. Cette phrase est tirée des Essais de Bacon (“De la Beauté”).
30. Poe cite son célèbre poème : “Le Corbeau” (v. 13).
31. Autre citation du “Corbeau” (v. 14).
32. La citation n'est pas de Montaigne, mais plus vraisemblablement de l'abbé Gilles Ménage (1613-1692). On lit, dans les Menagiana : “M. de la Chambre disait que la plume inspire, que souvent il ne savait ce qu'il allait écrire quand il la prenait, qu'une période produirait une autre période”.
33. Titre d'une nouvelle de Poe.
34. Allusion à une violente polémique lancée par Poe en 1845 ; il accusait alors Longfellow d'être un plagiaire éhonté.
35. Le nom de plume de Von Hardenberg. (N.d.A.)
36. Nom du pays des géants dans Les Voyages de Gulliver.
37. Cette cécité constitue le thème principal de La Lettre volée comme du Sphinx.
38. James Leigh Hunt (1784-1859), écrivain et journaliste anglais. Poe fait référence à un texte paru en 1844, sous le titre Imagination and Fancy.
39. Référence à Daniel, 6, 9 : “la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable”.
40. C'est en partie ce que tente de faire Edgar Poe dans The Rationale of Verse.
41. Le magnétisme humain : ses droits à une enquête impartiale, ou essai tendant à démontrer l'utilité de son application au soulagement de la souffrance humaine, par W. Newnham, auteur de L'Influence réciproque de l'esprit sur le corps. (N.d.A.)
42. William Newnham (1790-1865), auteur d'essais scientifiques et religieux portant sur le rapport entre médecine et sciences occultes.
43. Chauncey Hare Townshend (1798-1868), auteur de Facts in Mesmerism (1840).
44. Hamlet, II, 2, v.466 : “twas caviare to the general”.
45. Lors d'une assemblée de la New York Historical Society, M. Field a émis la proposition d'adopter le nom d'Amérique, en réservant celui de Colombie au continent. (N.d.A.)
46. Nicolas Trublet (1697-1770), essayiste et critique tourné en ridicule par Voltaire. La citation vient probablement de ses Essais sur divers sujets de Littérature et de Morale (1735).
47. Tout le passage sur l'ambition humaine est à rapprocher de sa variante insérée dans “Le Domaine d'Arnheim”
48. Citation de Thomas Gray, Élégie écrite dans un cimetière de campagne (v.59) : “Quelque Milton muet et sans gloire repose peut-être ici”.
49. Poe cite Le Dit du vieux marin (v. 111-114).
50. Baudelaire intitulera Mon cœur mis à nu ses projets d'écrits intimes.
51. Allusion au monologue d'Hamlet (III, 1, v.65) : there's the rub.
52. Hudibras, publié entre 1662 et 1677, long poème burlesque, inspiré de Don Quichotte. On y trouve une satire des débats théologiques et scientifiques de l'époque.
53. Autre référence au Novum Organum de Bacon, à propos des “distorsions” qui font obstacle à la connaissance. Les idoles de la caverne sont dues aux particularités individuelles de chacun ; celles de la tribu sont communes à l'humanité ; celles du forum relèvent du langage ; et celles du théâtre découlent de la mise en forme des savoirs.
54. Référence aux Chroniques, 1, 21, 2.
55. Poe n'a jamais écrit cet article mais son titre nous invite à faire le rapprochement avec deux essais qui sont antérieurs à cette note : Philosophy of Furniture à propos de l'art de l'ameublement, et Philosophy of Composition portant sur la genèse du Corbeau.
56. Poe joue sur le rapprochement des deux expressions : sleep-waker et sleep-walker.
57. La Vérité sur le cas de M. Valdemar a paru dans le Morning Post de Londres, le 5 janvier 1846, sous le titre Mesmerism in America ; puis, dans le Popular Record du 10 janvier sous le titre Mesmerism in America – Death of M. Valdemar of New York.
58. Célèbre morceau du compositeur tchèque Franz Kotzwara (1730-1791).
59. La citation est probablement empruntée à un passage de Gravina sur le bel canto dans Della Tragedia (1715).
60. James Crichton, dit l'Admirable (1560-1583), gentilhomme écossais, célèbre pour sa précocité, son érudition et ses talents dans le maniement des armes.
61. Citation quelque peu déformée de Tristram Shandy, L.6, ch.1.
62. Citation du Childe Harold de Byron (Chant III, stance 97).
63. La strophe en question est de Mary Elizabeth Howitt (1807-1894), dans un poème extrait de son recueil Songs of Our Land, intitulé “Alone”.
64. William Cowper (1731-1800), poète anglais connu pour ses Hymnes d'Olney (1776) et pour L'Œuvre (1785) ; Alexander Pope (1688-1744), poète et essayiste anglais, auteur de La Dunciade (1728) ; Thomas Moore (1779-1852), poète irlandais particulièrement admiré d'Edgar Poe.
65. Allusion à une pièce d'or américaine d'une valeur de dix dollars.
66. Christoph Martin Wieland (1733-1813), poète et essayiste allemand.
67. Voir les dialogues philosophiques intitulés Puissance de la parole, Colloque entre Monos et Una et Conversation d'Eiros avec Charmion.
68. Corinthiens, 5.8.
69. Référence à Pope, dans Essai sur la critique (II, v.15) : “A little learning is a dang'rous thing”.
70. Voir la conclusion de L'Homme des foules.
71. Les réflexions de Poe sur la musique, dans cette acception, sont nombreuses. Ici, la mention de Platon concerne probablement certains passages des livres II et III de La République, cités par Poe, dans une note accompagnant le Colloque entre Monos et Una.
72. Balthasar Denner (1685-1749), peintre réaliste allemand.
73. Zeuxis et Parrhasios sont deux peintres réalistes grecs du Ve siècle av. J.-C. Selon Pline : “Parrhasios offrit le combat à Zeuxis. Celui-ci apporta des raisins peints avec tant de vérité, que des oiseaux vinrent les becqueter ; l'autre apporta un rideau si naturellement représenté, que Zeuxis, tout fier de la sentence des oiseaux, demanda qu'on tirât enfin le rideau pour faire voir le tableau. Alors, reconnaissant son illusion, il s'avoua vaincu avec une franchise modeste, attendu que lui n'avait trompé que des oiseaux, mais que Parrhasios avait trompé un artiste, qui était Zeuxis.” (Histoire naturelle, XXXV, trad. Émile Littré).
74. Cette citation ne figure nulle part dans les écrits de Hegel.
75. Tertullien (né vers 155, mort vers 230), De la chair du Christ : “Le fils de Dieu est mort. On doit le croire parce que c'est absurde. Et il a ressuscité. Cela est certain parce que c'est incroyable.” La même citation figure dans Bérénice.
76. Hôpital d'aliénés de Londres.
77. Référence au Vathek de Beckford, conte oriental écrit directement en français par son auteur. Carathis est la mère du héros qui l'accompagne aux enfers.
78. Afrasiab est un roi touranien légendaire. Oxus est le nom antique du fleuve Amou-Daria.
79. Ce paragraphe conclut aussi la nouvelle intitulée L'Enterrement prématuré.
80. La vengeance est un thème majeur chez Poe, que ce soit dans Hop Frog, La Lettre volée ou La Barrique d'Amontillado.
81. Référence à La Tempête de Shakespeare (acte iii, scène 2) : Caliban, Stephano et Trinculo font des projets de gouvernement, qu'ils oublient aussitôt.
82. Louis Marie de La Haye (1788-1868), juriste et auteur de pamphlets politiques sous le pseudonyme de Timon. La citation, approximative, est tirée du Livre des Orateurs (L. I, ch.9).
83. Allusion à l'un des douze travaux d'Hercule. Un crabe est envoyé par Héra pour détourner l'attention d'Hercule, tandis qu'il affronte l'Hydre de l'Herne. Pour le remercier de sa vaillance, Héra lui dédie une constellation.
84. Plus connue sous le nom de George Sand.
85. Citation tirée du roman Valentine, ch. 23 : “Les anges sont moins purs que le cœur d'un homme de vingt ans lorsqu'il aime avec passion”.
86. Alexander Selkirk : marin écossais dont l'histoire véritable inspira Robinson. Il fut récupéré par l'expédition de Woodes Rogers en 1709, après avoir passé quatre ans sur une île déserte.
87. Le même sujet est traité par Poe dans quelques nouvelles somnambuliques : Révélation magnétique, La Vérité sur le cas de M. Valdemar, et surtout Colloque entre Monos et Una. Son poème Pour Annie s'inscrit dans une veine comparable.
88. Voir le prologue et la fin du Mystère de Marie Roget.
89. Johannes Kepler (1571-1630), astronome allemand. L'idée est chère à Poe et sera reprise dans Eurêka.
90. Poe n'a pas encore écrit son célèbre essai Philosophy of composition.
91. Roman historique de Dickens.
92. Roman de William Godwin, écrivain et philosophe anarchiste anglais, père de Mary Shelley.
93. John Dennis (1657-1734) fut ridiculisé par Pope ; Élie Catherine Fréron (1719-1776) et Pierre François Guydot Desfontaines (1685-1745) étaient tous deux des ennemis de Voltaire.
94. Cette idée figure, avec quelques modifications, dans Le Double Assassinat dans la rue Morgue ; et sera plus amplement développée dans Colloque entre Monos et Una.
95.Thomas Babington Macaulay (1800-1859), historien, écrivain et homme d'état britannique.
96. La “théologie naturelle” consiste à connaître Dieu à partir de l'expérience du monde et de la raison ; elle s'écarte, en cela, du dogme de la Révélation chrétienne. Le protestantisme est traditionnellement plus proche de la “théologie naturelle” que l'Église catholique.
97. Matthieu, 5, 44.
98. Voir Le Cottage Landor.
99. La même boutade est reprise dans la Philosophie de l'ameublement.
100. Référence à Horace, Épîtres, II, 2, v. 102 : “genus irritabile vatum” – la race irritable des poètes.
101. Poe s'est adonné aux sciences avec passion, comme l'atteste son chef-d'œuvre injustement méconnu, l'essai cosmogonique Eurêka.
102. Citation de Dryden (1631-1700) empruntée à son Absalon et Architophel (I, v.163).
103. Horace Greeley (1811-1872), homme de presse engagé dans la lutte égalitariste et antiesclavagiste.
104. La Nouvelle Héloïse. (N.d.A.)
105. Edmund Spenser (1552-1599), poète anglais, auteur de La reine des fées. La citation de Poe est extraite du Conte de la Mère Hubbard (v.905-906), mais dans ce passage il n'est pas question d'amour.
106. Révérend Samuel Horsley (1733-1806), mathématicien et théologien anglais.