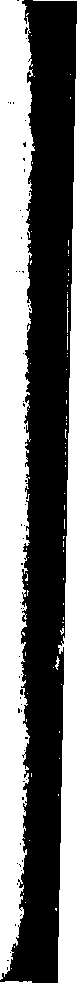
Le moment est venu d’analyser plus à fond, et sur le plan des États-Unis dans leur ensemble, l’antagonisme qui a opposé, depuis que des hommes y vendent leur force de travail à d’autres hommes, salariés blancs et salariés noirs. Cette recherche s’est heurtée à un sérieux obstacle : les porte-parole du syndicalisme ouvrier et ceux de la race noire, soucieux de défendre leur groupe respectif, présentent de cette histoire des versions nettement divergentes.
Dès le début du xixe siècle, des Noirs affranchis affluèrent dans de grandes villes telles que New York et Philadelphie, se contentant des plus bas salaires et disputant les emplois aux travailleurs blancs non qualifiés. Il en résulta une guerre de races. Les rixes se multiplièrent. À Cincinnatti, en 1829, une meute de Blancs blessa et tua des affranchis et des esclaves fugitifs. À Philadelphie, de 1828 à 1840, on enregistra une série de conflits raciaux. Celui de 1834 prit les proportions d’une bataille rangée et dura trois jours. Le fait se répéta en 1835, en 1838, en 1842.
Les ouvriers blancs essayaient par tous les moyens de restreindre ou de prévenir l’embauche des hommes de couleur. En même temps, les travailleurs blancs se montraient peu disposés à prendre parti pour l’abolition de l’esclavage, par crainte de voir se multiplier le nombre des salariés noirs.
Le comportement des abolitionnistes n’était pas fait pour dissiper cette méfiance. Ils avaient peu de sympathie pour les travailleurs et ils condamnaient la lutte des classes naissante entre capital et travail. Dès les premiers numéros de son journal, The Liberator, parus en janvier 1831, William Lloyd Garrison, à l’occasion d’un meeting ouvrier à Boston, dénonça le mouvement
ouvrier comme une conspiration organisée en vue d’« enflammer les esprits de notre classe laborieuse contre les plus opulents ».
Les syndicats étaient, selon lui, « criminels au plus haut degré ».
Les travailleurs s’irritèrent de voir les abolitionnistes «s’apitoyer en faveur de l’esclave du Sud, mais disposés à écraser d’une main de fer le travailleur blanc du Nord ». La défense du salariat leur parut plus importante que l’affranchissement des esclaves et ils craignirent qu’une campagne centrée uniquement autour de l’abolition ne détournât l’attention de leur propre sort. « La première cause de l’esclavage, assuraient-ils, réside dans la condition même de l’industrie; c’était cela qu’avant toute chose il s’agissait de changer. »
Ainsi, dès les débuts, le mouvement pour l’émancipation raciale et le mouvement pour l’émancipation sociale prirent des voies divergentes. «Les abolitionnistes, écrit Du Bois, n’aperçurent pas la nouvelle subordination à laquelle le travailleur était assujetti par le capital organisé, tandis que les travailleurs ne comprirent pas que l’exclusion du programme ouvrier de quatre millions de travailleurs était une omission fatale. » Et, pourtant, observe l’auteur de Black Reconstruction, l’union des deux mouvements les eût rendus « irrésistibles ». «Ils exhibèrent des divergences fondamentales au lieu de devenir le grand parti unique du travail libre et de la terre libre. » Options irréparables qui, pour des générations, devaient opposer les exploités blancs et noirs.
Les plus déshérités des travailleurs blancs du Nord étaient des immigrants irlandais. Leur condition n’était pas beaucoup moins déplorable que celle des esclaves. Ils avaient débarqué sur les rivages des États-Unis pour échapper à une oppression séculaire presque aussi dure que celle subie par les Africains.
Ils étaient, comme eux, au dernier échelon de l’échelle sociale et devaient se contenter des emplois les plus bas et les plus mal rétribués. Mais, au lieu de s’unir, ces deux groupes de déshérités se firent une concurrence acharnée.
En 1863, en pleine guerre de Sécession, une insurrection ouvrière éclata à New York. Les travailleurs blancs, en majorité irlandais, furent pendant quelques jours maîtres de la cité. La violence de ce soulèvement et la sauvagerie avec laquelle il fut réprimé présentent quelques analogies avec la Commune de Paris. Certains de ses aspects permettent d’y discerner un épisode de la lutte des classes. Les ouvriers étaient las d’une guerre dont ils supportaient financièrement presque tout le poids et hostiles au service militaire obligatoire qui faisait couler leur sang pour les riches. Malheureusement ce conflit social se doubla d’un pogrome racial. Le gros commerce de New York (à qui, au surplus, la guerre contre le Sud faisait perdre de l’argent) s’empressa de dériver l’indignation des travailleurs contre leurs frères de couleur. Ainsi excités, les prolétaires irlandais attribuèrent aux Noirs la responsabilité de la guerre et assouvirent, en même temps, un vieux ressentiment contre leurs concurrents sur le marché du travail ; ils tuèrent tous ceux qui leur tombèrent sous la main.
Quand Lincoln fut assassiné, en 1865, les organisations irlandaises de New York refusèrent de défiler avec les Noirs et le Conseil municipal n’admit pas les hommes de couleur dans le cortège funèbre.
La guerre de Sécession, comme le souligna une adresse de l’Association internationale des travailleurs, portant la signature de Karl Marx, avait eu «pour résultat immédiat une détérioration de la condition du travailleur américain ». Tandis que le Big Business en avait retiré de fabuleux profits, l’inflation avait accru les souffrances des salariés. Cependant, la guerre avait « offert une compensation dans l’émancipation des esclaves et l’impulsion ainsi donnée» à la lutte de classe ouvrière1. Le mouvement
ouvrier n’entendit guère cet appel à l’internationalisme prolétarien. À part quelques rares exceptions, le contenu et la portée révolutionnaires de la Reconstruction lui échappèrent. Il était trop occupé à combattre la nouvelle oligarchie industrielle qui, pour mater les planteurs du Sud, favorisait précisément cette expérience. De leur côté, les républicains radicaux blancs, tels que Charles Sumner et Thaddeus Stevens, témoignèrent peu d’intérêt et de sympathie pour le Labor.
Quant aux leaders noirs inféodés au Parti Républicain, ils ne saisirent pas combien le nouveau régime politique instauré dans le Sud était sous la dépendance de l’oligarchie capitaliste du Nord et, obnubilés par l’affranchissement politique de leur race, ils n’aperçurent pas la menace mortelle que faisait planer sur l’ensemble de la nation, et sur eux-mêmes, l’ascension foudroyante du capitalisme.
Le Labor, croyant ainsi combattre l’oligarchie capitaliste, se lia les mains au Parti Démocrate, parti de la contre-révolution sudiste. Les Noirs, croyant ainsi combattre la contre-révolution sudiste, se lièrent les mains au Parti Républicain, parti du grand capital triomphant. Ni les uns ni les autres ne saisirent l’occasion qui leur avait été donnée, au lendemain de la guerre de Sécession, d’opérer un vaste rassemblement des forces démocratiques et progressives, groupant à la fois les partisans de l’affranchissement politique des Noirs, les syndicats ouvriers, les petits fermiers de l’Ouest et les pauvres Blancs du Sud. Ce fut une des plus grandes occasions manquées de l’histoire sociale américaine.
La centrale syndicale des années 1860 s’appelait National Labor Union. Elle avait des tendances radicales et internationalistes. Elle avait noué des relations avec l’Association internatio-
de la classe ouvrière». «Les travailleurs européens, y lisait-on, sentent distinctement que la bannière étoilée porte le destin de leur classe». En présentant Lincoln comme le champion du prolétariat parce quil avait émancipé les esclaves, Karl Marx perdait de vue le contenu de classe (bourgeois et capitaliste) du régime nordiste. Le club communiste de New York protesta contre la lettre.
nale des travailleurs. Elle menait la lutte pour la journée de huit heures. Son animateur, William H. Sylvis, avait, sur la question raciale, une position relativement progressive. Il était partisan de l’unité entre travailleurs blancs et noirs. Il était conscient de la nécessité de gagner les Noirs à la cause du Labor. «Si nous pouvons réussir, déclara-t-il au cours d’un voyage dans le Sud, à les convaincre que c’est leur intérêt de faire cause commune avec nous, nous aurons un pouvoir, dans cette partie du pays, qui ébranlera Wall Street. » Mais il ne sut pas présenter aux Noirs un programme conforme à leurs aspirations démocratiques. Sa position sur la Reconstruction fut des plus timorées. Il se montra nettement hostile à la politique des républicains radicaux, aveugle au contenu révolutionnaire de l’expérience. Et il couvrit d’injures le Congrès qui imposait, d’une main de fer, au Sud récalcitrant, cette gigantesque mutation sociale.
À la suite de Sylvis, la National Labor Union, à son congrès de 1867, comprit que seule l’organisation des Noirs dans les syndicats ouvriers pouvait empêcher le patronat de les employer comme briseurs de grèves : « Ou nous ferons d’eux nos amis, ou le capital se servira d’eux comme d’une arme contre nous. » Pourtant, l’attitude des travailleurs blancs à l’égard de leurs frères de couleur restait hostile et la question brûlante de l’admission des Noirs était ajournée de congrès en congrès. C’est seulement à celui de 1869 que des délégués de couleur furent admis et que l’organisation des travailleurs noirs reçut un commencement d’exécution. Mais, las d’attendre, les affranchis constituèrent, à la fin de la même année, une centrale syndicale de couleur, en signe de protestation contre la discrimination que les syndicats blancs continuaient à exercer contre eux. Cette nouvelle organisation se considéra d’ailleurs comme faisant partie de la National Labor Union et envoya des délégués à son congrès.
À ses assises de 1870,1e rapprochement entre les travailleurs des deux couleurs, à peine esquissé, s’arrêta net. La centrale syndicale blanche fit, certes, un pas en avant lorsque, s’affranchis-
sant de la tutelle du Parti Démocrate, elle décida la création d’un Parti Travailliste ; mais elle le fit sur un programme de réformes ouvrières qui ignorait les revendications spécifiques des Noirs, telles que la défénse de leurs droits civiques, l’abolition de toute discrimination dans l’emploi et dans les salaires.
De leur côté, les ouvriers noirs eurent le tort de ne pas saisir cette occasion de s’unir avec les ouvriers blancs pour une action politique indépendante. Ils se cramponnèrent au Parti Républicain, qui conservait à leurs yeux le prestige de les avoir affranchis. Le congrès de la National Labor Union refusa d’admettre un des leaders noirs de la Reconstruction, non pas à cause de son épiderme, mais parce qu’il était un fonctionnaire du Parti Républicain. Un orateur noir, également républicain, s’opposa véhémentement à la fondation d’un troisième parti et invita le congrès à s’affilier au Parti Républicain - ce qui revenait à demander aux ouvriers de rejoindre le parti du patronat. La centrale syndicale noire, n’ayant pas obtenu gain de cause, rompit avec la National Labor Union et se transforma en une succursale noire du Parti Républicain, ce qui devait provoquer sa désagrégation. Par la faute de l’un et de l’autre, le divorce entre le Labor et le mouvement d’émancipation raciale était consommé.
Nous entrons maintenant dans les années sombres où le Big Business triomphant instaura sa domination illimitée. Dans le Sud, les Noirs furent trahis par le Parti Républicain et la contre-révolution balaya leurs conquêtes. Dans le Nord, la grande industrie édifia ses bastions dans lesquels elle jeta des cargaisons successives d’immigrants, non qualifiés et non organisés ; elle exploita et entretint leurs particularismes nationaux, les isolant les uns des autres, les dressant les uns contre les autres. Et, pour achever de briser leurs velléités de révolte, elle fit venir du Sud des wagons de prolétaires noirs, prêts à se contenter de salaires moindres que ceux des Blancs et à briser leurs grèves.
Le fossé qui avait été creusé entre les deux races par les esclavagistes servait on ne peut mieux les intérêts du patronat
moderne; d’une part, le préjugé racial prévenait l’épanouissement d’une solidarité de classe entre les ouvriers des deux couleurs ; d’autre part, la discrimination dans l’emploi incitait le travailleur noir à accepter avec empressement n’importe quel travail lui permettant de prendre pied dans l’industrie, fut-ce aux dépens des travailleurs blancs. Briser une grève était sa seule chance de renverser les barrières de la discrimination.
Là où un employeur se montrait disposé à l’embaucher de façon permanente, comme ce fut le cas du magnat ferroviaire Pullman, le Noir eut plus de sympathie pour le patron à qui il devait son emploi que pour les syndicats ouvriers qui s’efforçaient d’empêcher qu’il ne l’obtînt. Quand l’American Railway Union d’Eugene Debs fut entraînée en 1894 dans un grave conflit social avec la compagnie Pullman, les travailleurs noirs, au lieu de se solidariser avec les grévistes, se firent briseurs de grève. Ils ne pardonnaient pas à l’organisation, qui était pourtant très progressive, d’exclure statutairement les Noirs. Debs reconnut, plus tard, que la discrimination pratiquée par son syndicat avait été l’un des facteurs de sa défaite.
Ce pionnier du socialisme américain s’était lourdement trompé lorsqu’il prétendait qu’«z7 n’y a pas de question noire indépendamment de la question ouvrière, de la lutte de classes prolétarienne». «Nous n’avons rien de spécial à offrir aux Noirs, affirmait le grand « Gene », et nous ne pouvons faire des appels séparés à toutes les races. Quand la classe ouvrière aura triomphé, le problème racial aura disparu pour toujours. »
L’erreur était à la fois théorique et pratique, elle témoignait d’une compréhension inexacte des rapports existant entre l’« infrastructure » et la « superstructure », c’est-à-dire les manifestations du préjugé racial.
En pratique, la conception de Debs risquait d’inciter les Noirs à la passivité. Ils pouvaient en tirer la conclusion qu’il leur suffisait de se croiser les bras jusqu’à ce que le Labor eût accompli pour eux sa tâche historique, conclusion qui n’était qu’une
transposition prolétarienne de la conception bourgeoise selon laquelle les Noirs seraient trop arriérés pour être capables d’une action propre. En outre, une position abstraite du genre de celle de Debs détournait.du socialisme ouvrier beaucoup de Noirs, parce qu’ils n’y trouvaient aucune réponse immédiate à leurs préoccupations raciales.
Cependant, tous les syndicats ouvriers n’étaient pas hostiles aux travailleurs noirs. Les Chevaliers du Travail, ces précurseurs du syndicalisme d’industrie1, croyaient à l’unité de la grande famille humaine. Ils accueillaient dans leur organisation toutes les nationalités, toutes les races, toutes les croyances, toutes les qualifications professionnelles. À leur congrès de Richmond, ce fut une délégation de couleur qui introduisit le grand maître de l’ordre, Terence V. Powderly. Les travailleurs noirs affluèrent et, à leur apogée, en 1886, les Knights comprenaient quelque 60 000 adhérents de couleur.
Mais cette tentative d’organisation des non-qualifiés de la grande industrie fit long feu. La Chevalerie du Travail ne tarda pas à se désagréger, supplantée par le syndicalisme de métier et d’affaires de Samuel Gompers, aussi égoïste que particulariste. L’American Fédération of Labor (AFL) s’abstint systématiquement d’organiser les secteurs de la production où avaient réussi à pénétrer les Noirs et ferma jalousement ses unions d’ouvriers qualifiés aussi bien aux non-qualifiés blancs qu’aux Noirs. Pendant plusieurs décennies, les rapports entre ouvriers des deux couleurs se trouvèrent enfermés dans un cercle vicieux : la discrimination exercée par les uns acculait les autres à jouer le rôle de briseurs de grève ; et ce comportement de briseurs de grève était invoqué par les syndicats de métier pour justifier l’interdit dont ils frappaient les hommes de couleur.
Néanmoins, lorsque des syndicalistes se donnaient la peine de gagner la confiance des Noirs, leurs efforts n’étaient pas tou-
Cf. mon livre Le Mouvement ouvrier aux États-Unis, 1867-1967, Petite collection Maspero, 1970.
jours infructueux. Ce fut ainsi qu’au cours de la grève de l’acier, en 1901, trois cents Noirs furent amenés d’Alabama par une aciérie des environs de Chicago. Des militants de la Fédération du Travail entrèrent en contact avec eux et leur expliquèrent l’enjeu réel de la grève. Le résultat fut que les arrivants se refusèrent à trahir la cause de leurs frères de classe et que l’employeur dut les renvoyer à leur lieu d’origine. De même, en 1919 à Bogalusa (Louisiane), le patronat de l’industrie du bois contribua à rapprocher travailleurs blancs et noirs en faisant froidement assassiner à coups de revolver trois Blancs, parce qu’ils avaient courageusement accompagné dans les rues de la ville et protégé un Noir, coupable de recruter parmi ses congénères des adhérents au syndicat mixte. L’un de ces trois Blancs était le président de la section locale de l’AFL.
Cependant, ce ne furent là que cas exceptionnels. Quand, au lendemain de la Première Guerre mondiale, sous l’impulsion de l’Union des syndicats de Chicago, l’AFL se décida (ou se résigna) à entreprendre l’organisation des masses non qualifiées de la grande industrie, elle buta contre l’obstacle de la main-d’œuvre noire. La campagne de recrutement lancée à partir de 1917 dans les abattoirs de Chicago n’eut que peu de succès auprès des travailleurs noirs, qui représentaient pourtant un peu plus de 20 % des effectifs totaux de l’industrie. Un Afro-Américain au service du patronat organisa un syndicat «jaune» composé uniquement de Noirs. Il bénéficia de l’appui de la petite bourgeoisie de couleur et de ses différents organes (presse, Églises, professions libérales). Les organisateurs de l’AFL commirent l’erreur de parquer les syndiqués noirs dans des sections syndicales séparées. Ils réussirent néanmoins à recruter un certain nombre d’hommes de couleur, mais l’émeute raciale qui éclata à Chicago en juin 1919 mit brutalement fin à cette ébauche de rapprochement.
L’organisation de l’industrie de l’acier se heurta aux mêmes difficultés. Au cours de la grande grève de 1919, les employeurs
sein de l’AFL. À la longue, les résultats de son obstination ne furent pas entièrement négatifs.
Le syndicat des mineurs (United Mine Workers) fut une des rares organisations de l’AFL qui adopta, dès l’origine, une attitude libérale à l’égard des travailleurs noirs. Les Chevaliers du Travail, dont il était issu et qui l’avaient marqué de leur empreinte, lui avaient enseigné la fraternité de la famille humaine. En outre, il avait été constitué sur la base de l’industrie, et l’exclusivisme des syndicats de métier ne l’entacha jamais. Ses statuts spécifient qu’il se propose « de réunir en une organisation, sans considération de croyance, de couleur ou de nationalité, tous les travailleurs employés dans les mines de charbon». D’autres clauses assurent aux mineurs noirs et blancs une égalité de traitement. Blancs et Noirs sont organisés dans les mêmes sections syndicales. Le syndicat emploie des organisateurs noirs pour faciliter le recrutement des mineurs de couleur. Dans nombre de sections, des hommes de couleur remplissent les fonctions de président et de secrétaire. La communauté noire a apprécié cette attitude et s’est toujours montrée favorable au syndicat. Quand «Mother» Jones, l’héroïque et légendaire «grand-mère» des mineurs, dont la merveilleuse autobiographie a été traduite en français, ne trouvait aucune salle de réunion pour ses grévistes, elle tenait ses meetings dans des églises pour Noirs.
En Alabama, le syndicat eut quelque peine à prendre pied. Au cours de la grève de 1908, un prétendu « comité de citoyens » inspiré par les employeurs informa le syndicat que « le peuple d Alabama ne tolérerait jamais l’organisation des Noirs et leur participation à la grève aux côtés des Blancs ». 76 % des grévistes de 1920-1921 furent des Noirs, ce qui porta à son paroxysme la colère des créatures de l’US Steel. Mais le syndicat, sous l’impulsion à la fois énergique et généreuse de William Mitch, finit tout de même par s’implanter dans cette région. Il prit le taureau par les cornes. Ainsi, le Ku-Klux-Klan ayant été utilisé pour combattre l’organisation, les mineurs blancs y adhérèrent, s’en
assurèrent le contrôle, et le rendirent, de cette façon, inoffensif. Quand je visitai Birmingham en 1948, 45% des membres du syndicat dans le district étaient noirs.
Toutefois, la mécanisation des mines a tendu, depuis, à déclasser la main-d’œuvre noire, et le syndicat n’a pas suffisamment réagi contre cette situation.
L’exemple du syndicat des mineurs inspira le Congress of Industrial Organization, son rejeton. Dès sa création, sur la base de l’industrie et non plus du métier, le CIO adopta une politique raciale absolument différente de celle des syndicats corporatistes de la vieille AFL. Il ouvrit ses portes aux Noirs, sans se préoccuper de l’« accident de la couleur ». Il leur obtint des salaires égaux à ceux des Blancs. Il les associa à la direction de ses organisations à tous les échelons. Il réussit même, notamment dans le Nord, à abolir entre ses membres des deux couleurs toute ségrégation sociale et à les faire participer ensemble à des réunions récréatives ou dansantes. En outre, il fit une active propagande, orale et écrite, pour combattre le préjugé racial, non seulement parmi ses membres, mais aussi à l’extérieur. C’est ainsi qu’il mena campagne en faveur du programme de droits civiques.
Dans une brochure consacrée aux travailleurs noirs, le CIO expliquait qu’il avait eu, à sa fondation, « à bannir la discrimination raciale, tout comme il eut à bannir la discrimination de métier». «Le mouvement ouvrier moderne, ajoutait-il, a été convaincu par sa propre expérience qu’on ne peut pas davantage exclure des travailleurs du fait de la couleur de leur peau qu’on ne peut les exclure du fait de leurs différences de profession. » « La nature même du syndicalisme d’industrie, observèrent Irving Howe et B. J. Widick, dans leur livre sur le syndicat de l’automobile, rendait impossible les divisions raciales qui avaient prévalu dans Y AFL. Les nouvelles unions industrielles n’auraient pas pu consolider leur pouvoir sans gagner le soutien des travailleurs noirs. »
Quand le Comité d’organisation de l’acier entreprit, en 1936-1937, sa campagne de recrutement, il bénéficia du concours actif du National Negro Congress, ce qui aida à dissiper l’hostilité traditionnelle des dirigeants de la communauté noire à l’égard du Labor. Les travailleurs noirs, d’abord quelque peu méfiants, épaulèrent les travailleurs blancs. Au cours de la grève de Little Steel, en 1937, les Noirs se battirent aux côtés des Blancs sur les piquets de grève. Et, parmi les dix grévistes de Republic Steel qu’abattirent les forces de l’ordre, il y avait un homme de couleur.
La direction du puissant Syndicat de l’automobile (UAW), qui groupe un million et demi d’ouvriers, a été longtemps, au moins tant qu’il fut animé par Walter R Reuther, à l’avant-garde de la lutte contre la discrimination et le préjugé racial. « Les Noirs, selon Howe et Widick, ont appris dans les UAW que le monde blanc dans sa totalité n’est pas une conspiration dirigée contre eux, mais qu’il y a des syndicats prêts à prendre des risques pour leur venir en aide.» En mars 1946, le syndicat créa, sur le plan national, un département spécial de lutte contre la discrimination, dont l’objet était de veiller à l’exécution de la politique de l’organisation en matière raciale, par des interventions, soit auprès des employeurs, soit auprès des syndiqués eux-mêmes. Chaque section était tenue de constituer un comité local ayant les mêmes attributions. Le département en question était placé sous l’autorité directe du président Reuther, assisté d’un codirecteur noir.
Les UAW n’hésitaient pas, alors, à pénaliser ceux de leurs adhérents qui se livraient à des actes de discrimination. Mais le syndicat estimait, à juste titre, que des sanctions ne sauraient suffire : « On ne peut venir à bout de la discrimination que si le préjugé racial qui l’engendre est dissipé par l’éducation. » L’Anti-Discrimination Department éditait dans ce but toute une série de bulletins, de brochures, vivants et bien présentés, qui frappaient l’imagination des travailleurs. On y dénonçait sans relâche les « racines économiques de la discrimination ».
L’action des UAW s’exerça aussi sur des plans autres que celui de la production. C’est ainsi que les délégués noirs au congrès du syndicat, en 1940, à Saint-Louis (Missouri), ayant fait l’objet de discrimination dans les hôtels et les restaurants de la ville, le syndicat décida de ne tenir à l’avenir ses congrès que dans des villes où les syndicalistes de couleur seraient traités sur un pied d’égalité avec les Blancs. Le Syndicat de l’automobile contribua, pour une large part, en agissant sur ses membres blancs, à circonscrire la terrible rixe raciale qui éclata à Detroit en 1943.
Mais ces résultats ne furent pas obtenus du premier coup et sans difficultés. Pendant de longues années, les UAW eurent à lutter à la fois contre le préjugé racial de leurs propres membres et contre la méfiance, profondément enracinée, des Noirs à l’égard des syndiqués blancs. Pendant les sit-down (grèves avec occupation d’usines) de 1936-1937, beaucoup de travailleurs noirs demeurèrent dans l’expectative; pas tous cependant, puisqu’au cours de la grève Chrysler, en mars 1937, un homme de couleur fut élu membre du comité de grève. Mais la plupart des ouvriers noirs restèrent tout simplement chez eux jusqu’à la fin du conflit. S’ils ne coopérèrent pas avec les grévistes, ils ne firent pas non plus les «jaunes ». Pour eux, le syndicat n’était qu’un regroupement de travailleurs blancs, qu’ils avaient des raisons de suspecter.
La grève à l’usine Dodge, dans un faubourg de Detroit, en 1939, faillit provoquer une bagarre raciale. Un certain nombre de travailleurs, en majorité de couleur, franchirent les piquets de grève sous la protection de la police, afin de reprendre le travail. Le syndicat eut la sagesse de ne pas faire intervenir ses piquets et de reporter sur les patrons la responsabilité de cette reprise. Le conflit racial fut ainsi évité, et la voie ouverte à l’organisation ultérieure des Noirs.
La conquête de Ford, en 1941, présenta, du point de vue racial, des obstacles particulièrement sérieux. Le seigneur de Rivière-Rouge avait toujours ouvert ses portes aux hommes de couleur.
À la veille de la grève, ils étaient au nombre de 11000, soit 12 % des effectifs totaux. Cette politique d’embauche n’était certes pas inspirée par des considérations humanitaires. L’admission des Noirs visait à empêcher les syndicats ouvriers de s’implanter dans l’usine ; au surplus, les hommes de couleur étaient affectés aux travaux les plus rebutants. Enfin, les emplois étaient obtenus par l’intermédiaire des pasteurs et autres dirigeants de la communauté afro-américaine, dont les entreprises ou bonnes œuvres étaient sous l’étroite dépendance économique de Ford. Les Noirs affluaient dans les églises et les écoles du dimanche avec l’espoir d’être embauchés chez Ford. Par contre, les syndicalistes ou les universitaires de couleur favorables au mouvement ouvrier se voyaient refuser le droit de prendre la parole dans les églises réservées aux Noirs.
Lorsque Ford comprit qu’il ne pourrait immuniser longtemps ses usines contre la marée montante du syndicalisme ouvrier, les pasteurs noirs à sa solde vantèrent publiquement les mérites de l’AFL et prétendirent que cette organisation avait toujours agi au mieux des intérêts de leurs congénères. Mais une minorité de leaders noirs, indépendants et progressifs, animés par la NAACP, dont le secrétaire se rendit tout exprès à Detroit, fit campagne en faveur du syndicat CIO de l’automobile. La grève fut, par la suite, finalement gagnée sans heurts raciaux trop graves. La section syndicale Ford, la fameuse section 600, se plaça au premier rang des syndicats américains pratiquant la bonne entente raciale et associant les Noirs à sa direction.
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l’afflux des Noirs dans les usines d’armement et leur promotion occasionnèrent, de 1941 à 1943, toute une série de conflits raciaux. Ces incidents furent, en grande partie, stimulés, sinon provoqués par le Ku-Klux-Klan, très actif à Detroit du fait de la présence de nombreux travailleurs immigrés du Sud, et par le patronat lui-même. Chez Packard, à deux reprises, en 1941 et en 1943, les ouvriers blancs firent la grève sur le tas pour protester contre l’introduction ou
le reclassement de Noirs. La section syndicale locale de l’automobile adopta une attitude molle et équivoque. Mais la direction nationale intervint avec plus de vigueur.
Quand un incident analogue se produisit chez Chrysler en février 1942, le syndicat insista auprès des employeurs pour que tous les ouvriers qui refuseraient de reprendre le travail pour un motif raciste fussent licenciés. Au cours d’un meeting public interracial organisé en commun, en avril 1943, par les UAW et la NAACP, Walter Reuther déclara sans ambages que son syndicat « dirait à tout ouvrier qui refuserait de travailler avec un travailleur de couleur qu’il pouvait quitter l’usine où il n’avait plus sa place».
Cependant, ni le CIO dans son ensemble, ni le Syndicat de l’automobile en particulier n’avaient vraiment résolu le problème des relations interraciales sur le lieu du travail. Dans le cas d’incidents du genre de ceux qui viennent d’être relatés, les dirigeants nationaux n’étaient pas toujours intervenus avec promptitude et énergie. Ils s’étaient parfois crus obligés de faire des concessions aux préjugés raciaux de leurs adhérents.
Parfois même les chefs syndicalistes exploitèrent la tension raciale pour organiser une entreprise. C’est ce qui se produisit en 1941 à l’usine aéronautique Curtiss-Wright, à Colombus (Ohio). Une grève éclata en partie parce qu’un Noir avait obtenu un emploi plus qualifié. Mais, en réalité, les organisateurs du CIO avaient saisi ce prétexte pour déclencher une bataille en vue d’obtenir la reconnaissance du syndicat par l’employeur.
Sans doute le CIO fit-il accomplir au rapprochement des deux races un pas en avant. Il obtint des résultats appréciables à la fois en procurant aux Noirs pour un travail égal des salaires égaux à ceux des Blancs et en leur ouvrant l’accès d’emplois qui jusqu’alors leur étaient fermés. Mais sur l’un et l’autre de ces plans - et surtout sur le second - la situation était encore loin d’être brillante, en dépit des progrès accomplis.
La plupart des Noirs, dans les industries organisées par le CIO, étaient encore affectés à des travaux non qualifiés. Au cours d’une audition de Walter Reuther devant une commission du Sénat, en 1947, un sénateur le pressa d’indiquer le pourcentage des Noirs tenant des emplois qualifiés dans certaines grandes entreprises telles que Ford. Le président du syndicat de l’automobile, après avoir tenté d’esquiver plusieurs fois la question, dut finalement avouer que la grande majorité des travailleurs noirs de Ford étaient encore employés à la fonderie et convenir que les travaux de ce genre sont durs et comptent parmi les moins qualifiés.
Dans l’acier, les résultats obtenus n’étaient pas plus encourageants. En dépit des quelques progrès accomplis, le Noir continuait à se heurter à des limites rigides au-dessus desquelles il lui était impossible de s’élever dans la hiérarchie des qualifications.
En résumé, la fondation du CIO, dans les années 1930, avait contribué à faire reculer le racisme sur le lieu du travail. Pour la première fois alors, depuis de nombreuses décennies, depuis les temps héroïques des Chevaliers du Travail, le travailleur noir avait vu se tendre vers lui une main puissante qui l’invitait à s’intégrer dans le syndicalisme d’industrie. Répondant à cet appel, un million et demi d’hommes de couleur avaient rejoint les syndicats ouvriers où ils s’étaient montrés parmi les militants les plus dévoués et les plus combatifs.
Fait plus important encore, le CIO, du fait même de son existence, avait, indirectement, servi de point d’appui et de rempart à la communauté noire dans son ensemble, lui avait permis de consolider ses forces, de s’enhardir à formuler des revendications nouvelles, de prendre une attitude plus indépendante, de préparer le terrain pour les luttes de masses qu’elle a engagées depuis.
Mais à peine avait-il rendu ce service au mouvement de libération noire que le syndicalisme industriel s’étiolait. Depuis des années, il se tient sur une prudente défensive. Il pratique la colla-
boration et non plus la lutte des classes. Il ne se montre quelque peu actif que lorsqu’il s’agit de préserver les conditions des travailleurs les plus âgés, les plus privilégiés, les plus attachés aux avantages que leur confère l’ancienneté. Or, les privilèges de cette aristocratie ouvrière ne peuvent être sauvegardés qu’au détriment des travailleurs les plus déshérités, les plus exploités, dont les Noirs forment la plus large part.
Quand, en 1955, l’unité syndicale fut rétablie par la fusion de l’AFL et du CIO, deux hypothèses étaient permises : ou bien les anciens dirigeants du CIO réussiraient à convertir les vieux leaders des syndicats de métier à leur libéralisme en matière raciale, ou, au contraire, le racisme traditionnel des bonzes réformistes déteindrait sur le relatif radicalisme des syndicats d’industrie. C’est le second terme de l’alternative qui a prévalu. Les bureaucrates de la centrale réunifiée se sont engagés, certes, à éliminer le racisme, mais seulement du bout des lèvres. Pendant de longues années, ils ont mis sous le boisseau le programme de droits civiques. Ils n’ont pas davantage éliminé le préjugé racial de leurs propres rangs. À tel point que le président de l’AFL-CIO, l’ultra-réactionnaire George Meany, a eu, à ce sujet, de vives altercations, aussi bien avec A. Philip Randolph qu’avec un comité de la NAACP spécialisé dans les questions ouvrières.
Il a fallu l’explosion antiraciste de l’été 1963 et le ralliement du président Kennedy à un projet de législation de droits civiques pour que la puissante centrale syndicale qui groupe plus de quinze millions d’adhérents se décidât, un peu tard, à donner son appui à ce programme. Appui purement platonique, cependant, puisque, presque aussitôt, elle refusa son soutien officiel à la Marche des Noirs sur Washington du 28 août 1963, laissant à « ses membres toute liberté pour y participer à titre individuel». Seul le syndicat de l’automobile (UAW) entra dans le comité d’organisation de la Marche.
Selon une habitude ancienne, les bureaucrates syndicaux trouvent commode de rejeter sur la «base» leur propre carence.
Les plus réactionnaires dissimulent à peine leurs préjugés racistes, tandis que les moins conservateurs font preuve, vis-à-vis des hommes de couleur, d’un paternalisme temporisateur, leur prodiguant des appels à la « patience ». Les Noirs ne les intéressent au fond que lorsqu’il s’agit d’encaisser leurs cotisations, de les maintenir rivés au Parti Démocrate, ou, comme ce fut le cas lors de l’élection de John Kennedy, d’obtenir d’eux l’indispensable appoint permettant de faire passer, de justesse, leur candidat présidentiel.
Ces dernières années l’hostilité des travailleurs blancs à l’égard de leurs frères de couleur, loin de se tempérer, a été en s’exacerbant. Le principal motif en est, bien entendu, d’ordre économique. L’introduction de l’automation, la menace du chômage ont fait croire aux ouvriers d’origine européenne que leurs conditions d’existence seraient menacées par les quelques progrès accomplis par la communauté afro-américaine sur la voie de l’égalité des droits. À quoi s’ajouta l’entrée massive dans la grande industrie du Nord et de l’Ouest de travailleurs blancs en provenance du Vieux Sud. D’autre part, le conservatisme social de plus en plus virulent de la centrale syndicale unifiée a relégué au magasin des accessoires la lutte contre la discrimination qui avait été pratiquée dans la période ascensionnelle du syndicalisme d’industrie. Tandis que le raciste Meany continuait à tenir en main l’AFL-CIO, l’antiraciste Walter Reuther était éliminé, d’abord par une scission qui fit sortir son syndicat de la centrale, puis par sa mort accidentelle.
Cette maléfique évolution a achevé de convaincre les militants de l’émancipation noire qu’ils n’avaient rien à attendre d’un mouvement syndical de plus en plus intégré dans l’ordre établi, et elle a favorisé l’éclosion d’un nationalisme noir qui, on le verra, a pris souvent les formes d’un contre-racisme. En même temps elle incitait les travailleurs noirs, notamment à Detroit, à s’organiser à l’écart des syndicats ouvriers en même temps qu’ils en dénonçaient le rôle contre-révolutionnaire. Les révolu-
tionnaires noirs les plus disposés à la lutte commune avec les révolutionnaires blancs, telles les Panthères noires, consentent, certes, à faire alliance avec une jeunesse blanche estudiantine et intellectuelle en révolte contre l’impérialisme et le fascisme américains, mais ils sont plus sceptiques quant à une possible action commune avec les travailleurs blancs organisés. Le fossé entre les deux catégories d’exploités du grand capital est, au moins pour le moment, plus profond que jamais.
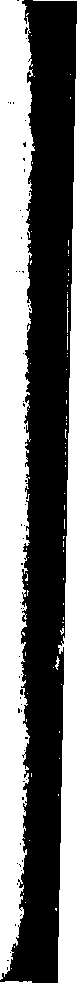

Dans cette remarquable Adresse, les intérêts à la fois respectifs et communs du mouvement ouvrier et du mouvement de libération des Noirs étaient appréciés avec exactitude. Cependant, Karl Marx n’eut pas toujours une position aussi heureuse. En novembre 1864, il avait fait adopter par l’Internationale une lettre dithyrambique à Lincoln, félicitant celui-ci de sa réélection et le traitant (inexactement) de «fils