Chapitre 12
Le Dragon, l’influence politique et les bons souvenirs
Qu’on le veuille ou non, la Société des alcools du Québec étant un organisme d’État, il y a eu plusieurs tentatives, souvent politiques, pour influencer certaines décisions. C’est l’une des choses que j’ai rapidement apprise.
Ainsi, chaque fois qu’un nouveau dossier tombait sur mon bureau, j’avais pris l’habitude de rencontrer le vice-président du département concerné pour qu’il m’en explique les subtilités. Lorsque se terminait le bail d’une succursale (qui était habi tuel - lement de 10 ans avec une option de 5 années additionnelles), il fallait retourner en appel d’offres. Pour éviter qu’il y ait du favoritisme, une grille d’analyse avait été élaborée en collaboration avec l’École des hautes études commerciales (HEC)43. Cette façon de faire avait été mise en place au début des années 1990 et fonctionnait très bien. Elle tenait compte d’un tas de facteurs, dont, bien entendu, l’emplacement de la succursale et le coût du loyer au pied carré.
Un jour, en 1998, j’ai reçu un dossier qui semblait poser problème quant à la relocalisation de la succursale de Sainte- Thérèse-en-haut. Le vice-président responsable de l’affaire m’a dit que cette succursale était située dans le Vieux-Sainte-Thérèse, que le bail se terminait bientôt et que la SAQ était allée en appel d’offres. L’analyse démontrait qu’il serait préférable de la déménager sur le boulevard Labelle, dans un coin plus achalandé et plus facile d’accès pour les consommateurs. Quinze ans plus tôt, le magasin avait été ouvert dans le vieux secteur de la muni - ci palité parce qu’on y prévoyait un vaste développement, qui ne s’est jamais produit.
Le maire d’alors, Éli Fallu44, a entendu parler du possible déménagement et a décidé de faire campagne contre cette décision de la SAQ. Il répétait que le Vieux-Sainte-Thérèse allait se développer bientôt et qu’une succursale de la SAQ n’était pas une roulotte qu’on pouvait bouger à son gré. Il fallait, selon lui, qu’elle reste où elle était.
Le vice-président ne savait pas comment réagir, car monsieur Fallu avait de très nombreux contacts politiques au Parti québécois, qui était alors au pouvoir. Dans mon esprit toutefois, à la lumière des conclusions de l’étude qui avait été réalisée, il n’était pas question de changer d’idée à cause d’intérêts partisans. La succursale devait déménager.
Je n’avais pas encore beaucoup d’expérience dans ce genre de lobbying politique et il me fallait protéger mes arrières. J’ai donc demandé une réunion avec Bernard Landry, qui était toujours ministre des Finances et vice-premier ministre.
— Le maire de Sainte-Thérèse fait campagne contre le déménagement de la succursale de sa ville, lui ai-je expliqué, mais nous croyons qu’il faut la déplacer.
— À quel endroit?
— Dans un endroit plus passant, sur le boulevard Labelle. Toutes nos études démontrent le bien-fondé de ce changement.
— Gaétan, m’a-t-il répondu, tu sais qu’il va y avoir beaucoup de pression. Est-ce que ton dossier est impeccable?
— Absolument!
— Alors, fais ce que tu as à faire…
Peu après, la SAQ a annoncé officiellement le déménagement de la succursale. Je n’ai jamais subi de pressions à la suite des démarches qu’avait entreprises Éli Fallu pour tenter de faire renverser cette décision. J’ai cependant appris qu’il était monté jusqu’au bureau du premier ministre Lucien Bouchard, qui avait maintenu la position de la SAQ.
L’avenir nous a d’ailleurs donné raison puisque, dès l’ou - verture de la succursale, les ventes ont augmenté de 50 % et cette progression s’est poursuivie par la suite.
Il est compréhensible qu’une ville se sente interpellée par la relocalisation d’une succursale de la SAQ. Toutefois, la grille d’analyse qui avait été développée pour déterminer le meilleur emplacement pour construire une de nos succursales tenait essentiellement compte du service aux consommateurs et de la rentabilité. Il ne pouvait en être autrement. Sainte- Thérèse n’est d’ailleurs pas la seule municipalité à avoir tenté d’influencer nos choix d’emplacements.
À l’été 2000, le même travail d’évaluation a été effectué pour la succursale principale de Boucherville. Celle-ci était alors située aux Promenades Montarville, un important centre commercial. Mais comme la ville s’était énormément développée au cours des 15 années précédentes, il fallait revoir tout le dossier.
Nous avons reçu quatre propositions pour le futur bail. La grille d’analyse avait favorisé celle prévoyant la construction d’une nouvelle succursale entièrement autonome, à proximité du centre commercial, mais non à l’intérieur de celui-ci. Boucherville était alors dirigée par la mairesse Francine Gadbois, qui avait la réputation d’avoir une poigne de fer. Je la connaissais un peu, car elle était l’épouse de Serge Gadbois, qui était viceprésident finances à l’époque où j’étais chez Metro-Richelieu.
Je l’avais, durant cette phase exploratoire, rencontrée par hasard au cours de je ne sais plus quelle activité. Je lui avais laissé entendre que nos premières études ciblaient un terrain près des Promenades Montarville pour bâtir la prochaine succur sale. Mais la discussion n’était pas allée plus loin.
Peu après, j’ai appris qu’elle intervenait auprès de la Société pour savoir où serait construit le futur établissement. J’ai alors demandé à Claude Marier, un de mes vice-présidents, d’aller la rencontrer pour lui expliquer notre choix. Malgré les éclaircissements sur la nature du processus, elle ne voulait rien entendre. Selon elle, l’emplacement retenu n’était pas le meilleur pour le développement de sa ville. Elle suggérait plutôt un autre terrain qui, selon les plans de la municipalité, serait bientôt dans un quartier en plein essor.
Claude Marier lui a répondu que le propriétaire du terrain en question n’avait même pas soumissionné pour qu’une succursale de la SAQ y soit bâtie et, qu’en conséquence, nous n’avions pu faire l’analyse de cette hypothèse. De plus, le site que la mairesse proposait se trouvait à proximité d’une école. Or, il y a une politique non écrite à la Société qui nous suggère de ne pas ouvrir une succursale près d’une institution scolaire.
C’est une question d’éthique.
La mairesse Gadbois ne voulait toujours rien entendre. Elle a répliqué que ce n’était certainement pas la SAQ qui allait lui dire comment développer sa ville.
Dois-je vous dire que j’ai très mal pris la chose quand le vice-président m’a rapporté les propos de la mairesse ? « Eh bien, ce n’est pas la ville de Boucherville qui va me dire comment développer mon réseau », avais-je lancé.
La SAQ n’a pas tardé à annoncer officiellement le choix du futur emplacement de sa nouvelle succursale à Boucherville. Ce choix ne tenait compte que des critères de notre grille d’évaluation et pas des voeux de la mairesse. Mais la ville n’avait, semble-t-il, pas l’intention de laisser les choses suivre leur cours normal. Peu après, le promoteur du projet nous interpellait, car il y avait déjà des délais dans l’échéancier. Il n’arrivait pas à obtenir de la ville son permis de construction et ne pouvait mettre en branle les travaux du nouvel édifice.
Était-ce une stratégie téléguidée par la mairesse Gadbois pour nous forcer à revenir sur notre décision? Possible. C’est du moins ce que plusieurs intervenants ont cru à l’époque. Ce qui m’apparaissait évident, en tout cas, c’est que la ville se traînait les pieds dans ce dossier. Il fallait trouver une façon de réagir. J’ai donc préparé, quelques jours après avoir pris connais - sance de cette situation, un communiqué de presse qui titrait : «La SAQ abandonne son projet d’une nouvelle succursale Sélection à Boucherville ».
Dans le texte, je précisais que le projet de construction d’une SAQ Sélection était abandonné à cause de l’intransigeance de la mairesse et des tracasseries administratives qui étaient imposées. Le message était assez direct.
En réalité, je n’avais pas du tout l’intention de faire parvenir ce texte aux médias. Je voulais plutôt organiser une «fuite» de cette information auprès des proches de la mairesse en espérant que les choses bougent enfin. Heureusement pour nous, c’est ce qui est arrivé. Le lendemain, ou dans les jours suivants, le promoteur a obtenu son permis et les travaux ont débuté.
Le mot a peut-être circulé dans le milieu des municipalités, mais jamais plus, après Éli Fallu et Francine Gadbois, un maire n’a essayé d’influencer ouvertement les décisions de la SAQ.
Les villes et les maires n’étaient pas les seuls à vouloir mettre leur grain de sel dans le fonctionnement de la SAQ. Certains hauts fonctionnaires ont aussi tenté le coup. Ainsi, au terme de ma première année complète d’activité, les profits avaient augmenté de façon notable, si bien que la SAQ prévoyait verser au gouvernement environ 25 millions de dollars de plus que ce qui était prévu au budget. À cette somme s’ajoutait un autre huit millions que nous avions convenu d’inscrire comme bénéfices reportés. Tous les bons gestionnaires mettent ainsi de l’argent de côté en prévision de mauvais jours ou de dépenses extraordinaires qui peuvent survenir.
À l’automne 1999, à mon retour d’un voyage en Angleterre, Gérald Plourde, premier vice-président, direction financière de la SAQ, est venu me voir.
— Tu ne vas pas être content, commença-t-il.
— Bon! Qu’est-ce qui se passe?
— Pendant que tu étais parti, le sous-ministre des Finances a décidé de récupérer les huit millions que nous avions mis de côté.
J’étais furieux. Il fallait que j’en aie le coeur net et que je sache d’où venait cette initiative. J’ai donc immédiatement contacté le bureau de Bernard Landry pour lui faire savoir que je désirais le rencontrer. Ce qui est arrivé, je crois, dès le lendemain.
— Alors, Gaétan, tu veux me parler? me dit-il.
— Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes satisfait des résultats financiers de la Société?
— Oui, bien entendu!
— On vous a remis 25 millions de plus que prévu, ai-je continué comme s’il ne m’avait pas répondu. Et nous avons décidé de garder une somme de huit millions pour que la SAQ puisse faire face, si cela se présente un jour, à d’éventuels problèmes financiers.
— Oui, et c’est très bien.
— Alors pourquoi le ministère est-il venu chercher cet argent ? Et pourquoi est-on venu le chercher pendant que j’étais à l’extérieur ? ai-je continué sans parvenir à dissimuler ma colère.
— Ah oui? a répondu le ministre visiblement surpris.
Et qui aurait fait cette ponction?
— Un des hauts fonctionnaires du ministère. On m’a dit qu’il s’agissait du sous-ministre.
Bernard Landry s’est alors détourné pour prendre son téléphone et contacter sa secrétaire.
— Pouvez-vous, s’il vous plaît, demander à Gilles Godbout de venir me voir immédiatement?
Il n’a fallu que quelques instants pour que le fonctionnaire arrive au bureau de Landry.
— Est-ce que tu es allé chercher un montant de huit millions que la SAQ avait gardé en provision ? lui a-t-il demandé sans autre préambule.
— Effectivement. Nous avons pen…
— Alors, le coupa-t-il, j’aimerais que tu le remettes immédiatement. Et fais-moi savoir quand ce sera fait, ajouta-t-il en le remerciant.
Cette somme, que nous avions mise de côté, avait effectivement été gardée en prévision de moins bons jours. C’est une question de saine gestion. Mais la ponction qui avait été faite m’avait profondément choqué parce qu’elle impliquait soit une ingérence dans mon administration, soit un manque de confiance du ministre à mon endroit. Et, dans les deux cas, il fallait que je clarifie la situation. La réaction de Bernard Landry m’a prouvé que j’avais encore tout son soutien. Elle a aussi montré aux autres fonctionnaires et députés qu’il ne fallait pas tenter de marcher dans mes plates-bandes. Le ministre Landry a, par sa réaction, réaffirmé que c’était moi qui avait les deux mains sur le volant de la SAQ, si je peux reprendre une phrase qu’un autre politicien a rendue célèbre.
Cela dit, c’est en commission parlementaire que j’ai eu le plus de problème avec des élus. Je ne le savais pas au départ, mais chaque année, la Société des alcools du Québec devait se présenter à la Commission parlementaire des finances publiques pour présenter son bilan et ses prévisions pour l’année suivante.
J’ai évidemment pris cette convocation annuelle très au sérieux. C’était le moment de répondre aux questions des députés et de leur expliquer la planification et ma vision du développement de la Société. Inutile de dire que j’étais extrêmement bien préparé. Nous avions en main tous les documents concernant les ventes, les dépenses d’opération, les promotions, les commandites, les bénéfices, les relations de travail, les investissements, les succursales, etc. Bref, j’étais prêt.
Rappelons qu’à l’automne 1999, Lucien Bouchard et le Parti québécois étaient toujours au pouvoir et que les libéraux formaient l’opposition.
Le ministre responsable, Bernard Landry, le premier vice-président, direction commerciale, le premier vice-président, direction financière ainsi que le premier vice-président, direction corporative de la SAQ et moi-même étions assis dans cette salle où le président de la commission et les députés s’apprê taient à nous entendre et, surtout, à nous questionner. Bernard Landry était assis à mes côtés. Deux députés libéraux siégeaient à cette commission : André Tranchemontagne, député de Mont-Royal, et Jacques Chagnon, député de Westmount- Saint-Louis et critique responsable de la SAQ pour l’oppo si tion officielle à cette commission de l’administration publique.
Dès le départ, je me suis rendu compte qu’il s’agissait essentiellement d’un exercice politique. L’opposition voulait, à mon sens, mettre en boîte le ministre en lui posant des questions très précises qui n’avaient aucun lien avec le budget de la SAQ. Chaque fois qu’une telle question était posée, je demandais à monsieur Landry s’il voulait que je réponde à sa place. La plupart du temps, il me laissait la parole. D’ailleurs, à titre de PDG de cette société, j’estimais qu’il aurait été tout naturel que ces questions me soient posées directement. Mais ce n’était pas la procédure. Tout le monde interrogeait le ministre. Qu’à cela ne tienne, monsieur Landry me laissait répondre.
La plupart des interventions étaient faites par Jacques Chagnon45 et elles étaient non seulement enfantines, mais, à mon avis, généralement biaisées. Néanmoins, comme j’étais bien préparé, j’avais réussi à répliquer à toutes ses questions et c’est souvent le député de l’opposition lui-même qui paraissait mal. Ce qui, évidemment, faisait sourire Bernard Landry, qui semblait apprécier ce qui se passait.
Depuis ce jour, Jacques Chagnon a décidé d’avoir sa revanche et de me prendre en grippe. C’est comme ça que je suis devenu une de ses cibles préférées, sa tête de Turc. Régu - lièrement, des interventions de Jacques Chagnon visant la Société des alcools du Québec ou son PDG étaient adressées au ministre Landry. Il s’agissait, la plupart du temps, de vétilles visant à saper ma crédibilité ou celle de la SAQ.
Toute cette histoire a culminé au printemps 2001. Bernard Landry avait remplacé Lucien Bouchard et était devenu, le 9mars, le 36e premier ministre du Québec. Pauline Marois46 avait été nommée vice-première ministre, ministre d’État à l’Économie et aux Finances et ministre des Finances. Elle devenait donc ma patronne.
Cette année-là, j’étais de nouveau convoqué en Commis - sion parlementaire pour présenter les grands dossiers de la Société des alcools du Québec. Depuis mon entrée à titre de PDG de la SAQ, j’avais un chauffeur et une voiture de fonction. C’est cette dernière que je venais de changer pour une Jaguar. Voilà l’étincelle qu’il a fallu pour que les libéraux lancent une chasse aux sorcières. Comment un employé d’une société d’État pouvait-il se pavaner dans une voiture aussi luxueuse?
Désormais, toutes les questions étaient posées à la ministre responsable de la SAQ qui devait, seule, répondre sans mon intervention. Si j’essayais de répondre, j’en étais empêché. Pourquoi donc me demander de venir témoigner si on ne voulait pas m’entendre? J’ai alors compris que le bilan de la SAQ ne les intéressait pas. Ni Jacques Chagnon ni Monique Jérôme-Forget47, alors porte-parole de l’opposition en matière de finances, ne semblaient préoccupés par les états financiers de la SAQ ou par ses projets d’avenir. On souhaitait simplement une querelle avec le gouvernement.
Le député libéral Jacques Chagnon demanda à la ministre des Finances, Pauline Marois, de divulguer la marque de la voiture conduite par le PDG de la SAQ. Les questions les plus significatives posées à madame Marois ne concernaient pas la gestion de la Société, mais la Jaguar de son PDG et son extravagant salaire qui était passé à 157 000 dollars. J’étais vraiment frustré, car je ne pouvais ni parler ni répondre, alors qu’il aurait été si simple de désamorcer cette fausse crise sur-le-champ.
En fait, sur la question de la voiture, voici quelques précisions : tous les PDG de la SAQ, depuis l’époque de la Commission des liqueurs et de la Régie des alcools, ont toujours bénéficié d’une voiture de fonction avec chauffeur. De plus, le prix d’achat de la Jaguar en question était de plusieurs milliers de dollars inférieur au maximum prévu pour ce type de location, selon les politiques écrites de la SAQ. Les critères établis étaient respectés.
Mais il semble que Chagnon voulait brandir son nouveau cheval de bataille : le président d’une société d’État ne devrait pas s’afficher sous des apparences de luxe.
Je réponds en disant que je n’ai jamais eu peur des apparences et que j’affichais mes choix de façon transparente. Je ne suis pas de l’école où nous devons paraître misérables pour mieux passer devant la classe politique.
Heureusement, je n’ai pas vraiment eu à me défendre seul. Ni pour la voiture ni pour le salaire. D’autres l’ont fait pour moi, dont plusieurs journalistes. Ainsi, Mario Roy, de La Presse, écrivait le 8 mai 2001:
« […] la question […] peut se résumer ainsi : ce traitement et ces bénéfices marginaux sont-ils équitables dans le cas d’un homme placé à la tête d’une entreprise de distribution et de vente au détail employant 5000 personnes, possédant 370 comp toirs, générant un chiffre d’affaires de deux milliards, et remettant au Trésor public québécois une enveloppe d’un demi-milliard?
« Sous cet angle, la réponse paraît évidente.
« […] Les libéraux, qui ont enfourché ce cheval avec ardeur, feraient bien de considérer qu’un jour ou l’autre, ils vont accéder au pouvoir. Et qu’ils auront alors à recruter des admi - nis trateurs efficaces pour la fonction publique en général, pour les sociétés paraétatiques en particulier.
« Ils n’en trouveront pas à embaucher au salaire minimum, qui se contenteront d’une trottinette électrique pour se véhiculer. »
En juillet 2011, René Vézina, de la revue Commerce, publiait un billet sur le sujet où il se faisait aussi assez cinglant:
« Gaétan Frigon fait faire des affaires d’or à la Société des alcools du Québec. […] Nos gestionnaires de sociétés parapu bliques livrent enfin la marchandise comme nous le sou haitons : les clients sont satisfaits et les gouvernements regorgent de dollars pour arrondir leurs fins de mois. […] Or, que fait le Parti libéral du Québec, en mal de cause? Il pourfend ce vilain Gaétan Frigon et son abominable salaire de 160000 dollars par an, parce qu’il a osé choisir une Jaguar comme limousine de fonction. […] La SAQ, Hydro-Québec et d’autres jouent à l’égal des grandes sociétés. Pour réussir, il leur faut de grands entrepreneurs. Et on n’attire ni ne conserve des leaders avec du beurre de pinottes. Si jamais ils se plantent, tant pis, on pourra leur taper dessus. Mais de grâce, n’allons pas ressortir des boules à mites les vieux arguments puritains et exiger que les administrateurs de l’État jouent les pauvres afin de ne pas effaroucher les contribuables. […] »
Car c’était peut-être là l’enjeu véritable des libéraux. Tenter d’orienter l’électorat en laissant croire que les mandarins de l’État devaient paraître misérables. Or, la réalité est tout autre. Le député de Marguerite-D’Youville a voulu l’expliquer dans le journal La Relève du 8 juin 2001. Il écrit:
« […] À 157 000 dollars par année plus des bonis pouvant atteindre 16 000 dollars, le président de la SAQ – une entreprise avec un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars – est payé 10 fois moins que le PDG de Metro qui, en 2000, a empoché plus d’un million de dollars en salaire et en primes. Sans parler de la vente de ses actions qui ont fait grimper son revenu à six millions de dollars. […] ) »
Non satisfait semble-t-il de cette histoire de salaire et de voiture, le député Chagnon en avait rajouté en mettant en doute le bien-fondé des primes versées aux cadres supérieurs pour l’achat de vin. Un autre sujet sur lequel les libéraux auraient dû réfléchir avant de parler. Il faut au moins connaître l’histoire de la SAQ avant de faire la leçon. Avant mon arrivée, sous le règne des libéraux et de l’ancienne administration, tant les vice-présidents que le président de la SAQ pouvaient puiser dans les réserves de la cave de la Société pour s’approvisionner, car aucune politique écrite ne venait en délimiter les paramètres. J’avais mis fin à ce régime en adoptant une politique officielle qui limitait les dépenses dans ce domaine. Non seulement les montants disponibles étaient alors contingentés, mais en plus, ils n’étaient remboursés que sur présentation de pièces justificatives.
Mais au fond, ce qui m’embêtait le plus dans toute cette histoire, c’est que je considérais qu’aucun élu, de quelque formation politique qu’il soit, n’aurait dû avancer des propos aussi arbitraires pour de simples considérations bassement électora - listes. Ce genre d’attitude n’est payant pour personne et n’aide pas à construire le Québec. Ça ternissait l’image de la Société des alcools du Québec et particulièrement celle de ses employés.
Dans toute cette saga, et à travers tout ce qui s’est dit et écrit, il y a un texte que je conserve précieusement parce qu’à mes yeux, il représente la somme de tous les efforts que nous avons faits pour ramener des relations de travail harmonieuses à la SAQ et pour créer, autant que faire se peut dans une entreprise si importante, un esprit d’équipe. Il s’agit d’une prise de position officielle du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB), émise par communiqué le 11 juin 2001, dont je me permets de reprendre quelques lignes:
« Le Syndicat […] dénonce à son tour les attaques pernicieuses de l’opposition libérale du Québec à l’endroit de la SAQ et se dit prêt à la mobilisation générale pour faire front commun contre l’attitude du PLQ. »
« Le SEMB, qui représente le plus important syndicat à la SAQ avec quelque 3586 membres, condamne vivement l’opposition libérale qui ne cesse de ternir l’image de la SAQ et de ses dirigeants par des accusations farfelues et des insinua tions malveillantes. Nous demandons au chef de l’opposition, Jean Charest, de mettre un terme à cette saga sur la Jaguar, le motorisé et les frais de remboursement de boissons alcooliques. Sinon, nous allons mobiliser l’ensemble de nos membres et la population pour lutter contre ces agissements.
« […] le Parti libéral est en train de saper et de détruire le travail de toute une équipe, celle de la direction et des employés de la SAQ qui, par leur acharnement, ont contribué à propulser les ventes et le bénéfice net de l’entreprise au cours des dernières années et à faire de la SAQ l’une des sociétés d’État les plus florissantes et la plus admirée des Québécois. […] »
Pour en terminer avec cette histoire de Jaguar, le mot de la fin revient à Bernard Landry qui, répondant à une question d’un journaliste a dit : « Ce que je pense de Gaétan Frigon ? Il a transformé la SAQ en véritable… Jaguar!»
Il ne faut pas oublier que les députés qui critiquaient la SAQ ou son PDG à l’Assemblée nationale bénéficiaient de l’immunité parlementaire. Malheureusement, la plupart d’entre eux n’osaient pas répéter leurs accusations en dehors de cette enceinte, car ils auraient alors été sujets à poursuite judiciaire, comme n’importe quel autre citoyen. Certains animateurs de radio n’ont pas pris ces précautions et allaient, selon moi, beaucoup trop loin. En voici d’ailleurs un exemple.
André Arthur, de la station CHRC, avait l’habitude de critiquer tant la SAQ que son PDG sur toutes sortes de sujets.
Cette habitude avait d’ailleurs débuté bien avant mon arrivée à la SAQ. Mon prédécesseur, Jocelyn Tremblay, avait, paraît-il, longtemps été sa tête de Turc. Quant à moi, je ne m’en faisais pas trop avec ces accusations frivoles en provenance de stations de radio dites « poubelles ».
Mais une bonne journée, André Arthur a dépassé les bornes. Il a utilisé des termes qui insinuaient que nous étions tous un « gang » de voleurs. Je me suis dit qu’il ne l’empor - terait pas au paradis. La SAQ a intenté une poursuite de 500 000 dollars non seulement contre lui, mais contre le poste de radio CHRC, contre Radiomutuel, la compagnie propriétaire du poste de radio, et contre tous les administrateurs de Radiomutuel, dont Normand Beauchamp, Claude Beaudoin et Paul-Émile Beaulne. Ces derniers ne l’ont évidemment pas trouvée drôle, mais ils ont vite compris que je n’avais pas, moi non plus, trouvé amusantes les calomnies d’André Arthur.
Ils ont laissé moisir le dossier plusieurs mois jusqu’à ce qu’ils réalisent que la poursuite en question se devait d’être inscrite dans leur rapport annuel. C’est alors que j’ai reçu un appel d’un des administrateurs de la station. Il voulait régler l’affaire rapidement et à l’amiable. Mes conditions étaient simples: ils devraient verser une somme substantielle à deux fondations déterminées par la SAQ et s’assurer qu’André Arthur ne parle plus jamais, en bien ou en mal, de Jocelyn Tremblay et de Gaétan Frigon.
Les dirigeants de la station ont accepté, sans condition. La somme a été versée et André Arthur n’a plus jamais parlé de nous deux.
* * *
Mon passage à la Société des alcools du Québec a aussi été marqué par plusieurs anecdotes dont certaines sont amusantes, d’autres moins. Quelques-unes me semblent intéressantes à raconter. Les voici:
Mes relations avec Pauline Marois ont toujours été un peu en dents de scie, parfois bonnes, parfois plus difficiles. Environ deux mois après sa nomination comme ministre des Finances, alors que je me rendais en voiture à New York pour une réunion, j’ai reçu un appel de Nicole Stafford, sa chef de cabinet. C’était un vendredi après-midi d’automne, si ma mémoire est exacte.
Le matin, avant mon départ, la SAQ avait fait parvenir un communiqué aux médias présentant les résultats financiers trimestriels de la Société.
— Monsieur Frigon, a-t-elle commencé, la ministre a su que vous aviez envoyé un communiqué pour annoncer vos états financiers, Or, ce document n’a pas été approuvé par madame Marois au préalable.
— Ça fait 80 ans que la SAQ existe, lui ai-je répondu assez sèchement, et jamais le président n’a fait accepter ses résultats par le ministre responsable et ce n’est pas moi qui vais commencer. Il appartient au conseil d’administration d’approu ver les états financiers de la SAQ, et non à la ministre.
— Il arrive que les procédures changent, a-t-elle poursuivi.
— Écoutez-moi bien ! C’est le gouvernement qui nomme les membres du conseil d’administration de la SAQ et c’est la seule instance qui a à accepter les états financiers. Point final.
La discussion était terminée et j’ai raccroché. La ministre ne m’en a jamais reparlé par la suite et je n’ai jamais su non plus si la demande venait directement d’elle ou si madame Stafford avait pris quelques libertés.
Admettons toutefois que les commentaires que j’avais formulés n’étaient pas de nature à bonifier mes relations avec la ministre responsable de la SAQ.
À l’automne de l’an 2000, j’ai reçu un appel d’André Bourbeau, qui avait été ministre des Finances dans un précédent gouvernement libéral.
— Gaétan, m’a-t-il dit, Jean Charest est très mécontent. Il vient de recevoir une facture salée de la SAQ. Il s’agit d’une facture de taxes pour une caisse de vin qu’il a achetée en Californie et qui a été dûment déclarée aux douanes canadiennes à son retour. Il trouve totalement exagéré le montant qu’on lui réclame et veut même soulever le point à l’Assemblée nationale.
— Laisse-moi vérifier, André, et je te reviens aussitôt que possible, lui ai-je répondu.
Quelques heures plus tard, je le rappelais en lui disant:
— André, tu as la mémoire courte. Lorsque tu étais ministre des Finances, c’est toi qui avais demandé à la SAQ de taxer, comme s’ils avaient été achetés au Québec, les vins provenant de l’étranger et rapportés au Québec par des individus. L’objectif de ta mesure visait à décourager ce genre d’achats à l’étranger. Voilà ! As-tu d’autres commentaires?
— Oups! fut sa réponse…
À l’automne 2001, Jacques Parizeau48 avait appelé la SAQ pour savoir ce qu’il devait faire pour que son vin, le Coteau de l’Élisette, soit vendu en succursale. Jacques Parizeau avait effectivement un vignoble situé à Collioure, dans le sud de la France, où il produisait son propre vin.
Par politesse et respect pour l’individu, j’avais décidé de le recevoir moi-même, à mon bureau, pour lui expliquer la politique de la SAQ à ce sujet. Ce que j’ai fait.
Peu après, je me souviens très bien d’avoir appelé le responsable du contrôle de la qualité pour lui dire : « Si le vin de Jacques Parizeau rencontre nos normes, je veux que la SAQ l’accepte. D’une part, il n’a que quelques centaines de caisses disponibles et, d’autre part, bon ou pas bon, ce vin va se vendre à la vitesse de l’éclair simplement parce que c’est celui de Jacques Parizeau. » C’est d’ailleurs ce qui est arrivé, car les journaux s’étaient emparés de la nouvelle. Tout le vin de Jacques Parizeau s’est vendu avant même qu’il n’atteigne les tablettes des succursales.
Au printemps 2000, alors que je siégeais au comité exécutif de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal, France Chrétien-Desmarais, qui venait de remplacer Monique Leroux comme présidente du conseil d’administration, s’était approchée de moi pour me demander si j’avais des idées origi - nales qui permettraient de lancer un nouvel événement majeur. Sur le moment, tout ce que j’ai pu lui dire, c’est que j’y songerais.
L’année précédente, j’avais entendu un reportage diffusé à CBC49 où on avait présenté une étude scientifique danoise prouvant que le vin rouge et le coeur faisaient bon ménage. Les chercheurs avaient suivi plus de 13 000 hommes et femmes pendant une période de 16 ans et ils avaient découvert que ceux qui consommaient modérément du vin réduisaient consi - dérablement leurs risques de souffrir de maladies cardiovasculaires par rapport à ceux qui n’en prenaient pas.
C’était une piste de travail stimulante qui m’a donné une idée, considérant que la SAQ oeuvrait dans les « vins » et que la Fondation de l’Institut de Cardiologie oeuvrait dans les « coeurs».
J’ai proposé à France d’organiser le « Grand Bal des Vins-Coeurs ». Il s’agirait d’un événement prestigieux où les convives paieraient pour déguster de très grands crus fournis par la Société des alcools du Québec.
La suggestion a été rapidement acceptée et le premier bal a été organisé à l’automne 2000. À cette occasion, plus de 600 convives, en tenue de soirée, ont pu déguster de grands vins en écoutant les commentaires de conseillers de la SAQ qui expliquaient les caractéristiques des produits servis. Ce premier Grand Bal des Vins-Coeurs a rapporté près de 500 000 dollars à la Fondation. Le 6 septembre 2012, lors de sa 12e édition, cette soirée tenue à la salle des pas perdus de la gare Windsor a réuni près de 850 convives et a permis d’amasser 2,4 millions de dollars.
Le Grand Bal des Vins-Coeurs n’a donc cessé de grandir et de profiter de l’engagement des gens d’affaires. Je suis d’ailleurs heureux que la SAQ y soit toujours associée. Comme quoi le vin et le coeur font effectivement bon ménage.
* * *
À sa deuxième édition, en 2001, le Grand Bal avait encore attiré beaucoup de monde. Toutefois, je n’étais pas présent à cette édition. En effet, Paul Kefalas, qui était membre du conseil d’administration de la Société des alcools du Québec, m’avait proposé, ainsi qu’à quatre autres couples, de louer un bateau et d’aller passer quelques jours à faire le tour des îles grecques. Paul, d’origine grecque, est un excellent ambassa - deur de son ancien pays et a merveilleusement su nous présenter son idée. Évidemment, chacun payait ses dépenses. «Et pourquoi pas ? » me suis-je dit. L’occasion était propice et nous étions, Hélène et moi, mûrs pour des vacances. Rapide - ment, nous avons organisé cet extraordinaire voyage. Parmi ceux qui avaient été approchés par Paul, il y avait Alexandre de Lur Saluces, un de ses bons amis que l’on connaissait comme étant le comte de Saluces et dont la famille était propriétaire depuis plusieurs centaines d’années du Château d’Yquem, dans la région de Sauternes, en France. Pour ceux qui l’ignorent, le Château d’Yquem50 est l’un des plus prestigieux vins français.

Bref, les six couples s’étaient retrouvés à Athènes aux alentours du 7 septembre et nous sommes partis pour notre croisière. Le 11 septembre, nous nous trouvions quelque part dans les îles grecques. Nous étions, pour la plupart, sur le pont du bateau car il faisait beau. Le capitaine avait mis le navire à l’abri dans une petite baie, car le vent soufflait et nous voyions, plus loin, la haute mer où les vagues étaient carrément mauvaises. Mais c’était sans danger pour nous.
Vers 15 heures, heure de la Grèce, le comte Alexandre, avec son téléphone satellite, a contacté son bureau en France pour s’assurer que tout allait bien. Il était 15 heures pour nous et 9 heures à New York, heure à laquelle un avion s’est écrasé sur l’une des tours du World Trade Center. Sa secrétaire, cons - ternée, lui décrivait ce qui se passait, en direct, à la télévision. Soudainement, pour nous comme pour le reste de la planète, le monde a basculé. Nous nous demandions ce que nous faisions là alors que des événements tragiques se passaient tout près de chez nous.
Malgré la mer agitée, nous avons réussi à convaincre le capitaine de prendre le large pour gagner une île d’où nous pourrions avoir d’autres nouvelles et contacter nos proches. La houle, trop forte, a empêché le capitaine d’accoster et nous avons dû revenir à notre point de départ, dans la baie qui nous abritait. Ce n’est que deux jours plus tard que nous sommes arrivés à l’île de Santorini, où nous avons dévoré les journaux anglais pour comprendre ce qui s’était passé à New York. Nous en avions déjà une bonne idée, puisque chacun d’entre nous, par téléphone satellite, avait contacté ses proches ou son bureau pour connaître les développements et les répercussions de cette tragédie.
Je peux, comme des milliers d’autres personnes dans le monde, vous garantir que je me souviendrai toujours de l’endroit où j’étais quand est survenu ce tragique événement. Mais peu de personnes pourront dire qu’elles l’ont appris de la bouche de la secrétaire d’Alexandre de Lur Saluces…
À une autre occasion, nous étions en France, dans la région de Bordeaux, où se tient aux deux ans Vinexpo, le grand salon international du vin et des spiritueux. C’est le rendez-vous des grossistes, détaillants, acheteurs de la grande distribution, restaurateurs, sommeliers, importateurs et autres professionnels du domaine. Un événement incontournable pour le PDG de la Société des alcools du Québec.
Nous avions prévu visiter quelques-uns des nombreux châteaux qui se trouvent dans la région de Bordeaux. Lors de l’une de nos visites, on nous a présenté Emile Castéja, propriétaire du Château Batailley51. Il produisait l’un des plus grands crus Pauillac. L’homme devait avoir 80 ans et faisait très «vieille France ». Nous avons discuté un moment, puis il nous a invités à dîner à son château le soir même.
À 19 heures, comme prévu, notre petite délégation est arrivée au château. Il y avait, entre autres, Pierre Parent, le président du conseil d’administration de la SAQ, sa conjointe, Carmen Catelli, et Hélène m’accompagnait. Le château était une magnifique propriété qui s’ouvrait sur une immense cour intérieure. Au milieu de ce jardin providentiel se trouvait un arbre gigantesque qui semblait protéger les environs. Le domaine était énorme et splendide.
Nous nous en sommes approchés et, comme il faut le faire dans n’importe quelle maison, j’ai frappé à la porte principale.
Au bout de quelques instants, une dame âgée est venue nous répondre.
— Monsieur Frigon? a-t-elle demandé avec l’extraordinaire accent de cette région.
— Oui, madame. Nous venons rencontrer monsieur Emile Castéja.
— Oui, je sais, répondit doucement la dame. C’est mon mari. Et savez-vous, monsieur Frigon, où est mon mari?
— Non, lui ai-je répondu.
— Mon mari est à l’étage.
— Ah bon!
— Et savez-vous, monsieur Frigon, ce qu’il fait à l’étage?
— Non ! — Il écoute la radio.
— Bien! ai-je répondu, ne sachant trop où cette discussion nous mènerait.
— Et savez-vous, monsieur Frigon, pourquoi il écoute la radio?
— Pas la moindre idée, madame.
— Il écoute toutes les chaînes en espérant que l’une d’entre elles annoncera du beau temps demain pour que les vendanges puissent commencer. Mais jusqu’à maintenant, on ne prévoit que de la pluie. Il écoute la radio en se disant qu’un poste finira bien par annoncer du beau temps…
Et voilà comment nous avons commencé notre soirée au château. L’épouse d’Emile Castéja, Denise Borie, avait un sens de l’humour extraordinaire. Ce sens de l’humour pincesans- rire qui lui permettait parfois de dire à son mari ses quatre vérités. Mais toujours de façon absolument sympathique et amicale. C’était tout à fait charmant. D’ailleurs, son mari n’était pas en reste.
Pendant le souper, il était assis tout à côté d’Hélène, avec qui il s’entretenait de tout et de rien.
— Vous savez, lui raconta-t-il, la semaine dernière, je suis tombé en panne avec la voiture. J’ai été obligé d’attendre de longues minutes sur le côté de la route avant que quelqu’un passe et me donne un coup de main.
— Mais vous n’avez pas de téléphone cellulaire ? lui a demandé Hélène.
— Vous n’y pensez pas, madame. Ma femme pourrait me joindre partout et en tout temps. Ce ne serait pas une vie!
C’est dans cette atmosphère cordiale que nous avons dégusté un dîner exceptionnel dans une salle magnifique en savourant une ou deux bouteilles de la prestigieuse cave de nos hôtes.
J’ai eu la chance de participer à plusieurs autres dîners mémorables à titre de PDG de la SAQ. En voici quelques-uns:
Avec la baronne Philippine de Rothschild, la fille du baron Philippe de Rothschild, propriétaire de Mouton Rothschild.
Avec le marquis Antinori et ses trois filles, Albiera, Allegra et Alessia, de la fameuse maison du même nom en Italie.
Avec Vittorio Frescobaldi, de la maison du même nom, également en Italie.
Avec Colette Faller et ses deux filles, Catherine et Laurence, du domaine Weinbach, en Alsace.
Avec Jean-Pierre et François Perrin, producteurs du Château Beaucastel, un châteauneuf-du-pape très connu.
Avec Pierre-Henry Gagey, sa femme et leurs deux jeunes enfants, de la Maison Louis Jadot, à leur résidence de Beaune, en Bourgogne.
Avec Robert Mondavi et son fils Michael, à leur vignoble en Californie.
Avec le directeur général de Penfolds, à son restaurant Magill Estate à Adelaide, en Australie.
Avec Mario Saradar, propriétaire de la Banque Saradar, à sa résidence de Beyrouth, en compagnie du propriétaire de la maison Massaya, un vignoble de la vallée de la Bekaa, au Liban.
Et surtout avec Jean-Claude Boisset, son épouse, son fils Jean-Charles et sa fille Nathalie, à leur domaine de Nuits- Saint-Georges, en Bourgogne, un ancien couvent des Ursulines. Aujourd’hui, Jean-Charles est marié avec Gina Gallo, la petite-fille du fondateur de la maison Ernest & Julio Gallo, en Californie.
Au printemps 1999, j’avais planifié un voyage pour aller visiter de grands vignobles italiens. Mes collaborateurs et moi avions pris des ententes avec chacun des producteurs que nous voulions rencontrer pour établir notre itinéraire.
Quelques semaines avant de partir, j’ai reçu une lettre d’un certain Giorgio Lungarotti, dont j’ignorais tout. Sa lettre, manuscrite et en français, se lisait à peu près ainsi:
« Cher Monsieur Frigon,
J’ai appris que vous veniez visiter des vignobles italiens et que, malheureusement, le mien ne se trouvait pas sur votre route. J’ai 88 ans. J’ai rencontré et connu vos prédécesseurs et on m’a beaucoup parlé de vous en bien. Alors j’insiste un peu, car j’apprécierais que vous veniez voir mon domaine et goûter à mes vins. Je vous invite d’ailleurs à mon hôtel, Le Tre Vaselle à Torgiano52, qui se fera un plaisir de vous accueillir. »
Comme je ne savais pas de qui il s’agissait, j’ai consulté l’un des experts de la SAQ qui m’a expliqué que Giorgio Lungarotti était propriétaire de l’un des vignobles les plus reconnus d’Italie. J’ai donc vérifié où était située la ville de Torgiano pour me rendre compte qu’elle était à peine à une centaine de kilomètres de Rome, où se terminait notre voyage. Il était donc facile de modifier notre itinéraire pour inclure une visite chez ce producteur. Je lui ai confirmé que nous passerions le rencontrer le 16 avril en matinée, ce qui nous permettrait de revenir en après-midi sur Rome.
La veille de notre rendez-vous, nous avons réservé une chambre à l’hôtel Le Tre Vaselle. Au matin, vers huit heures, nous attendions tel que convenu dans le hall de l’hôtel que monsieur Lungarotti vienne nous y retrouver. Or, c’est plutôt Theresa, l’une de ses deux filles, qui s’est présentée. Elle nous a expliqué que son père ne se sentait pas très bien et qu’il devait se reposer un peu avant de venir nous saluer. En l’attendant, elle nous proposait de visiter leur vignoble.
Vers 10 heures, la tournée étant presque complétée, Theresa a appelé à la maison pour apprendre que son père n’allait pas mieux et qu’il devait rester au lit. Comme nous devions reprendre la route, je lui ai demandé de le saluer pour nous et de lui dire que je profiterais d’un autre voyage pour venir le rencontrer. J’y tenais étant donné la belle lettre qu’il m’avait envoyée avant mon départ.
Vers midi, nous sommes arrivés à notre hôtel à Rome. Nous avons alors reçu un message nous annonçant que monsieur Lungarotti était décédé une heure plus tôt.
Je n’ai donc jamais eu le plaisir de rencontrer cet homme, lui qui était une des célébrités parmi les producteurs de vin italiens. J’avais cependant pu faire la connaissance de sa fille qui, avec sa soeur Chiara, a ensuite repris l’entreprise qui fonctionne encore aujourd’hui.
Un soir de juin 2001, à la salle Claude-Champagne de l’Université de Montréal, j’avais choisi de répondre à mes détracteurs avec humour. Plus de 700 personnes étaient réunies dans le cadre d’une soirée-bénéfice pour entendre un concert de l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal, alors que 6 PDG avaient été invités à jouer les maestros. J’étais l’un de ceux-là. L’activité visait à recueillir des fonds pour cet orchestre.
Quand mon tour est venu, je me suis avancé sur la scène, vêtu d’une queue-de-pie en soie bleue et portant fièrement une abondante perruque blanche. J’ai regardé sérieusement le public, je me suis incliné pour saluer et je me suis retourné pour faire face aux musiciens. Dans mon dos étaient épinglés des logos de la SAQ, de Jaguar et de Winnebago, ce véhicule qu’on m’avait reproché d’avoir stationné au siège social de la Société. Les gens ont aussitôt compris mon message et se sont mis à rire et applaudir. J’avais fait mon petit coup de théâtre!
* * *
Malgré tous les succès de la SAQ, il s’agit quand même d’un monopole avec toutes les restrictions que cela impose. Par exemple, si la Société refuse un vin qui lui est proposé par un agent, ce vin ne peut tout simplement pas être vendu en succursale. La conséquence directe est que même si la SAQ offre des milliers de vins différents, il en reste des dizaines de milliers d’autres qui ne sont pas accessibles aux consommateurs québécois.
J’avais trouvé une façon d’atténuer ce problème.
En effet, je souhaitais ouvrir une succursale unique et géante qui serait appelée SAQ Découvertes. L’idée était simple : tous les fournisseurs de la planète, dont les vins ne sont pas offerts à la SAQ, auraient été invités à envoyer, à leurs frais et sur une base de vente garantie, une petite quantité de leurs meilleurs produits, lesquels auraient été proposés dans la succursale SAQ Découvertes.
Ladite succursale aurait alors offert des milliers de nouveaux vins que les consommateurs auraient été en mesure d’acheter et de goûter. Cette succursale aurait servi de laboratoire en permettant de démocratiser la sélection des nouveaux produits. En effet, les produits les plus populaires de la SAQ Découvertes auraient pu ensuite se retrouver dans les succursales régulières. Ce faisant, ce sont les consommateurs qui en bout de ligne auraient décidé de la sélection des produits à la SAQ.
Malheureusement, j’ai quitté la SAQ pour Loto-Québec avant même d’avoir pu mettre en oeuvre ce projet, et mes succes seurs n’y ont pas donné suite.
* * *
Quand, au printemps 2001, Bernard Landry est devenu premier ministre, Claude H. Roy, avec qui j’avais travaillé puis - qu’il était premier vice-président, affaires corporatives, à la Société des alcools du Québec, est devenu son chef de cabinet. Même après sa nomination, nous avons continué à nous parler assez régulièrement pour discuter de certains dossiers53.
Un jour, en janvier 2002, il m’a donné un coup de fil.
— Gaétan, m’a-t-il dit, Michel Crête54 terminera bientôt son mandat à Loto-Québec. Le premier ministre souhaiterait que tu prennes le poste.
— Je ne suis pas certain que ça m’intéresse. D’abord, il me reste une année à faire pour compléter mon mandat à la SAQ et puis je ne suis pas convaincu de vouloir m’embarquer pour un autre cinq ans…
— Prends le temps de réfléchir. On se reparle bientôt.
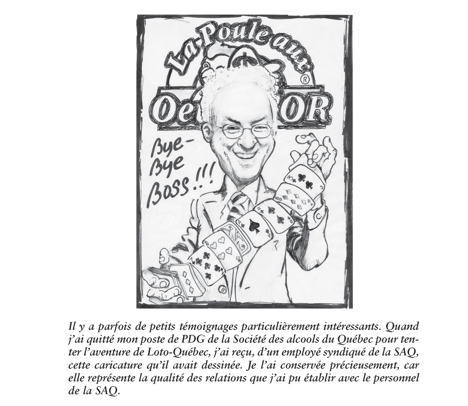
J’avais 62 ans. Est-ce que je voudrais, l’année suivante, prendre un autre mandat quinquennal à la SAQ ? J’en doutais. Au fond, j’avais le choix. Soit je terminais mon mandat à la SAQ et je revenais ensuite à Publipage, soit j’abandonnais tout de suite mon poste à la SAQ et j’acceptais celui à Loto-Québec.
J’en ai naturellement parlé avec Hélène. Selon elle, c’était un défi extraordinaire à relever et elle me voyait bien accepter ce poste. Et je dois avouer que plus j’y pensais, plus l’expérience m’attirait. J’ai finalement acquiescé.
Ainsi, après quatre années de mandat à la Société des alcools du Québec, je partais entreprendre une nouvelle mission.
Je laissais une entreprise florissante où j’avais plus que comblé les attentes. Pendant mon séjour, les ventes nettes étaient passées de 1,136 milliard de dollars à près de 2 milliards. Les profits qui avaient diminué, ou au mieux stagné, pendant les 10 ans qui ont précédé mon arrivée, avaient bondi en 4 ans. Les Québécois, comme le gouvernement, étaient heureux des résultats que nous avions atteints. D’une certaine façon, j’avais le sentiment d’avoir remis cette société aux consommateurs et j’en étais fier55.
J’ajouterais que les employés aussi étaient satisfaits de ce renversement de situation qui avait permis de bons échanges avec les syndicats, et qui, surtout, les avait rendus fiers de leur travail et de leur employeur. La SAQ était devenue l’une des entreprises les plus appréciées des Québécois, avec un taux de 95 % selon un sondage préparé par le journal Les Affaires en septembre 2001.
Personne ne pouvait nous enlever le crédit de ce qui avait été accompli.