L’Ancien Paris, les quartiers
Tandis que l’arc de triomphe de la porte Saint-Denis et la statue équestre de Henri le Grand, ces deux ponts, ce Louvre, ces Tuileries, ces Champs-Élysées égalent ou surpassent les beautés de l’ancienne Rome, le centre de la ville, obscur, resserré, hideux, représente le temps de la plus honteuse barbarie.
VOLTAIRE,
Hélas ! le vieux Paris disparaît avec une effrayante rapidité.
BALZAC,
« Je gagnais d’abord, après bien des détours, la rue Montmartre et la pointe Saint-Eustache ; je traversais le carreau des Halles, alors à ciel ouvert, au milieu des grands parapluies rouges des marchandes de poisson ; puis les rues des Lavandières, Saint-Honoré et Saint-Denis ; la place du Châtelet était bien mesquine à cette époque et la renommée du Veau qui Tette en éclipsait les souvenirs historiques. Je franchissais le vieux Pont-au-Change que je devais plus tard faire également reconstruire, abaisser, élargir ; je longeais ensuite l’ancien palais de justice, ayant à ma gauche l’amas ignoble de tapis francs qui déshonorait naguère encore la Cité, et que j’eus la joie de raser plus tard, de fond en comble – repaire de voleurs et d’assassins, qui semblaient là braver la Police correctionnelle et la Cour d’assises. Poursuivant ma route par le pont Saint-Michel, il me fallait franchir la pauvre petite place où se déversaient, comme dans un cloaque, les eaux des rues de la Harpe, de la Huchette, Saint-André-des-Arts et de l’Hirondelle… Enfin, je m’engageais dans les méandres de la rue de la Harpe, pour gravir ensuite la Montagne Sainte-Geneviève et arriver, par le passage de l’hôtel d’Harcourt, la rue des Maçons-Sorbonne, la place Richelieu, la rue de Cluny et la rue des Grès, sur la place du Panthéon, à l’angle de l’École de Droit2. » Tel est l’itinéraire d’Haussmann, étudiant en droit habitant la Chaussée-d’Antin, au début de la monarchie de Juillet. À son époque, le centre de la ville n’a guère changé depuis trois cents ans. Le Paris inscrit dans le boulevard de Louis XIV, ce carré aux angles légèrement émoussés où l’on peut voir une figure de la densité et de la contrainte, est encore une ville du Moyen Âge. Comme le couteau de Jeannot dont on change tantôt le manche et tantôt la lame mais qui reste toujours le couteau de Jeannot, les rues de Paris, dont les maisons avaient été une par une remplacées au fil du temps, restaient des rues médiévales, tortueuses et sombres. « Hugo évoquant le Paris de Louis XI n’avait qu’à regarder autour de lui ; les rues noyées d’ombre où se perdent Gringoire et Claude Frollo ne sont pas tellement différentes de ces rues du Marais, de la Cité, des boulevards eux-mêmes où il allait errant dans les années 1830 et qu’il nous décrit, en phrases également chargées de ténèbres, d’obscurité, de danger, en un mot de nuit, dans Choses vues3. » Dans les années 1850, Privat d’Anglemont décrit, « derrière le Collège de France, entre la bibliothèque Sainte-Geneviève, les bâtiments de l’ancienne École normale, le collège Sainte-Barbe et la rue Saint-Jean-de-Latran, tout un gros pâté de maisons connu sous le nom de Mont-Saint-Hilaire…. quartier tout emmêlé de petites rues sales et étroites…. vieilles, noires et tortueuses4 ». Et les métiers qu’on y pratique – fabricants d’asticots, cuiseurs de légumes, loueurs de viandes, peintres de pattes de dindons, culotteurs de pipes – sont issus eux aussi des tréfonds du Moyen Âge.
Sous le Second Empire, en vingt ans, l’éclairage au gaz, les grandes percées, l’eau en abondance, les nouveaux égouts bouleversent la physionomie de la ville plus que les trois siècles précédents (« Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet, ce qu’il entend par progrès, il répondra que c’est la vapeur, l’électricité et l’éclairage au gaz, miracles inconnus aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens », écrit Baudelaire dans l’Exposition universelle de 1855). Pourtant le Moyen Âge n’a pas disparu de Paris au XIXe siècle. Juste avant la guerre de 1914, Carco décrit encore un quartier Latin où Villon ne se serait pas senti si dépaysé : « Rue de l’Hirondelle, à deux pas de la Seine que l’on gagnait par l’étroit et puant couloir de la rue Gît-le-Cœur, la clientèle, composée d’anarchistes, de rôdeurs, d’étudiants, de drôles, de trottins, de pauvresses, festoyait à bon marché…. S’il existe quelque part au monde, dans les ports, des quartiers réservés à la perversité humaine qui passent l’ignominie de ceux qui avoisinent la Seine et s’étendent autour de la rue Mazarine, où sont-ils ?5 » Et jusqu’à la fin des années 1950, les ruelles entre Maubert et la Seine – rues de Bièvre, Maître-Albert, Frédéric-Sauton –, le quartier Saint-Séverin, la rue Mouffetard, étaient encore sales et misérables. Dans son parcours parisien du côté des pauvres, Jean-Paul Clébert décrit les cuisines de la rue Maître-Albert, « cette ruelle en coude qu’évitent les inhabitués, invisibles de la chaussée et dans lesquelles on pénètre par le côté, empruntant le couloir d’accès aux étages, et il faut pousser une porte au hasard, la première à tâtons, pour tomber d’une marche dans une salle grande comme une cage à poules, en pleine famille6 ». À la Contrescarpe on rencontrait plus de clochards que de situationnistes, et dans certains cafés il n’était pas facile d’entrer pour qui n’était pas alcoolique et déguenillé. Il n’y avait là ni touristes, ni restaurants, ni boutiques. Les hôtels louaient des chambres à la journée à des travailleurs immigrés auxquels on ne demandait pas leurs papiers. Les locaux du MTLD de Messali Hadj étaient rue Xavier-Privas, à deux pas de Notre-Dame. Contrairement à une idée répandue, la véritable éradication du Moyen Âge à Paris n’a pas été menée à son terme par Haussmann et Napoléon III mais par Malraux et Pompidou, et l’œuvre emblématique de cette disparition définitive n’est pas Le Cygne de Baudelaire mais plutôt Les Choses de Perec.
*
Ville de formation médiévale, l’Ancien Paris en garde le caractère dans la façon dont ses quartiers sont assemblés. Sur la rive droite, ils sont quatre gros noyaux compacts : le Palais-Royal, le plus récent, avec ses satellites que sont le quartier Tuileries-Saint-Honoré et le quartier de la Bourse ; les Halles, le plus ancien des quatre et le plus maltraité ; le Sentier, qui change sous nos yeux ; et le Marais, qui n’est pas un quartier mais plusieurs. Entre ces grandes régions s’insinuent des zones de transition qui comblent tous les interstices. C’est la région la plus dense de Paris7.
Que le monde ait eu jadis son centre là où gisent aujourd’hui les colonnes ruinées d’Athènes et de Rome, il est facile de le concevoir, justement parce qu’il s’agit de ruines. Au Palais-Royal au contraire, dans les allées du jardin, sous les arcades où les boutiques de soldats de plomb, de croix et de rubans, de pipes, de jouets en peluche, de tapisserie au point, forment un décor dignement démodé, rien ne permet d’imaginer que le lieu fut pendant cinquante ans l’agora, le forum de Paris, et que son prestige s’étendait dans l’Europe entière. Quand les troupes alliées entrèrent dans la ville après Waterloo, « À Paris, que demandaient-ils d’abord ? Le Palais-Royal ! Un officier russe y entra à cheval. Au Palais-Royal, quel était leur premier désir ? Celui de se mettre à table chez les restaurateurs, dont ils citaient les noms glorieusement venus jusqu’à eux8. »
Le début du Neveu de Rameau – « Qu’il fasse beau, qu’il fasse laid, c’est mon habitude d’aller sur les cinq heures du soir me promener au Palais-Royal. C’est moi qu’on voit, toujours seul, rêvant sur le banc d’Argenson » – date des années 1760 et c’est donc encore du vieux Palais-Royal qu’il s’agit. Le cardinal de Richelieu avait acheté à l’extrémité de la rue Saint-Honoré un ensemble de maisons, d’hôtels et de parcelles de terrain qu’il avait réunies en un seul domaine, un quadrilatère qui serait aujourd’hui limité par les rues Saint-Honoré, des Petits-Champs, de Richelieu et des Bons-Enfants9. Le Palais-Cardinal construit par Lemercier se trouvait à peu près à l’emplacement actuel du Conseil d’État. Le reste du terrain formait un jardin : à droite, du côté de ce qui sera la galerie de Valois, c’était l’allée d’Argenson dont parle Diderot ; en face, l’allée tirait son nom du café de Foy, le premier en date des établissements qui feront la gloire du Palais-Royal (juste après lui sera fondé le Caveau. Le vieux Diderot écrit à sa fille, le 28 juin 1781 : « Je m’ennuie chez moi. J’en sors pour m’ennuyer encore davantage. Le suprême et seul bonheur dont je jouisse, c’est d’aller régulièrement à cinq heures tous les jours prendre la tasse de glace au Petit-Caveau »). La même année, le duc de Chartres, le futur Philippe-Égalité, charge Victor Louis de construire les bâtiments qui encadrent aujourd’hui le jardin sur trois côtés10. Les cent quatre-vingts arcades terminées, le succès est immédiat. « Point unique sur le globe. Visitez Londres, Amsterdam, Madrid, Vienne, vous ne verrez rien de pareil : un prisonnier pourrait y vivre sans ennui, et ne songer à la liberté qu’au bout de plusieurs années…. On l’appelle la capitale de Paris. Tout s’y trouve ; mais mettez là un jeune homme ayant vingt ans et cinquante mille livres de rente, il ne voudra plus, il ne pourra plus sortir de ce lieu de féerie…. Ce séjour enchanté est une petite ville luxueuse, renfermée dans une grande ; c’est le temple de la volupté, d’où les vices brillants ont banni jusqu’au fantôme de la pudeur : il n’y a pas de guinguette dans le monde plus gracieusement dépravée11. »
Vers la fin du règne de Louis XVI, les clubs se multiplient au Palais-Royal. En juillet 1789, l’agitation est permanente et le Palais devient le noyau de la comète Révolution, comme dira Hugo. Camille Desmoulins raconte la journée du 13 juillet : « Il était deux heures et demie. Je venais de sonder le peuple. Ma colère contre les despotes était tournée au désespoir. Je ne voyais pas les groupes, quoique vivement émus ou consternés, assez disposés au soulèvement. Trois jeunes gens me parurent agités d’un plus véhément courage ; ils se tenaient par la main. Je vis qu’ils étaient venus au Palais-Royal dans le même dessein que moi. Quelques citoyens passifs les suivaient.
– Messieurs, leur dis-je, voici un commencement d’attroupement civique : il faut que l’un de nous se dévoue et monte sur une table pour haranguer le peuple.
– Montez-y !
– J’y consens. Aussitôt je fus porté sur la table (du café de Foy) plutôt que je n’y montai. À peine y étais-je que je me vis entouré d’une foule immense. Voici ma harangue, que je n’oublierai jamais :
– Citoyens, il n’y a pas un moment à perdre. J’arrive de Versailles, Necker est renvoyé ; ce renvoi est le tocsin d’une Saint-Barthélemy de patriotes. Ce soir, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du Champ-de-Mars pour nous égorger. Il ne nous reste qu’une seule ressource, c’est de courir aux armes et de prendre une cocarde pour nous reconnaître12. »
Pourtant, au cours de la Révolution, le Palais-Royal rebaptisé Palais-Égalité devient vite le lieu de ralliement des royalistes, modérés, feuillants, de tous ceux que Robespierre appelle les fripons. Au restaurant Mafs, les collaborateurs du journal royaliste Les Actes des apôtres – l’abbé Maury, Montlausier, Rivarol – font chaque semaine leur « dîner évangélique ». Ils écrivent la conversation sur un coin de table, et « le numéro ainsi fait est laissé sur la carte de Mafs, et de Mafs passe chez Gattey, à la fameuse boutique des galeries de bois13 ». Le 20 janvier 1793, jour où la Convention décide d’envoyer Louis Capet à la guillotine, c’est dans un modeste restaurant de la galerie de Valois, chez Février, que le garde du corps Pâris assassine Le Peletier de Saint-Fargeau. À la Convention, le 19 nivôse an II, « le Comité révolutionnaire de la Montagne dénonce les traiteurs et restaurateurs du Palais de l’Égalité, qui n’a changé que de dénomination et qui pourrait porter encore celle de Palais-Royal par le luxe insolent qu’on y étale14 ». Barras – qui habite au Palais-Royal, au-dessus du Véfour – et ses amis préparent le 9 Thermidor au glacier Corazza et sous le Directoire les incroyables font la chasse aux républicains dans les jardins, cocarde blanche au chapeau et gourdin à la main.
L’apogée du Palais-Royal, l’époque qui en fit un mythe sans équivalent dans toute l’Europe moderne, ce furent les vingt ans suivant l’entrée des Alliés dans Paris en 1815. L’arrivée des soldats et des officiers russes, autrichiens, prussiens, anglais, donna une impulsion nouvelle aux deux activités nourricières du lieu, la prostitution et le jeu. Les galeries de bois, baraques alignées transversalement sur l’emplacement actuel de la double colonnade de la galerie d’Orléans, eurent alors leur moment de gloire15. « Il n’est pas inutile de peindre ce bazar ignoble ; car, pendant trente-six ans, il a joué dans la vie parisienne un si grand rôle, qu’il est peu d’hommes âgés de quarante ans à qui cette description incroyable pour les jeunes gens, ne fasse encore plaisir. En place de la froide, haute et large galerie d’Orléans, espèce de serre sans fleurs, se trouvaient des baraques, ou, pour être plus exact, des huttes en planches, assez mal couvertes, petites, mal éclairées sur la cour et sur le jardin par des jours de souffrance appelés croisées, mais qui ressemblaient aux plus sales ouvertures des guinguettes hors barrière. Une triple rangée de boutiques y formait deux galeries, hautes d’environ douze pieds. Les boutiques sises au milieu donnaient sur les deux galeries dont l’atmosphère leur livrait un air méphitique, et dont la toiture laissait passer peu de jour à travers des vitres toujours sales…. Ce sinistre amas de crottes…. allait admirablement aux différents commerces qui grouillaient sous ce hangar impudique, effronté, plein de gazouillements et d’une gaieté folle, où, depuis la Révolution de 1789 jusqu’à la Révolution de 1830, il s’est fait d’immenses affaires. Pendant vingt années, la Bourse s’est tenue en face, au rez-de-chaussée du Palais…. On se donnait rendez-vous dans ces galeries avant et après la Bourse. Le Paris des banquiers et des commerçants encombrait souvent la cour du Palais-Royal, et refluait sous ces abris par les temps de pluie…. Il n’y avait là que des libraires, de la poésie, de la politique et de la prose, des marchandes de modes, enfin des filles de joie qui venaient seulement le soir. Là fleurissaient les nouvelles et les livres, les jeunes et les vieilles gloires, les conspirations de la Tribune et les mensonges de la Librairie16. »
À cette époque bénie où les métiers de libraire et d’éditeur étaient encore confondus (avec parfois l’imprimerie de surcroît), les galeries de bois virent les débuts de maisons dont certaines étaient destinées à un bel avenir, Stock, Garnier, Le Dentu, qui fut dit-on le modèle du Dauriat des Illusions perdues, auquel Lucien de Rubempré essaie de vendre ses sonnets sur les Marguerites (« Pour moi, la question…. n’est pas de savoir si vous êtes un grand poète ; vous avez beaucoup, mais beaucoup de mérite ; si je commençais la librairie, je commettrais la faute de vous éditer. Mais d’abord, aujourd’hui, mes commanditaires et mes bailleurs de fonds me couperaient les vivres….»).
Sous les arcades on ne lit pas, on joue, au creps, au passe-dix, au trente-et-un, au biribi. Le tripot numéro 9 (qui occupe les arcades 9 à 12) offre deux tapis de trente-et-quarante, une table de creps, et les joueurs peuvent y boire du punch flambé. Au début de La Peau de Chagrin, Raphaël monte pour son malheur l’escalier du numéro 36 (« Quand vous entrez dans une maison de jeu, la loi commence par vous dépouiller de votre chapeau. Est-ce une parabole évangélique et providentielle ? »). Mais l’établissement le plus célèbre est sans conteste le 113 : huit salles, six tables de roulette. Blücher, l’un des deux vainqueurs de Waterloo, ne quittait pas le tripot du 113. Il dépensa six millions pendant son séjour, et toutes ses terres étaient gagées lorsqu’il quitta Paris. Autour des tripots sont installés des prêteurs sur gages, et le soir les filles se mêlent aux joueurs. Celles qui se promènent sous la galerie de bois et dans les petites allées du jardin s’appellent les « demi-castors », celles des galeries sont des « castors » et celles de la terrasse du Caveau sont des « castors finis ».
On peut aussi boire et manger dans les galeries du Palais-Royal. Le café de Foy est le seul à servir dans un pavillon du jardin. Au premier étage, son club d’échecs, qui a compté Talleyrand et David parmi ses clients, fait concurrence à celui du café de la Régence, où se déroule Le Neveu de Rameau. Le café des Mille Colonnes, dont la patronne est une beauté célèbre, est le préféré de Balzac. Près du passage du Perron, le café de la Rotonde avait été pendant la Révolution le quartier général des brissotins (on ne disait pas les « girondins » à l’époque), après avoir abrité sous Louis XVI les controverses entre gluckistes et piccinistes. Le café Lemblin est fréquenté par les nostalgiques de l’Empire. Philippe Brideau « fut un des bonapartistes les plus assidus du café Lemblin, véritable Béotie constitutionnelle ; il y prit les habitudes, les manières, le style et la vie des officiers à demi-solde17 ». Les garçons tiennent des épées à la disposition des consommateurs, derrière le comptoir, enveloppées de serge verte. Certains soirs la demande est telle qu’ils doivent s’excuser : « Messieurs, elles sont en main. » Parmi les établissements spécialisés dans la prostitution, le plus célèbre est le café des Aveugles, qui tire son nom de la composition de son orchestre (« Pourquoi des aveugles, direz-vous, dans ce seul café, qui est un caveau ? C’est que, vers la fondation, qui remonte à l’époque révolutionnaire, il se passait là des choses qui eussent révolté la pudeur d’un orchestre18 »).
Des trois grands restaurants de La Comédie humaine, deux sont au Palais-Royal – le troisième étant le Rocher de Cancale rue Montorgueil. « S’agit-il d’un dîner d’étrangers ou de provinciaux à qui l’on veut donner une haute idée de la capitale ? C’est chez Véry qu’il faut les conduire…. C’est le premier des traiteurs par la cherté, d’où il est permis de conclure qu’il doit être le premier dans la hiérarchie des gens de mérite de sa profession, un des artistes les mieux éclairés de ceux qui veillent au maintien du bon goût, et qui s’opposent aux invasions de la cuisine bourgeoise19. » Lucien de Rubempré arrivant d’Angoulême, malheureux et humilié, « prit la route du Palais-Royal, après l’avoir demandée, car il ne connaissait pas encore la topographie de son quartier. Il entra chez Véry, commanda, pour s’initier aux plaisirs de Paris, un dîner qui le consolât de son désespoir. Une bouteille de vin de Bordeaux, des huîtres d’Ostende, un poisson, une perdrix, un macaroni, des fruits furent le nec plus ultra de ses désirs. Il savoura cette petite débauche en pensant à faire preuve d’esprit ce soir auprès de la marquise d’Espard, et à racheter la mesquinerie de son bizarre accoutrement par le déploiement de ses richesses intellectuelles. Il fut tiré de ses rêves par le total de la carte qui lui enleva les cinquante francs avec lesquels il croyait aller fort loin dans Paris. Ce dîner coûtait un mois de son existence d’Angoulême20 ».
Véry finira absorbé par son voisin Véfour, l’ancien café de Chartres où Alexandre de Humboldt, de retour d’Amérique « équinoxiale », dînait très souvent sous l’Empire. En 1815, Rostopchine, l’homme qui avait fait brûler Moscou, y festoyait souvent avec son professeur de français, Flore, une belle actrice des Variétés. Quant aux Frères Provençaux, « il n’est point d’étranger, de femme galante, pas même de bourgeois de la place Royale qui ne connaisse ces trois enfants de la Durance, arrivés à Paris sans autre ressource que le secret des brandades de morue, dont ils ont fini par rendre tributaire toute l’Europe civilisée, de l’embouchure du Tage aux bords de la Neva21 ».
La fin de la vogue du Palais-Royal peut se dater avec précision : le 31 décembre 1836 à minuit, les jeux de hasard furent interdits à Paris. Dès lors le déclin fut rapide. Les dandys, les badauds, les viveurs et les filles émigrèrent à quelques centaines de mètres de là, vers la nouvelle promenade enchantée, vers les Boulevards.
Autrefois, quand les quartiers passaient de mode, ils tombaient dans une sorte de léthargie qui pouvait durer très longtemps. Au temps de leur gloire, ils n’avaient pas été en proie à ce métabolisme commercial accéléré qui a ravagé depuis les années 1960 le quartier Saint-Séverin, le quartier Mouffetard, la Bastille et le Marais, et qui est actuellement à l’œuvre à la Butte-aux-Cailles, dans le quartier Saint-Blaise à Charonne, rue Montorgueil ou rue Oberkampf. Le Palais-Royal est donc resté tel qu’il était lorsque les foules l’ont quitté pour partir vers le nord. L’essentiel de son charme ne tient pas aux travées de Victor Louis, dont la monotonie est comme redoublée par l’impeccable alignement des quatre allées de tilleuls. Ce qui ménage des surprises, c’est la façon dont le Palais-Royal, espace fermé, communique avec les rues qui l’entourent. Certains passages sont d’une beauté monumentale, avec statues, candélabres et grilles dorées – comme celui qui mène par la place de Valois vers l’entrée de la galerie Véro-Dodat ; ou comme les deux colonnades couvertes par lesquelles on accède du fond du jardin à la rue de Beaujolais, celle de gauche le long du restaurant Véfour, celle de droite menant vers le passage des Deux-Pavillons, le passage Colbert et la Bibliothèque nationale. D’autres se faufilent au contraire de façon presque clandestine, comme le passage du Perron ouvrant une échappée vers la rue Vivienne entre poupées anciennes et boîtes à musique, ou les trois gracieux passages-escaliers qui montent de la rue de Montpensier vers la rue de Richelieu.
*
Pour Diderot, pour Camille Desmoulins, il était tout simple de passer du Palais-Royal aux Tuileries. Trente ans plus tard, Géricault, Henri de Marsay ou Stendhal devaient traverser la nouvelle grande artère du quartier, la rue de Rivoli, mais ils n’avaient pas à affronter l’avenue de l’Opéra ni à contourner l’énorme masse du Louvre de Napoléon III. Le Palais-Royal n’était pas enclavé comme aujourd’hui, il était en liaison avec le quartier Tuileries-Saint-Honoré. Liaison directe ou presque car il fallait traverser en oblique un quartier qui, fait unique dans le centre de Paris, a disparu sans laisser la moindre trace, y compris dans les mémoires : le Carrousel. La strophe du Cygne (« Là s’étalait jadis une ménagerie ;/ Là je vis, un matin, à l’heure où sous les cieux/Froids et clairs le Travail s’éveille, où la voirie/Pousse un sombre ouragan dans l’air silencieux,/ Un cygne qui s’était évadé de sa cage ») n’est pas une vision purement poétique comme L’Albatros. Alfred Delvau, chroniqueur-badaud du Second Empire, se souvient : « Elle était charmante autrefois, cette place du Carrousel – aujourd’hui peuplée de grands hommes en pierre de Saint-Leu. Charmante comme le désordre et pittoresque comme les ruines ! C’était une forêt, avec son inextricable fouillis de baraques en planches et de masures en torchis, habitées par une foule de petites industries. J’ambulais fréquemment dans ce caravansérail du bric-à-brac, à travers ce labyrinthe de planches et ces zigzags de boutiques, et j’en connaissais presqu’intimement les êtres, – hommes et bêtes, lapins et perroquets, tableaux et rocailleries22. » Le guide Joanne de 1870, reprenant lui aussi le mot même de Baudelaire – « Je ne vois qu’en esprit tout ce camp de baraques » – regrette la disparition de « cette multitude de petites baraques qui formaient, depuis le Musée jusqu’à la rue de Chartres, comme une foire perpétuelle de curiosités, de vieilles ferrailles et d’oiseaux vivants ».
Le quartier de Carrousel
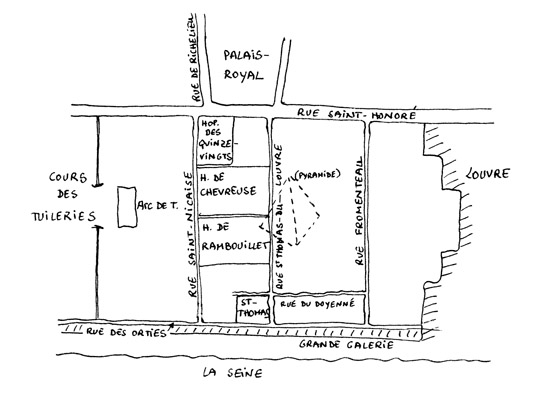
L’extraordinaire quartier du Carrousel s’étendait entre le pavillon de l’Horloge du Louvre et les cours du château des Tuileries. Il était limité au sud, du côté de la Seine, par la Grande Galerie qui depuis Henri IV réunissait les deux châteaux. Une rue longeait cette galerie du côté intérieur, qui portait le nom de rue des Orties. Au nord, la limite du Carrousel était la rue Saint-Honoré. Trois rues perpendiculaires au fleuve joignaient la rue des Orties à la rue Saint-Honoré : la rue Saint-Nicaise, la rue Saint-Thomas-du-Louvre et la rue Fromenteau.
La rue Saint-Nicaise, dans la continuité de la rue de Richelieu, serait aujourd’hui sur la ligne des guichets du Louvre. Du côté de la rue Saint-Honoré, elle bordait un grand hôpital, les Quinze-Vingts, fondé par Louis IX pour soigner, dit la légende, trois cents chevaliers – quinze fois vingt font trois cents – revenus aveugles de la croisade, les Sarrasins leur ayant crevé les yeux (curieusement, la plupart des historiens du vieux Paris rapportent cette histoire comme s’il s’agissait d’un fait historiquement établi, de même d’ailleurs que celle du juif Jonathas qui, vers la même époque, avait fait bouillir du côté des Billettes une hostie dont il était sorti du sang, ce pourquoi on l’avait brûlé vif, comme on peut le voir sur la prédelle de Paolo Uccello à Urbino23). L’enclos de l’hôpital abritait toute une population d’artisans, exempts d’impôts comme au Temple. En 1780, les Quinze-Vingts furent transférés dans l’ancienne caserne des mousquetaires noirs de la rue de Charenton, où ils se trouvent toujours.
La rue Saint-Thomas-du-Louvre passerait aujourd’hui par la pyramide de Ieoh Ming Pei. Elle desservait, outre l’hôtel de Chevreuse, une demeure d’une importance sans égale dans toute la littérature française, l’hôtel de Rambouillet. « Je ne dirai point que c’est le plus renommé du royaume, car personne n’en doute, écrit Sauval qui était un habitué. Tout le beau monde a lu son éloge et sa description dans le Grand Cyrus, et dans les ouvrages des plus délicats esprits du siècle. Peut-être même ne serait-il pas besoin de faire ressouvenir que dans le Cyrus c’est lui qui est nommé le palais de Cléomire, et que partout ailleurs on l’appelle le palais d’Arthénice, qui est l’anagramme de Catherine, nom de baptême de Catherine de Vivonne, marquise de Rambouillet, et qui a été fait par Malherbe. Tous les illustres ont publié à l’envi le nom de cette héroïne et ne m’ont presque rien laissé à dire de son hôtel…. et de plus nous ont appris qu’elle en a fait et donné le dessin, qu’elle seule l’a entrepris, conduit et achevé : son goût fin et savant tout ensemble a découvert à nos architectes des agréments, des commodités et des perfections ignorées même des Anciens, et que depuis ils ont répandus dans tous les logis propres et superbes24. Par les découvertes qu’Arthénice a faites dans l’Architecture, en se divertissant, on peut juger de celles qu’elle a faites dans les Belles-Lettres, où elle est consommée. La vertu et le mérite de Catherine de Vivonne ont attiré dans sa maison, pendant plusieurs années, tous les gens d’esprit de la cour et du siècle. Dans sa chambre bleue, tous les jours il se tenait un cercle de personnes illustres, ou pour mieux dire, l’Académie ; car c’est là que l’Académie française a tiré son origine ; et c’est des grands génies qui s’y rendaient, dont la plus noble partie de ce Corps si considérable est composée. Aussi est-ce pour cela que l’hôtel de Rambouillet a été appelé longtemps le Parnasse français…. Ceux qui n’y étaient pas connus ne passaient que pour des personnes ordinaires, et il suffisait d’y avoir entrée pour être mis entre les illustres du siècle25. »
La rue Fromenteau longeait le fossé du Louvre, le long du pavillon de l’Horloge, et aboutissait à la rue Saint-Honoré à peu près au niveau de la rue de Valois. Elle était depuis toujours mal famée : « La rue Fromenteau n’est-elle pas à la fois meurtrière et de mauvaise vie ? » demande Balzac au début de Ferragus. Reliant les rues Fromenteau et Saint-Thomas-du-Louvre, la petite rue du Doyenné était occupée par une foire à la peinture où, à l’époque romantique, on pouvait acheter à bas prix des toiles du XVIIIe siècle français. C’est là qu’habite la cousine Bette au début du roman : « Lorsqu’on passe en cabriolet le long de ce demi-quartier mort, et que le regard s’engage dans la ruelle du Doyenné, l’âme a froid, l’on se demande qui peut demeurer là, ce qui doit s’y passer le soir, à l’heure où cette ruelle se change en coupe-gorge, et où les vices de Paris, enveloppés du manteau de la nuit, se donnent pleine carrière. » Dans les années 1830, un groupe de jeunes écrivains et d’artistes encore peu connus s’installe rue du Doyenné dans une sorte de squat. Parmi eux, Gérard de Nerval : « C’était dans notre logement commun de la rue du Doyenné que nous nous étions reconnus frères…. dans un coin du vieux Louvre des Médicis, bien près de l’endroit où exista l’ancien hôtel de Rambouillet…. Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d’une échelle, où il peignait sur un des trois dessus-de-glace un Neptune – qui lui ressemblait ! Puis les deux battants d’une porte s’ouvraient avec fracas : c’était Théophile (Gautier). On s’empressait de lui offrir un fauteuil Louis XIII, et il lisait, à son tour, ses premiers vers, pendant que Cydalise Ire, ou Lorry, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la blonde, tendu à travers l’immense salon…. Quels temps heureux ! On donnait des bals, des soupers, des fêtes costumées…. Nous étions jeunes, toujours gais, souvent riches… Mais je viens de faire vibrer la corde sombre : notre palais est rasé. J’en ai foulé les débris l’automne passé. Les ruines mêmes de la chapelle (du Doyenné, qui faisait partie de Saint-Thomas-du-Louvre) qui se découpaient si gracieusement sur le vert des arbres…. n’ont pas été respectées. Vers cette époque, je me suis trouvé, un jour encore, assez riche pour enlever aux démolisseurs et racheter deux lots de boiseries du salon, peintes par nos amis. J’ai les deux dessus-de-porte de Nanteuil ; le Watteau de Vattier, signé ; les deux panneaux longs de Corot, représentant deux paysages de Provence ; le Moine rouge, de Châtillon, lisant la Bible sur la hanche cambrée d’une femme nue qui dort ; les Bacchantes, de Chassériau, qui tiennent des tigres en laisse comme des chiens…. Quant au lit Renaissance, à la console Médicis, aux deux buffets, au Ribera, aux tapisseries des Quatre Éléments, il y a longtemps que tout cela s’était dispersé. Où avez-vous perdu tant de belles choses ? me dit un jour Balzac. – Dans les malheurs ! lui répondis-je en citant un de ses mots favoris26. »
Rue Saint-Nicaise, le 24 décembre 1800, des conspirateurs royalistes firent exploser une machine infernale sur le passage du Premier consul qui se rendait des Tuileries à l’opéra de la rue de Richelieu. L’attentat, qui fit huit morts, marqua le début de la fin pour le quartier du Carrousel. Bonaparte, conscient du danger d’avoir de tels coupe-gorge à proximité du château, fit détruire les maisons endommagées et quelques autres. Plus tard, il démolit les baraques et les barrières de planches qui fermaient les cours des Tuileries27 et fit construire l’arc de triomphe du Carrousel, pour servir d’entrée d’honneur au palais. Les démolitions continuèrent lentement jusqu’en 1848, où le rythme s’accéléra car il fallait trouver du travail pour les ateliers nationaux. « Les trois quarts de la place étaient déblayés en 1850. Il ne restait plus que l’ancien bâtiment des écuries du roi (sur la rue Saint-Nicaise)…. et au beau milieu de la nouvelle esplanade, l’hôtel de Nantes, qui avait résisté jusqu’au bout à toutes les propositions du jury d’expropriation. L’hôtel est maintenant démoli ; les écuries du roi sont tombées à leur tour28. »
Le Carrousel actuel est une steppe poussiéreuse entre la pyramide du Louvre et les grilles du jardin des Tuileries, traversée par le flot des voitures – qui doivent contourner, curieuse idée, un rond-point unidirectionnel – et en sous-sol par un tunnel dont les accès bétonnés apportent à l’ensemble sa touche finale. L’arc de triomphe n’ayant plus de sens au milieu de ce désert, il a été imaginé de le relier aux jardins des Tuileries et aux ailes du Louvre de Napoléon III par de petites plantations en éventail au-dessus desquelles émergent les têtes ou les fesses des grosses dames de Maillol : il y a des jardins pompiers comme il y a des tableaux pompiers. Heureusement, quelques très beaux marronniers ont été sauvegardés, qui pendant l’été donnent de l’ombre aux marchands de glaces et de cartes postales autour du monument de Percier et Fontaine.
*
En 1946, la place du Marché-Saint-Honoré reçut le nom de place Robespierre, décision annulée en 1950 quand la bourgeoisie française redressa la tête. Sa haine envers Robespierre n’a jamais faibli depuis Thermidor. Outre l’Incorruptible lui-même – qui logeait chez le menuisier Duplay avec sa sœur Charlotte et son frère Augustin, au bout de la rue Saint-Honoré –, d’autres acteurs de la Révolution habitaient le quartier Tuileries-Saint-Honoré : Sieyès, Olympe de Gouges, Héron, Barère dont Robespierre faisait l’éloge ambigu : « Il sait tout, il connaît tout, il est propre à tout. » Ce n’était pas que ce quartier fût spécialement révolutionnaire, mais la rue Saint-Honoré était l’axe géographique de la vie politique. Dans les années 1789-1791, le club de La Fayette et des modérés tenait ses séances dans l’ancien couvent des Feuillants, sur l’emplacement de la rue de Castiglione. La Société des Amis de la Liberté et de l’Égalité est restée dans l’histoire sous le nom de club des Jacobins, dont les terrains occupaient l’actuelle place du Marché-Saint-Honoré jusqu’à la rue Gomboust. La Constituante, la Législative et la Convention à ses débuts siégeaient salle du Manège, dans les jardins des Tuileries, vers l’abouchement de la rue Saint-Roch dans la rue de Rivoli. Après le 10 août, la Convention s’installa au Château dans la salle des Machines que Soufflot avait transformée et où Sophie Arnould avait autrefois triomphé dans Castor et Pollux de Rameau. La tribune de la Convention, qui, d’après les devis, était une construction basse, peinte en vert antique, ornée de pilastres jaunes avec des chapiteaux bronzés et trois couronnes en porphyre feint, se situait près de l’actuel pavillon de Marsan. Le Comité de salut public se réunissait dans l’aile opposée, au sud du palais.
Après Thermidor, la Convention fit démolir les Jacobins – que Merlin de Thionville dénonçait comme « un repaire de brigands » –, et le vide ainsi créé devint pour quelque temps la place du Neuf-Thermidor. Pourtant, lorsque la pression royaliste se fit inquiétante, Barras s’assura les services d’un jeune officier passant pour robespierriste, Napoléon Bonaparte, qui prit les dispositions pour protéger l’Assemblée pendant l’émeute royaliste du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795) : les insurgés furent écrasés sur les marches de l’église Saint-Roch par la mitraille d’une pièce de huit mise en batterie au bout du cul-de-sac Dauphin, qui est aujourd’hui la partie de la rue Saint-Roch comprise entre la rue Saint-Honoré et les Tuileries.
Les deux principales places du quartier Saint-Honoré, la place du Marché-Saint-Honoré et la place Vendôme, toutes différentes qu’elles sont, ont en commun d’avoir été défigurées ces derniers temps. Dans la première, un attentat urbanistique avait déjà eu lieu à la fin des années 1950 lorsqu’on avait démoli le marché construit par Molinos sous l’Empire – quatre halles, avec au milieu une fontaine alimentée par la pompe à feu de Chaillot – et construit à sa place un bloc de béton servant de caserne de pompiers et de commissariat de police. Récemment, la banque Paribas a chargé Bofill d’y édifier un nouveau bâtiment. Conscient de ce que ses colonnes creuses et ses frontons pseudo-classiques commençaient à lasser, l’architecte a conçu un édifice pseudo-high-tech, mal proportionné et parfaitement étranger à l’esprit du lieu, provoquant une glaciation de la place que la prolifération des restaurants ne parvient pas à masquer.
La place Vendôme a reçu des mains d’architectes des bâtiments publics et palais nationaux un indescriptible pavage parsemé de plots d’acier brossé, et pour son parking souterrain des entrées de bunker. Les chauffeurs qui attendent en époussetant leur limousine devant Cartier, le Ritz ou le Crédit foncier ont des costumes sombres, des lunettes noires et des allures de gardes du corps. En passant par là, il me vient toujours une affectueuse pensée pour les gardes nationaux, les cantinières, les gavroches, les civils en armes et les canonniers sur leur affût, qui posaient en groupes pour le photographe devant les débris de la colonne en mai 1871.
*
Entre les jardins du Palais-Royal et les Boulevards, la région qu’on appelle souvent le quartier de la Bourse est l’une des plus homogènes, des plus harmonieuses de l’Ancien Paris. Dans ce bâti qu’on qualifie faute de mieux de néoclassique, beaucoup d’immeubles datent du règne de Louis XVI, d’autres de la période révolutionnaire – la rue des Colonnes, dont le vocabulaire néo-grec miniature, les colonnes doriques sans base, les arcades à palmettes et les étranges balustres aux fenêtres forment un ensemble si original que des architectes parmi les plus grands, Gilly, Soane, Schinkel, vinrent de toute l’Europe l’admirer et la dessiner. D’autres encore furent construits sous l’Empire, comme la Bourse de Brongniart. Le paradoxe d’un bâtiment aussi grandiose voué à une activité aussi méprisable n’avait pas échappé aux contemporains : « Je me courrouce toutes les fois que j’entre à la Bourse, ce bel édifice de marbre, bâti dans le style grec le plus noble et consacré à cet ignoble trafic des fonds publics…. C’est ici, dans cette immense salle, que s’agite l’agiotage avec ses mille figures tristes et ses dissonances criardes, comme le bouillonnement d’une mer d’égoïsme. Du milieu des flots d’hommes s’élancent les grands banquiers, pareils à des requins, créatures monstrueuses qui s’entre-dévorent29. »
Le quartier de la Bourse est quadrillé par trois parallèles d’orientation à peu près nord-sud – les rues Vivienne, de Richelieu et Sainte-Anne – et deux transversales. L’une des deux est très ancienne, c’est la rue des Petits-Champs qui réunit deux places royales, la place des Victoires et la place Vendôme30. L’autre est la rue du Quatre-Septembre, qui est parmi les moins réussies des percées haussmanniennes. Sous le Second Empire, elle s’appelait rue du Dix-Décembre, commémorant le jour de l’élection de Louis Bonaparte à la présidence de la République en 1848. La société du Dix-Décembre, fondée par le prince-président, recrutait dans le Lumpenproletariat parisien caricaturé par Daumier avec Ratapoil et jouait un rôle comparable à celui du SAC gaulliste dans les années 1960.
Depuis très longtemps le quartier est voué à trois activités qui résistent tant bien que mal au déferlement de la mode et du luxe : le livre, la finance et la musique. « Depuis le règne d’Henri IV, raconte Germain Brice, (la Bibliothèque royale) avait été gardée avec beaucoup de négligence dans une maison particulière de la rue de la Harpe. En 1666, elle fut transportée dans une autre de la rue Vivienne, par les ordres de Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bâtiments…. On a pris la résolution en l’année 1722 de la mettre dans l’hôtel de Nevers, ou plutôt dans les appartements qui avaient servi à la Banque pendant quelque temps, auxquels on en a ajouté d’autres où l’on travaille encore, qui ont été pris sur des jardins négligés qui se trouvaient assez proches, de manière que le public aura la satisfaction de la voir bien plus avantageusement qu’autrefois qu’elle était distribuée dans diverses chambres de cette vilaine maison de la rue Vivienne31. » De la Régence aux années 1990, la Bibliothèque – royale, impériale, nationale – est restée dans ce quadrilatère entre la rue Vivienne et la rue de Richelieu. Pour résumer l’esprit de cette institution archaïque, exaspérante et bénie, je choisirais la photographie de Gisèle Freund montrant Walter Benjamin au travail, avec ses lunettes et ses cheveux ébouriffés, voûté sur un livre qu’il tient ouvert avec son coude gauche, prenant des notes avec un gros stylo noir. Et comme légende je citerais un connaisseur en bibliothèques : « Il se peut qu’en faisant peindre de légers branchages en haut des très hauts murs de la Bibliothèque nationale de la rue de Richelieu, Henri Labrouste, un architecte à qui, sans doute, il arrivait de lire, ait eu l’intuition de ce lien (entre lecture et nature). C’est en tout cas ce que l’on peut croire en lisant cette remarque que Benjamin écrivit à propos de cette salle qu’il connaissait bien et qui aura été au fond le seul véritable “appartement” dont il ait disposé à Paris : “Lorsqu’on feuillette les pages en bas, un murmure se fait entendre en haut”32. »
Les liens du quartier avec la finance datent eux aussi du XVIIIe siècle. Pour Sébastien Mercier, « il y a plus d’argent dans cette seule rue (Vivienne) que dans tout le reste de la ville ; c’est la poche de la capitale. Les grandes caisses y résident, notamment la Caisse d’escompte. C’est là que trottent les banquiers, les agents de change, les courtiers, tous ceux enfin qui font marchandise de l’argent monnayé…. Les catins y sont plus financières que dans tout autre quartier, et distinguent un suppôt de la Bourse à ne pas s’y tromper. Là, tous ces hommes à argent auraient besoin de lire plus que les autres, pour ne pas perdre tout à fait la faculté de penser ; mais ils ne lisent point du tout ; ils donnent à manger à ceux qui écrivent…. Tous les habitants de cette rue sont à la lettre des hommes qui travaillent contre leurs citoyens, et qui n’en éprouvent aucun remords….» Depuis, les banques ont quitté la rue Vivienne pour les Boulevards mais on y trouve encore de nombreuses boutiques où l’on vend des monnaies et où l’on change de l’or comme au temps de Balzac.
La rue de la Banque mène de la Bourse à l’autre institution financière locale, la Banque de France. L’hôtel de La Vrillière, construit par François Mansart, avait été confisqué à la Révolution pour y installer l’Imprimerie nationale. On y tirait à 400 000 exemplaires les discours de Robespierre, et Marat faisait tourner trois presses dans la cour pour imprimer L’Ami du peuple. La célèbre Galerie dorée – d’où l’on avait transféré au Louvre pour les offrir aux regards du peuple les tableaux de Pierre de Cortone, du Tintoret, de Véronèse – servait de magasin à papier. La Banque de France prit la place de l’Imprimerie en 180833 et, comme le font toutes les banques, elle détruisit la merveille qui lui avait été confiée. Disparu, le portail de Mansart qui, dit Germain Brice, « passe pour son chef-d’œuvre parce qu’il a su conserver la régularité de l’ordre ionique, malgré l’accouplement des colonnes, ce qui jusqu’alors avait été considéré comme très difficile ». Détruits, les jardins qui faisaient dire à Sauval que « les regards se perdent dans deux perspectives admirables : d’un côté ils découvrent un grand parterre entouré de phillyreas, et accompagné tant de statues que de bustes antiques et modernes, de bronze et de marbres ; de l’autre, ils glissent le long de la rue des Fossés-Montmartre [d’Aboukir] et se vont enfin égarer vers la rue Montmartre…. De tous les palais qui sont à Paris, il n’y a que le palais d’Orléans [Royal] et celui-ci qui possèdent une si longue avenue et jouissent d’une perspective si rare ». Démolie dans les années 1870, la Galerie dorée, « la plus achevée de Paris et peut-être de toute la France » pour Sauval, et dont les cinquante mètres se terminaient en surplomb, portés par une trompe, sur la rue Radziwill.
Ce quartier qui ne possède qu’une seule église (Notre-Dame-des-Victoires, où se réunissaient les agents de change pendant le chantier de la Bourse) a connu trois opéras – sans compter l’opéra Garnier qui n’est pas loin si l’on ne tient compte que des distances à vol d’oiseau. Sur le square face à l’entrée principale de la Bibliothèque nationale, à l’emplacement de l’ancien hôtel Louvois, là où se rencontrent trois rues dédiées à de grands ministres de l’Ancien Régime – Richelieu, Colbert, Louvois –, s’élevait une salle de spectacle construite par Victor Louis pour la Montansier. L’entrée était un péristyle de treize arcades surmonté d’un balcon sur la rue. Le vestibule était supporté par deux rangs de colonnes doriques ; quatre escaliers monumentaux peints en blanc et or desservaient les cinq étages. Sous un prétexte assez fallacieux – Chaumette à la Commune le 14 novembre 1793 : « Je dénonce la citoyenne Montansier comme ayant fait bâtir sa salle de spectacle rue de la Loi [Richelieu] pour mettre le feu à la Bibliothèque nationale ; l’argent de l’Anglais a beaucoup contribué à la construction de cet édifice et la ci-devant reine y a fourni 50 000 écus » –, la Convention confisqua la salle et décida d’y transférer l’Opéra national, qui s’y installa le 20 thermidor, onze jours après la chute de Robespierre. C’est en s’y rendant pour la première française de La Création de Haydn que Bonaparte faillit sauter rue Saint-Nicaise, et c’est un autre attentat qui causa la perte du lieu : le 13 février 1820, le duc de Berry fut poignardé à la sortie du spectacle. De même que le château des Tournelles avait été rasé après que Montgomery y eut tué Henri II d’un coup de lance malheureux, la salle de la Montansier fut démolie après la mort de l’héritier du trône. Il était prévu d’élever sur l’emplacement un monument expiatoire, mais Louis-Philippe préféra faire construire par Visconti la gracieuse fontaine des Fleuves. Comme vestiges de cet opéra, il reste les noms des rues bordant le square, Cherubini, Rameau, Lulli – dont la maison n’était pas loin, à l’angle des rues Sainte-Anne et des Petits-Champs, « ornée par le dehors de grands pilastres d’ordre composé, et de quelques sculptures qui ne sont pas mal imaginées34 ».
Après cette catastrophe, l’Opéra émigra pour quelques mois à la salle Favart, construite dans les années 1780 sur les terrains du duc de Choiseul et qui était jusque-là consacrée à la comédie italienne. Sa curieuse situation, tournant le dos au boulevard des Italiens et ouvrant sur la petite place Boieldieu, s’explique par le désir des comédiens de ne pas être confondus avec les bateleurs du boulevard du Temple35. En 1821, l’Opéra s’éloigna de quelques mètres, traversant le boulevard des Italiens pour se fixer à l’angle de la rue Le Peletier. Ce fut là le grand Opéra du XIXe siècle, la salle mythique de Rossini, de Boieldieu, de Meyerbeer, de Donizetti, de Berlioz, de Balzac, de Manet. Elle brûla elle aussi en 1873, et l’Opéra revint alors quelques mois dans le quartier de la Bourse, salle Ventadour36, avant de se fixer dans la nouvelle salle construite par Garnier, inaugurée en 1875 avec La Juive de Scribe et Halévy.
Finance et opéra n’étaient pas des activités exclusives. À l’ouest de la rue de Richelieu (« la rue des affaires et du plaisir », pour Alfred Delvau), débordant le tracé de ce qui sera plus tard l’avenue de l’Opéra, s’élevait une butte de gravats, fruit entre autres de la démolition de la vieille enceinte de Charles V et de la porte Saint-Honoré. Cette butte des Moulins était l’un des grands lieux de la prostitution parisienne. Au début de Splendeurs et misères des courtisanes, la touchante Esther habite rue Langlade, minuscule ruelle entre la rue de Richelieu et la rue Traversière-Saint-Honoré [Molière]. « Ces rues étroites, sombres et boueuses, où s’exercent des industries peu soigneuses de leurs dehors, prennent à la nuit une physionomie mystérieuse et pleine de contrastes. En venant des endroits lumineux de la rue Saint-Honoré, de la rue Neuve-des-Petits-Champs et de la rue de Richelieu, où se presse une foule incessante, où reluisent les chefs-d’œuvre de l’Industrie, de la Mode et des Arts, tout homme à qui le Paris du soir est inconnu serait saisi d’une terreur triste en tombant dans le lacis de petites rues qui cercle cette lueur reflétée jusque sur le ciel…. En y passant pendant la journée, on ne peut se figurer ce que toutes ces rues deviennent à la nuit ; elles sont sillonnées par des êtres bizarres qui ne sont d’aucun monde ; des formes à demi nues et blanches meublent les murs, l’ombre est animée. Il se coule entre la muraille et le passant des toilettes qui marchent et qui parlent. Certaines portes entrebâillées se mettent à rire aux éclats…. Des ritournelles sortent d’entre les pavés…. Cet ensemble de choses donne le vertige. » La butte des Moulins sera arasée pour permettre la jonction de l’avenue de l’Opéra avec la rue Saint-Honoré. Une photographie de Marville montre ces travaux gigantesques, avec au fond la façade du nouvel Opéra entrevue à travers la poussière. Mais la tradition de l’amour vénal survivra longtemps rue des Moulins, dont Toulouse-Lautrec a peint le célèbre Salon, ou encore rue Chabanais, qui abritait avant-guerre encore l’une des maisons closes les plus sélectes de Paris – d’où l’expression autrefois fréquente dans Le Canard enchaîné : « C’était un beau chabanais. »
*
La plupart des grands passages parisiens sont groupés entre l’avenue de l’Opéra, la place des Victoires, la rue des Petits-Champs et les Grands Boulevards. Certains sont rénovés, muséifiés, glacés, comme le passage Colbert. D’autres sont devenus des galeries marchandes de semi-luxe, comme la galerie Vivienne. Mais quelques-uns, si différents qu’ils soient du temps de leur splendeur, gardent un charme particulier : la galerie Véro-Dodat – où habita Rachel et où se trouvaient les bureaux de La Caricature de Philipon –, avec ses boiseries sombres et le damier de son pavage37 ; le passage Choiseul, où Lemerre éditait les Parnassiens et où le pêle-mêle maintient des possibilités d’inattendu ; et surtout l’ancêtre, le passage des Panoramas. Son nom provient de deux tourelles de bois qui encadraient son entrée sur le boulevard Montmartre. Un groupe de peintres, parmi lesquels Daguerre, avait exécuté sur d’immenses toiles – près de cent mètres de circonférence et vingt mètres de haut – des vues panoramiques de Toulon, de Tilsit, du camp de Boulogne, de la bataille de Navarin… Les spectateurs, au centre de la rotonde, étaient immergés dans le spectacle éclairé par le haut. Chateaubriand, dans l’Itinéraire de Paris à Jérusalem : « L’illusion était complète, je reconnus au premier coup d’œil les monuments que j’avais indiqués. Jamais voyageur ne fut mis à si rude épreuve : je ne pouvais m’attendre qu’on transportât Jérusalem et Athènes à Paris pour me convaincre de mensonge ou de vérité. » Les rotondes ont disparu mais il reste le théâtre des Variétés, où triompha Offenbach avant Meilhac et Halévy, Lavedan, Capus, de Flers et Caillavet. C’est devant son entrée que le pauvre comte Muffat attend Nana, « sous les vitres blanchies de reflets, un violent éclairage, une coulée de clartés, des globes blancs, des lanternes rouges, des transparents bleus, des rampes de gaz, des montres et des éventails géants en traits de flamme, brûlant en l’air ; et le bariolage des étalages, l’or des bijoutiers, les cristaux des confiseurs, les soies claires des modistes, flambaient derrière la pureté des glaces, dans le coup de lumière crue des réflecteurs ; tandis que, parmi la débandade peinturlurée des enseignes, un énorme gant de pourpre, au loin, semblait une main saignante, coupée et attachée par une manchette jaune ».
La mélancolique beauté du passage des Panoramas se prolonge au-delà du boulevard Montmartre par le passage Jouffroy et le passage Verdeau jusqu’à la rue de Provence, un long parcours sans se mouiller quand il pleut. Telle est bien la principale raison de la vogue des passages, du Directoire à la fin du Second Empire : on pouvait y flâner sans patauger dans la célèbre boue parisienne ni risquer de se faire tuer par les voitures (au début du XXe siècle encore : « Gourmont m’expliquait que lorsqu’il était à la Bibliothèque nationale, il habitait rue Richer et pouvait venir à la Bibliothèque, les jours de mauvais temps, presque sans subir celui-ci, par les passages Verdeau, Jouffroy, des Panoramas, la rue des Colonnes, etc. »38). En 1800, il n’existait dans Paris que trois rues pourvues de trottoirs : la rue de l’Odéon, la rue Louvois et la rue de la Chaussée-d’Antin. Ailleurs, le caniveau était le plus souvent au milieu de la chaussée comme au Moyen Âge. « À la moindre averse, écrit Sébastien Mercier, il faut dresser des ponts tremblants », c’est-à-dire des planches sur lesquelles les petits Savoyards faisaient traverser moyennant péage. Frochot, préfet de la Seine sous l’Empire, pouvait se lamenter : « La capitale de la France, ornée de monuments admirables et qui possède tant d’établissements utiles, n’offre à ceux qui la parcourent à pied qu’une voie excessivement pénible, ou même dangereuse, et qui semble avoir été exclusivement destinée au mouvement des voitures39. » Cinquante ans plus tard, le tableau n’a guère changé : « Mon cher, écrit Baudelaire dans le “petit poème en prose” intitulé Perte d’auréole, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l’heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois….» Le déclin des passages coïncide avec l’achèvement des premières percées haussmanniennes : « Nos rues plus larges et nos trottoirs plus spacieux ont rendu aisée la douce flânerie impossible à nos pères ailleurs que dans les passages40. » À la fin du siècle on parlait déjà des passages au passé : « Le passage, qui fut pour le Parisien une sorte de salon-promenoir où l’on fumait, où l’on causait, n’est plus qu’une sorte d’asile dont on se souvient tout à coup, quand il pleut. Certains passages gardent une certaine attraction à cause de tel ou tel magasin célèbre qu’on y trouve encore. Mais c’est la renommée du locataire qui prolonge la vogue, ou plutôt l’agonie du lieu41. »
Délaissés, délabrés, les passages parisiens sont pourtant présents dans la littérature du XXe siècle – le passage de l’Opéra dans Le Paysan de Paris d’Aragon, qui donna à Walter Benjamin l’idée d’entreprendre le Passagenwerk, l’extraordinaire passage des Bérésinas [Choiseul] dans Mort à crédit de Céline, « pas croyable comme croupissure ». Ce qui est plus étrange, c’est qu’on n’en trouve guère de traces dans les œuvres écrites au temps de leur gloire. À ma connaissance, il n’est question des passages ni dans La Comédie humaine – ni d’ailleurs dans des textes de Balzac comme Histoire et physiologie des boulevards de Paris –, ni chez Nerval, ni dans les Tableaux parisiens ou les Petits Poèmes en prose bien que Poulet-Malassis, l’éditeur des Fleurs du mal, eût ses bureaux passage Mirès [des Princes, qu’on vient de démolir], ni dans Les Misérables, ni dans Les Mystères de Paris. Peut-être le passage, lieu si poétique aujourd’hui, n’était-il pour les contemporains qu’un détail urbain commode mais peu digne d’intérêt, comme sont pour nous les galeries commerciales, les cinémas multisalles ou les parkings souterrains.
*
Passer du Palais-Royal aux Halles, c’est passer du quartier le plus récent de l’Ancien Paris, le plus élégant aussi et le mieux préservé, à un autre qui est tout son contraire. Entre eux, la frontière la plus évidente est la rue du Louvre, élargissement de la très ancienne rue des Poulies. Une autre, plus précise peut-être car elle suit le tracé de l’enceinte de Philippe Auguste, est la rue Jean-Jacques-Rousseau, qui se nommait rue Plâtrière quand Jean-Jacques y habitait, gagnant sa vie en copiant de la musique. « Son imagination, écrit Sébastien Mercier, ne se reposait que dans les prés, les eaux, les bois et leur solitude animée. Cependant il est venu presque sexagénaire se loger à Paris, rue Plâtrière, c’est-à-dire dans la rue la plus bruyante, la plus incommode, la plus passagère et la plus infestée de mauvais lieux. »
Les Halles avant Baltard
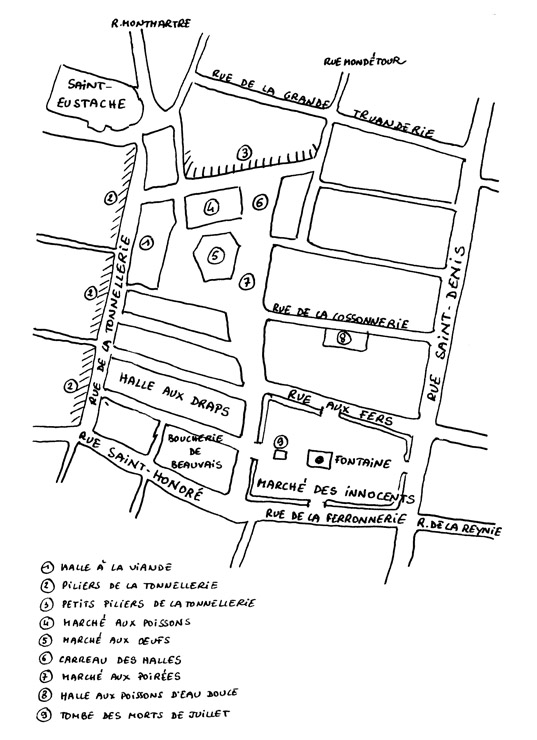
La destruction des Halles dans les années 1970 a été un tel traumatisme qu’on en a oublié les démolitions de Baltard au début du Second Empire42. Près de quatre cents maisons avaient pourtant été rasées pour percer les voies des nouvelles halles : la rue axiale (rue Baltard), qui prolongeait la rue du Pont-Neuf vers la pointe Saint-Eustache ; la rue des Halles, qui arrivait en oblique du Châtelet, et la rue Rambuteau, déjà percée sous Louis-Philippe mais qu’il avait fallu élargir. Le terrain devait être dégagé pour construire les dix pavillons métalliques dessinés par Baltard, six à l’est et quatre à l’ouest de l’axe médian43. C’était une intervention brutale en plein cœur de la ville mais, à la différence du désastre de 1970, elle ne faisait que perpétuer une vieille tradition voulant que ce quartier fût périodiquement bouleversé sans jamais perdre son rôle ni son esprit.
Les premières halles dataient de Philippe Auguste. Il avait fait construire deux grandes bâtisses pour abriter un marché qui se tenait là, en plein air, sur une petite éminence appelée les Champeaux. Ces halles étaient entourées de murs et les portes étaient fermées pendant la nuit : on entrait là comme dans une ville. Les maisons tout autour avaient un rez-de-chaussée en retrait et des étages soutenus par des piliers, ce qui formait une galerie où s’ouvraient des boutiques. On distinguait les grands piliers de la rue de la Tonnellerie – dans l’axe du futur Pont-Neuf – et les petits piliers, ceux des potiers d’étain, qui donnaient sur une placette triangulaire au chevet de la petite église Saint-Eustache primitive. On appelait carreau des Halles ce marché en plein air au point de convergence des trois rues – Coquillière, Montmartre et Montorgueil – par lesquelles arrivaient de l’ouest et du nord le blé et la marée. Au centre de la place voisinaient une fontaine et un pilori qui était comme un panopticum de Bentham inversé, « une ancienne tour de pierre octogone, dont l’étage supérieur est percé de grandes fenêtres dans toutes les faces. Au milieu de cette tour est une machine de bois, tournante, et percée de trous où l’on fait passer la tête et les bras des banqueroutiers frauduleux, des concussionnaires et autres criminels de cette espèce, qu’on y condamne. On les y expose pendant trois jours de marché consécutifs, deux heures chaque jour ; et de demi-heure en demi-heure on leur fait faire le tour du pilori où ils sont vus en face et exposés aux insultes de la populace44 ».
Le cimetière des Innocents, le plus important de Paris pendant des siècles, occupait l’angle de la rue Saint-Denis et de la rue de la Ferronnerie45. Philippe Auguste l’avait fait entourer lui aussi d’un mur percé de quatre portes. Les morts étaient jetés dans des fosses communes profondes de plusieurs mètres, qui pouvaient accueillir jusqu’à mille cadavres. Quand une fosse était pleine, on la fermait et on en creusait une autre. Au XVe siècle, l’intérieur du mur d’enceinte fut doublé de galeries à arcades surmontées de combles, les charniers, où l’on entassait les ossements des fosses les plus anciennes pour faire de la place. Du côté de la rue de la Ferronnerie, les murs de la galerie étaient décorés d’une danse macabre comme ce siècle en a dispersé dans toute la France. En ce temps où l’on vivait en familiarité avec la mort, le cimetière était l’un des lieux les plus fréquentés de Paris, comme plus tard la galerie Mercière du Palais de Justice et les jardins du Palais-Royal. On y trouvait des lingères, des écrivains publics, des marchandes à la toilette, des vendeurs de livres et de tableaux et toutes sortes de charlatans.
Dans le marché, un certain désordre avait commencé sous Louis IX, qui avait autorisé les « pauvres femmes » à vendre le poisson de mer au détail près de la halle aux poissons frais, privilège qui s’est maintenu jusqu’à la destruction finale : ce sont elles et leurs grands parapluies rouges que rencontrait le jeune Haussmann sur le chemin de la faculté de droit. Le long du mur du cimetière, les lingères et les fripiers pouvaient eux aussi exposer gratis leurs marchandises. Au nord des Innocents, près de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles, la rue de la Grande-Truanderie n’a cessé au cours des siècles de justifier son nom : Sauval écrit qu’elle « a pris le nom des gueux qui y sont autrefois demeurés et ce n’était pas seulement une Cour des miracles, mais peut-être la première et la plus ancienne de Paris ».
La première grande « réformation » des Halles fut menée sous Henri II, à partir des années 1550, en même temps que l’on commençait à construire l’église Saint-Eustache. « En 1551, écrit Gilles Corrozet, les Halles de Paris furent entièrement baillées et rebâties de neuf, et furent dressés, bâtis et continués d’excellents édifices, hôtels et maisons somptueuses pour les bourgeois preneurs de vieilles places46. » L’ancien mur d’enceinte des Halles est alors abattu, et l’on y accède désormais par de vraies rues. La répartition des denrées se fait plus claire. Au sud, du côté où sont aujourd’hui les rues des Bourdonnais, Sainte-Opportune, des Deux-Boules, des Lavandières, c’est la Halle aux draps et aux toiles. On y trouve aussi des boucheries, bien que l’essentiel de cette activité ait lieu dans le quartier de Saint-Jacques-de-la-Boucherie – la tour Saint-Jacques est un vestige de cette grande église –, où les troupeaux sont conduits sur pied jusqu’aux écorcheries.
Au nord-ouest, aux alentours de l’actuelle Bourse du commerce, c’est la Halle aux blés, près de l’hôtel que Catherine de Médicis a fait construire par Philibert de l’Orme (« Un écrivain moderne, écrit Germain Brice deux siècles plus tard, que l’on peut suivre en cette occasion, dit qu’il n’y a pas après le Louvre de maison plus noble dans le royaume que cet hôtel »). Au nord-est, vers la pointe Saint-Eustache, c’est le carreau des Halles, qui se prolonge par le marché aux poirées : « On y vend en toutes saisons, et tous les jours, toutes sortes d’herbes, tant médicinales que potagères, et toutes sortes de fruits et de fleurs, en sorte que cette place est un jardin, où l’on voit les fleurs et les fruits de toutes les saisons47. » Cette disposition – textiles et viande au sud ; blé, poisson et légumes au nord – persistera jusqu’à Baltard.
À la fin de l’Ancien Régime, les Halles vont être une nouvelle fois bouleversées de fond en comble. L’hôtel de Catherine de Médicis – l’hôtel de Soissons – est démoli et sur son emplacement Le Camus de Mézières construit une nouvelle Halle aux blés, grand bâtiment circulaire que Molinos, dans les années 1780, couvre d’une immense coupole de bois selon une technique nouvelle à Paris. Les halles datant de la Renaissance sont remplacées par des bâtiments neufs. Et surtout on abat les maisons qui entourent le cimetière des Innocents, sur la rue aux Fers48 [Berger], la rue de la Lingerie, la rue Saint-Denis.
Les destructions emportent l’église des Innocents mais épargnent la fontaine qui lui était adossée. C’était un monument très admiré : « Le cavalier Laurent Bernin, un des plus renommés architectes de ces derniers siècles, d’ailleurs fort avare de louanges et qui affectait de ne rien estimer de tout ce qu’il voyait de beau en cette ville, ne put s’empêcher de se récrier en examinant cet incomparable ouvrage, et déclara qu’il n’avait rien remarqué de pareil en France49. » La fontaine des Innocents reçoit alors une quatrième arcade qui complète celles que Jean Goujon avait sculptées, ce qui permet de la placer non plus contre un mur mais au centre du nouveau marché des Innocents. Le cimetière, en effet, a été fermé. Dans une veine écologique, Mercier écrit que « l’infection, dans cette étroite enceinte, attaquait la vie et la santé des habitants. Les connaissances nouvellement acquises sur la nature de l’air (Lavoisier !) avaient mis dans un jour évident le danger de ce méphitisme…. Le danger était imminent ; le bouillon, le lait, se gâtaient en peu d’heures dans les maisons voisines du cimetière : le vin s’aigrissait lorsqu’il était en vidange ; et les miasmes cadavéreux menaçaient d’empoisonner l’atmosphère ». Les ossements sont alors emportés vers les carrières du sud de Paris, qui deviennent les Catacombes. « Qu’on se représente des flambeaux allumés, cette fosse immense, ouverte pour la première fois, ces différents lits de cadavres, tout à coup remués, ces débris d’ossements, ces feux épars que nourrissent des planches de cercueil, les ombres mouvantes de ces croix funéraires, cette redoutable enceinte subitement éclairée dans le silence de la nuit !50 »
C’était en observant l’évolution du site des Halles au fil des siècles que l’on pouvait comprendre le paysage de Paris. Il est impossible de se consoler de la fin stupide de ce lieu qui, comme l’écrivait Sauval trois siècles plus tôt, « est plein de tout : les légumes, les fruits des jardins et des marais, le poisson de mer et de rivière, les choses qui peuvent contribuer à la commodité et aux délices de la vie, enfin ce que l’air et la terre ont de plus excellent, de plus exquis et de plus rare, arrivant à Paris, s’amène là ». Mais, tout inconsolable que l’on soit, il ne faut pas pour autant oublier le déroulement de cette fin. Louis Chevalier l’a observé de l’intérieur, il a entendu tous les arguments que la mauvaise foi faisait valoir en faveur de la destruction : « L’argument économique, le plus mystérieux et le plus obscur… était le plus souvent cité. Et puis l’hygiène. La saleté légendaire des Halles… Je cite en vrac les mots tels que je les trouve dans les discours, sans chercher à les mettre en ordre, comme on arrangeait les marchandises, les légumes par exemple, en harmonieux édifices qui, dans la lumière éclatante des lampes, respiraient l’ordre, la beauté, le goût, et bien évidemment la propreté : si frais, si propres, que c’était même dommage de les éplucher. Mais la saleté arrangeait tout le monde…. Pour dramatiser davantage, les rats. La vieille peur moyenâgeuse des rats…. Et pour compléter ce spectacle à la Gustave Doré, les grosses prostituées de Villon, peu discrètes il est vrai, certaines étalant leurs charmes jusque sur les marches de Saint-Eustache51. » Chevalier revoit son condisciple à l’École normale supérieure, Georges Pompidou, avec lequel il dînait de temps en temps : « Il me sembla – simple illusion peut-être – que Pompidou, connaissant mes idées sur la question, à l’exact opposé des siennes, me lança un regard inflexible et goguenard qui signifiait sans doute qu’avec des gens de mon espèce les Parisiens camperaient encore dans les huttes où les avait trouvés César. »
Une fois prise la décision de transférer les Halles à Rungis, le désastre était écrit. Dans les années 1960-1970, l’architecture française était au plus bas. Les grandes commandes allaient aux membres de l’Institut, auxquels on doit – entre autres – l’immeuble administratif du boulevard Morland et sa pergola, le palais des Congrès de la porte Maillot, la tour Montparnasse, la maison de la Radio et la faculté des Sciences de Jussieu. Et dans un néfaste effet de ciseau, la corruption, la collusion au sein des sociétés d’économie mixte entre les promoteurs et les truands du gaullisme parisien étaient au plus haut. On ne se contenta donc pas d’abattre les pavillons de Baltard : pour rentabiliser l’opération la destruction s’étendit largement aux alentours. La pointe entre la rue de Turbigo et ce qui restait de la rue Rambuteau, toute la région entre feu la rue Berger et la rue de la Ferronnerie, furent remplacées par des hôtels et des immeubles de bureaux d’une laideur si agressive qu’il faut aller loin, au fond du quartier Italie ou sur le Front de Seine, pour en trouver l’équivalent, et encore. Les « jardins » sur l’emplacement des Halles montrent eux aussi à quelle décrépitude de leur art en étaient arrivés les paysagistes français. Cernés de rues mutilées, affublés de la pire panoplie du postmodernisme, ces « espaces » transforment les vieux itinéraires parisiens en parcours du combattant grâce à un dispositif complexe de barrières métalliques, de colonnes d’aération, de passerelles surplombant des fosses où végètent de misérables plantations, d’orifices de voies souterraines, de fontaines où flottent des cannettes vides. Quant au centre commercial souterrain auquel a été attribué le noble nom de forum, le plus étonnant est que son auteur soit encore classé parmi les architectes. Mais l’ensemble est si mal construit, avec des matériaux si pauvres, que sa ruine prochaine est inéluctable. On peut même dire qu’elle a déjà commencé.
Le plateau Beaubourg, entre la rue Beaubourg et la rue Saint-Martin, limité au nord par la rue du Grenier-Saint-Lazare et au sud par l’église Saint-Merri, est une dépendance des Halles auxquelles le relient, à travers le boulevard de Sébastopol, les très anciennes rues de La Reynie et Aubry-le-Boucher. Doisneau a photographié dans les années 1950 ce « vieux dépotoir des Halles où les camions se garaient, où tout un peuple de la nuit venait s’embaucher, se débaucher quelquefois, dans la pénombre, loin des pavillons éblouissants de lumière, comme des acteurs s’échauffent dans la coulisse avant d’entrer en scène52 ». Cette immense esplanade pavée, cet étrange vide dans une région si dense, était l’œuvre d’Haussmann, achevée dans les années 1930. Il avait soigneusement détruit le lacis de ruelles – rues Maubuée, de la Corroierie, des Vieilles-Étuves, du Poirier, du Maure… – qui avait servi de scène tragique à presque toutes les insurrections de la première moitié du XIXe siècle. La minuscule rue de Venise, face au centre Beaubourg, est le seul vestige de cet ensemble qu’on appelait le cloître Saint-Merri et que les journées de juin 1832 avaient rendu célèbre dans toute l’Europe. Autour du Centre lui-même, qui fait désormais partie du paysage parisien – tant il est vrai que la bonne architecture finit toujours par avoir raison des criailleries –, les sociétés d’économie mixte ont exercé leurs ravages : le « quartier de l’Horloge », avec ses sombres boyaux, ses boutiques en faillite, ses pauvres gadgets, ses odeurs suspectes, est à un vrai quartier ce qu’une cafétéria d’entreprise est à un vieux bistrot parisien.
*
La région comprise entre les Halles et les Grands Boulevards est sous-tendue et organisée par la rue Montmartre, qui sert de tuteur à deux enclaves successives, de part et d’autre de la rue Réaumur. Avant, c’est le quartier Montorgueil qui s’appuie sur la rue Montmartre par l’intermédiaire de la rue Tiquetonne, de la rue Bachaumont construite sur l’emplacement du passage du Saumon, de la rue Léopold-Bellan qui portait au XVIIIe siècle le beau nom de rue du Bout-du-Monde. Malgré son travestissement de zone piétonne, Montorgueil reste vivant grâce à son marché qui, même s’il n’est plus tout à fait vrai, joue le même rôle protecteur que rue Mouffetard ou – de moins en moins – rue de Buci. Plus loin, entre la rue Réaumur et le boulevard Montmartre, c’est l’ancien quartier de la presse, qui date de bien avant les rotatives. Lucien de Rubempré, lorsqu’il « sortit un matin avec la triomphante idée d’aller demander du service à quelque colonel de ces troupes légères de la Presse…. arriva rue Saint-Fiacre auprès du boulevard Montmartre, devant la maison où se trouvaient les bureaux du petit journal et dont l’aspect lui fit éprouver les palpitations du jeune homme entrant dans un mauvais lieu53 ».
À la belle époque de la presse quotidienne, entre la fin du Second Empire et la guerre de 1914, tous les grands journaux et les moins grands avaient là leur rédaction et leur imprimerie, superposées dans les mêmes bâtiments. Le Petit Journal était à l’angle de la rue de Richelieu et du boulevard Montmartre, à l’emplacement du fameux Frascati. Le rez-de-chaussée était occupé par une librairie et un gigantesque bazar où un aquarium de poissons exotiques voisinait avec des œuvres de Corot et de Meissonier. Rue Montmartre, à la fin du siècle, on trouvait La Presse, La France, La Liberté, Le Journal des voyages, l’imprimerie Paul Dupont dont l’immeuble abritait L’Univers, Le Jockey, Le Radical, L’Aurore. Rue du Croissant logeaient La Patrie, Le Hanneton, Le Père Duchesne, Le Siècle, La République, L’Écho de l’armée, L’Intransigeant. Le Soleil était rue Saint-Joseph, L’Illustration rue de Richelieu, La Rue et Le Cri du peuple rue d’Aboukir. Certains journaux avaient franchi le boulevard Montmartre : Le Temps était rue du Faubourg-Montmartre, La Marseillaise rue Bergère et Le Figaro au n° 26 de la rue Drouot dans un bel immeuble néogothique. Léon Daudet raconte : « C’est là que j’ai fait mes débuts en 1892 sous Magnard. Je signais “un jeune homme moderne” des petites moralités un peu là et des filets assez acerbes. Dans le même temps, Barrès, jeune homme, aussi gai et blagueur que moi, collaborait à l’illustre maison. Nous étions les chouchous de Magnard qui nous gardait dans son cabinet pendant que se morfondaient à l’étage au-dessous, orné du buste de Villemessant, les plus importants personnages. Un jour nous aperçûmes, à la caisse, Verlaine, avec sa bobine de satyre retraité – nous lui faisions une petite pension, à quelques-uns – qui venait palper ses pépètes, pas bien nombreuses. Naturellement il était saoul et, levant en l’air un gros doigt sale, il riait et répétait d’un air malicieux, indescriptible : “nonobstant… pourtant.”54 »
Le temps n’est pas si loin où l’on n’imaginait même pas de passer en voiture rue du Croissant, où des camions déchargeaient en permanence les bobines de papier pour les rotatives de l’Imprimerie de la Presse. La crise de la presse écrite, la concentration des titres, la migration des imprimeries vers la banlieue n’ont laissé derrière elles que des vestiges de cette glorieuse époque : l’immeuble du Figaro à l’angle de la rue du Mail, celui de La Tribune, les belles cariatides de l’immeuble de La France, journal du soir et la plaque du café du Croissant rappelant qu’« ici, le 31 juillet 1914, Jean Jaurès fut assassiné ». Le long de la rue du Croissant, de la rue des Jeûneurs, de la rue Saint-Joseph, le Sentier voisin s’est infiltré dans les vides laissés par la presse.
Le Sentier
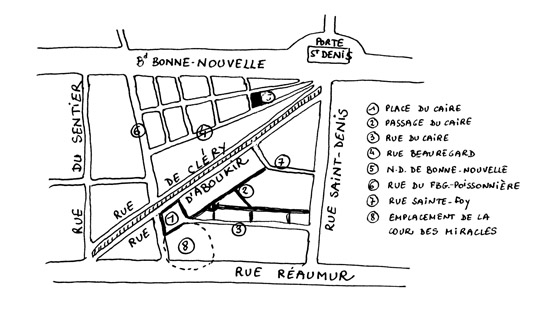
Le Sentier est aujourd’hui le seul quartier parisien dont le nom désigne à la fois un territoire, une activité économique exclusive jusqu’à ces derniers temps – le commerce des tissus et la confection – et un type social. L’implantation récente des « nouvelles technologies » a fait monter les prix de l’immobilier mais n’a pas encore ébranlé le monopole séfarade ni diminué les embouteillages, qui sont de loin les pires de Paris. D’autres noms de quartiers avaient autrefois ce pouvoir de caractériser leurs habitants. De l’Ancien Régime jusqu’à l’époque des Misérables, être du faubourg Saint-Marcel, c’était pour Sébastien Mercier faire partie de « la populace de Paris la plus pauvre, la plus remuante et la plus indisciplinable ». Jusqu’aux années 1950, être de Belleville et même de Montmartre, c’était aussi annoncer quelque peu la couleur. Ces particularismes ont disparu, sauf au Sentier, qui reste un quartier d’entrée difficile, physiquement isolé, socialement à l’écart, peu étudié, peu visité, célèbre mais mal connu55.
On pense souvent que, dans le commerce des tissus et la confection, les juifs arrivés à la fin de la guerre d’Algérie ont pris la relève des juifs de l’Est, venus par vagues successives entre les grands pogroms du début du siècle et les années 1930. En réalité le Sentier a une tradition textile bien plus ancienne. Au XVIIIe siècle, la Compagnie des Indes, qui importait entre autres des cotonnades, avait son siège près de la rue du Sentier. Les fabricants locaux et les teinturiers étaient mécontents de cette concurrence à laquelle ils livrèrent une véritable « bataille des cotonnades ». La marquise de Pompadour, fille du quartier – née rue de Cléry, elle habitait au n° 33 de la rue du Sentier quand elle était mariée au fermier général Le Normant d’Étioles –, assura la promotion des tissus locaux en les utilisant pour décorer son intérieur. Le développement de l’activité textile entraîna alors la construction d’immeubles très particuliers dont on trouve encore beaucoup d’exemples. Dans les détails, leur vocabulaire est celui du néoclassicisme, mais ce qui est inhabituel, ce qui donne à la rue de Cléry, à la rue d’Aboukir, à la rue d’Alexandrie une physionomie si particulière, c’est la densité du plan et la grande hauteur des immeubles : il fallait faire tenir dans le même bâtiment la boutique, le dépôt sur la cour, les ateliers de production dans les étages et le logement. Cette disposition (densité-hauteur) est une caractéristique des quartiers d’immigration ouvrière des grandes villes : les immeubles du Sentier rappellent ceux du ghetto de Venise et ceux d’un autre quartier historique du textile, la Croix-Rousse de Lyon.
Au XXe siècle, chaque période historique a vu arriver ici de nouveaux immigrants. Depuis une vingtaine d’années, Turcs (souvent des Kurdes), Serbes, Asiatiques du Sud-Est et Chinois, Pakistanais, Sri Lankais, Bangladais, Sénégalais et Maliens sont venus louer leur force de travail comme manutentionnaires ou presseurs-finisseurs, quand ils ne sont pas simplement employés à l’heure ou à la journée pour charger un camion ou vider un entrepôt.
Le Sentier a la forme d’un carré avec comme limites la rue Réaumur, la rue Saint-Denis, le boulevard de Bonne-Nouvelle et la rue du Sentier. Il est divisé en deux par la diagonale des rues de Cléry et d’Aboukir, droite tendue entre la porte Saint-Denis et la place des Victoires sur un segment de l’enceinte de Charles V dont les traces se lisent avec grande clarté : la rue de Cléry est construite sur la contrescarpe de l’enceinte et la rue d’Aboukir, très nettement en contrebas, est tracée dans le fossé (elle s’est d’ailleurs appelée rue « du Milieu-du-Fossé », avant de prendre le nom de Bourbon-Villeneuve, puis celui d’Aboukir en 1848).
Des deux triangles délimités par cette diagonale, le plus frénétique est du côté de la rue Réaumur et de la rue Saint-Denis. C’est le quartier retour d’Égypte de Paris56. Le nom des rues (du Nil, d’Alexandrie, de Damiette, du Caire) et surtout l’extraordinaire façade encadrant l’entrée du passage sur la place du Caire – les colonnes à chapiteaux-lotus, la frise en creux, à l’égyptienne, les trois têtes de la déesse Hathor – témoignent de l’engouement des Parisiens pour l’Égypte lors de l’expédition de Bonaparte, engouement qui dure toujours.
La place du Caire, où attendent à longueur de journée des Pakistanais et des Maliens appuyés sur leur diable, occupe l’emplacement de la principale cour des Miracles de Paris57, « une place d’une grandeur très considérable, écrit Sauval, et un très grand cul-de-sac puant, boueux, irrégulier, qui n’est point pavé. Autrefois il confinait aux dernières extrémités de Paris, à présent il est situé dans l’un des quartiers les plus mal bâtis, des plus sales et des plus reculés de la ville…. comme dans un autre monde…. Quand en 1630 on porta les fossés et les remparts de la porte Saint-Denis au lieu où nous les voyons maintenant58, les Commissaires députés à la conduite de cette entreprise résolurent de traverser la cour des Miracles d’une rue qui devait monter de la rue Saint-Sauveur à la rue Neuve-Saint-Sauveur ; mais quoi qu’ils pussent faire, il leur fut impossible d’en venir à bout : les maçons qui commençaient la rue furent battus par les gueux et ces fripons menacèrent de pis les entrepreneurs et les conducteurs de l’ouvrage ». Magnifique époque.
Au cœur du quartier, dans le passage du Caire qui est le doyen des passages parisiens (1798), beaucoup de boutiques, et ce sont les plus belles, exposent du matériel pour vitrines – mannequins, bustes, porte-étiquettes et portants dorés, arbres en plastique et fourrures en papier. Cette activité correspond à la tradition la plus ancienne du passage, spécialisé à ses débuts dans la lithographie pour calicots, qui étaient les banderoles par lesquelles les boutiques annonçaient leur commerce59.
Le triangle opposé, dans tous les sens du terme – la partie du Sentier bordée par le boulevard de Bonne-Nouvelle –, est construit sur une butte artificielle faite de gravats, de boues et d’immondices divers accumulés pendant des siècles et qu’on appelait la Butte-aux-Gravois60. Pendant la Ligue, les moulins et la petite église qui couronnaient cette butte avaient été rasés pour fortifier le rempart. C’est d’ailleurs encore avec des airs de muraille que les immeubles surplombent le boulevard du côté de la rue de la Lune ou de la rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, et la rue Beauregard rappelle la vue qui s’étendait sur la campagne du nord avec au loin les moulins de Montmartre.
On grimpe de la porte Saint-Denis à la Butte-aux-Gravois en croisant les pointes étrangement effilées des immeubles au bout des rues de la Lune, Beauregard et de Cléry. Un peu plus avant dans le quartier, la rue Notre-Dame-de-Recouvrance, la rue de la Ville-Neuve, la rue Thorel sont de très vieilles ruelles où certains murs ont des percées basses qui ne sont ni des portes ni des fenêtres mais les étals d’anciennes boutiques. En Égypte, les boulangeries donnent encore ainsi sur la rue par des soupiraux dont les grilles s’ouvrent lorsque le pain est cuit.
De l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle construite au XVIIe siècle, il ne reste que le clocher dont l’inclinaison sur la rue Beauregard dénote un sous-sol peu stable61. Le corps du bâtiment actuel date des années 1820, et c’est donc dans une église presque neuve qu’ont lieu à la fin de la deuxième partie des Illusions perdues les funérailles de la douce Coralie, que les frasques de Lucien de Rubempré avaient fait quitter sa belle demeure de la rue de Vendôme [Béranger] pour un quatrième étage rue de la Lune.
*
Entre les Halles et le Sentier d’un côté, le Marais de l’autre, la frontière est formée par les trois axes nord-sud de Paris en parallèles serrées : les rues Saint-Denis et Saint-Martin, qui sont d’anciennes voies romaines, et au milieu la percée haussmannienne par excellence, le boulevard de Sébastopol. Le contraste entre la rue Saint-Denis, ses amours tarifées, ses souvenirs sanglants, ses tapages nocturnes, et la chaste et paisible rue Saint-Martin se lit dès les Boulevards, sur les deux portes dédiées par les édiles parisiens à Ludovico Magno. Avec ses bossages vermiculés et ses bas-reliefs calmes, la porte Saint-Martin est aussi modeste que peut l’être un arc de triomphe. La « très belle et très inutile porte Saint-Denis », comme dit André Breton dans Nadja, expose au contraire le programme décoratif-politique de la monarchie absolue à son apogée. « Sa porte principale est entre deux pyramides engagées dans l’épaisseur de l’ouvrage et chargées de chutes de trophées d’armes, et terminées par deux globes aux armes de France…. Au bas de ces pyramides sont deux statues colossales dont l’une représente la Hollande sous la figure d’une femme consternée et assise sur un lion terrassé et mourant, qui tient dans ses pattes les sept flèches qui désignent les Provinces-Unies. La statue qui fait symétrie avec celle-ci est celle d’un fleuve qui tient une corne d’abondance et représente le Rhin. Dans les tympans sont deux Renommées dont l’une, par le son de la trompette, annonce à toute la terre que l’armée du roi vient de passer le Rhin à la nage et en présence des ennemis…. Sur la face de cette porte qui est du côté du faubourg, le bas-relief représente la prise de Maastricht62. » Le parallèle est intéressant avec le plafond du Painted Hall au Royal Naval College de Greenwich où Louis XIV vaincu se traîne misérablement aux pieds de Guillaume III.
Bien qu’elle soit assez délabrée et que les commerces n’y soient pas tous reluisants, la rue Saint-Denis garde l’unité et les nobles restes d’une voie royale. « La rue Saint-Denis anciennement et très longtemps s’est appelée la Grand’Rue, comme par excellence, écrit Sauval. En 1273, elle se nommait encore magnus vicus… C’était avec grand sujet car non seulement elle a été pendant plusieurs siècles la seule grande rue du quartier que nous appelons la Ville, mais encore la seule qui conduisait à la Cité, en quoi consistait tout Paris. Et même depuis, ç’a été comme une autre rue triomphale par où nos rois ont fait ordinairement leurs entrées magnifiques, à leur avènement à la couronne, après leur sacre, à leurs mariages, ou en revenant victorieux de leurs ennemis ; et enfin depuis plus de trois cents ans, c’est par là qu’après leur mort on les a portés à Saint-Denis, où sont leurs mausolées. » Les bâtiments qui bordent la rue sont très anciens, branlants et irréguliers près des Halles où prolifèrent sex-shops et peep-shows, et deviennent de beaux immeubles néoclassiques à mesure qu’on s’approche de la Porte.
En comparaison, la rue Saint-Martin est presque villageoise. Ce n’est pas seulement affaire de toponymie, parce qu’elle longe Saint-Martin-des-Champs et Saint-Nicolas-des-Champs. Elle est large, aérée, avec une belle halte sous les marronniers dans le square face au grand mur du Conservatoire des arts et métiers. Vers le centre, elle reprend l’étroitesse d’une rue médiévale, mais très détériorée. Mieux vaut passer par la rue Quincampoix, qui n’a guère changé depuis que John Law y avait établi sa Banque centrale et qu’« on se portait en foule dans cette rue étroite pour convertir en papier les espèces monnayées63 ».
Une fois franchie la rue Saint-Martin – certains diraient peut-être plutôt la rue Beaubourg –, on entre dans le Marais64. L’apparition du mot pour désigner une région de Paris est assez récente : c’est au XVIIe siècle seulement que l’on trouve ainsi dénommée la seule zone encore vraiment marécageuse du Marais, vers l’actuelle convergence des rues de Turenne, Vieille-du-Temple, de Bretagne et des Filles-du-Calvaire, non loin du cirque d’Hiver65. Quand il s’agit du quartier parisien, marais signifie région de jardins maraîchers plutôt que marécage. Si marécage il y avait eu, si la bataille de Lutèce entre Camulogène et César s’était déroulée tout autour, depuis lors on avait construit l’enceinte de Charles V, qui servait de digue, et ses fossés, de canal de drainage. Cette disposition est toujours très lisible : le boulevard Beaumarchais, bâti sur l’enceinte, est en situation si surélevée qu’en venant du Marais les rues des Tournelles et Saint-Gilles doivent monter très fort dans leurs derniers mètres pour l’atteindre. Et de l’autre côté, pour descendre vers la rue Amelot – anciennement rue des Fossés-du-Temple –, il a même fallu construire des escaliers.
Fait étrange et sans équivalent à Paris, la physionomie du Marais actuel est hantée par les fantômes de trois grands domaines dont il reste beaucoup de noms mais pas une seule pierre : le Temple, l’hôtel Saint-Pol et l’hôtel des Tournelles.
Le Marais à la fin du Moyen Âge
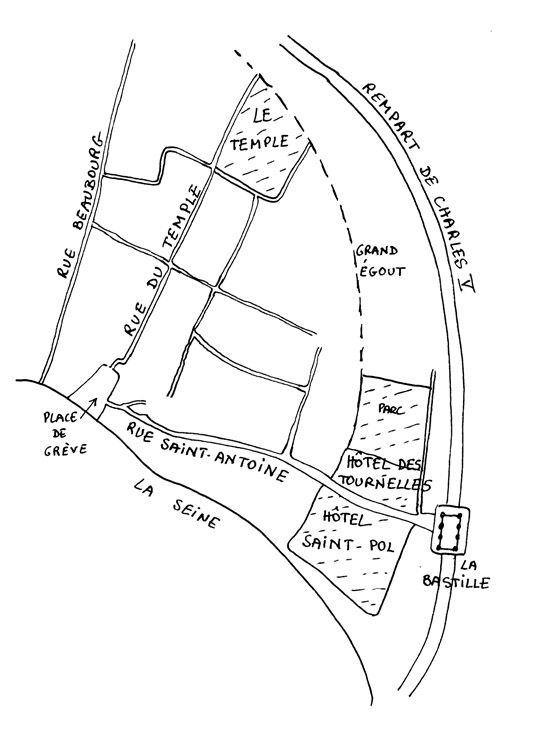
La maison mère de l’ordre militaire des Templiers, fondé à Jérusalem au XIIe siècle, était située à l’extrémité du grand axe nord-sud de la région, la rue du Temple66. Ses terrains comprenaient deux parties distinctes. Le cœur était l’enclos du Temple, quadrilatère fortifié dont les limites seraient la rue du Temple, la rue de Bretagne, la rue Charlot et la rue Béranger. Au milieu de l’enclos s’élevait le donjon qui allait servir de prison à Louis XVI et à sa famille après le 10 août, et plus tard à Babeuf et à Cadoudal. Une grande partie de cet enclos était louée à des artisans, exempts d’impôts comme dans tous les enclos religieux de Paris.
Au sud et à l’est de l’enclos, les Templiers possédaient de vastes terrains agricoles : c’était la censive du Temple dont les limites dessinaient un autre quadrilatère, étendu jusqu’à la rue du Roi-de-Sicile et qui correspond donc à une grande partie du Marais d’aujourd’hui. La muraille de Philippe Auguste traversait cette censive, sur le trajet de la rue des Francs-Bourgeois67. Du côté de la ville, ces terrains se peuplaient peu à peu le long des axes – en particulier le long de la rue Vieille-du-Temple qui s’appelait alors rue de la Couture (culture)-du-Temple – mais du côté extérieur on n’y voyait jusqu’au XVIe siècle que des jardins de maraîchers.
L’autre grand axe du Marais, orienté est-ouest, était – est toujours – la rue Saint-Antoine. À son extrémité, à la limite de Paris, deux demeures royales se faisaient face, l’hôtel Saint-Pol et les Tournelles. Saint-Pol était une création du dauphin, le futur Charles V. Lassé du vieux palais de la Cité, où il avait eu à affronter les insurrections populaires et Étienne Marcel, il décida de s’installer au calme. Il acheta au comte d’Étampes, à l’archevêque de Sens, aux abbés de Saint-Maur, des bâtiments et des jardins et finit par acquérir tout le terrain entre la rue Saint-Antoine et la Seine, depuis la rue Saint-Paul jusqu’à la rue du Petit-Musc. Saint-Pol n’était pas un hôtel au sens habituel mais un ensemble de constructions dans des jardins, réunies par des galeries couvertes encadrant une succession de préaux, une cerisaie, une vigne, un sauvoir pour l’élevage des saumons, des volières et une ménagerie où l’on nourrissait des lions, pensionnaires de l’hôtel jusqu’à sa fin (dans les Vies des dames galantes, Brantôme raconte qu’« un jour que François Ier s’amusait à regarder un combat de ses lions, une dame ayant laissé tomber son gant, dit à de Lorges, si vous voulez que je croie que vous m’aimez autant que vous me le jurez tous les jours, allez ramasser mon gant. De Lorges descend, ramasse le gant au milieu de ces terribles animaux, remonte, le jette au nez de la dame et depuis, malgré toutes les agaceries et les avances qu’elle lui faisait, ne voulut jamais la voir »).
De la porte principale de l’hôtel Saint-Pol on pouvait voir de l’autre côté de la rue Saint-Antoine le portail de l’hôtel des Tournelles, qui, selon Piganiol de La Force, « avait pris son nom de la quantité de tours dont il était environné ». Dans les années 1420, pendant l’occupation anglaise, le duc de Bedford, régent du royaume, avait fait sa résidence d’un petit hôtel qui se situerait entre la rue de Birague et l’impasse Guéménée. « Jean, duc de Bedford, y logea pendant les troubles des Bourguignons et des Armagnacs, écrit Sauval. Il l’agrandit et le fit bâtir magnifiquement, que depuis ç’a été une maison royale, que nos rois ont préférée à celle de Saint-Pol, et où Charles VII, Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François Ier ont longtemps demeuré….» Piganiol de La Force rapporte que « l’on comptait dans ce palais plusieurs préaux, plusieurs chapelles, douze galeries, deux parcs, six grands jardins, sans compter un labyrinthe qu’on nommait Dédale, non plus qu’un autre jardin ou parc de neuf arpents, que le duc de Bedford faisait labourer à la charrue par son jardinier68 ». L’hôtel, revenu à la couronne de France, était donc entouré d’un grand parc, où François Ier élevait des chameaux et des autruches, et qui a donné son nom à la rue du Parc-Royal. Il servait également aux sports équestres, mais les tournois avaient lieu sur la rue Saint-Antoine qui s’élargissait entre les deux hôtels, disposition qui existe toujours à hauteur de la statue de Beaumarchais.
La manière dont ces trois grands ensembles ont disparu explique en grande partie le Marais contemporain. L’hôtel Saint-Pol fut le premier sacrifié : François Ier, toujours à court d’argent et qui avait décidé de rénover le Louvre pour en faire sa résidence, entreprit de le vendre par lots. « On ne voit à présent aucun reste de ces édifices qui étaient composés d’un grand nombre d’hôtels, tels que celui de la Pissotte, de Beautreillis, de l’Hôtel-de-la-Reine, de l’Hôtel Neuf, appelé d’Étampes, etc. Et c’est sur leurs ruines que se sont formées les rues qui sont depuis celles de Saint-Paul jusqu’aux fossés de l’Arsenal, lesquelles conservent les noms des bâtiments qui y étaient au temps de l’hôtel Saint-Pol, comme celles de Beautreillis, des Lions, du Petit-Musc et de la Cerisaie69. » Comme tout le Marais construit à la Renaissance, cette partie du quartier Saint-Paul, malgré les noms des rues qu’on dirait issus de manuscrits enluminés, est dessinée de façon moderne : les lots sont réguliers, le quadrillage des rues est orthogonal, contrastant avec le lacis médiéval du côté de l’hôtel de Sens, des rues des Nonnains-d’Hyères et de l’Ave-Maria.
La destruction des Tournelles ne fut pas provoquée par des difficultés financières mais par un accident : en 1559, rue Saint-Antoine, lors du tournoi pour le mariage des princesses, le roi Henri II fut mortellement blessé devant ce palais d’un éclat de lance, par Gabriel de Montgomery, « le plus bel homme et le meilleur gendarme de ce temps-là », selon Sauval. Catherine de Médicis, sa veuve, décida de faire raser les Tournelles et s’installa dans son nouvel hôtel aux Halles. Dans le parc à l’abandon, un marché aux chevaux s’installa pour de longues années.
Mais pendant ce temps, dans la partie du Marais plus proche du centre, un quartier neuf se construisait entre les deux enceintes, celle de Philippe Auguste autour de la ville à forte densité, et celle de Charles V, qui passait en pleins champs. Une fois franchies les « fausses portes » de la vieille enceinte, on entrait dans une région où les maraîchers cultivaient en paix leurs choux et leurs poireaux. C’était là un paradis pour les promoteurs car la demande était forte dans la première moitié du XVIe siècle avant les guerres de Religion. François Ier donna l’exemple en lotissant l’hôtel de Tancarville, dont les terrains se situaient de part et d’autre de l’enceinte de Philippe Auguste, à l’angle de la rue Vieille-du-Temple et de la rue des Rosiers. Les communautés religieuses – en particulier Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, qui possédait la vaste couture Sainte-Catherine, vers la rue Payenne – lotirent également leurs terrains70. Le mouvement s’étendait du côté des rues Barbette et Elzévir. C’était un quartier moderne qui se constituait là, très influencé par le nouveau goût venu d’Italie, avec des demeures dont l’hôtel Carnavalet reste un somptueux exemple.
Cet essor, longtemps bloqué par les guerres de Religion, par la Ligue et le terrible siège, reprend avec l’entrée d’Henri IV à Paris en 1594. Par la voix du prévôt des marchands, il fait annoncer que « son intention est de passer les années en cette ville, et y demeurer comme vrai patriote, rendre cette ville belle, placide et pleine de toutes les commodités et ornements qu’il sera possible, voulant le parachèvement du Pont-Neuf et le rétablissement des fontaines…. (désirant même) faire un monde entier de cette ville et un miracle du monde, en quoi certainement il nous fait connaître un amour plus que paternel71 ».
Ce qui manque alors au Marais – et à Paris en général –, c’est une grande place « pour les habitants de notre ville, lesquels sont fort pressés en leurs maisons à cause de la multitude du peuple qui y afflue de tous côtés72 ». Henri IV et Sully ont l’idée de construire cette place Royale [des Vosges] sur le parc des Tournelles, alors délaissé car loin du centre. Et pour faire coup double, le roi décide d’implanter sur le côté nord de la place une manufacture de draps de soie, brodés d’or et d’argent, produits de luxe jusque-là importés de Milan. « Et de fait en 1605 les entrepreneurs de ces manufactures y avaient fait un grand logis qui occupait tout un côté. Le Roi vis-à-vis y fit marquer une grande place de soixante-douze toises en carré qu’il voulut être appelée la place Royale et pour un écu d’or de cens donna les places des trois autres côtés, à la charge de les couvrir de pavillons selon l’élévation qui leur serait fournie. De plus il fit percer les rues qui y conduisaient et commença à ses dépens tant le pavillon Royal situé au bout de la rue Royale [de Birague], que celui de la Reine, placé au bout de la rue du Parc-Royal…. Tous les pavillons consistent en trois étages, sont tous bâtis de brique, rehaussés d’arcades, de chaînes, d’embrasures, d’entablements et de pilastres de pierre, d’ailleurs tous couverts d’un comble d’ardoise à deux coupes, terminé d’un faîte garni de plomb…. On trouvait dans la rougeur des briques, la blancheur de la pierre et la noirceur de l’ardoise et du plomb un mélange, ou si cela peut se dire, une certaine nuance de couleurs si agréable…. que depuis elle a passé jusqu’aux maisons bourgeoises73. »
Sous les arcades s’alignaient des boutiques élégantes, mais on y trouvait aussi – comme plus tard au Palais-Royal – des tripots, et les prostituées en avaient fait l’un de leurs lieux favoris74. Le centre de la place, inaugurée par Louis XIII lors du grand carrousel de 1612, était plat, sablé, dégagé : il servait de terrain aux cavalcades, aux tournois, aux jeux de bagues et parfois aussi à des duels dont certains sont restés célèbres75.
Non loin de là, Henri IV et Sully avaient imaginé une autre place, une sorte de cité administrative pour abriter entre autres le Grand Conseil. Il y avait une occasion à saisir car le grand prieur du Temple lotissait son immense censive. Le projet de cette place de France était un demi-cercle dont le diamètre – près de deux cents mètres – se confondait avec l’enceinte. Une nouvelle porte royale, percée entre les rues du Pont-aux-Choux et des Filles-du-Calvaire, ouvrait vers la route de Meaux et d’Allemagne. Six rues rayonnaient de la place vers l’intérieur de la ville, portant les noms des provinces sièges de cours souveraines – premier exemple, dit Sauval, de rues dénommées d’après la géographie. Le dessin de voies divergentes depuis une porte de ville était à la mode depuis le trident de la Porta del Popolo à Rome76. De ce projet interrompu par la mort d’Henri IV, il persiste le nom de certaines rues (Poitou, Picardie, Saintonge, Perche, Normandie…) qui, même si elles ne correspondent pas au plan d’origine, en perpétuent la toponymie. Le dessin initial est également rappelé par le tracé rayonnant de la rue de Bretagne et surtout le demi-cercle formé par la rue Debelleyme. Il reste aussi le marché des Enfants-Rouges77, conçu pour alimenter ces vastes aménagements. Ravaillac a eu plus d’influence qu’on ne le pense sur l’urbanisme parisien car, si ce grand projet avait été mené à terme, le centre de gravité de la ville s’en serait trouvé de façon durable déplacé vers l’est.
Comme le temps des lieux n’est ni continu ni homogène, un quartier peut soudain prendre de l’accélération et il s’y passe alors plus d’événements en vingt ans qu’en deux siècles. Avec la place Royale et ses alentours, c’est la première fois qu’on aménage à Paris un quartier destiné à ce qui ne s’appelle pas encore la flânerie, un « promenoir » offert à une société qui revit après le cauchemar des guerres de Religion. Ce n’est pas la paix pourtant : au moment où la mode de l’Espagne est au plus haut, lors de la première du Cid en 1636, l’armée espagnole est à Corbie, à trois jours de marche de Paris, et le danger ne sera écarté que bien plus tard, après Rocroi. Ce n’est pas non plus la tolérance religieuse : en 1614, dans le cahier de la Ville de Paris aux États généraux, le vœu est exprimé que les juifs, les anabaptistes et autres ne professant point la foi catholique ou ne pratiquant pas la religion prétendue réformée, « tolérée par les édictz », soient punis de mort78. Il n’empêche : entre le nouveau quartier et une certaine aristocratie cultivée, une haute bourgeoisie ouverte, un milieu intellectuel et artistique en pleine ébullition, c’est une histoire d’amour qui se noue. Dans l’une des premières comédies de Corneille, La Place Royale (1633), il n’est guère question de la place elle-même mais il est révélateur de choisir son nom pour titre d’une pièce sur la jeunesse à la mode79. Dix ans plus tard, le valet de Dorante le Menteur, chargé d’enquêter sur une belle rencontrée dans la rue : « La langue du cocher a bien fait son devoir,/ La plus belle des deux, dit-il, est ma maîtresse,/ Elle loge à la place, et son nom est Lucrèce./ – Quelle place ? – Royale, et l’autre y loge aussi….» Scarron, quittant le quartier, fait ses Adieux aux Marets et à la place Royale : « Adieu donc jusqu’après la foire/Que vous me verrez revenir/Car qui peut longtemps se tenir/Si loin de la Place Royale ?/ Adieu belle Place où n’habite/Que mainte personne d’élite,/ Or adieu Place très illustre/D’une illustre ville le lustre. »
C’est au Marais que l’intelligentsia du Paris baroque tient ses réunions. Rue de Béarn, derrière la place Royale, le nouveau couvent des Minimes vient d’être achevé, avec une chapelle décorée par Vouet, La Hyre et Champaigne et un portail qui passe pour le chef-d’œuvre de François Mansart. Le père Mersenne – « a savant in whom there was more than in all the universities together », dit de lui Hobbes en exil à Paris – y donne l’hospitalité à son ami Descartes qui passe là plusieurs mois avant de partir pour la Hollande. Il recevra aussi Gérard Desargues, savant géomètre spécialiste du dessin des escaliers, accompagné d’un jeune élève, Blaise Pascal, qui habite non loin de là, rue de Touraine. Curieux couvent, en pointe à la fois dans la lutte contre les mal-pensants – la « Confrérie des bouteilles », Théophile de Viau, Saint-Amant, Guez de Balzac – et dans la recherche scientifique, avec une bibliothèque de 25 000 volumes. À l’hôtel de Montmort, rue du Temple, on rencontre Huygens, Gassendi – qui léguera à Hubert de Montmort, conseiller au Parlement, la lunette personnelle de Galilée –, Claude Tardy, le médecin qui introduit en France les idées nouvelles de William Harvey sur la circulation du sang et le rôle du cœur : une controverse passionnée oppose dans les salons circulateurs et anticirculateurs qui défendent le système de Galien. Tous les lundis, le président Lamoignon réunit des écrivains dans son hôtel de la rue Pavée80 – Racine, Boileau, La Rochefoucauld, Bourdaloue – auxquels se joint souvent Guy Patin, médecin du roi et professeur au Collège de France.
Les femmes elles aussi tiennent salon. Certaines sont des demi-mondaines, comme on dira plus tard : Marion Delorme, qui reçoit place Royale et Ninon de Lenclos, dont la demeure de la rue des Tournelles est le rendez-vous des libertins – des libres-penseurs –, ce qui ne l’empêche pas d’avoir parmi ses habitués La Rochefoucauld et Mme de Lafayette, Boileau, Mignard et Lulli. La légende veut que Molière y ait lu pour la première fois le Tartuffe, devant La Fontaine et Racine venu avec la Champmeslé. Mme de Sévigné écrit à sa fille (à propos de son fils, 1er avril 1671) : « Mais qu’elle est dangereuse, cette Ninon ! Si vous saviez comme elle dogmatise sur la religion, cela vous ferait horreur…. nous faisons tous nos efforts, Mme de la Fayette et moi, pour le dépêtrer d’un engagement si dangereux. » On trouve aussi au Marais des intellectuelles vertueuses : Mlle de Scudéry, la précieuse par excellence, reçoit tous les samedis dans son petit hôtel de la rue de Beauce, dont la cour est ornée d’un acacia – une rareté – et d’une volière. C’est là qu’elle écrit avec son frère le Grand Cyrus et la Clélie, illustrée de la fameuse carte du Tendre. Mme de Sévigné passe toute sa vie parisienne au Marais. Elle naît chez son grand-père, à l’angle de la place Royale et de la rue de Birague. Orpheline, elle habite chez son oncle, rue Barbette puis rue des Francs-Bourgeois. Après son mariage à Saint-Gervais, elle s’installe rue des Lions. Bientôt veuve, elle emménage avec ses deux enfants rue de Thorigny, face à l’ambassade de Venise, puis rue des Trois-Pavillons [Elzévir] et enfin à l’hôtel Carnavalet : « C’est une affaire admirable, nous y tiendrons tous et nous aurons le bel air. Comme on ne peut pas tout avoir, il faut se passer des parquets et des petites cheminées à la mode ; mais nous avons du moins une belle cour, un beau jardin et de bonnes petites filles bleues qui sont fort commodes81. »
Chaque grande demeure de la place Royale cache, dit Scarron, « Ses dedans somptueux, ses superbes lambris,/ Ses riches ornements, ses peintures sans prix,/ Ses rares cabinets, ses dais et ses balustres ». Le duc de Richelieu, petit-neveu du Cardinal, a réuni dans son hôtel (actuel n°21) une collection qui comprend plus de dix tableaux de Poussin, dont Élièzer et Rébecca – sujet d’une célèbre conférence de Philippe de Champaigne devant l’Académie – et le Moïse sauvé des eaux qui sera acheté par Louis XIV et qui est aujourd’hui au Louvre. Le Bernin, grand admirateur de Poussin, rend visite au duc lors de son séjour parisien comme il va voir les Sacrements chez Chantelou. Ayant vendu les Poussin, le duc achètera des Rubens, dont Le Massacre des Innocents et la Chasse aux lions qui est aujourd’hui à Munich. Au n°10 de la place habite le président Amelot de Gournay. Son fils a pour précepteur Roger de Piles, dont les écrits théoriques sont à l’origine d’une controverse célèbre, celle des poussinistes – la majorité de l’Académie – contre les rubénistes, défenseurs de la couleur et dénoncés comme corrupteurs des arts visuels, eux qui ont « introduit par leur cabale je ne sais quelle peinture libertine et entièrement dégagée de toutes les sujétions qui rendaient autrefois cet art si admirable et si difficile82 ».
Beaucoup d’artistes choisissent d’habiter le Marais, près de leurs commanditaires civils et religieux. On y trouve des peintres comme Quentin Varin, dont l’atelier est rue Saint-Antoine à l’angle de la rue de Birague ; Claude Vignon, dans la même rue près de la Visitation ; La Hyre, qui loge rue d’Angoumois [Charlot] et peint une Nativité pour l’église de ses voisins, les capucins du Marais, à l’angle de sa rue et de la rue du Perche. Un peu plus tard, tous les grands noms de l’architecture sont réunis au Marais : François Mansart, qui se fait construire rue Payenne une maison très simple (actuel n°5) ; son neveu par alliance, Jules Hardouin-Mansart, qui habite rue des Tournelles un hôtel décoré par Mignard, Le Brun et La Fosse ; Libéral Bruant, rue Saint-Louis [de Turenne]83 ; Le Vau dans la même rue, et Jacques II Gabriel, rue Saint-Antoine.
Le quartier a son théâtre, qui est le plus couru de Paris, narguant les Comédiens du roi de l’hôtel de Bourgogne. Il est inauguré en 1629 dans un jeu de paume de l’impasse Berthaud – derrière le centre Beaubourg – avec Mélite ou les Fausses Lettres, comédie d’un jeune provincial inconnu, Pierre Corneille. Le succès est immédiat grâce au talent du principal comédien de la troupe, Montdory. Lorsque le théâtre aura déménagé au jeu de paume des Maretz, rue Vieille-du-Temple84, c’est lui qui interprétera le rôle-titre du Cid. Après les premières représentations, il écrit à Guez de Balzac : « Le Cid a charmé tout Paris. Il est si beau qu’il a donné de l’amour aux dames les plus continentes, dont la passion a même plusieurs fois éclaté au théâtre public…. La foule a été si grande à nos portes…. que les recoins du théâtre, qui servaient les autres fois comme niches aux pages, ont été des places de faveur pour les Cordons bleus et la scène y a été d’ordinaire parée de croix de chevaliers de l’Ordre85. »
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l’impetus du Paris baroque se calme et les grands hôtels que l’on construit désormais au Marais, en pierre de taille, entre cour et jardin, n’ont plus rien de fantaisies à l’italienne. Avec l’hôtel d’Aumont, rue de Jouy (Le Vau), l’hôtel Guénégaud de Brosses, rue des Archives (François Mansart), l’hôtel de Beauvais, rue Saint-Antoine (Le Pautre), l’hôtel Amelot de Bisseuil, rue Vieille-du-Temple (Cottard), l’hôtel d’Avaux, rue du Temple (Le Muet), l’hôtel Salé, rue de Thorigny (de Bourges), ce qui s’élabore à ce moment et dans ce quartier, c’est l’hôtel classique français.
Mais vers la fin du règne de Louis XIV, fermiers généraux et conseillers au Parlement, maréchaux, ducs et pairs se sentent à l’étroit dans le parcellaire serré du Marais et commencent à investir le faubourg Saint-Honoré et surtout le faubourg Saint-Germain, où il reste encore de grands terrains à bâtir. Cette migration a des conséquences définitives sur la physionomie de Paris : le centre résidentiel élégant se déplace en quelques années de l’est à l’ouest, et il y restera. Balzac, bien plus tard, a encore la conscience de ce bouleversement : « …. la noblesse, compromise au milieu des boutiques, abandonna la place Royale, les alentours du centre parisien, et passa la rivière afin de pouvoir respirer à son aise dans le faubourg Saint-Germain, où déjà des palais s’étaient élevés autour de l’hôtel bâti par Louis XIV au duc du Maine, le benjamin de ses légitimés86. » La décadence du Marais est consommée à la fin de l’Ancien Régime, au moment où Mercier écrit le Tableau de Paris : « Ici, vous retrouvez du moins le siècle de Louis XIII, tant pour les mœurs que pour les opinions surannées. Le Marais est au quartier brillant du Palais-Royal, ce que Vienne est à Londres. Là règne, non la misère, mais l’amas complet de tous les vieux préjugés : les demi-fortunes s’y réfugient. Là, se voient les vieillards grondeurs, sombres, ennemis de toutes les idées nouvelles ; et des conseillères bien impérieuses y frondent, sans savoir lire, les auteurs dont les noms parviennent jusqu’à elles : on y appelle les philosophes des gens à brûler. »
Pendant la Révolution, l’émigration finit de vider le quartier de ce qui y restait d’aristocratie. Dans La Comédie humaine, Balzac loge au Marais les déclassés, les laissés-pour-compte humbles, dignes et solitaires. Déjà, dans les « Prolégomènes » du Traité de la vie élégante, Balzac explique que « le petit détaillant, le sous-lieutenant, le commis rédacteur…. s’ils ne thésaurisent pas comme les manouvriers, afin d’assurer à leur vieillesse le vivre et le couvert, l’espérance de leur vie d’abeille ne va guère au-delà : car c’est la possession d’une chambre bien froide, au quatrième, rue Boucherat [de Turenne] ». Le comte Octave (Honorine), qui « occupait l’une des plus hautes places de la magistrature », menait une vie « plus obscure car il demeurait au Marais, rue Payenne, et ne recevait presque jamais ». Le cousin Pons, le grand personnage balzacien du Marais, dont le caractère et la condition s’identifient avec le quartier, habite rue de Normandie, « une de ces vieilles rues à chaussée fendue, où la ville de Paris n’a pas encore mis de bornes-fontaines, et dont le ruisseau noir roule péniblement les eaux ménagères de toutes les maisons, qui s’infiltrent sous les pavés et y produisent cette boue particulière à la ville de Paris ».
Ayant échappé aux percées haussmanniennes – de peu : le baron projetait de prolonger la rue Étienne-Marcel jusqu’au boulevard Beaumarchais –, le Marais est resté en déshérence jusqu’au milieu du XXe siècle. Dans les années 1945-1950, c’était encore un quartier pauvre, où les cours des grands hôtels étaient encombrées de fourgonnettes, d’appentis à toits de tôle, de piles de palettes et de charrettes à roues en bois cerclées de fer. Les années de Gaulle-Malraux-Pompidou ont vite corrigé cet archaïsme. Les promoteurs n’ont pas tardé à voir le parti à tirer de bâtiments si historiques, si délabrés et habités par une population si peu capable de se défendre. En vingt ans le Marais devint méconnaissable, et depuis les vieux hôtels – patine décapée, modénatures abrasées, huisseries plastifiées, sécurité et parking assurés – sont aux mains d’une bourgeoisie fortunée, en un mouvement inverse de celui qui, deux siècles auparavant, l’avait vue émigrer en masse vers l’ouest.
Les limites assignées au Marais ont fluctué au fil du temps. Au XVIIIe siècle, il s’étendait jusqu’aux limites de la ville. Pour Piganiol de La Force, « bordé à l’orient par les remparts et la rue du Mesnil-Montant [Oberkampf], au septentrion par les extrémités du faubourg du Temple et de la Courtille [boulevard de Belleville], à l’occident par la grande rue des mêmes faubourgs [rue du Faubourg-du-Temple] », il comprenait une grande partie de l’actuel XIe arrondissement. Aujourd’hui, Marais désigne tout ce qui se trouve entre les Boulevards, la rue Beaubourg et la Seine, avec un petit décrochement le long de la rue de la Verrerie pour ce qui reste du quartier de l’Hôtel de Ville. Mais la double origine du Marais – le nord artisanal autour de l’enclos du Temple, le sud aristocratique autour des hôtels royaux – a laissé de si profondes traces qu’il y a comme un abus de langage à tout recouvrir du même nom. Tout compte fait, le quartier, bien qu’il date presque entièrement de la même et brève époque, comporte tant de particularismes régionaux qu’il ne peut se lire que comme un archipel.
Le Marais des artisans commence au nord de l’axe que forme la séquence des rues Saint-Gilles, du Parc-Royal, de la Perle, des Quatre-Fils, des Haudriettes et Michel-le-Comte. Il est divisé en trois par le T que forment la rue de Bretagne et la rue du Temple. 1°) Entre la rue de Bretagne et la République, sur l’emplacement de l’enclos du Temple, c’est l’équipement municipal type de la IIIe République, la mairie, le commissariat de police, le square et le marché, ici représenté à la fois par les Enfants-Rouges et le carreau du Temple, de très ancienne tradition fripière87. 2°) Entre la rue de Bretagne, la rue du Temple et le boulevard, c’est un dédale de rues courtes, étroites, orientées en tous sens comme si l’abandon du projet de place de France avait laissé le chaos derrière lui. La rue Charlot et la rue de Saintonge, rectilignes et parallèles, sont comme superposées à cette trame anarchique. « La rue Charlot et toutes les rues des environs, écrit Sauval, ont été bordées de maisons par Claude Charlot, pauvre paysan de Languedoc que de nos jours la fortune a nourri, engraissé et étouffé entre ses bras puisqu’enfin d’adjudicataire général des gabelles et des cinq grosses Fermes et de seigneur du duché de Fronta, il est retombé mort dans la boue d’où la fortune l’avait tiré. » L’ancien artisanat du métal, voisinant avec de bonnes galeries d’art contemporain, subsiste dans ces rues calmes où des typographies dorées annoncent des activités d’un autre âge, gravure et estampage, poinçons et matrices, placages, électrolyse, basse fusion, cire perdue et polissage. 3°) En un de ces contrastes qui font le charme du quartier, de l’autre côté de la rue du Temple et jusqu’à la rue Beaubourg inclusivement, c’est le domaine agité de l’horlogerie, de la joaillerie et de la maroquinerie en gros. Juifs et Asiatiques coexistent pacifiquement sur le territoire de la section révolutionnaire des Gravilliers, le fief des Enragés, « des âmes chaudes, véhémentes, des hommes qui éclairent, entraînent et subjuguent », comme écrivait Jacques Roux à Marat88. Rue Volta, rue au Maire, rue des Gravilliers, rue Chapon, les cours sont encore celles du vieux Marais : portes grandes ouvertes, camionnettes et diables, amoncellements de cartons, embouteillages et klaxons, tous les signes cliniques de la vie.
Le sud du quartier, le Marais des rois, des promoteurs, des historiens et des touristes, est traversé et organisé par la rue Saint-Antoine, l’une des plus belles de Paris – vraie ville de rues, ce qui ne se dirait pas de New York, de Tokyo ni même de Rome, plutôt faite de ruelles entre des places. La rue Saint-Antoine est au point d’équilibre entre régularité – dans l’alignement des bâtiments, le gabarit, l’harmonie colorée – et tension, par sa double courbe et son évasement terminal (pour les rues, il n’est pas de beauté sans régularité : la rue des Archives, désarticulée par d’incessantes variations de largeur, des dents creuses et des ajouts hétéroclites, ne tient pas la comparaison avec sa contemporaine et voisine, la très régulière rue du Temple. Inversement, la régularité sans tension peut devenir ennuyeuse sur de longs trajets, comme les arcades de la rue de Rivoli ou le boulevard Magenta. La beauté dans la répétition modulaire stricte se rencontre surtout dans les rues courtes, comme – dans des styles évidemment différents – la rue du Cirque, la rue des Colonnes, la rue de Marseille ou la rue des Immeubles-Industriels qui intriguait tant Walter Benjamin).
Les courbes de la rue Saint-Antoine (les courbes, car la rue François-Miron est historiquement son segment initial) sont ponctuées par deux dômes qui ne sont pas pour moi – et pour bien d’autres, assurément – de simples silhouettes mais des amis. Celui de Saint-Paul-Saint-Louis, l’église des Jésuites, est le premier grand dôme parisien, encore un peu maladroit, trop petit sur un tambour trop haut, ce qui donne à l’église le charme d’une adolescente montée en graine, surtout de dos depuis la rue des Jardins-Saint-Paul89. La Visitation de François Mansart, vestige du couvent des Visitandines qui s’étendait jusqu’à la porte de la Bastille, est au contraire la plus parfaite coupole sur plan centré qu’on puisse trouver à Paris, avec la chapelle de la Salpêtrière de Libéral Bruant.
De part et d’autre de la rue Saint-Antoine s’étend l’archipel du Marais. Du côté de la Seine, ce sont les rues silencieuses du quartier Saint-Paul. De l’autre côté se succèdent d’est en ouest la place des Vosges, la grande île des musées90 et l’île aux Juifs. « La rue de la Juiverie [Ferdinand-Duval depuis 1900] est ainsi appelée pour ce que le temps passé les Juifs y habitaient, avant qu’ils fussent chassés de France par le roi Philippe Auguste pour leurs usures excessives, et les impiétés et crimes exécrables qu’ils exerçaient contre les chrétiens », écrit l’abbé Du Breuil91. Sauval, dont l’opinion est différente, note que, « à l’égard des rues de cette juiverie, quelques-unes sont fort étroites, tortues et obscures…. Toutes les maisons qui les bordent sont fort petites, hautes, malfaites, et semblables aux juiveries de Rome, Metz ou Avignon ». Le quartier juif actuel est prospère et animé, malgré la pression des boutiques de mode d’un côté et des bars homosexuels de l’autre. Et l’inéluctable disparition des vieux bundistes à casquette n’empêche pas la civilisation du pickelfleish et du gefiltefish de résister vaille que vaille à celle du falafel92.
Sur la rive droite, l’Ancien Paris forme approximativement un demi-cercle. Sa circonférence est bordée par l’arc des Boulevards et son diamètre par une bande étroite le long de la Seine, entre la rue de Rivoli et les quais, depuis la colonnade du Louvre jusqu’à l’Hôtel de Ville, ou, pour le dire autrement, du gothique flamboyant de Saint-Germain-l’Auxerrois à la façade classique de Saint-Gervais. Cette bande est un cas à part où les couches successives, au lieu d’entrer comme ailleurs en résonance comme des harmoniques, forment un ensemble discordant et confus. Ce n’est pas faute de beaux bâtiments, de détails pittoresques, de souvenirs historiques, mais ils sont perdus dans un patchwork si hétéroclite que le sens général n’est plus lisible. On y trouve pêle-mêle des percées haussmanniennes avortées (l’avenue Victoria) ou ravagées par les bretelles et entrées de souterrains (la rue du Pont-Neuf, la rue des Halles), des places éventrées (la place du Châtelet, encore ravissante en 1860 sur une photographie de Marville, toute petite, presque close autour de sa fontaine) ou aménagées de façon ridicule (la place de l’Hôtel-de-Ville, le square de la tour Saint-Jacques), des rues anciennes massacrées par la rénovation (rue Bertin-Poirée) ou par la circulation automobile (rue des Lavandières-Sainte-Opportune dans laquelle un rond-point déguisé en jardin zen dérive tout le flot de la rue Saint-Honoré). Même Haussmann, d’ordinaire plutôt content de lui, sent confusément qu’il y a là quelque chose qui ne va pas et qu’il attribue aux difficultés du terrain : « Le dénivellement de tout le quartier environnant la place du Châtelet, motivé par l’abaissement à l’est de la butte que dominait la tour Saint-Jacques, et par le rehaussement, à l’ouest, du quai de la Mégisserie et de ses abords, avait nécessité la démolition de toutes les maisons comprises de la rue des Lavandières à la rue des Arcis [Saint-Martin], entre la ligne des quais et la rue de Rivoli », une manière de justification qui n’est pas fréquente dans les Mémoires de celui qui se disait « artiste démolisseur ».
Le pire avait pourtant été évité : il était fortement question de faire partir le prolongement de la rue de Rivoli du milieu de la colonnade du Louvre. « Guerre aux démolisseurs ! » écrit Hugo dans La Revue des Deux Mondes du 1er mars 1832. « Le vandalisme a son idée à lui. Il veut faire tout à travers Paris une grande, grande, grande rue. Une rue d’une lieue ! Que de magnifiques dévastations chemin faisant ! Saint-Germain-l’Auxerrois y passera, l’admirable tour de Saint-Jacques-de-la-Boucherie y passera peut-être aussi. Mais qu’importe ! une rue d’une lieue !….. une ligne droite tirée du Louvre à la barrière du Trône ! » Haussmann, qui était protestant, refusa le projet, craignant que la destruction de Saint-Germain-l’Auxerrois fût interprétée comme une revanche de la Saint-Barthélemy, dont le signal fut donné, dit-on, par les cloches de cette église.
*
«La vie de Paris, sa physionomie, a été, en 1500, rue Saint-Antoine ; en 1600, à la place Royale ; en 1700, au Pont-Neuf ; en 1800, au Palais-Royal. Tous ces endroits ont été tour à tour les Boulevards ! La terre a été passionnée là, comme l’asphalte l’est aujourd’hui sous les pieds des boursiers, au perron de Tortoni. » Quand Balzac écrit en 1844 Histoire et physiologie des boulevards de Paris, il y a près de dix ans que la mode a quitté le Palais-Royal, dix ans que le Paris de Manon Lescaut, d’Adolphe, d’Henry de Marsay a disparu avec les quinquets, les demi-solde, la vogue de Cherubini et les succès de Byron, Walter Scott et Fenimore Cooper. Dans un mouvement du goût accompagnant les dandys, les filles, les journalistes et les gourmets dans leur migration vers les Boulevards, c’est un autre romantisme qui apparaît alors, celui de Berlioz, de Frédérick Lemaître et de la Fanfarlo. Mais, par une des mille façons qu’ont les données sensibles de narguer les catégories de l’histoire de l’art, il se trouve que les Boulevards, la grande scène du romantisme parisien, sont un long déroulé d’architecture néoclassique (paradoxe qui rejoint celui que le malin Lousteau expliquait à Lucien de Rubempré vers 1830 : « …. nos grands hommes sont divisés en deux camps. Les Royalistes sont romantiques, les Libéraux sont classiques. La divergence des opinions littéraires se joint à la divergence des opinions politiques, et il s’ensuit une guerre à toutes armes, encre à torrents, bons mots à fer aiguisé, calomnies pointues, sobriquets à outrance, entre les gloires naissantes et les gloires déchues. Par une singulière bizarrerie, les Royalistes romantiques demandent la liberté littéraire et la révocation des lois qui donnent des formes convenues à notre littérature ; tandis que les Libéraux veulent maintenir les unités, l’allure de l’alexandrin et le thème classique93 »).
De la Madeleine à la Bastille, il ne reste rien des demeures de légende construites à la fin de l’Ancien Régime sur le rempart, d’où la vue s’étendait sur la ville d’un côté et sur les jardins maraîchers de l’autre : rien de la maison de Beaumarchais, dans son jardin dessiné par Bellanger, où Mme de Genlis vint assister à la démolition de la Bastille avec les enfants du duc d’Orléans, rien du pavillon de Hanovre construit pour les soupers fins du maréchal de Richelieu – « le pavillon des fées », disait Voltaire –, rien de l’hôtel bâti par Ledoux pour le prince de Montmorency à l’angle de la Chaussée-d’Antin, dont l’entablement portait, comme un hommage à Palladio, les statues des huit connétables de Montmorency, « vertus héroïques que le vandalisme a détruites, impression profonde que le temps n’efface pas94 ». Sur le boulevard de la Madeleine, on pouvait encore récemment admirer les deux rotondes encadrant l’abouchement de la rue Caumartin, celle de l’hôtel du duc d’Aumont et celle de l’hôtel du fermier général Marin de La Haye – dont le toit portait jadis un jardin suspendu où, selon Hillairet, deux petits ponts chinois chevauchaient un ruisselet qui, après avoir formé une île, distribuait l’eau dans les salles à manger et les bains de l’immeuble. Elles viennent d’être façadisées, ce qui est peut-être pire que démolies95.
Mais malgré les destructions, le parcours des Boulevards reste un grand catalogue déambulatoire de l’architecture néoclassique parisienne de Louis XVI à Louis-Philippe, surtout vers la ville, du côté des numéros impairs (sud si l’on veut), où les propriétaires étaient aux premières loges sur la promenade. Beaucoup firent même construire des terrasses qui surplombaient l’animation du boulevard96. Là alternent le pur Louis XVI – l’hôtel Montholon, boulevard Poissonnière, avec ses six colonnes ioniques colossales supportant le balcon du troisième étage, et sa terrasse-jardin –, le style de l’Empire et de la Restauration, plus dépouillé encore, plus archéologique, et celui de la monarchie de Juillet, orné et souriant, avec de grands immeubles de rapport aux allures de palais italiens où l’on sent l’éclectisme pointer derrière le goût de l’Antique97.
S’il est si difficile d’imaginer le pouvoir de séduction des Boulevards au temps de leur splendeur, c’est que leur séquence comportait alors des scansions rythmiques mais non des ruptures. Malgré leur longueur, ils avaient une continuité, quelque chose d’un espace clos, ce qui avait fait le succès de la place Royale et du Palais-Royal. Ils étaient comme l’enfilade des pièces d’un immense palais, avec pour chacune son décor, ses horaires, ses habitués. Or, d’Haussmann à Poincaré, cette intimité urbaine a été éventrée. L’opéra Garnier et son rond-point giratoire, l’abouchement du boulevard Haussmann dans le boulevard Montmartre créant l’informe carrefour « Richelieu-Drouot » et la brutale implantation de la place de la République sur la rencontre du faubourg du Temple et du boulevard du Crime ont remplacé de subtiles césures par des vides béants. Le père de Lucien Leuwen, cet homme exquis, providence des danseuses de l’Opéra, quand il se « (promenait) sur le boulevard, son laquais lui donnait un manteau pour passer devant la rue de la Chaussée-d’Antin ». Quelles précautions n’aurait-il pas dû prendre pour traverser la place de la République !
La segmentation des Boulevards est devenue très sèche. Entre la Madeleine et l’Opéra, les grands hôtels et les agences de voyages. De l’Opéra à Richelieu-Drouot, les banques. Puis, jusqu’à la République, une portion qui, bien qu’assez détériorée, est sans doute la plus proche en esprit des anciens Boulevards. Enfin, entre la République et la Bastille, c’est le domaine de la motocyclette, de la photographie et de la musique, qui ne manque ni de charme ni de lieux singuliers mais ne fait plus vraiment partie des Boulevards.
Comme point d’inflexion dans le temps, comme amorce de la longue descente des Boulevards aux enfers, l’image qui me vient est la mort de Nana dans une chambre du Grand-Hôtel, boulevard des Capucines. « “Voyons, il faut partir, dit Clarisse. Nous ne la ressusciterons pas… Viens-tu, Simonne ?” Toutes regardaient le lit du coin de l’œil, sans bouger. Pourtant, elles s’apprêtaient, elles donnaient de légères tapes sur leurs jupes. À la fenêtre, Lucy s’était accoudée de nouveau, toute seule. Une tristesse peu à peu la serrait à la gorge, comme si une mélancolie profonde eût monté de cette foule hurlante. Des torches passaient encore, secouant des flammèches ; au loin, les bandes moutonnaient, allongées dans les ténèbres, pareilles à des troupeaux menés de nuit à l’abattoir ; et ce vertige, ces masses confuses, roulées par le flot, exhalaient une terreur, une grande pitié de massacres futurs. Ils s’étourdissaient, les cris se brisaient dans l’ivresse de leur fièvre se ruant à l’inconnu, là-bas, derrière le mur noir de l’horizon. “À Berlin ! à Berlin ! à Berlin !”»
C’est sur les Boulevards que sont apparues une par une les nouveautés de la ville moderne : la première ligne parisienne de transports en commun, la célèbre Madeleine-Bastille, les urinoirs, les stations de fiacres, les kiosques à journaux, les colonnes Morris. Mais le grand bouleversement qui pointe en 1817 dans le passage des Panoramas et se répand sur les Boulevards dans les années 1840, c’est l’éclairage au gaz. On peut saisir chez Baudelaire le basculement des Fleurs du mal, éclairées à la lumière tremblotante de l’huile (« À travers les lueurs que tourmente le vent/La Prostitution s’allume dans les rues »), au Spleen de Paris, illuminé au gaz (« Le café étincelait. Le gaz lui-même y déployait toute l’ardeur d’un début, et éclairait de toutes ses forces les murs aveuglants de blancheur….98»). C’est le gaz qui permet de vivre les heures les plus profondes de la nuit. « Traversez la ligne qui fait l’axe de la rue de la Chaussée-d’Antin et de la rue Louis-le-Grand, et vous voilà entré dans le domaine de la foule. Le long de ce boulevard, du côté droit particulièrement, tout est magasins brillants, pompeux étalages, cafés dorés, illumination permanente. De la rue Louis-le-Grand à la rue de Richelieu le flot de lumières qui jaillit des boutiques vous permettrait de lire le journal en vous promenant », écrit Julien Lemer dans Paris au gaz, publié chez Le Dentu en 186199. À l’heure de la fermeture, « sur les boulevards, à l’intérieur des cafés, les papillons de gaz des girandoles s’envolaient très vite, un à un, dans l’obscurité. L’on entendait du dehors le brouhaha des chaises portées en quatuors sur les tables de marbre100 ». Mais, grâce au gaz, la vie nocturne ne s’interrompt pas. Alfred Delvau, noctambule professionnel, propose un guide du couche-tard sur les Boulevards du Second Empire : « On peut se replier, passé minuit, vers le café Leblond, dont l’entrée du boulevard des Italiens ferme à minuit, mais dont la sortie passage de l’Opéra reste ouverte jusqu’à deux heures. Le café des Variétés (dans le passage des Panoramas), qui a la permission de 1 h 30, reçoit de nombreux soupeurs à la sortie des théâtres. Au café Wolf, 10, rue du Faubourg-Montmartre, les noctambules du quartier Bréda se rabattent vers minuit pour…. boire de la bière et manger des saucisses à l’oignon, en attendant l’heure de la fermeture. À deux heures restent ouverts Brabant, au coin du boulevard et du faubourg Montmartre, Bignon, au coin de la Chaussée-d’Antin, et surtout Hill’s Tavern, boulevard des Capucines, où se mêlent la fashion et la bohème débraillée. »
Une coutume se répand sur les Boulevards des années 1850 – si enracinée depuis dans la vie des Parisiens qu’il est difficile d’imaginer la ville sans elle : les cafés installent des tables en terrasse. « Tous les cafés garnissent de sièges le trottoir qui longe leur devanture ; on en établit un groupe notable entre la rue Laffitte et la rue Le Peletier, et il n’est pas rare de voir, pendant les chaleurs de l’été, les flâneurs accablés rester, jusqu’à une heure du matin, à la porte des cafés à humer des glaces, de la bière, des limonades et des soda-waters101. » Quand Georges Leroy, Bel-Ami, « la poche vide et le sang bouillant », traînait sur le boulevard des Italiens par une soirée étouffante, « les grands cafés, pleins de monde, débordaient sur le trottoir, étalant leur public de buveurs sous la lumière éclatante et crue de leur devanture illuminée. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, les verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances ; et dans l’intérieur des carafes on voyait briller les gros cylindres transparents de glace qui refroidissaient la belle eau claire ».
« Rien de plus facile ni de plus agréable qu’une telle promenade (sur les Boulevards). Les chaussées réservées aux piétons sont dallées ou bitumées, ombragées d’arbres et garnies de sièges. Les cafés sont peu éloignés l’un de l’autre. De distance en distance, des fiacres stationnent sur la chaussée. Enfin, des omnibus vont incessamment de la Bastille à la Madeleine. » En partant dans le sens inverse de ce que propose ainsi le guide Joanne de 1870, la promenade commençait par les boulevards de la Madeleine et des Capucines. Pendant longtemps tout ce segment, jusqu’à la césure de la rue de la Chaussée-d’Antin, était à l’écart de la vie des Boulevards. « De la Madeleine à la rue Caumartin, on ne flâne pas, écrit Balzac. C’est un passage dominé par notre imitation du Parthénon, grande et belle chose, quoi qu’on en dise, mais gâtée par les infâmes sculptures de café qui déshonorent les frises latérales…. Toute cette zone est sacrifiée. On y passe, on ne s’y promène pas102. »
Une quinzaine d’années plus tard, on sent pointer une certaine animation : « Vous venez de la Madeleine, vous n’avez encore qu’un seul côté de trottoir qui soit véritablement vivant, le côté droit ; l’autre est occupé par une rue, la rue Basse-du-Rempart, aujourd’hui ravagée par la démolition pour faire place à la future salle de l’Opéra103. » Et lors de l’Exposition universelle de 1867, d’après le Paris Guide tout semble changé : « De nos jours, la partie la plus monumentale des boulevards est celle qui va de la rue de la Chaussée-d’Antin à la Madeleine. Le nouvel Opéra est entouré de palais. La richesse et le confort des aménagements intérieurs du Grand-Hôtel, de l’hôtel où s’est transféré le Jockey-Club, répondent à la magnificence du dehors. Il ne reste plus de vestiges de l’humide rue Basse qu’encombra de morts et de blessés la décharge du 23 février (1848). Les édifices, les magasins rivalisent de somptuosité. » Mais le tableau se termine par une singulière conclusion où La Bédollière retrouve les mots mêmes de Balzac : « Et pourtant, sur les boulevards des Capucines et de la Madeleine, il semble que le froid du pôle se fasse sentir. On y passe sans s’y promener ; on y demeure, mais on n’y stationne pas. Les files de voitures qui reviennent de Vincennes, dans l’après-midi des jours de courses, tournent court et quittent les boulevards à la hauteur de la rue de la Paix. Enfin, pour nous servir d’une locution toute parisienne, ça n’est plus ça !104 »
Petit-Coblentz en 1815, dénommé d’après la ville-symbole de l’émigration, boulevard de Gand, où s’était réfugié Louis XVIII pendant les Cent-Jours, le boulevard des Italiens tire son nom définitif de l’ancien théâtre des Comédiens-Italiens, la salle Favart – qui pourtant, on l’a vu, lui tourne le dos. Entre la rue de la Chaussée-d’Antin et la rue de Richelieu, c’est le Boulevard par excellence pour « ceux qu’on a appelés tour à tour raffinés, beaux, merveilleux, incroyables, dandys, fashionables, lions, gandins, cocodès, petits crevés105 ». Là, dit Balzac, « commencent ces édifices bizarres et merveilleux qui sont tous un conte fantastique ou quelques pages des Mille et Une Nuits…. Une fois que vous avez mis le pied là, votre journée est perdue si vous êtes un homme de pensée. C’est un rêve d’or et d’une distraction invincible. Les gravures des marchands d’estampes, les spectacles du jour, les friandises des cafés, les brillants des bijoutiers, tout vous grise et vous surexcite106 ». Quand Bixiou et Léon de Lora veulent montrer Paris à un cousin de province, c’est là qu’ils l’amènent, devant « cette nappe d’asphalte sur laquelle, de une heure à deux, il est difficile de ne pas voir passer quelques-uns des personnages pour lesquels la Renommée embouche l’une ou l’autre de ses trompettes107 ».
Les cafés et les restaurants élégants étaient plus nombreux sur le boulevard des Italiens que partout ailleurs – le Helder, fréquenté surtout par des officiers (« Sont-ce encore des gandins, ces hommes d’une tenue sévère, attablés au café du Helder ? Ne remarquez-vous pas sur le front de la plupart les traces du soleil de l’Algérie, de la Cochinchine ou du Mexique ?108 »), le café de Foy à l’angle de la Chaussée-d’Antin, le café Anglais et ses vingt-deux salons particuliers dont le fameux Grand-Seize, le Grand-Balcon entre les rues Favart et de Marivaux, le café Riche, le café Hardy, la pâtisserie Frascati à la place de la célèbre maison de jeu fermée en 1837, les Bains chinois au coin de la rue de La Michodière, le restaurant de la Maison dorée à l’angle de la rue Laffitte… L’épicentre était précisément localisé entre la rue Le Peletier et la rue Taitbout, encadrée à son abouchement par deux établissements mythiques : à gauche le café de Paris et à droite Tortoni dont le perron, auquel on accédait par trois marches, fut l’un des lieux les plus célèbres du monde pendant cinquante ans. Tortoni était fréquenté par les dandys, les artistes – Manet y était tous les soirs – et les financiers : « On sort du champ de bataille de la Bourse pour aller aux restaurants, en passant d’une digestion à l’autre. Tortoni n’est-il pas à la fois la préface et le dénouement de la Bourse ? » Et ce sont deux des plus belles crapules de La Comédie humaine qu’on y retrouve naturellement : « Vers une heure Maxime (de Trailles) mâchonnait son cure-dents en causant avec du Tillet sur le perron de Tortoni où se tient, entre spéculateurs, cette petite Bourse, préface de la grande109. » L’entrée principale de l’Opéra était à deux pas de là, rue Le Peletier, et le passage de l’Opéra avec ses deux galeries – du Thermomètre et du Baromètre – permettait l’accès direct depuis le boulevard.
Dans la partie des rues Laffitte et Le Peletier attenante aux Boulevards, on vit se former dans les années 1870 ce qui ne s’était encore jamais vu à Paris, un rassemblement de marchands de tableaux sur les mêmes trottoirs. En 1867, Paul Durand-Ruel transféra sa galerie de la rue de la Paix au n° 16 de la rue Laffitte, avec des locaux rue Le Peletier110. Au n° 8 de la même rue se trouvait déjà la galerie d’Alexandre Bernheim, fils d’un marchand de couleurs de Besançon, qui vendait des toiles de son ami Courbet, de Corot, d’Harpignies et de Rousseau. Malgré les sarcasmes que l’on sait (Albert Wolff dans Le Figaro en 1876 : « La rue Le Peletier a du malheur. Après l’incendie de l’Opéra, voici un nouveau désastre qui s’abat sur le quartier. On vient d’ouvrir chez Durand-Ruel une exposition qu’on dit être de peinture….»), d’autres suivirent, et en peu de temps ces quelques mètres étaient devenus le territoire de l’art à Paris. Baudelaire à Nadar : « Si tu étais un ange, tu irais faire ta cour à un nommé Moreau, marchand de tableaux, rue Laffitte…. et tu obtiendrais de cet homme la permission de faire une double belle épreuve photographique d’après La Duchesse d’Albe, de Goya (archi-Goya, archi-authentique). » Manet disait souvent qu’« il est bon d’aller rue Laffitte ». Degas, descendu de Pigalle par l’omnibus, la parcourait souvent, en client. « Il contemplait, dit Romi, les Corot de Bernheim, critiquait les Fantin-Latour chez Tempelaere et s’offrait un Delacroix qu’il faisait livrer chez lui, en grand seigneur. » Gauguin, qui travaillait chez un agent de change de cette même rue Laffitte, s’arrêta pendant douze ans devant ces vitrines magiques jusqu’au jour où, n’y tenant plus, il abandonna la Bourse pour la peinture. Certaines galeries étaient consacrées à Boudin, à Corot, à Daumier, d’autres montraient les tableaux coûteux de Henner, de Bouguereau et de Meissonier. Près de la boutique révolutionnaire de Durand-Ruel se trouvait la respectable galerie de M. Beugnet, qui exposait en permanence les bouquets de fleurs léchés de Madeleine Lemaire. Chaque mois, un admirateur de l’artiste mondaine venait vaporiser sur ses violettes, ses œillets et ses roses un léger nuage du parfum correspondant. « Réclame poétique ! » disait M. Beugnet. En 1895 Ambroise Vollard déclencha un scandale en montrant cinquante toiles de Cézanne dans sa nouvelle galerie au 39, rue Laffitte (la précédente était au n° 8 de la même rue). Vollard y invitait à dîner dans sa cave. « Tout le monde, raconte Apollinaire dans Le Flâneur des deux rives, a entendu parler de ce fameux hypogée…. Bonnard a peint un tableau représentant la cave et, autant qu’il m’en souvienne, Odilon Redon y figure. » Dans la même rue se trouvaient les bureaux de « l’amicale, à tous prête » Revue blanche, où passaient chaque jour des chroniqueurs, des illustrateurs, des amis, Mallarmé ou Jarry, Blum ou Gide, Lautrec, Vallotton ou Bonnard.
Deux raisons expliquent la catastrophe qui s’est abattue sur le boulevard des Italiens et sur ses coulisses artistiques, faisant de celui-là un haut lieu de la fast food et de celles-ci un sinistre désert. La première est la prolifération des banques et des compagnies d’assurances, qui envahirent le quartier au tournant du siècle. De la construction, dans les années 1890, du lourd bâtiment du Crédit lyonnais – qui a si opportunément pris feu au moment du scandale précipitant cette banque dans la honte publique –, à la dénaturation de la Maison dorée dans les années 1970 par l’un des premiers et pires exemples de façadisation, chacun des trottoirs où s’alignaient ces « édifices bizarres et merveilleux » a été saccagé. La Banque nationale de Paris, qui possède à elle seule tout le nord du boulevard, de la rue Laffitte au carrefour Richelieu-Drouot, ne s’est pas contentée de défigurer la Maison dorée : elle offre là un concentré de ce qu’elle a répandu dans des centaines de rues et de carrefours parisiens. Les assurances, elles, se sont partagé les rues de l’art moderne et les ont transformées en canyons grisâtres, peuplés de vigiles et traversés par des flots de voitures. Elles ont été aidées – c’est la deuxième raison – par le prolongement du boulevard Haussmann dans les années 1920, seule percée réalisée au XXe siècle dans le centre de Paris, qui a entraîné de gigantesques démolitions et en particulier celle du fameux passage de l’Opéra. « “Le boulevard Haussmann est arrivé aujourd’hui rue Laffitte”, disait l’autre jour L’Intransigeant. Encore quelques pas de ce grand rongeur, et, mangé le pâté de maisons qui le sépare de la rue Le Peletier, il viendra éventrer le buisson que traverse de sa double galerie le passage de l’Opéra, pour aboutir obliquement sur le boulevard des Italiens. C’est à peu près au niveau du café Louis XVI qu’il s’abouchera à cette voie par une espèce singulière de baiser, de laquelle on ne peut prévoir les suites ni le retentissement dans le vaste corps de Paris111. »
Le boulevard des Italiens se termine à la rue de Richelieu, c’est un fait. Mais la vie élégante ne s’étendait-elle pas au-delà, sur le boulevard Montmartre ? Ne se poursuivait-elle pas jusqu’au carrefour formé par l’intersection de la rue Montmartre, du faubourg et du Boulevard, si terrible qu’on l’appelait le carrefour des écrasés ? Certains penchaient plutôt pour la négative : « Ce qu’on appelait alors “le Boulevard” ne s’étendait que de la Chaussée-d’Antin au passage de l’Opéra, peut-être jusqu’au faubourg Montmartre à cause des Variétés, mais il était de fort mauvais ton de se montrer plus loin. Au-delà du Café Anglais les dandys ne flânaient guère ; après les Variétés ils ne se montraient plus112. » Mais pour la plupart, c’était le faubourg Montmartre qui formait la frontière entre boulevards élégants et boulevards populaires. Pour Balzac, « le cœur du Paris actuel…. palpite entre la rue de la Chaussée-d’Antin et la rue du Faubourg-Montmartre…. À partir de la rue Montmartre jusqu’à la rue Saint-Denis, la physionomie du Boulevard change entièrement113 ». Si le boulevard Montmartre appartient plutôt aux artistes et aux commerçants qu’aux gens de lettres et aux dandys, il reste pourtant aux yeux de Julien Lemer une promenade recommandable et il est même le préféré de La Bédollière : « Le torrent impétueux que nous venons de traverser (la rue du Faubourg-Montmartre) est une sorte de Bidassoa qui sépare deux contrées, et nous tombons en pleine littérature. Voici des journalistes, des romanciers, des chroniqueurs, des vaudevillistes, des artistes dramatiques, voire des conférenciers…. Ce n’est pas sans raisons que de vastes salons littéraires, une librairie internationale se sont installés sur le boulevard Montmartre…. Et tous, comme des abeilles, bourdonnent autour du théâtre des Variétés, à la porte des cafés, à l’heure de l’absinthe surtout…. Les passages, Jouffroy, Verdeau, des Panoramas, sont ce qu’était jadis le Palais-Royal. Dans la matinée le silence y règne, troublé seulement par les pas d’apprentis, de commis, de demoiselles de comptoir qui se rendent à leur poste…. Vers onze heures apparaissent les habitués du Dîner de Paris, du Dîner du Rocher, du Dîner du passage Jouffroy…. Cinq heures sonnent ; les journaux du soir se distribuent dans les kiosques des boulevards…. À six heures, grand remue-ménage ! le faubourg descend ! Les habitantes des quartiers Bréda et Notre-Dame-de-Lorette s’avancent à la conquête des boulevards. C’est une région que signalent de loin le cliquetis du jais, l’odeur du musc, le frissonnement de la soie114. »
Traverser le carrefour Montmartre, s’engager sur les boulevards Poissonnière et de Bonne-Nouvelle, c’était passer de l’élégance au négoce, de la littérature au calicot, de l’art le plus contemporain à l’artisanat le plus traditionnel. « Le Gymnase y montre vainement sa petite façade coquette ; plus loin, le bazar Bonne-Nouvelle, aussi beau qu’un palais vénitien, est en vain sorti de terre comme un coup de baguette d’une fée115 : tout cela, peines perdues ! Il n’y a plus d’élégance chez les passants, les belles robes y sont comme dépaysées, l’artiste, le lion, ne s’aventurent plus dans ces parages…. Un seul boulevard d’intervalle produit ce changement total116. » Pendant la journée, le boulevard Poissonnière est pourtant très animé : « Entrez au restaurant Baurain, vous y trouverez plusieurs représentants de commerce venus pour acheter et vendre du velours, des linons, des toiles écrues ou peintes, des cotons filés ou retors. Entrez au théâtre du Gymnase, vous reconnaîtrez dans l’auditoire des doyens de la nouveauté et du calicot, qui applaudissent Sardou et Alexandre Dumas fils, comme ils ont applaudi Scribe et Melesville. Faites un tour sur la petite promenade en biseau, ombragée de maigres sycomores, à l’angle de la rue d’Hauteville. Les garçons et filles, qui y prennent leurs ébats et mangent de la galette, sont nés au milieu des tulles, des barèges, des blondes, des laines et des soies. Ils ont su, dès leur tendre enfance, ce qu’était l’article de Tarare, l’article de Saint-Quentin, et la marchandise A.G.117. » Sur le boulevard Poissonnière s’alignaient la maison du Pont-de-Fer, sorte de centre commercial sous une immense arcade métallique double, le Dock du Campement spécialisé dans les objets de voyage, la maison Barbedienne, « qui vend des modèles antiques en bronze, reproduits par le procédé Colas, et les médaillons de David (d’Angers)…. Un peu plus loin, les salons du restaurateur Brébant…. les magasins de tapis de M. Roncier, et deux maisons plus loin, le bazar de l’Industrie française, dont les deux étages exposent les richesses les plus variées118 ».
La partie des Boulevards comprise entre le faubourg Montmartre et la porte Saint-Denis est celle qui a le moins changé depuis le XIXe siècle, malgré le Grand Rex et l’assez malencontreuse poste de la rue de Mazagran. C’est peut-être pour cette raison que les surréalistes avaient fait de ce segment leur boulevard, même s’ils fréquentaient aussi le passage de l’Opéra et en particulier le café Certa – « lieu où, vers la fin de 1919, un après-midi, André Breton et moi décidâmes de réunir désormais nos amis, par haine de Montparnasse et de Montmartre, par goût aussi de l’équivoque des passages » – et le Théâtre-Moderne – « cette salle aux grandes glaces usées, décorées vers le bas de cygnes gris glissant dans des roseaux jaunes, aux loges grillagées, privées tout à fait d’air, de lumière, si peu rassurantes »119. Les quelques mètres que l’on désigne faute de mieux par le nom de « Strasbourg-Saint-Denis » exerçaient sur Breton une attirance qu’il s’expliquait par « l’isolement des deux portes qu’on y rencontre et qui doivent sans doute leur aspect si émouvant à ce que naguère elles ont fait partie de l’enceinte de Paris, ce qui donne à ces deux vaisseaux, comme entraînés par la force centrifuge de la ville, un aspect totalement éperdu120 ». Mais pour lui, dans ces années-là, le centre du monde c’est le boulevard Bonne-Nouvelle : « On peut, en attendant, être sûr de me rencontrer dans Paris, de ne pas passer plus de trois jours sans me voir aller et venir, vers la fin de l’après-midi, boulevard Bonne-Nouvelle entre l’imprimerie du Matin et le boulevard de Strasbourg. Je ne sais pourquoi c’est là, en effet, que mes pas me portent, que je me rends presque toujours sans but déterminé, sans rien de décidant que cette donnée obscure, à savoir que c’est là que se passera cela (?)121. »
Au-delà de la porte, le boulevard Saint-Martin jouait un rôle de transition entre un boulevard encore quelque peu bourgeois et le boulevard vraiment populaire, « comme la veste est une transition entre l’habit et la blouse122 ». Au XIXe siècle, ce qui frappait le plus, c’était son aspect de canyon : les travaux de nivellement de Rambuteau n’avaient porté que sur la chaussée, qui se trouvait donc « baissée, et tellement baissée, que, depuis la porte Saint-Martin jusqu’au théâtre de l’Ambigu-Comique, on a dû, de chaque côté, établir une rampe, avec des escaliers de distance en distance. À cet endroit, la chaussée se trouve donc encaissée comme un chemin de fer…. Lorsqu’on a annoncé la rentrée des troupes ramenées par le maréchal Canrobert, après la guerre d’Italie, en 1859, dès la veille au soir cette partie du boulevard était envahie, les places contre la rampe étaient prises, et l’on y a passé toute la nuit ».
Il y avait là quelques-uns des grands théâtres romantiques : celui de la Porte-Saint-Martin, construit par Lenoir en quarante jours sur ordre de Marie-Antoinette, où l’on avait applaudi Frédérick Lemaître et Marie Dorval dans Marion Delorme et Mlle George dans Lucrèce Borgia ; l’Ambigu, spécialement consacré au drame (« C’est là qu’il vous faut aller, ô vous, amateurs de ces grandes pièces, bien sombres, bien mystérieuses, mais où l’innocence parvient toujours à triompher, entre onze heures et minuit123 ») ; les Folies-Dramatiques dans la rue de Bondy, où « l’on joue habituellement le vaudeville, le drame mêlé de chant et enfin la Fantaisie ». Pour Heine, c’est là que le théâtre est au plus haut et il va en se dépréciant à mesure qu’on s’éloigne vers l’est, vers le boulevard du Crime, jusqu’à « Franconi, dont la scène ne peut guère compter pour un rang, parce qu’on y donne des pièces faites plutôt pour les chevaux que pour les hommes124 ».
Avec Franconi, on passe du boulevard Saint-Martin au boulevard du Temple. À hauteur du n° 52 – une plaque indique que Gustave Flaubert y a vécu de 1856 à 1869 –, la ligne des immeubles s’incurve fortement vers le nord, vers la droite si l’on regarde vers la place de la République toute proche. Le dernier de ces immeubles décalés bute sur un immense mur aveugle, perpendiculaire au boulevard et qui replace dans l’alignement général les quelques mètres précédant la place. Cette disposition a une explication simple : la courbe des immeubles décalés indique le tracé du boulevard du Temple « primitif », avant le percement du boulevard du Prince-Eugène [Voltaire] et de la place du Château-d’Eau [de la République]. Ce premier boulevard du Temple allait rejoindre le boulevard Saint-Martin vers l’emplacement actuel de la caserne de la garde républicaine. La rue du Temple et la rue du Faubourg-du-Temple se trouvaient dans le prolongement direct l’une de l’autre, de part et d’autre des Boulevards. Ce carrefour légèrement dilaté formait une petite place, avec au centre une fontaine contre laquelle se tenait, le mardi et le jeudi, un marché aux fleurs125.
C’est la partie la plus célèbre du boulevard du Temple qui fut détruite par les travaux de 1862 : le boulevard du Crime, ainsi dénommé « non par MM. les procureurs impériaux mais par des vaudevillistes jaloux des lauriers du mélodrame126 ». Sa vogue populaire commence dans les dernières années de l’Ancien Régime. À son apogée, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, « c’était une kermesse parisienne, une foire perpétuelle, un landit de toute l’année…. On y voyait des oiseaux faisant l’exercice, des lièvres battant la caisse, des puces qui traînaient des carrosses, Mlle Rose, la tête en bas et les pieds en l’air, Mlle Malaga à la crapaudine, des escamoteurs, des joueurs de gobelet, des nains, des géants, des hommes-squelettes, des femmes de huit cents livres, des avaleurs de serpents, de cailloux, d’huile bouillante. Enfin Munito, ce chien savant, ce profond calculateur, n’a pas dédaigné d’y donner des représentations et des leçons aux joueurs de dominos du café de la Régence127 ». En 1844, Balzac pouvait encore écrire que « c’est le seul point de Paris où l’on entende les cris de Paris, où l’on voie le peuple grouillant, et ces guenilles à étonner un peintre, et ces regards à effrayer un propriétaire. Feu Bobèche était là, l’une des gloires de ce coin…. Son compère s’appelait Galimafrée. Martainville a écrit pour ces deux illustres saltimbanques les parades qui faisaient tant rire l’enfant, le soldat et la bonne, dont les costumes émaillent constamment la foule sur ce célèbre boulevard128 ». Haussmann, on le devine, avait le souci de faire disparaître au plus vite « ces distractions malsaines qui dégradent et abrutissent de plus en plus les masses populaires de Paris ».
Réinscrits dans la mémoire collective par le joyeux carton-pâte des Enfants du Paradis, sept théâtres s’alignaient côte à côte sur le côté gauche du boulevard en regardant vers la Bastille. Pour toutes ces salles, l’entrée des artistes était rue des Fossés-du-Temple [Amelot] qui leur formait une sorte de coulisse commune. Il y avait là le Théâtre-Lyrique, « égaré dans ces parages » selon Haussmann. Massenet, élève au Conservatoire, y tenait les timbales le soir pour gagner sa vie. « Je dois l’avouer, je blousais de remarquable façon, à ce point que Berlioz voulut bien un jour m’en complimenter et ajouter : “De plus vous êtes juste, ce qui est rare !”129» Au Cirque-Olympique, exploité par les Franconi, alternaient des attractions – jongleurs indiens, sauteurs chinois, acrobates italiens, animaux savants – et des parades militaires ressuscitant l’épopée du Premier Empire. Puis venaient les Folies-Dramatiques, la Gaîté, vouée malgré son nom aux plus sombres mélodrames, et les Funambules dont la vedette était le mime Debureau, rôle tenu par Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis. Le chroniqueur du Globe, journal des saint-simoniens, écrivait le 28 octobre 1831 : « Il y a dans les farces de cet homme je ne sais quoi d’amer et de triste : le rire qu’il provoque, ce rire qui part si franc de sa poitrine fait mal quand à la fin, après nous avoir si bien divertis de toutes les manières, on le voit, pauvre Debureau ou plutôt pauvre peuple ! retomber de tout son poids à l’état de soumission, d’abaissement et de servitude où nous l’avons trouvé au commencement de la pièce et dont il ne s’est échappé un instant que pour tant nous réjouir. Adieu Pierrot ! Adieu Gilles ! Adieu Debureau ! Adieu peuple, à demain !130 » La rangée des théâtres se terminait par les Délassements-Comiques et le Petit-Lazzari – qui devait son nom à un mime italien du XVIIIe siècle –, tout près de la maison d’où Fieschi fit exploser sa machine infernale sur le passage de Louis-Philippe, en 1835. Plus, écrit Haussmann, « d’autres bouis-bouis oubliés131 ».
Ces théâtres étaient à l’origine d’une multiplication de petites industries, « de l’ouvreur de voitures, du ramasseur de bouts de cigares, et surtout du marchand de contremarques, lequel est peu nombreux aux portes des autres théâtres132 ». Si l’on trouvait là des bouts de cigare à ramasser et des portières à ouvrir, c’est qu’il y avait une clientèle chic qui venait s’encanailler sur le boulevard du Crime : « Ces dames viennent dans ces petites salles, qu’en argot dramatique on appelle des bouis-bouis, de la même façon que les impures de la Régence se donnaient la distraction d’aller de temps à autre au théâtre de la Foire133. »
Les grands travaux haussmanniens ont fait disparaître presque toutes ces merveilles. Il reste le théâtre Déjazet (« Ce nom seul vous fait sourire, car il vous rappelle une actrice charmante, que vous devez avoir applaudie cent fois, et que vous pouvez applaudir encore. Déjazet est une huitième merveille du monde, et, pour ma part, je la préfère de beaucoup au colosse de Rhodes134 ») qui dut son salut au fait qu’il se trouvait, tout seul, sur le trottoir opposé aux démolitions. Il reste aussi le cirque d’Hiver qui est l’ancien cirque Napoléon construit par Hittorff, où, le dimanche après-midi, les lions et les clowns étaient remplacés par des concerts organisés par Pasdeloup. « On exécute là des œuvres de Haydn, Beethoven, Mozart, Weber, etc. Vous voyez qu’il ne s’agit plus ici de contredanses ni de polka ; c’est de la musique sévère, sérieuse, de la grande musique enfin135. »
« Le reste du boulevard, de la rue d’Angoulême [Jean-Pierre-Timbaud] jusqu’à la Bastille, a, il faut l’avouer, un triste parfum de Marais, cette espèce de nécropole après neuf heures du soir136. » Balzac ne montre guère d’estime pour les deux grands établissements qu’on y trouve : « Le fameux Cadran Bleu n’a pas une fenêtre ni un étage qui soient du même aplomb. Quant au Café Turc, il est à la Mode ce que les ruines de Thèbes sont à la Civilisation…. Bientôt commencent des boulevards déserts, sans promeneurs. Le rentier s’y promène en robe de chambre s’il veut ; et par les belles journées, on y voit des aveugles qui font leur partie de cartes. In piscem desinit elegantia. »
*
D’habitude, les villes construites sur un fleuve grandissent sur l’une des deux rives et l’autre sert de faubourg, souvent populaire, souvent pittoresque, mais faubourg quand même : le Trastevere, l’Oltrarno, Lambeth, Brooklyn… Le Danube ne passe pas dans Vienne et à Budapest il sépare deux cités qui lui tournent le dos. À Paris au contraire la rive droite et la rive gauche sont en symbiose depuis la nuit des temps et, malgré le béton répandu, le fleuve lui-même – les quais, les ponts, les bras, les îles – est à la fois origine, frontière, lien, décor et structure. Mais ce « grand miroir toujours vivant de Paris », comme dit Benjamin, est souvent voilé par tout un attirail, un corpus de clichés qui, de tous ceux que la ville a fait naître, comptent parmi les plus convenus. Chansons, cartes postales, poèmes (Pont Mirabeau compris), technicolor et photographies de mode ont fini par donner de la Seine une image délavée et commerciale quand elle n’est pas littérairement attendrie (cas fréquent et qui provoque la rage d’André Breton lors de la mort d’Anatole France : « Pour y enfermer son cadavre, qu’on vide si l’on veut une boîte des quais de ces vieux livres qu’il aimait tant, et qu’on jette le tout à la Seine. Il ne faut plus que mort cet homme fasse de la poussière137 »). Les mièvreries ne doivent pas faire oublier que le rôle de la Seine ne s’est pas toujours joué pour le meilleur, les jours où, « couverte d’humains, de blessés mi-noyés », comme dit d’Aubigné, elle charriait les massacrés de la Saint-Barthélemy, ou d’autres fois les insurgés de juin 1848 fusillés sur les ponts, ou les Algériens assommés et jetés à l’eau en octobre 1961 par la police de Maurice Papon et Charles de Gaulle.
L’asymétrie des deux rives – qu’il s’agisse de l’Ancien ou du Nouveau Paris – n’a pas pour seule cause la forme du méandre qui enserre la rive gauche et en limite l’expansion. L’essentiel de la différence actuelle – six arrondissements sur la rive gauche contre quatorze sur la rive droite – est dû au décalage du développement, au retard de l’urbanisation de la rive gauche. À l’apogée de l’Ancien Régime, alors que la rive droite éclate dans le bornage officiel, que tous les vides se comblent, que les maisons se surélèvent, que les constructions débordent les limites autorisées, la rive gauche est comme endormie dans ses collèges, ses couvents et ses jardins et ne parvient même pas à remplir l’espace qui lui est réglementairement attribué. Ce développement inégal se lit sur les berges mêmes de la Seine : « Quel contraste éloquent, écrit Sébastien Mercier, entre la magnifique rive droite du fleuve et la rive gauche qui n’est point pavée et toujours remplie de boue et d’immondices ! Elle n’est couverte que de chantiers et de masures habitées par la lie du peuple. » Le plan de Delagrive, qui date de 1728, montre sur la rive gauche une zone d’urbanisation dense dans un demi-cercle centré sur la place Maubert. Ses extrémités seraient l’une au Pont-Neuf et l’autre à l’université de Jussieu, et l’arc de cercle passerait par le carrefour de l’Odéon, le métro Luxembourg et la place de l’Estrapade, soit à peu près le tracé de l’enceinte de Philippe Auguste. Sur ce plan, le faubourg Saint-Germain apparaît comme un quartier de jardins, ce qu’il est d’ailleurs resté. La rue Saint-Jacques, la grande voie vers Orléans, devient très vite une route de campagne entre les vergers et les potagers des Ursulines, des Feuillantines, des Carmélites, des Visitandines, des Chartreux, de Port-Royal et des Capucins. Les autres axes de la rive gauche – la rue de la Harpe ou bien la séquence des rues Galande-Sainte-Geneviève-Mouffetard qui mène vers la route d’Italie – apparaissent dans ce Paris de la Régence comme des chemins vicinaux, une fois sortis de l’étroite zone de forte densité.
La rive gauche ne se réveille vraiment qu’à la fin du XVIIIe siècle. Sur l’emplacement de l’hôtel de Condé acquis par Louis XVI pour y loger les Comédiens-Français, Peyre et de Wailly dessinent le théâtre de l’Odéon – inauguré en 1782 avec Iphigénie de Racine –, la place en hémicycle qui lui fait face et la patte d’oie des rues de l’Odéon, Crébillon et Voltaire [Casimir-Delavigne]. C’est l’un des premiers lotissements modernes de Paris, avec des trottoirs comme à Londres138. Les deux immeubles, qui encadrent toujours avec noblesse l’extrémité de la rue de l’Odéon opposée au théâtre, servent de vitrine publicitaire à l’opération.
Vers la même époque, le comte de Provence, frère du roi et futur Louis XVIII, vend une partie du Luxembourg où Chalgrin dessine le lotissement des rues de Fleurus, Jean-Bart, Duguay-Trouin, qui seront construites plus tard, sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Pendant la Révolution, l’une des propositions de la Commission des artistes consiste à désenclaver l’enclos des Chartreux139 (« Le jardin des Chartreux a le caractère du désert ; la terre des allées n’y est point remuée ; les arbres n’y portent point l’empreinte de la faucille, ils sont humbles et courbés comme les religieux qui vous saluent sans vous regarder », écrit Sébastien Mercier). C’est l’origine de la patte d’oie dont la branche médiane est l’avenue de l’Observatoire, qui matérialise le méridien de Paris entre la rue de l’Est [boulevard Saint-Michel] et la rue de l’Ouest [rue d’Assas].
Malgré ces prémices, la rive gauche est encore bien désertique au début du XIXe siècle. À l’époque où se déroule l’action des Misérables, le Mont-Parnasse est rangé parmi « ces lieux singuliers », que « presque personne ne connaît », au même titre que la Glacière, Mont-Souris et la Tombe-Issoire. Dans Les Mystères de Paris, quand le Chourineur suit les diaboliques Tom et Sarah, leur fiacre s’arrête dans une nuit si noire que pour se repérer « il tira son couteau de sa poche et fit une large et profonde entaille à un des arbres auprès desquels s’était arrêtée la voiture » : ce lieu sinistre est l’avenue de l’Observatoire. En 1836, à l’angle de la rue Notre-Dame-des-Champs et de la rue de l’Ouest [d’Assas], « qui, ni l’une ni l’autre n’étaient encore pavées à cette époque…. on ne marchait que le long des enceintes en planches qui bordaient des jardins marécageux, ou le long des maisons, par d’étroits sentiers bientôt gagnés par des eaux stagnantes qui les convertissaient en ruisseaux140 ». Au début des Mohicans de Paris, Dumas remarque que « le Paris de la rive gauche est naturellement stationnaire, et tend plutôt à se dépeupler qu’à se peupler », et comme seuls travaux réalisés sur la rive gauche de 1827 à 1854, il cite « la place et la fontaine Cuvier, la rue Guy-Labrosse, la rue de Jussieu, la rue de l’École-Polytechnique, la rue de l’Ouest, la rue Bonaparte, l’embarcadère d’Orléans [gare d’Austerlitz] et celui de la barrière du Maine [gare Montparnasse] ».
Ce décalage de près d’un siècle explique qu’il n’ait rien existé sur la rive gauche qui fût de près ou de loin l’équivalent des Grands Boulevards. Dans leur projet, Bullet et Blondel prévoyaient bien que le nouveau cours planté devait entourer toute la ville. Mais sur la rive droite il s’appuyait sur tout un passé, sur l’ancien bras mort de la Seine, sur les pierres des enceintes médiévales, sur des monuments aussi solides que la Bastille et le Temple, alors que les « boulevards du Midi » étaient tracés au milieu de carrières, de pâturages et de moulins, laissant à l’extérieur les bâtiments contemporains les plus importants, les Invalides, l’Observatoire, l’Hôpital général [la Salpêtrière]. La ceinture des boulevards du Midi ne fut bouclée que très tard, dans la seconde moitié du XIXe siècle, avec deux conséquences encore évidentes : d’une part ils ne forment pas la vraie limite de l’Ancien Paris, qui ne s’étend pas jusqu’à eux, qui en reste séparé par une lame de bâti « moderne » ; d’autre part ils étaient – et restent – avant tout une voie de circulation. Le seul secteur où l’on s’y promenait, le boulevard Montparnasse entre l’avenue de l’Observatoire et le boulevard d’Enfer [Raspail], était à mille lieues du boulevard des Italiens : « Ce trottoir n’est pas bitumé mais il est planté de tilleuls centenaires pleins d’ombre et de gaieté au printemps…. Le matin il est envahi par les jardiniers du cimetière ; le soir, le silence est coupé de distance en distance par des chants d’ivrognes qui reviennent de la barrière ou par des baisers d’amants qui reviennent du pays radieux de l’amour141. »
Parmi les lieux qui expriment de façon claire et subtile à la fois le balancement de la mode d’une rive à l’autre, il y a les jardins que Paris doit aux deux reines florentines, Catherine et Marie de Médicis. Pendant l’essentiel du XIXe siècle, les ombrages préférés des dandys, des amoureux et des écrivains, ce sont les Tuileries. Dans le flamboyant début de La Fille aux yeux d’or – dédiée, on s’en souvient, « à Eugène Delacroix, peintre » –, c’est tout naturellement sur la terrasse des Feuillants qu’Henri de Marsay rencontre Paquita Valdès. Mais à partir de Verlaine et du symbolisme et tout au long du XXe siècle, même si le jet d’eau des Tuileries tient encore son rôle dans Nadja, c’est vers le Luxembourg que se portent la jeunesse et la poésie. Journal de Paul Léautaud, 4 mai 1901 : « Le crépuscule donnait à tout le jardin une profondeur infinie et une vapeur légère flottait. J’étais sur la terrasse, non loin de la porte des serres. Dans la partie basse du jardin le jet d’eau montait et redescendait presque sans bruit. Bientôt le tambour commença à battre. On allait fermer. Je songeais que j’avais devant moi un beau paysage baudelairien… » Chez Jules Vallès, chez Léon Daudet, André Gide, Jules Romain, Jean-Paul Sartre, Michel Leiris, Jacques Roubaud, il n’est guère de journaux intimes ni de romans parisiens sans Luxembourg, lieu central et symbolique d’une rive gauche censée accueillir maternellement la jeunesse étudiante, les écrivains, les éditeurs et les libraires, les cinémas d’art et d’essai, les galeries et les artistes d’avant-garde, sans compter les étrangers installés à la suite d’Oscar Wilde, de James Joyce, de Joseph Roth et de Henry Miller. La fragilité de cette construction, pour une bonne part mythique, il allait revenir à notre époque d’en faire un peu tristement la démonstration.
Comme on dit d’un vestibule ou d’un palier qu’il distribue les pièces auxquelles il donne accès, le Luxembourg distribue les quartiers centraux de la rive gauche. Près de l’école d’apiculture il touche à Montparnasse ; par sa grille principale il ouvre vers l’Observatoire ; du côté de l’orangerie et du monument à Delacroix il borde Saint-Sulpice et communique par son intermédiaire avec Saint-Germain-des-Prés ; la rue de Vaugirard seule le sépare du quartier de l’Odéon. Et il est par-dessus tout, comme dit Léon Daudet, « le centre respiratoire, le poumon végétal du laborieux Quartier Latin ».
*
Avec les Halles, le quartier Latin est la région de l’Ancien Paris la plus bouleversée depuis l’enfance de Baudelaire et la jeunesse de Rastignac. L’atlas de Perrot qui date de 1834 montre le quartier de Balzac, organisé par deux grands axes nord-sud, la rue de la Harpe et la rue Saint-Jacques. La première part comme aujourd’hui de la rue Saint-Séverin, monte le long de Cluny, gagne la place Saint-Michel [Edmond-Rostand] où elle se continue avec la rue d’Enfer : c’est à peu près le trajet du boulevard Saint-Michel. Les parallèles de la rue de la Harpe et de la rue Saint-Jacques sont réunies par de nombreuses transversales : la rue de la Parcheminerie dont le nom vient des enlumineurs et des relieurs qui y travaillaient depuis le XIIe siècle, la rue du Foin, la rue des Mathurins sur l’emplacement de la rue du Sommerard, la rue des Grès vers la faculté de droit sur le trajet de la rue Cujas, la rue Saint-Hyacinthe qui joint obliquement la place Saint-Michel à la rue des Fossés-Saint-Jacques en croisant obliquement le tracé de la future rue Soufflot. Entre la rue de la Harpe et la rue Monsieur-le-Prince – autre grande artère du quartier –, la disposition du plan de 1834 n’est pas très différente d’aujourd’hui, boulevard Saint-Germain mis à part. Sur l’autre flanc de la colline au contraire, à l’est de la place Maubert, il serait impossible de s’y reconnaître s’il ne restait quelques repères, l’École polytechnique, l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, les rues d’Arras, de Pontoise et de Poissy.
Le Luxembourg s’ouvre vers le quartier Latin par la rue Soufflot. C’est une rue « récente » : au temps où le père Goriot habitait la pension Vauquer, elle n’était percée qu’entre le Panthéon et la rue Saint-Jacques, ce qui rendit difficile la tâche des canonniers cherchant à déloger les insurgés retranchés dans le monument en juin 1848 – j’en parlerai plus loin. Sur la place, qui s’est longtemps appelée place Saint-Michel – elle prit le nom de place du Luxembourg lorsque la place Saint-Michel actuelle fut construite sur le petit bras de la Seine au débouché du pont, et elle devint place Edmond-Rostand dans les années 1950 –, le départ de la rue Soufflot était jadis encadré par deux vieux cafés, le Capoulade à gauche et le Mahieu à droite (Journal de Léautaud, 19 janvier 1933 : « Tout un moment de ma jeunesse, la lecture des poètes, la lecture de Verlaine, les rencontres que je fis de lui souvent dans ses traîneries le soir boulevard Saint-Michel, une fois aussi rue Monsieur-le-Prince, tournant de la petite rue de Vaugirard, mal fichu, claudicant, un bruit d’enfer sur le trottoir avec les coups de sa canne, un autre soir au caveau du Soleil d’Or où je m’étais aventuré (le café qui fait le coin du boulevard Saint-Michel et du quai, c’était bien le Soleil d’Or ?), une après-midi que je le vis assis, en compagnie d’Eugénie Krantz, à la terrasse du café qui fait le coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel (café Mayeux je crois), terrasse côté boulevard, les dernières tables, tout près de la porte d’immeuble qui sépare le café du bureau de tabac, et que je lui fis porter un bouquet de violettes par un gamin »).
La rue Soufflot monte vers la rue Saint-Jacques, qui est la vraie voie du quartier Latin – plus que le boulevard Saint-Michel, conçu pour neutraliser les vieilles rues de désordres et de barricades et que j’ai toujours connu comme un couloir de bruit et de laideur. Entre le fleuve et la rue des Écoles, il reste quelques vieux libraires-éditeurs pour rappeler que jusqu’à la fin de l’Ancien Régime la rue Saint-Jacques avait le quasi-monopole de l’impression – depuis que les trois frères Gering, originaires de Constance, y avaient installé leurs presses à l’enseigne du Soleil d’Or en 1473 – mais aussi de l’édition et de la librairie, activités alors confondues. Le Catalogue chronologique des libraires et libraires-imprimeurs de Paris depuis l’an 1470, époque de l’établissement de l’Imprimerie dans cette capitale jusqu’à présent (1789) recense des maisons presque toutes groupées rue Saint-Jacques et dans ses abords immédiats, rues des Poitevins, des Anglais, Galande, Serpente, ou place de la Sorbonne142. Les Estienne, imprimeurs de père en fils depuis le grand Robert dont François Ier vint en personne visiter l’atelier, sont rue Saint-Jacques, et les Didot, rue Saint-André-des-Arts. « Il n’y a rien de plus comique que le début timide et avantageux d’un poète qui grille d’être mis au jour, et qui aborde pour la première fois un typographe de la rue Saint-Jacques, lequel se rengorge, et se rend appréciateur du mérite littéraire », écrit Sébastien Mercier. Au début du XIXe siècle, le livre, avant de traverser la Seine pour investir le Palais-Royal, déborde sur le quai des Grands-Augustins où se trouve parmi bien d’autres « la maison Fendant et Cavalier, une de ces maisons de librairie établies sans aucune espèce de capital, comme il s’en établissait beaucoup alors, et comme il s’en établira toujours, tant que la papeterie et l’imprimerie continueront à faire crédit à la librairie, pendant le temps de jouer sept à huit de ces coups de cartes appelés publications143 ». En matière de jeu, de crédit et de faillites, Balzac en connaissait, comme on dit, un rayon.
Entre la rue des Écoles et la rue Soufflot, la rue Saint-Jacques a été entièrement refaite dans les années 1860, mais on peut aimer le cadre que forment le petit jardin en pente devant le Collège de France, où les marronniers, les platanes, les tilleuls et les acacias, sans doute plantés à l’époque où Claude Bernard était titulaire de la chaire de médecine, ont atteint des tailles gigantesques, le lycée Louis-le-Grand – mon lycée – et la Sorbonne surmontée de sa tour-observatoire à la silhouette de minaret, avec au fond, tout en haut de la côte, le clocher janséniste de Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
À gauche de la rue Saint-Jacques, à l’est si l’on préfère, la rue des Écoles sépare deux régions différentes. La plus basse, moderne, active, s’étend vers l’université de Jussieu et le Jardin des Plantes. Son centre est la place Maubert. En 1862 Delvau écrivait encore qu’elle « est peut-être le seul lieu de Paris qui ait conservé sa physionomie d’autrefois. À dix pas de là, Paris s’habille de moellon neuf et de plâtre frais des pieds à la tête : la place Maubert seule affiche cyniquement ses haillons ! Ce n’est pas une place, c’est une large tache de boue…. Elle est comme une tradition vivante du Paris du Moyen Âge. En clignant un peu les yeux on croirait voir et entendre encore sa population du temps d’Isabeau de Bavière et de Louis XI ! Race prolifique et tenace, on a voulu la détruire et même la civiliser – comme dirait M. Joseph Prudhomme –, rien n’y a fait ! Rien, ni le canon, ni la peste, ni la famine, ni la misère, ni la débauche – ni l’école mutuelle !144 » La spéculation immobilière des années 1960 a réussi là où le canon et la peste avaient échoué.
Le haut de la Montagne, région très ancienne qui s’étend à travers la place du Panthéon vers le quartier Mouffetard, est en partie défiguré par la prolifération des crêperies et des restaurants. La Contrescarpe et la rue Mouffetard, « grouillement localisé, sorte de survivance villonnienne » au temps de Léon Daudet, et dont les situationnistes avaient fait le continent Contrescarpe dans les années 1950, ne sont plus que les ombres d’elles-mêmes. Pourtant, sur le territoire irrégulier limité par la rue Tournefort, la rue Lhomond, la rue de l’Arbalète, la rue Claude-Bernard, la rue d’Ulm et la rue de l’Estrapade, dans un cadre architectural modeste, presque villageois, se croisent les souvenirs de Diderot, des quatre sergents de La Rochelle – il existait encore en 1970 un café portant leur nom à l’angle de la rue Descartes et de la rue Clovis, et il est juste, je pense, que ce soit sur le zinc que le souvenir de leur martyre républicain ait été si longtemps cultivé145 –, d’Eugène Rastignac encore naïf pensionnaire de maman Vauquer, et d’un autre étudiant, le jeune Vingtras, alias Vallès.
« On ne sait ni comment ni pourquoi les quartiers de Paris se dégradent et s’encanaillent, au moral comme au physique ; comment le séjour de la Cour et de l’Église, le Luxembourg et le Quartier Latin, deviennent ce qu’ils sont aujourd’hui…. pourquoi l’élégance de la vie s’en va, pourquoi de sales industries et la misère s’emparent d’une montagne, au lieu de s’étaler loin de la vieille et noble ville. » Tel est le questionnement de Balzac, dans Les Petits Bourgeois. Vingt ans plus tard, Théodore de Banville s’interroge lui aussi : « Comment l’étudiant actuel aurait-il pu s’obstiner à être ce que fut l’étudiant d’autrefois, quand l’inévitable établissement de bouillon Duval avec ses moulures, ses dorures et ses plafonds de bois exotique s’est installé dans un palais, à la place même où s’ouvraient naguère les modestes gargotes, et quand on peut voir, en pleine rue des Grès, là où le Moyen Âge avait si fortement laissé son empreinte, une taverne anglaise débitant son rosbif, son jambon d’York, ses pickles, ses sauces de hanneton pilé (voir Balzac), son pale ale comme dans la rue Royale ?146 » Et en 1964, Yvan Christ ne croyait pas tomber si juste en prédisant que, « dans vingt ans, de nouveaux et tendres barbons verseront des larmes mélancoliques sur le vieux Quartier Latin des années soixante, les meilleures qui furent jamais147 ».
Depuis Villon, le quartier Latin, étant le quartier de la jeunesse, fut plus que tout autre exposé à la nostalgie du bon vieux temps. Mais si méfiant que l’on puisse être envers ce sentiment, comment ne pas regretter la profusion, la variété, la gaieté des cafés du Quartier entre les années 1850 et la guerre de 1914 – non pas leur cadre, en rien comparable aux féeriques établissements des Boulevards, mais leur atmosphère ? Certains étaient politiques avant tout. Dans Le Bachelier, Vallès raconte qu’en 1850, au café qu’on appelait du Vote universel, « il y a des gens qu’on dit avoir été chefs de barricades à Saint-Merri, prisonniers à Doullens, insurgés de Juin ». Tout près, au café de la Renaissance, face à la fontaine Saint-Michel, le public « avait une physionomie particulière à l’heure de l’absinthe et le soir. Des étudiants débraillés, les cheveux en désordre, des étudiantes…. Les maîtres de Paris sous la Commune y ont tenu leurs assises et préparé le plan de campagne sinistre qui devait finir par l’incendie et par le meurtre148 ». Rue Saint-Séverin, là où La Joie de lire de François Maspero a servi d’université politique à toute une génération, la brasserie Saint-Séverin était l’une des cantines des dirigeants de la Commune. D’après Lepage, peu suspect d’objectivité, « au-dessus d’eux planait Raoul Rigault…. qui arrivait à cheval, faisait caracoler sa monture sur le boulevard Saint-Michel, et, derrière un double lorgnon, regardait effrontément les femmes ».
D’autres lieux étaient plus prosaïques. L’immense d’Harcourt, à l’angle de la place de la Sorbonne et du boulevard Saint-Michel (du côté opposé à l’actuelle librairie des PUF), était un café à femmes. Pour les étudiants pauvres, les restaurants les plus accueillants étaient Flicoteaux et la pension Laveur. « Dans les cas extraordinaires, on a Flicoteaux », indique Dumas dans Les Mohicans de Paris. On y mangeait sur de longues tables, dans deux salles en équerre dont l’une donnait sur la place de la Sorbonne et l’autre rue Neuve-de-Richelieu [Champollion]. Quand Lucien de Rubempré n’a plus le sou, il dîne chez Flicoteaux, et c’est là qu’il fait la connaissance, décisive, de Lousteau. « Il est peu d’étudiants logés au Quartier Latin pendant les douze premières années de la Restauration qui n’aient fréquenté ce temple de la faim et de la misère…. le cœur de plus d’un homme célèbre doit éprouver les jouissances de mille souvenirs indicibles à l’aspect de la devanture à petits carreaux donnant sur la place de la Sorbonne et sur la rue Neuve-de-Richelieu, que Flicoteaux II ou III avait encore respectée, avant les journées de Juillet, en leur laissant ces teintes brunes, cet air ancien et respectable qui annonçait un profond dédain pour le charlatanisme des dehors, espèce d’annonce faite pour les yeux aux dépens du ventre par presque tous les restaurateurs d’aujourd’hui149. »
Quant à la pension Laveur, c’était, raconte Léon Daudet, une « véritable institution historique et qui a vu passer trois générations, sise rue des Poitevins, en face de l’École de Médecine, dans un vieil hôtel délabré…. On accédait aux salles à manger et tables d’hôtes par un escalier de pierre aux marches polies et usées ainsi que la margelle d’un puits breton. Tante Rose, affectueuse et vénérable, se tenait à la caisse, assistée de la brune Mathilde et de Baptiste, qui recevaient les commandes en riant et apportaient les plats en bougonnant150 ». Et Francis Carco, vers la même époque : « J’avais crédit à la pension Laveur et mangeais deux fois par jour. Ah ! Cette pension ! Malgré l’odeur des chats dans l’escalier et son manque d’apparat, Baptiste faisait bien les choses…151. » Une trentaine d’années auparavant on pouvait parfois y rencontrer Courbet – qui n’était pas encore le « célèbre déboulonneur », comme l’appelle Lepage –, mais son établissement attitré était plutôt la brasserie Andler, rue Hautefeuille, où était son atelier. L’entrée de Courbet chez Andler ne passait pas inaperçue : « Il s’avança, portant haut la tête – comme Saint-Just – et on l’entoura ! Il s’assit – et l’on fit cercle autour de lui ! Il parla – et on l’écouta ! Quand il s’en alla, on l’écoutait encore152. » Dans la liste des habitués, oubliés pour la plupart (« Simbermann, préparateur de chimie et membre de la Société de météorologie, Dupré, professeur d’anatomie, Furne, éditeur »), apparaît comme dans un coin sombre « Charles Baudelaire, l’auteur des Fleurs du mal qui alors étaient encore inédites, qui essayait l’effet de son Edgar Poe sur la tête de ses compagnons ».
Parmi les cafés littéraires, il en était de très humbles, comme le Soleil d’Or, à l’angle de la place Saint-Michel et du quai, où se tenaient les soirées symbolistes de La Plume, ou comme la laiterie du Paradoxe, rue Saint-André-des-Arts, où l’on rencontrait « Auguste Poulet-Malassis, élève de l’École des chartes, aujourd’hui libraire ; un grand garçon très pâle ressemblant à Henri III…. causeur charmant, très spirituel et très érudit, qui aurait été aimé de tout le monde s’il n’avait pas fait tous ses efforts pour en être un peu haï…. Nadar, un romancier qui n’était pas encore photographe, Asselineau, un jeune bibliophile qui n’était pas encore critique, Charles Baudelaire, un poète qui n’était pas encore candidat à l’Académie, Privat d’Anglemont, un explorateur des dessous de Paris qui n’était pas encore au cimetière Montmartre153 ». Mais le plus fameux des cafés intellectuels était le Vachette, au coin de la rue des Écoles et du boulevard Saint-Michel, que fréquentaient Maurras, Catulle Mendès, Heredia, Huysmans, Mallarmé parfois, Barrès (« C’est là, disait-il, que les jeunes gens gagnent les dyspepsies qui vers quarante ans leur font une physionomie distinguée »), et surtout Moréas. « Je suis arrivé au Vachette, raconte Carco, juste à temps pour connaître Moréas. Aux jeunes gens qui l’entouraient, il déclarait : “Appuyez-vous fortement sur les principes.” Puis lissant ses moustaches et assujettissant avec autorité son monocle, il ajoutait : “Ils finiront bien par fléchir !”»
À la limite occidentale du Quartier, les symbolistes du Mercure de France et les gens de théâtre avaient leurs habitudes autour de l’Odéon. Au café Tabourey, à l’angle de la rue Molière [Rotrou] et de la rue de Vaugirard, au temps du réalisme, on voyait souvent « Champfleury, Pierre Dupont le poète rustique, Charles Baudelaire le poète matérialiste, Leconte de Lisle le poète panthéiste, Hippolyte Babou, Auguste Préault le sculpteur, Théodore de Banville… J’eus l’honneur de voir là, moi petit, moi obscur, moi adolescentule, le grand, le glorieux M. de Balzac au matin de la première représentation des Ressources de Quinola154 ». Bien plus tard, au café Voltaire, sur la place de l’Odéon, où venaient souvent Pierre Louÿs et Henri de Régnier, Paul Fort célébra le mariage de sa fille avec Severini : « Le Prince des Poètes, debout sur le piano, chantait. Marinetti, dont la superbe auto blanche tranchait sur le pavé gris de la place de l’Odéon, s’abandonnait à des joies futuristes. Il brisait la vaisselle. C’était splendide155. »
*
Le quartier de l’Odéon – triangle isocèle qui a son sommet au carrefour de l’Odéon, sa base au Luxembourg, et dont les côtés sont formés par la rue Monsieur-le-Prince et la rue de Condé – fait-il partie du quartier Latin ? Léautaud est catégorique et il sait de quoi il parle puisqu’il a habité rue Monsieur-le-Prince, rue de l’Odéon et rue de Condé, et qu’il travaille au Mercure de France dans cette même rue. Journal, 6 octobre 1903 : « Déménagement de la rue de Condé pour la rue de l’Odéon le 6 octobre. Horreur de tout ce Quartier Latin. Quand pourrai-je habiter ailleurs ? » Pour lui, c’est en traversant la rue de Tournon qu’on entre à Saint-Germain-des-Prés. Au début du siècle et dans l’entre-deux-guerres, cette façon de voir avait bien des raisons. Si le quartier de l’Odéon n’était pas véritablement étudiant, les bouquinistes sous les arcades du théâtre avaient leur importance dans la vie littéraire. Pour le Bachelier Vingtras-Vallès, « l’Odéon, c’est notre club et notre asile ! on a l’air d’hommes de lettres à bouquiner par là, et on est en même temps à l’abri de la pluie. Nous y venons quand nous sommes las du silence ou de l’odeur de notre taudis ». Bien des années plus tard, Léon Daudet, étudiant en médecine qui a mal tourné, est attiré lui aussi par « les fameuses galeries de la librairie Flammarion, autour de l’Odéon, ainsi cuirassé de bouquins. Elles sont liées pour moi à bien des rendez-vous avec des jeunes personnes peu farouches et aussi à mon premier succès, Les Morticoles. Je n’osais pas m’informer, le volume ayant paru depuis quinze jours. Les vendeurs, qui me connaissaient, me firent signe de loin et l’un d’eux me cria : “Gros succès !”156». Et, vers la même époque, Léon-Paul Fargue : « Nous lisions sous les galeries de l’Odéon, debout, fourrant le nez le plus avant que nous pouvions dans les feuillets qui n’étaient pas coupés pour y chercher notre picotin157. » Derrière le théâtre, à l’angle de la rue de Tournon et de la rue de Vaugirard, le restaurant Foyot était fréquenté par les intellectuels jusqu’à ce qu’une bombe anarchiste le fasse sauter – il y venait aussi des sénateurs158. Le Mercure, les librairies d’Adrienne Monnier et de Sylvia Beach rue de l’Odéon donnaient au triangle une coloration littéraire qui pouvait le faire rattacher au quartier Latin, et qui a depuis presque entièrement disparu.
*
Pour passer du Luxembourg à Saint-Germain-des-Prés il faut traverser le petit quartier Saint-Sulpice, et pour gagner sa place centrale il faut choisir entre trois rues qui, bien que parallèles, descendantes, courtes et de même époque, ont chacune à mes yeux un charme différent. La rue Férou a peut-être l’architecture la plus parfaite. La rue Servandoni est le cadre d’un épisode important des Trois Mousquetaires à propos duquel Umberto Eco écrit que, « si, en bons lecteurs empiriques, nous sommes émus d’évoquer la rue Servandoni parce que c’était l’adresse de Roland Barthes, Aramis ne pouvait en aucun cas habiter à l’angle de la rue Servandoni car cette histoire se déroule en 1625, alors que l’architecte florentin Giovanni Niccolo Servandoni est né en 1695, qu’il a dessiné la façade de l’église en 1733 et que cette rue lui a été dédiée en 1806159 ». Pour ma part, je choisis toujours la troisième, la rue Garancière, non pas pour la petite fontaine de la princesse Palatine ni pour les béliers de l’hôtel de Sourdéac et le souvenir de la maison Plon-Nourrit, mais pour saluer une fois encore, au chevet de Saint-Sulpice, le pélican de plomb qui surmonte le gros toit bulbeux de la chapelle de l’Assomption et surtout la trompe qui soutient le surplomb de la chapelle axiale sur la rue, chef-d’œuvre de la stéréotomie parisienne, peut-être même plus belle que la trompe de l’hôtel Portalis, à l’angle de la rue Croix-des-Petits-Champs et de la rue de La Vrillière.
« Il y a beaucoup de choses place Saint-Sulpice, par exemple : une mairie, un hôtel des finances, un commissariat de police, trois cafés dont un fait tabac, un cinéma, une église à laquelle ont travaillé Le Vau, Gittard, Oppenordt, Servandoni et Chalgrin et qui est dédiée à un aumônier de Clotaire II qui fut évêque de Bourges de 624 à 644 et que l’on fête le 17 janvier, un éditeur, une entreprise de pompes funèbres, une agence de voyages, un arrêt d’autobus, un tailleur, un hôtel, une fontaine que décorent les statues des quatre grands orateurs chrétiens (Bossuet, Fénelon, Fléchier et Massillon), un kiosque à journaux, un marchand d’objets de piété, un parking, un institut de beauté et bien d’autres choses encore160. » Par contamination avec l’art saint-sulpicien, on a longtemps pensé beaucoup de mal de cette place et de l’église (« Herrera demeurait rue Cassette, près de Saint-Sulpice, église à laquelle il était attaché. Cette église, d’un style dur et sec, allait à cet Espagnol dont la religion tenait de celle des Dominicains161 »). Mais nombreux sont désormais ceux qui admirent le double portique de la façade de Servandoni et regrettent que la mort l’ait empêché de terminer la place et de réaliser dans l’axe de l’église la grande arcade qu’il avait dessinée, sous laquelle se serait ouverte la rue Neuve-Saint-Sulpice162.
*
Des quartiers définis par l’ordonnance de 1702, Saint-Germain-des-Prés est le vingtième et dernier, signe qui indique assez qu’il n’était pas de même nature que les autres. La vieille abbaye, restée en dehors de l’enceinte de Charles V mais fortifiée à la même époque, avait gardé ses murailles jusque dans les années 1670 et ne faisait pas partie de Paris. Quand toutes les fortifications tombèrent, l’abbaye abattit elle aussi son enceinte crénelée et combla ses fossés sur lesquels sont bâties les principales rues du quartier actuel.
Autour du monastère – dont le clocher de Saint-Germain-des-Prés indique le centre – s’était développée toute une cité de marchands et d’artisans qui vivaient là tranquillement comme dans les autres enclos parisiens. On l’appelait indifféremment bourg ou faubourg Saint-Germain. C’était au XVIIIe siècle un quadrilatère dont trois côtés correspondent à des rues actuelles : rue Saint-Benoît, rue Jacob, rue de l’Échaudé (un échaudé n’est pas un supplicié mais un gâteau triangulaire – et par extension un pâté de maisons comme celui que limite la rue de l’Échaudé précisément, avec la rue de Seine et la rue Jacob). Le quatrième côté était formé par la séquence de trois rues, à peu près sur le tracé du boulevard Saint-Germain : d’ouest en est, la rue Taranne – où habita longtemps Diderot qui a là sa statue –, les rues Sainte-Marguerite et des Boucheries163. D’autres rues s’étaient formées autour du palais abbatial à l’intérieur de l’enceinte, dont subsistent la rue Abbatiale [passage de la Petite-Boucherie], la rue Cardinale et la rue de Furstemberg (la place de Furstemberg est la cour des écuries de l’abbaye). Malgré le percement de la rue de l’Abbaye et de la rue Bonaparte au début du XIXe siècle sur proposition de la Commission des artistes et celui, infiniment plus brutal, du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes, le centre de Saint-Germain-des-Prés est aujourd’hui encore le quartier de l’Abbaye.
Entre le bourg Saint-Germain et la ville, l’animation était concentrée en deux carrefours qui ont conservé depuis tout leur potentiel énergétique. Le premier était le confluent de la rue de Buci avec la rue du Four et la rue des Boucheries. C’est l’actuel carrefour Mabillon. De là, par la rue de Montfaucon, on gagnait la foire Saint-Germain, l’une des grandes attractions de Paris depuis le XIIe siècle. Elle se tenait chaque année du début de février au dimanche des Rameaux sur l’emplacement de l’actuel marché, entouré de quatre rues portant les noms de Clément, Mabillon, Lobineau et Félibien, gloires de l’ordre du monastère, les Bénédictins164. C’était d’abord un marché luxueux où l’on trouvait des objets rares, « gentillesses » de Flandre et d’Allemagne, miroirs de Venise, toiles des Indes et merveilles d’autres pays lointains apportées par les marchands portugais évoqués par Scarron : « Menez-moi chez les Portugais/Nous y verrons à peu de frais/Des marchandises de la Chine./ Nous y verrons de l’ambre gris/Et des ouvrages de vernis/De cette contrée divine/Ou plutôt de ce paradis. » Mais la foire était aussi un lieu de divertissement pour une population très mêlée, préfigurant les galeries de bois du Palais-Royal ou la descente de la Courtille. L’aristocratie s’y rendait le soir, après souper. On y jouait aux quilles, au tourniquet, aux dés, aux cartes. Les femmes du plus haut rang, masquées de velours noir, regardaient jouer ou jouaient elles-mêmes, leurs yeux réfléchissant l’éclat des flambeaux. À la foule élégante se mêlaient les « écoliers » bagarreurs, les laquais, les bourgeois, les larrons qui vidaient les poches et coupaient les bourses. « Là, des hommes de six pieds, montés sur des brodequins, coiffés comme des sultans, passent pour des géants. Une ourse rasée, épilée, à qui l’on a passé une chemise, un habit, veste et culotte, se montre comme un animal unique, extraordinaire. Un colosse de bois parle, parce qu’il a dans le ventre un petit garçon de quatre ans165. »
L’autre grand carrefour animé était à la porte de Buci, percée dans la muraille parisienne par le travers de la rue Saint-André-des-Arts à hauteur de la rue Mazet actuelle. Cette porte contrôlait un antique chemin qui, jusqu’à la construction du Pont-Neuf, était l’itinéraire obligé pour les habitants du bourg Saint-Germain qui voulaient gagner la Cité par le Petit-Pont : l’axe rue du Four-rue de Buci-rue Saint-André-des-Arts. La rue Dauphine, grande voie de la première opération parisienne d’urbanisme concerté – avec la place homonyme et le Pont-Neuf –, venait buter obliquement sur ce carrefour (avec ses neuf mètres, elle était la rue la plus large de Paris. Henri IV voulait qu’elle fût d’architecture régulière. Le 2 mai 1607 il écrivait à Sully : « Mon ami, sur ce que j’ai été averti que l’on commence de travailler aux bâtiments qui sont en la rue neuve qui va du bout du Pont-Neuf à la porte de Bussy, je vous ai bien voulu faire ce mot pour vous dire que je serais très aise que vous fissiez en sorte envers ceux qui commencent à bâtir en ladite rue, qu’ils fissent le devant de leurs maisons toutes d’un même ordre, car cela serait d’un bel ornement de voir au bout dudit pont cette rue toute d’une même façade166 »).
Lorsque les fortifications furent détruites, la porte de Buci fut abattue et les fossés comblés formèrent les rues Mazarine et de l’Ancienne-Comédie, venant ajouter à une animation qui n’a pas faibli depuis trois siècles. Ainsi, à l’emplacement du n° 4 de la rue de Buci, en face de la rue Grégoire-de-Tours, se tenaient dans les années 1730 chez un traiteur nommé Landelle des séances gastronomiques et littéraires auxquelles participaient entre autres Piron, Crébillon père et fils, Duclos et Helvétius. C’est là que se réunissait également la première loge maçonnique de Paris, fondée par des Anglais. À la Révolution, le local abritait l’imprimerie du Courrier français, le journal de Brissot. En 1860, la maison avait pour locataires le peintre Giacomelli et l’éditeur Poulet-Malassis, qui venait d’avoir de sérieux ennuis avec la justice après la publication des Fleurs du mal167.
Les rues qui entourent l’École des beaux-arts, l’Institut et la Monnaie sont différentes du reste de Saint-Germain. L’ombre de ces grands bâtiments, un certain éloignement, la proximité du fleuve leur prêtent une grâce silencieuse à laquelle les poètes et les étrangers furent de tous temps sensibles. Des plaques que les familiers connaissent par cœur signalent que dans ces rues vécurent et travaillèrent Saint-Amant, Racine, Balzac, Heine, Mickiewicz, Wagner, Oscar Wilde – et Picasso, si l’on pousse jusqu’à l’hôtel de la rue des Grands-Augustins où il peignit Guernica dans les murs mêmes où Balzac écrivit Le Chef-d’œuvre inconnu.
*
Par une aberration de la toponymie, la partie du VIIe arrondissement comprise entre la rue des Saints-Pères et le boulevard des Invalides est appelée « faubourg » Saint-Germain. Curieux faubourg : à l’intérieur de l’Ancien Paris, sans voie matricielle – le boulevard Saint-Germain est bien sûr beaucoup plus récent –, il est tout à fait différent de l’autre grand faubourg aristocratique, le faubourg Saint-Honoré. C’est encore le retard d’urbanisation qui explique cette anomalie : ce quartier s’est construit dans un vide, il s’est bâti dans la ville ancienne en même temps que les « vrais » faubourgs, qui, eux, étaient déjà dehors, et c’est cette concomitance qui l’a fait dénommer « faubourg » comme eux.
Le faubourg Saint-Germain appartient d’ailleurs autant au domaine du mythe qu’à celui de la géographie, ce qui revient pour beaucoup aux deux grandes scènes auxquelles il sert à la fois de décor et de troupe, La Comédie humaine et la Recherche du temps perdu. Balzac : « Ce que l’on nomme en France le faubourg Saint-Germain n’est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place Royale, le faubourg Saint-Honoré, la Chaussée-d’Antin possèdent également des hôtels où se respire l’air du faubourg Saint-Germain. Ainsi, déjà tout le faubourg n’est pas dans le faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s’agréger à ce monde, tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à jamais bannies168. » Et Proust, à propos de l’hôtel de Guermantes : « La présence du corps de Jésus-Christ dans l’hostie ne me semblait pas un mystère plus obscur que ce premier salon du Faubourg situé sur la rive droite et dont je pouvais de ma chambre entendre battre les meubles le matin169. »
La construction du Faubourg s’est faite en deux temps, à près d’un siècle d’intervalle. Au début du XVIIe siècle, la reine Margot – Marguerite de Valois, première femme d’Henri IV – avait acheté un immense terrain parallèle au fleuve, face au Louvre. Elle se fit construire là un hôtel dont les jardins s’étendaient jusqu’à la rue des Saints-Pères et se prolongeaient au-delà, par un parc non clos de murs, occupant tout l’espace entre la rue de l’Université et la Seine et ouvrant au loin sur la campagne170. À la mort de Margot, Louis XIII lotit les terrains pour payer les dettes. Les longues parallèles des rues de Lille, de Verneuil et de l’Université marquent depuis bientôt quatre siècles le tracé des allées du parc de la reine Margot.
Vers la fin du règne de Louis XIV, on commence à construire, au-delà de la rue des Saints-Pères, un nouveau faubourg Saint-Germain pour l’aristocratie qui abandonne le Marais. La rue Saint-Dominique, la rue de Grenelle et la splendide fontaine des Quatre-Saisons de Bouchardon, la rue de Varenne sont alors tracées parallèlement aux rues du domaine de Margot. Des perpendiculaires au fleuve complètent le quadrillage : les rues de Bellechasse et de Bourgogne, et surtout la commerçante rue du Bac, grande voie de communication du Faubourg avec la rive droite après la construction du Pont-Royal. C’est par là que les duchesses vont faire leur cour aux Tuileries. Cette grille urbaine très lâche délimite aujourd’hui encore de vastes îlots où les hôtels, entre cour et jardin, sont passés des mains de l’aristocratie à la technocratie ministérielle, ce qui ne les a pas rendus plus accessibles qu’autrefois, où l’on pouvait entrer dans beaucoup de nobles demeures sans badge ni pièce d’identité171.
Le Saint-Germain-des-Prés existentialiste tient lui aussi de la légende, alimentée en grande partie par les articles haineux de la presse « de droite » – guillemets indispensables car dans les grandes années du Tabou, de la Rose-Rouge, du Bar-Vert et du Montana, entre la Libération et 1950, personne ne se disait de droite, vu que ce terme équivalait à celui de collaborateur et que les gens de droite étaient souvent en prison ou séjournaient prudemment à l’étranger. Mais ce qui relève des certitudes, c’est que Saint-Germain-des-Prés était jusqu’à la fin des années 1980 le centre de l’édition française. Elle avait certes des prolongements, au quartier Latin (Maspero-La Découverte devant la Sorbonne, Hachette dans son immeuble historique à l’angle du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel), à Montparnasse (Albin Michel, Larousse), voire sur la rive droite (Calmann-Lévy). Mais l’essentiel était groupé dans le VIe arrondissement avant que la concentration, le souci des économies d’échelle et le mépris de l’histoire aient dispersé les grands groupes et leurs contrôleurs de gestion dans des tours climatisées, à l’abri de toute contagion avec des livres, des lecteurs ou des librairies172.
Le livre n’est d’ailleurs pas le seul expulsé du quartier. Place Saint-Germain-des-Prés, cinq tumeurs – Dior, Vuitton, Armani, Lanvin, Cartier – ont envahi le tissu de la ville : il arrive parfois qu’un même organe soit envahi par des métastases multiples. Ici, ce sont les extensions d’un cancer primitif qui se trouve du côté de la place Vendôme et de la rue de la Paix. Certains prodromes l’avaient fait redouter – Sonia Rykiel à la place des accueillantes boiseries du restaurant des Saints-Pères, Yves Saint-Laurent à Saint-Sulpice au milieu des chasubles – mais ils étaient restés longtemps isolés. Soudain les défenses ont craqué, et en deux ans le mal était fait. Souhaitons que la librairie La Hune ne soit pas remplacée un beau matin par la boutique d’un parfumeur, qui n’aura vraisemblablement rien à voir avec le bon Birotteau. Rêvons au jour où le peuple en colère brisera les blindages de ces hideuses et insolentes vitrines, remerciera les vigiles et les vendeuses bronzées et rendra la vie à ce lieu qui n’avait pas mérité pareil sort. « Mes amis, disait Diderot, faisons des rêves ; tandis que nous en faisons, nous oublions, et le rêve de la vie s’achève sans qu’on y pense. »
*
Dans les limites de l’Ancien Paris, les percées du XIXe siècle ont été plutôt raisonnables, moins d’ailleurs par scrupule archéologique que par manque de temps. C’est grâce aux désastres de Metz et Sedan, grâce aux talents militaires de Mac-Mahon et de Bazaine que Paris a échappé à l’éventrement complet de Saint-Germain-des-Prés par une rue de Rennes poussée jusqu’au pont des Arts et au ravage du Marais par le prolongement de la rue Étienne-Marcel jusqu’à la Bastille. Les tracés réalisés ont des raisons urbanistiques claires. Sur la grande voie nord-sud Sébastopol - Saint-Michel sont branchées deux voies est-ouest, une sur chaque rive : la rue de Rivoli prolongée et le boulevard Saint-Germain – dont la rue des Écoles est une ébauche avortée. Ce système orthogonal est complété par des transversales comme la rue Réaumur et des obliques comme la rue de Turbigo ou l’avenue de l’Opéra.
Les quartiers anciens ont bien cicatrisé au contact de ces percées. De part et d’autre de la place Saint-Michel, paradigme de l’haussmannisme, la place Saint-André-des-Arts et le quartier Saint-Séverin forment un encadrement intact, architecturalement au moins173. De part et d’autre de l’avenue de l’Opéra, les rues des Petits-Champs et Danièle-Casanova, Saint-Roch et Sainte-Anne, Gaillon et Daunou témoignent de la résistance du Paris de Nucingen face au Paris des Rougon-Macquart. « Sue, Hugo, et bien sûr Balzac reconnaissent autour d’eux, inchangé, le Paris du Moyen Âge, le même que nous retrouvions bien vivant, malgré Haussmann, il n’y a pas tellement longtemps dans les tronçons de ces rues qui reliaient autrefois la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin et qui, tranchées en leur milieu par le boulevard Sébastopol, avaient trouvé le moyen de reconstituer à leurs deux extrémités les vieilles ardeurs inchangées174. » Ce qui contribue au caractère pacifique de la coexistence, c’est le soin mis par les architectes du XIXe siècle aux raccords entre leurs percées et les voies anciennes, comme par exemple à l’angle de la rue de Rennes et de la rue du Vieux-Colombier, où l’architecture du Second Empire reprend sur le côté moderne les ordonnances du XVIIIe siècle175. Les deux immeubles de la place des Victoires qui encadrent le départ de la rue Étienne-Marcel sont eux aussi d’extraordinaires adaptations des rythmes et des modénatures louis-quatorziennes. Le souci d’intégration a même parfois entraîné le réemploi de tout un côté de rue dans les nouvelles percées – la rue Taranne en partie intégrée, on l’a vu, dans le boulevard Saint-Germain, ou des pans entiers des antiques rues Phélipeaux et Thévenot absorbés dans la rue Réaumur, près du Temple.
La Cité fait exception car, là, Haussmann a été dévastateur. C’était pour lui « un emplacement obstrué par une foule de masures mal habitées, mal hantées, et sillonné de rues humides, tortueuses et malpropres », description que l’on retrouve, transfigurée, dans certaines gravures de Meryon comme L’Hôtellerie de la Mort ou La Rue des Chantres, où « la profondeur des perspectives (est) augmentée par la pensée de tous les drames qui y sont contenus176 ». Sans doute fallait-il assainir « ce dédale de rues obscures, étroites, tortueuses qui s’étend depuis le Palais de Justice jusqu’à Notre-Dame », comme il est dit au début des Mystères de Paris. Mais de là à tout nettoyer par le vide, à faire que « le berceau de la capitale, démoli tout entier, ne renferme plus qu’une caserne, une église, un hôpital et un palais177 », il y avait un pas. S’il fut franchi, la raison en est politique et militaire avant tout. Lors des journées de juin 1848, qui ont si fort marqué l’époque, on s’était beaucoup battu dans la Cité et la partie attenante du quartier Latin – j’y reviendrai –, et ce foyer devait être éradiqué.
Une telle phrase, je le sais, va contre l’historiographie actuelle. Par un amalgame qui est bien dans l’esprit du temps, la revalorisation (utile) de l’architecture du XIXe siècle a entraîné celle d’Haussmann au point de minimiser jusqu’à l’absurde ses préoccupations anti-émeutières, de même qu’il est de bon ton d’insister sur un Napoléon III philanthrope saint-simonien178. Haussmann est pourtant explicite : au moment où le percement de la rue de Turbigo et l’élargissement de la rue Beaubourg font disparaître la rue Transnonain, il exulte : « C’est l’effondrement du vieux Paris, du quartier des émeutes, des barricades. » Et les contemporains ne s’y trompent pas : « J’ai lu, dans un livre qui a obtenu l’année dernière un très grand succès, qu’on avait élargi les rues de Paris afin de permettre aux idées de circuler, et surtout aux régiments de défiler. Cette malignité équivaut à dire, après d’autres, que Paris a été stratégiquement embelli. Eh bien, soit…. Je n’hésiterais pas à proclamer l’embellissement stratégique le plus admirable des embellissements179. »
En quittant la Cité par le pont Saint-Michel, on se trouve face à face avec une représentation de ce triomphe stratégique de l’ordre : « À qui, parmi ceux qui traversent aujourd’hui la place Saint-Michel, les figures de la fontaine, entourées de canettes de bière et de Coca-Cola, ont-elles encore quelque chose à dire ? Qui serait capable de déchiffrer historiquement cette allégorie pour touristes, de reconnaître que l’archange à l’épée pointée sur le dos de Satan devait à l’époque représenter le triomphe du bien sur le mauvais peuple de juin 48 ? Mais à l’ère des insurrections, au seuil de l’arrondissement rebelle, cette statue avait un sens dépourvu d’équivoque. Chacun savait que ce saint Michel symbolisait le Second Empire écrasant le démon de la révolution et que la rue Saint-Jacques et le Quartier Latin pouvaient reconnaître leur image dans la bête infernale jetée au sol180. »