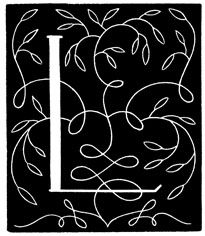
L
J’aime Lazare, passionnément – on comprendra pourquoi si l’on me suit jusqu’au terme de cette entrée.
Tout à la fois énigmatique et éblouissante, son histoire est l’un des épisodes les plus importants du Nouveau Testament. Lazare n’est pas un mythe, il a bel et bien existé : frère de Marthe et de Marie (la ménagère de moins de quarante ans et la mystique) avec lesquelles il habite, il est issu d’une famille de notables influents et fortunés ; ami très proche de Jésus*, il vit à Béthanie de Judée, à moins de trois kilomètres de Jérusalem* ; là, le ciel* est d’un bleu profond, presque maritime, sèches sont les collines hérissées d’oliviers et bruissantes de moutons, le monde de Lazare sent bon le caillé et le suint, on entend grincer les sandales sous lesquelles crépite cette poussière judéenne qui ne se résout pas à être grise.
« Encore aujourd’hui, dit (au IVe siècle) Eusèbe de Césarée, prélat, théologien, créateur de l’Histoire ecclésiastique, on y montre l’emplacement de la tombe de Lazare. »
La résurrection de Lazare ne s’est pas déroulée en catimini, mais au grand jour et devant une foule considérable. Ah ! pour du spectacle, ce fut du spectacle ! La famille de Lazare étant composée de notables fortunés (quelques jours plus tard, Marie répandra sur les pieds de Jésus un demi-litre d’un parfum très cher, fait du nard le plus pur, valant au moins trois cents pièces d’argent – ce qui fera enrager Judas* qui faisait fonction de trésorier-payeur), les plus hautes personnalités juives de Jérusalem entouraient déjà Marthe et Marie lorsque Jésus arriva. Marie sanglotait, Marthe se désolait : « Ah ! si Jésus était venu plus tôt, il aurait supplié Dieu de guérir son ami ; et comme l’Éternel accède à toutes les prières de celui qui se dit son Fils, notre bien-aimé Lazare ne serait certainement pas mort ! »
Le fait est que Jésus, pourtant dûment averti de la gravité de la maladie de Lazare, a curieusement laissé traîner les choses. Comme s’il n’avait pas voulu intervenir avant l’issue fatale, avant que le décès de Lazare n’eût été officiellement constaté. Explication : Jésus a déjà réanimé des gens qui présentaient toutes les apparences de la mort, tels la fille de Jaïre ou le fils de la veuve de Naïm ; j’emploie à dessein le verbe réanimer et non ressusciter, car peut-être la fillette et le jeune homme n’étaient-ils pas vraiment morts, mais juste tombés en catalepsie, ou dans le coma. Pour Lazare, dont le retour à la vie « doit servir à montrer la puissance glorieuse de Dieu et à manifester ainsi la gloire du Fils de Dieu » (Jn 11, 4), il faut que rien ne puisse entacher ni diminuer le miracle : le prodige doit être indiscutable – et il le sera.
Sauf pour quelques incrédules chroniques, au premier rang desquels ricane Ernest Renan. Ah ! Renan (un odieux raciste, soit dit en passant : « Et quant à la mort d’un sauvage, ce n’est guère un fait plus considérable dans l’ensemble des choses que quand le ressort d’une montre se casse, et même ce dernier fait peut avoir de plus graves conséquences, par cela seul que la montre en question fixe la pensée et excite l’activité d’hommes civilisés », si, si, c’est du Renan, il a écrit ça dans L’Avenir de la science, Pensées de 18481), c’est à lui, paradoxalement, que je dois les plus sincères et les plus vibrants credo de mes jeunes années. Que voulez-vous, une mauvaise foi aussi systématique que la sienne avait pour effet de me faire prendre – tout aussi systématiquement – une position antipodique. En tout cas, concernant Lazare, Renan s’est surpassé : « Il est donc vraisemblable, écrit-il2, que le prodige dont il s’agit ne fut pas un de ces miracles complètement légendaires et dont personne n’est responsable. En d’autres termes, nous pensons qu’il se passa à Béthanie quelque chose qui fut regardé comme une résurrection. » La difficulté, pour Renan, consiste à donner de ce « quelque chose qui fut regardé comme une résurrection » une explication rationnelle. Eh bien, ça n’est pas triste : « Il semble, reprend Renan, que Lazare était malade, et que ce fut même sur un message des sœurs alarmées que Jésus quitta la Pérée. La joie de son arrivée put ramener Lazare à la vie. » Mais même pour Renan, cette hypothèse de la joie thérapeutique n’est apparemment pas très convaincante, aussi se dépêche-t-il d’en échafauder une autre : « Peut-être Lazare, pâle encore de sa maladie, se fit-il entourer de bandelettes comme un mort et enfermer dans son tombeau de famille. » Quel épatant « baron » aurait fait ce Lazare au service d’un magicien de fête foraine ! Prêt à tout pour abuser de la crédulité des braves gens, et pas claustrophobe pour trois sous. Parce que se faire entortiller dans des bandelettes qui vous entravent en vous recouvrant des orteils jusqu’au sommet du crâne, puis se laisser enfermer dans les ténèbres d’une niche étroite et profondément creusée dans la roche, laquelle niche est encore scellée par une énorme pierre, tout ça alors qu’on relève à peine de maladie et qu’on n’a pas la moindre idée du temps pendant lequel on va rester ainsi ligoté et claustré, moi j’appelle ça de l’extrême héroïsme. Ou de l’extrême masochisme. Heureusement, Jésus « désira voir encore une fois celui qu’il avait aimé, et, la pierre ayant été écartée, Lazare sortit avec ses bandelettes et la tête entourée d’un suaire ». Quelle chance ! Parce que si Jésus n’avait pas émis le désir de se recueillir devant le cadavre de son ami, combien de temps encore le malheureux Lazare aurait-il croupi dans son tombeau ?
Mais je me gausse à bon compte, et j’ai tort : Ernest Renan, avec sa tête à la Robert De Niro, estimait que la biographie de Jésus devait être écrite comme celle de n’importe quel autre homme, ce qui lui valut d’être accusé de blasphème, et il préconisait aussi que la Bible* fût soumise aux mêmes examens critiques que n’importe quel autre document devant servir à l’Histoire – et il avait raison de réclamer l’objectivité dans un cas comme dans l’autre.
Renan ne croit pas en la divinité du Christ, c’est son droit. Il veut nous faire partager son incrédulité en nous prouvant que nous sommes des ânes, des naïfs, des gogos, libre à lui. Dommage qu’il s’y prenne mal. Dommage surtout, lui qui tient à sauver de Jésus tout ce qui peut l’être – c’est-à-dire ce qu’il appelle « l’homme admirable » –, qu’il passe à côté d’une des images les plus fortes de l’histoire de Lazare : le trouble de Jésus, son frémissement intérieur, et par-dessus tout ses larmes (Jn 11, 33-38).
Voyant pleurer Jésus (un homme en larmes était aussi incongru à cette époque qu’aujourd’hui), les Juifs mirent ses sanglots sur le compte de l’affection qu’il avait pour Lazare : « Voyez comme il l’aimait ! » (Jn 11, 36). Oui, bien sûr. Mais pas seulement. Je pense que Jésus, ce jour terrible où il se confronte avec elle, pleure aussi par horreur de la mort. Il a beau savoir qu’il va rappeler Lazare à la vie, il n’ignore rien du hideux, du nauséeux, du rebutant, de l’infect, de l’obscène de la mort – Marthe l’a d’ailleurs mis en garde quand il a demandé qu’on ôte la pierre qui scelle l’entrée du sépulcre : « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais : il est dans la tombe depuis quatre jours… » Il suffit d’avoir reniflé l’odeur d’un corps humain en décomposition, surtout le corps d’une personne que l’on a aimée, pour comprendre ce que je veux dire. Ce que voulait dire Marthe. Et ce que savait Jésus. Entre tout de suite et l’instant imminent de la résurrection de Lazare, il y a l’odeur* intolérable, l’odeur tellement contraire à l’homme, l’odeur du cadavre. Les larmes du Christ, ai-je écrit dans Il fait Dieu – et Dieu sait que je ne renie pas un mot de ce livre –, sont la réponse de Jésus à la mort des hommes : la mort est détestable, nous avons reçu de la part de Dieu le droit de la haïr car elle a fait pleurer son Fils. Je la hais donc. Elle est ma seule haine, je l’atteste, mais cette haine est sans appel.
Contrairement à une idée reçue, on continue d’avoir des nouvelles de Lazare. C’est ainsi que six jours avant la fête de la Pâque, on le retrouve attablé en compagnie de Jésus chez un certain Simon le lépreux (c’est la version de Marc et de Matthieu), lequel Simon, vraisemblablement guéri de sa lèpre par Jésus, pourrait bien être le père de Lazare. Peu importe. Ce qui est assuré, c’est que « la foule nombreuse des Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y allèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ramené d’entre les morts. Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus » (Jn 12, 9-11).
En fait, tout à leur obsession de perdre Jésus, ils en oublièrent Lazare.
Pour s’en souvenir dix ans plus tard : d’après la Tradition (qui prend donc ici le relais des Évangiles*, évidemment sans prétendre à la même authenticité), Lazare, ses sœurs Marthe et Marie, ainsi que d’autres fidèles du Christ, furent alors jetés sur un navire qui, n’ayant ni voiles ni rames, était condamné tôt ou tard à se fracasser contre un récif. Par miracle, la sinistre nef réussit à traverser la Méditerranée. Elle aborda à Marseille, où Lazare et ses compagnons prêchèrent tout ce que Jésus leur avait enseigné par ses paroles et par sa vie. Lazare fut pendant trente ans l’évêque de la jeune communauté chrétienne de Marseille (« Ô pôvre, comme dit quelquefois l’exquise Edmonde Charles-Roux, ils ont bien de la chance, ces Marseillais ! ») jusqu’au jour où les païens, inquiets de la concurrence que leur faisait cette nouvelle religion, sommèrent Lazare d’abjurer sous peine de mort. Mais la mort, Lazare en était déjà revenu. Il ne la craignait plus. Il n’en fut pas moins condamné à mourir, non sans avoir auparavant été écorché vif par des peignes en fer, et après avoir dû supporter sur ses épaules une cuirasse rougie au feu, et avoir été lié sur un gril reposant sur des charbons ardents, et avoir eu la poitrine transpercée par des flèches. Bien qu’il fût alors un fragile vieillard, ces divers supplices ne réussirent pas à le tuer, et l’on dut se résoudre à le faire décapiter par le glaive du bourreau.
Du Colonel Chabert au Comte de Monte-Cristo, en passant par le Lazare de Léonid Andreïev ou celui de Malraux, ou encore le Frankenstein de Mary Shelley, voire même L’Homme qui revient de loin de Gaston Leroux, les Lazare littéraires sont légion.
Mais avec Jean Cayrol, c’est brusquement toute une littérature, celle de l’après-guerre, qui devient – ou est appelée à devenir – lazaréenne.
Arrêté en 1942 pour faits de Résistance, déporté au camp de concentration de Mauthausen, Jean Cayrol, petit, frêle, le plus souvent de gris (léger) vêtu, sorte d’homme nuage qu’un rien (croit-on !) pouvait souffler, était poète. Mais à son retour des camps (toujours aussi petit, toujours aussi frêle, et désormais si taiseux qu’il en était presque muet), il aborda un genre nouveau : la prose, la fiction. Il publia un texte concis, ramassé, « Pour un romanesque lazaréen3 », où il exposait sa vision de la littérature surgissante, celle qui s’extrayait de la guerre comme d’une gangue. Pour lui, elle serait lazaréenne ou ne serait pas. Car c’était la société des hommes, désormais, qui était marquée par les camps de façon aussi indélébile que l’avaient été les chairs tatouées des déportés. Puisqu’on ne vivrait plus jamais comme avant, on n’écrirait pas (et on ne lirait pas) non plus comme avant. Je simplifie, bien sûr. Au risque de réduire l’intuition de Cayrol. Mais il me le pardonnera. Il sait combien je l’aime. Il a été mon père en littérature. C’est lui qui a édité mon premier livre. C’est lui qui m’a accompagné aussi longtemps qu’il en a eu la force. Je lui dois tout. Il n’est plus de ce monde, mais de l’autre. Lazare, il a retrouvé son royaume. Qui n’est pas la mort, mais l’après-vie. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi j’aime Lazare.
C’est à la Bible* que la licorne doit en grande partie la reconnaissance officielle de son existence. Certes, il existait déjà, à Babylone* et en Chaldée, des sceaux où figurait une sorte d’équidé au front orné d’une corne. Mais la licorne, la vraie, a réellement obtenu ses lettres de créance lorsque fut composée, vers 270 av. J.-C., la première version en grec de la Bible hébraïque, appelée la Septante parce qu’elle est supposée avoir été transcrite dans la langue d’Homère par quelque soixante-dix (septante, donc) traducteurs. Il semble que ceux-ci aient alors achoppé sur le mot hébreu Reem, ou Remim, dont le sens actuel se rapprocherait de buffle, de cerf, voire de ce bos primigenius, ou auroch, qui vécut au Moyen-Orient. Toujours est-il que les septante traduisirent Reem par monoceros, terme flou qui voulait peut-être désigner une sorte de rhinocéros.
À la fin du IVe siècle (de notre ère), on entreprit, sous la houlette de saint Jérôme*, une nouvelle traduction* de la Bible, en latin cette fois, et qui, sous le nom de Vulgate (c’est-à-dire vulgaire, mais au sens de courante, d’usuelle, de commune à tous), devait devenir la Bible officielle de l’Église romaine. Or, plutôt que de se fonder sur le texte hébreu, les traducteurs latinistes choisirent de partir de la version grecque des Septante. Où ils ne tardèrent pas à rencontrer le mystérieux monoceros dont eux non plus ne surent d’abord pas trop que faire : qu’est-ce que c’était donc que cette bête-là ? Une chose était sûre : le préfixe mono impliquait que l’animal* possédait une seule et unique corne, aussi décidèrent-ils de le baptiser unicornis, qui donna unicorne, nom par lequel on désigne aussi la licorne.
« Vingt jours après avoir quitté Jérusalem, nous entrâmes dans un désert montagneux dont la végétation se bornait seulement à quelques buissons épineux ; les pèlerins en cueillirent quelques branches parce que, disait-on, la couronne du Christ avait été tressée de ces épines. Il était à peu près midi quand nous vîmes dans le désert un étrange animal. Nous pensâmes d’abord à un chameau, mais notre guide nous assura qu’il s’agissait d’une licorne, ou rhinocéros des sables. Il nous montra sa corne unique, longue de quatre pieds4, si pointue et si dure qu’il n’est rien qui par elle ne soit percé ; et par conséquent la plus grande prudence devait accompagner nos faits et gestes si nous ne voulions pas, par elle, être tous décousus… »
Le voyageur qui s’exprime ainsi s’appelle Bernard von Breydenbach. Doyen de la cathédrale Saint-Martin de Mayence, il entreprit en 1483 un voyage à Jérusalem* et au mont Sinaï, dont il publia au retour un récit très documenté, Peregrinatio in Terram sanctam, qui connut un incroyable succès pour l’époque puisqu’il fut réimprimé treize fois en trente ans. Il faut dire que Breydenbach avait eu l’excellente idée de se faire accompagner par un peintre et graveur sur bois, Erhard Reuwich, d’Utrecht, dont les illustrations contribuèrent pour beaucoup au retentissement du livre. L’ouvrage ne comportait qu’une seule planche consacrée aux animaux rencontrés par les voyageurs, mais elle est étonnante : à côté d’une girafe, d’un crocodile et d’un dromadaire, on voit en effet une licorne, la légende du dessin précisant que ces animaux « sont véritablement représentés tels que nous les avons vus en Terre sainte ».
Alors, la blanche et gracieuse licorne ne serait donc pas un mythe, et elle aurait paisiblement vécu près des rives du Jourdain* ?

C’était la conviction du jésuite Athanase Kircher, surnommé le Maître des Cent Savoirs, sorte de génie dont l’étendue des connaissances le faisait comparer à Léonard de Vinci, et qui, dans le volume qu’il consacra en 1675 à l’Arche de Noé, ne manqua pas de faire figurer la licorne à bord du navire : « Ceux qui assurent qu’une espèce aussi illustre a péri dans le Déluge nient la Providence divine. Cela revient à dire que Dieu ne voulut, ou ne put, sauver cet animal… celui qui dit cela ne craint pas le blasphème ! » Était-ce une pierre dans le jardin d’un de ses prédécesseurs en histoire licornienne, Conrad Gesner, auteur d’une époustouflante Historia animalium qui recensait tout ce qu’on pouvait savoir au XVIe siècle sur tous les animaux existant ou ayant existé ? Car Gesner était formel : jusqu’au Déluge*, on pouvait rencontrer des licornes à chaque coin de rue (enfin, à chaque angle de clairière…) ; mais quelque chose que Gesner ne s’expliquait pas avait empêché les pauvres licornes d’embarquer dans l’Arche, et c’est ainsi qu’elles avaient été noyées par les flots du Déluge et effacées de la surface de la terre.
Bruno Faidutti, historien, sociologue, auteur d’une thèse épatante sur les licornes, répond aujourd’hui qu’il n’est pas impossible que ce soit la longueur excessive de sa corne, signe d’orgueil d’après une tradition talmudique, qui ait en effet interdit à la licorne de monter dans l’Arche où, de toute façon, la hauteur sous barrots5 était limitée. Oui, mais si la licorne ne pouvait trouver place à bord à cause de la taille de sa corne, quid de la girafe ? Faut-il supposer que la licorne et son interminable appendice étaient moins logeables que la girafe emmanchée d’un long cou ? La licorne n’en finit pas d’être une énigme…
Ce qui est certain, c’est qu’une iconographie abondante montre des licornes embarquant dans l’Arche – avec cette singularité que souvent elles sont solitaires, alors que les autres animaux vont par couples. Serait-ce le signe qu’elle n’était pas appelée à se reproduire une fois le Déluge apaisé ? Si oui, pourquoi ? En quoi la chère petite avait-elle démérité ?
Parce que, enfin, elle est adorable ! Qu’elle appartienne au règne animal ou à celui des légendes, il est difficile de trouver plus exquis, plus gracieux qu’une licorne : de taille modeste mais admirablement proportionnée, le menton orné d’une barbiche soyeuse qui lui donne un petit air de sagesse, la robe immaculée, couronnée par cette fameuse longue corne spiralée dotée de vertus extraordinaires, elle aurait même, aux dires de certains auteurs, les yeux d’un bleu attendrissant. De caractère farouche – d’aucuns, sans doute vexés de n’avoir pas réussi à la caresser, ont eu le triste culot de la prétendre féroce –, la licorne est l’un des animaux les plus difficiles à capturer. Il n’existe qu’une méthode, pas très honnête avouons-le, mais dont les amateurs de licornes assurent qu’elle est imparable. Il s’agit d’attirer la jolie bête avec ce qui, pour elle, représente une tentation à laquelle elle est incapable de résister : une jeune fille vierge. Seule de tous les êtres vivants, la licorne a en effet le privilège de pouvoir humer le parfum suave et délicieux (c’est du moins l’opinion des licornes) de la chasteté. Alors, aussitôt qu’elle repère une jeune vierge, la licorne s’en approche et, abdiquant toute méfiance, pose sa tête sur les genoux de la demoiselle (en ayant garde de ne pas la blesser avec sa corne), et elle s’endort presque instantanément. Au veneur, alors, de sortir du bois…
À en croire les vieux grimoires sur ce sujet, des quantités considérables de licornes auraient été attrapées de cette façon. Mais Martin Luther s’inscrit en faux : parce que cet animal extraordinaire représente Jésus-Christ (voir : Jésus), licorne céleste venue se loger dans le sein de la Vierge, jamais nul ne s’en emparera. C’est peut-être pourquoi la licorne continue de courir dans mes rêves. La Bible est ravissante.
Certaines traditions voient en Lilith la première moitié (presque au sens littéral) d’Adam*, la femme dont la version première de la Genèse rapporte qu’elle fut façonnée en même temps que lui : « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il les créa » (Gn 1, 27).
Était-ce Lilith ? On ne peut que le supposer, car elle n’est pas nommée. D’ailleurs, à peine a-t-elle ouvert l’histoire la plus prodigieuse de tous les temps qu’elle quitte déjà la scène. Remplacée par une autre femme à laquelle Adam, dans une deuxième relation de la création* du monde, cette fois donne un nom : « Ève, c’est-à-dire la Vivante, car c’est elle la mère de tous les vivants » (Gn 3, 20).
Lilith réapparaît sous son nom au chapitre 34 du Livre d’Ésaïe (et encore, pas dans toutes les traductions*) à l’occasion d’une description des épouvantables cataclysmes dont Dieu afflige Édom, royaume fondé par Ésaü* et devenu un des ennemi mortels d’Israël* : « … ses torrents tourneront en naphte, son sable en soufre, sa terre sera de naphte en feu, nuit et jour enflammée […] dans ses citadelles croissent ronces, orties, chardons dans ses villes fortes, elle est la closerie des chacals, la volière des nichées d’autruches, les chats-huants côtoient les hyènes, le vieux bouc crie après son frère – là au moins s’arrête Lilith, elle va y trouver le repos… »
Quelle femme étrange est donc Lilith pour trouver à se reposer dans un tel environnement ? D’après un livre kabbalistique, l’Alphabet de Ben Sira, la vraie nature de Lilith se serait révélée très peu de temps après la Création, à la suite d’un violent affrontement (la toute première dispute conjugale, donc !) l’ayant opposée à Adam : Lilith refusait en effet que, dans l’acte sexuel, l’homme se tienne au-dessus d’elle. Elle avait pour ça un argument difficilement réfutable : créée en même temps qu’Adam et pétrie de la même glaise que lui, elle ne voyait vraiment pas au nom de quelle prétendue prééminence son partenaire adopterait une posture qu’elle jugeait dominatrice.
De son côté, Adam devait manquer de curiosité en matière de sexualité, car il refusa de tenter l’expérience que lui proposait sa compagne : il déclara qu’il resterait dessus et qu’elle se tiendrait dessous, et que cela vaudrait pour tout le temps qu’ils vivraient ensemble – autant dire l’éternité, puisque le jeune couple habitait le Paradis terrestre où la mort n’avait pas encore été inventée.

Lilith fit alors ce que des millions de femmes allaient faire après elle : elle quitta Adam, ses obsessions machistes et son Paradis ; et pour tirer plus vite sa révérence, elle demanda à Dieu de lui donner des ailes. De son côté, Adam éprouva ce que des millions d’hommes allaient connaître après lui : un chagrin d’amour. Devant le désespoir d’Adam, Dieu dut regretter d’avoir doté Lilith des ailes qu’elle lui avait réclamées – de grandes ailes membraneuses, paraît-il ; c’était assez inélégant, mais ça lui permettait de voler vite et loin –, et il dépêcha trois anges* aux trousses de la belle fugueuse avec mission de la convaincre de réintégrer le paradis conjugal. Mais rien n’y fit : Lilith refusa de revenir sur sa décision.
Qu’elle ait repoussé Adam, passe encore. Mais qu’elle dise non à Dieu, c’était autrement grave. Pour son châtiment, elle fut condamnée à voir mourir chaque jour une centaine de ses enfants – elle devait en avoir tant et plus, car elle possédait le pouvoir de concevoir des myriades de petits démons à partir du sperme que les hommes répandaient sur le sol. Ce verdict la rendit si enragée qu’elle jura alors de tuer et de dévorer tous les nouveau-nés qu’elle pourrait.
La mort subite du nourrisson serait-elle une des conséquences de la fureur vengeresse de Lilith ? Dans certains pays d’Europe centrale, et jusqu’au XVIIe siècle bien sonné, l’usage voulait qu’on réveille les bébés qui souriaient béatement dans leur berceau – car ce n’était pas aux anges qu’il faisaient risette, croyait-on, mais à la cruelle et séduisante Lilith qui se penchait sur eux pour les étrangler.
Lilith s’était en tout cas vite consolée de ses amours manquées avec Adam. Elle avait rencontré et épousé un certain Samaël (étymologiquement : le venin de Dieu), un des pires démons des royaumes obscurs : vêtu de feu, lui aussi muni d’ailes membraneuses, il n’est autre que l’Ange de la Mort ; parmi ses horribles facéties, on lui prête celle d’avoir fécondé Ève* à son insu : Caïn* serait son fils.
Mise au ban de la Bible*, Lilith a été largement « récupérée » par la littérature. De la Lilith de George MacDonald (1895) trop injustement oubliée (c’est pourtant une formidable high fantasy, je ne saurais trop vous la recommander), au conte que lui a consacré Marcel Schwob, en passant par Primo Levi qui en a fait un référent de la vie concentrationnaire (la vie-Lilith, la vie des camps toute de ténèbres et d’effroi, en opposition à la vie-Ève, la vie lumineuse et blonde de l’autre côté), Lilith a connu d’éblouissants avatars. Dont évidemment Lolita : la nymphette, Dolores Haze de son vrai nom (haze signifiant brume légère, c’est-à-dire un milieu ambigu et trouble), est une métaphore parfaite de Lilith – laquelle, en 1938, avait déjà inspiré un poème à Nabokov. Jouant de l’ange et du diable, inconsciemment parfois, la jeune fille Lolita est aussi dangereuse pour l’homme que Lilith la démone. À cause d’elle, Humbert Humbert, le héros du roman, finira désespéré, meurtrier et prisonnier. « Humbert Humbert était parfaitement capable de forniquer avec Ève, mais c’était Lilith qu’il rêvait de posséder. » Ainsi parle Maurice Couturier dans Nabokov ou la cruauté du désir. Une chance pour notre humanité qu’Adam n’ait pas eu les mêmes rêves qu’Humbert Humbert, sinon vous et moi serions probablement des démons issus de démons…
« Pas une goutte de son sang n’était humaine, pourtant elle était faite comme la plus tendre et la plus douce des femmes », écrit le peintre-poète Dante Gabriel Rossetti qui a travaillé plus de dix ans sur le canevas de celle qu’il a peinte sous le nom de Lady Lilith.
1894. Précédé par ses moustaches à la Hercule Poirot ou à la Marcel Proust, Pierre Loti, de son vrai nom Julien Viaud, quarante-quatre ans, officier de marine et académicien français depuis trois ans, mais aussi grand professionnel de l’angoisse (dixit très justement François Bon dans son blog excellent : « Le Tiers Livre »), part en expédition en Terre sainte. Avec pour but avoué de « ressaisir [là-bas] quelques bribes de foi… ».
Il embarque à Marseille le 4 février 1894 sur l’Oxus, l’un des paquebots des Messageries Maritimes. Il est accompagné de son ami Léo Thémèze (le marin à gueule d’ange qui lui a inspiré le roman Matelot écrit deux ans auparavant) et du duc de Dino, arrière-petit-neveu de Talleyrand. Après cinq jours d’une traversée sans histoire, l’Oxus est à Alexandrie. À l’oasis de la fontaine de Moïse* (là même où Moïse, frappant le rocher de son bâton, fit jaillir une source pour étancher la soif du peuple immense qui le suivait), Loti et ses compagnons rejoignent une caravane composée de bédouins et d’une vingtaine de chameaux qui doit les mener vers le mont Sinaï, à travers les montagnes, les déserts* d’Arabie et le Djebel de Tih.
Pour Loti, cette marche d’approche dans le désert est l’occasion de se préparer au choc qu’il espère de toutes ses forces : retrouver à Jérusalem* la foi qu’il a perdue lorsque Dieu a laissé mourir du choléra son jeune frère Gustave, puis une petite amie d’enfance qu’il aimait profondément, puis le propre père de Loti (celui-ci n’ayant alors que vingt ans) qui n’avait pas supporté des accusations mensongères portées contre lui.
Arrivés à Gaza le 26 mars, Loti, le marin et le duc rallient Jérusalem en passant par Hébron et Bethléem*.
À sa grande déception – on peut même parler d’une réelle souffrance spirituelle –, Loti ne ressent rien en visitant Jérusalem. En proie à une sécheresse intérieure qui enferme son âme comme dans une gangue, il ne voit de Jérusalem que l’exploitation qu’on fait des Lieux saints : lui qui avait espéré entendre chanter les anges* se retrouve assourdi par les criailleries des marchands, des guides et des zélotes des trois religions. Il n’emporte de la Ville sainte qu’une vision de touriste exténué, suant et poussiéreux, qui repart les mains vides : « Jérusalem !… Oh ! l’éclat mourant de ce nom !… Comme il rayonne encore, du fond des temps et des poussières, tellement que je me sens presque profanateur, en osant le placer là, en tête du récit de mon pèlerinage sans foi ! […] Vraiment, mon livre ne pourra être lu et supporté que par ceux qui se meurent d’avoir possédé et perdu l’Espérance Unique ; par ceux qui, à jamais incroyants comme moi, viendraient encore au Saint-Sépulcre avec un cœur plein de prière, des yeux pleins de larmes, et qui, pour un peu, s’y traîneraient à deux genoux… […] Nous quittons Jérusalem sous des nuages de tourmente. C’est le côté des concessions européennes, des hôtels, des toits en tuiles rouges – et la Ville sainte, derrière nous, s’éloigne avec des aspects de ville quelconque… »
Le cœur en berne, Loti chevauche vers Damas et Beyrouth, où il montera à bord du bateau pour l’Europe, il passe par Jéricho, Samarie et le puits de Jacob où Jésus* demanda à boire à la Samaritaine, par Tibériade, par Nazareth, la cité christique par excellence – toujours sans ressentir d’émotion particulière. Il faut dire que les conditions sont exécrables, même le désert ne se ressemble pas, il y pleut à verse, on s’y enrhume : « Nous ne sommes plus que des errants quelconques, en lutte physique contre un temps d’hiver, et, par moments, contre nos chevaux qui tournent le dos à l’ondée cinglante, refusant d’avancer […] Il vente en tempête. […] Transis, nous nous séchons là devant un grand feu de branches, qui nous enfume à nous faire pleurer. Dans le désert rocheux qui nous environne, les rafales sifflent, la pluie s’abat, furieuse… »
Après une escale à Constantinople, il débarque à Marseille le 7 avril. Il n’a rien retrouvé de sa foi disparue. Il était parti en quête d’un signe du Ciel*, et il ne rapporte qu’une mémoire de terre caillouteuse, ravinée, aride, de petites cités aux noms sans doute magiques mais que toute magie a désertées : les ruelles où la poussière n’en finit pas de retomber exhalent non plus le nard dont Marie-Madeleine baigna les pieds du Christ, mais des odeurs* d’urine.
Sans la foi, Loti n’a plus rien à opposer à la mort. Celle-ci reste ce que, malgré tout ce qu’il a pu tenter contre elle, elle n’a au fond jamais cessé d’être : une destruction abjecte de toute chair selon une méthode particulièrement hideuse, visqueuse, puante.
Cette idée le terrifie. Et il n’est pas le seul.
C’est pourquoi Pierre Loti, tout autant que tel ou tel champion de la foi, a sa place dans ce Dictionnaire amoureux de la Bible. Ce livre ne se concevait pas sans un porte-drapeau de l’incroyance – oh, pas de l’incroyance triomphante, arrogante, des déicides, mais de celle, poignante, d’un « agnostique qui, comme l’écrit son ami Claude Farrère, ne se résigna jamais à renoncer à Dieu ». Alors oui, j’ai choisi Loti, le prétendu mondain qui porte à merveille l’uniforme de capitaine de vaisseau et tout aussi bien l’habit vert d’académicien, mais qui, lors de sa visite au jardin des Oliviers, n’est plus qu’une plainte, cette longue plainte aussi vieille que la Bible*, cette plainte assoiffée des hommes sans foi : « Contre l’olivier mon front lassé s’appuie et se frappe. J’attends je ne sais quoi d’infini… et rien ne vient à moi, et je reste le cœur fermé, sans même un instant de détente un peu douce […] Non, rien, personne ne me voit, personne ne m’écoute, personne ne me répond… »
1- Sans doute n’avait-il que vingt-cinq ans quand il écrivit cet essai. Qu’il ne publia d’ailleurs que quarante ans plus tard (Calmann-Lévy 1890), mais sans pour autant revenir sur ce passage.
2- Vie de Jésus, 1863.
3- Dans son recueil Lazare parmi nous, 1950.
4- Environ un mètre vingt-deux.
5- Ce que les Terriens appellent la hauteur sous plafond…