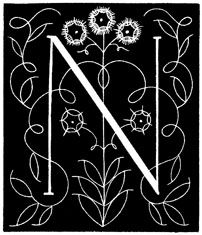
N
Si je vous dis que mon premier est une pomme, mon deuxième une adorable fille, et mon troisième un homme portant un prénom biblique, vous en déduirez que mon tout doit avoir quelque rapport avec le Paradis terrestre et les sottises d’Adam* et Ève*. Eh bien, non ! La pomme dont il est question est une Flower of Kent, rouge avec des stries de jaune et de vert, l’adorable fille s’appelle Catherine Barton, et l’homme au prénom biblique n’est autre qu’Isaac Newton.
On a lontemps cru que l’histoire d’une pomme tombant sur la tête de Newton, et lui faisant du même coup découvrir la loi de la gravitation universelle, relevait de la pure légende. La vérité est qu’il s’agit peut-être d’une histoire d’amour : Newton s’était épris de sa nièce, Catherine Barton, une ravissante jeune personne de dix-sept ans qui s’était installée chez lui plus ou moins comme sa gouvernante. Catherine était une fille particulièrement intelligente, et qui n’aimait rien tant que soutenir de longues et savantes discussions avec son oncle – enfin, savantes jusqu’à un certain point, car il était des domaines où Catherine avait tout de même quelques difficultés à suivre ; la question de la gravitation en faisait partie, et il semblerait que ce soit pour se faire mieux comprendre de sa nièce adorée que Newton ait choisi cette image de la chute d’une pomme.
Il existe des variantes de ce récit, bien sûr incontrôlables, mais qui toutes intègrent une pomme tombant d’un arbre. En somme, le scénario est le même, c’est le casting qui change : le confident de Newton n’est plus sa nièce, mais tel ou tel de ses amis ou collègues – par exemple l’archéologue William Stukeley qui fut aussi son biographe, ou Voltaire* qui raconte l’anecdote comme s’il en avait reçu confidence de la bouche même de Catherine Barton.
Quoi qu’il en soit, la pomme sied à Newton. Celui-ci était en effet un passionné de Bible*, se considérant comme faisant partie d’une catégorie d’élus choisis par Dieu pour décrypter les écrits bibliques. Pour lui, la philosophie qui traite à la fois des fins dernières et du quotidien de l’homme n’est pas seulement une des données du grand livre de la Nature : elle est pareillement révélée par les textes sacrés tels que la Genèse, le Livre de Job*, les Psaumes*, le Livre d’Ésaïe, etc. Et Newton d’en conclure que le plus grand philosophe du monde était probablement Salomon*, dont le Temple* avait été un modèle mathématique et initiatique parfait, à partir duquel l’homme pouvait déchiffrer les mystères de l’univers.
À la mort de Newton, qui, à la manière des kabbalistes, avait toute sa vie fouillé la Bible en quête d’un code* secret qu’il y croyait caché, on constata qu’il avait écrit quatre millions de mots sur le thème de la religion contre un million seulement se rapportant à la science. Mais il lui arrivait aussi de mêler les deux, comme en 1704, lorsqu’il avait annonça la fin du monde pour 2060. Précisant qu’il ne s’agissait pas là d’une prédiction (il laissait cela aux charlatans), mais d’un calcul. À la fois biblique et mathématique. Et donc imparable…
« Noli me tangere, ne me touche pas », dit Jésus* à Marie-Madeleine en larmes – larmes de joie, mais qui brouillent ses yeux, du coup elle a besoin de palper pour vérifier –, alors qu’elle avance la main pour s’assurer qu’elle ne rêve pas, que l’homme souriant qui se tient devant elle est bien Jésus, celui qu’elle a vu mourir sur la croix*, et que voilà ressuscité des morts, plus beau, plus radieux que jamais. Noli me tangere, une des plus fascinantes et des plus mystérieuses phrases prononcées par Jésus. Trois mots qui n’ont plus rien à voir avec les prêches, les paraboles, les objurgations, les conseils fraternels. Trois mots prononcés (criés, peut-être ?) dans l’urgence, trois mots qu’on n’attendait pas : Noli me tangere – est-ce la première chose à dire à une femme qui vous a cru mort, et à travers cette jeune femme à toute l’humanité qui elle aussi vous a cru mort ? Mais Jésus pare au plus pressé, car il y a urgence : il ne faut surtout pas que cette jeune femme le touche !
Revoyons la scène. Dimanche matin. Marie de Magdala se tient sur le seuil du tombeau, sanglotante. Tout à la fois elle veut et ne veut pas voir le corps de Jésus dans son linceul. Malgré les premières précautions prises le vendredi soir, le linge a dû s’imprégner de sang. De sanies. Les morts, ça se vide de partout. C’est pourquoi il fallait venir ce matin, apporter des parfums, des aromates. Maintenant qu’elle est là, autant regarder. D’ailleurs, la mère de Jésus lui demandera certainement de raconter ce qu’elle a vu. Alors, sans cesser de pleurer, Marie-Madeleine se penche vers l’intérieur du sépulcre. Elle voit deux jeunes hommes en vêtements blancs, assis sur la banquette de pierre, là où reposait le corps de Jésus, l’un à la tête et l’autre aux pieds. Elle ne sait pas qu’ils sont des anges*. Étranglée par son chagrin, elle s’attend à tout instant à être confrontée à quelque chose de mortifère, de répugnant, d’immonde, elle est à des années-lumière de pouvoir imaginer quoi que ce soit de féerique. « Les anges lui demandèrent : “Femme, pourquoi pleures-tu ?” Elle leur dit : “Parce qu’on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a mis.” Ayant dit cela, elle se retourna, et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit : “Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?” Le prenant pour le jardinier, elle lui dit : “Seigneur, si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et je le reprendrai.” Jésus lui dit : “Marie !” Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu : “Rabbouni !”, ce qui veut dire : “Maître”. Jésus lui dit : “Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père…” » (Jn 20, 13-17).
Pourtant, huit jours plus tard, alors qu’il n’est toujours pas monté vers le Père, Jésus commandera à Thomas de mettre sa main dans la blessure qu’il porte au côté. Pourquoi a-t-il repoussé l’attendrissante Marie-Madeleine et obligé Thomas à accomplir le geste un peu morbide d’enfoncer les doigts dans une plaie ouverte ? Est-ce parce que Thomas est toujours englué dans le monde du paraître, alors que Marie-Madeleine a déjà quelque chose d’un ange – les hommes s’empoignent, les anges s’effleurent ? Conjectures, supputations, jeux de l’esprit, aucune des explications que l’on m’a proposées ne m’a vraiment satisfait. Au fond, je ne suis pas sûr d’avoir envie de savoir : il est si joli, le mystère de l’intouchable !…
Ce Noli me tangere est pour moi l’instant le plus éblouissant, l’apogée, le zénith de la Résurrection : il est l’aveu, pudique mais incontestable, de la réappropriation par le Christ de sa nature pleinement divine. Les morts, nos morts, ne seront plus aussi morts qu’avant. Le Mal a perdu la guerre – certes, il y aura encore des contre-offensives, des batailles des Ardennes à l’échelle de Satan*, c’est dire les tragédies effroyables que la longue agonie diabolique va encore engendrer, mais au bout du compte la victoire de Dieu est inéluctable : Noli me tangere, c’est l’évidence de la Résurrection, trois petits mots pour signer le plus grand des prodiges – comprenez-vous à quel point cette modeste mise en garde sonne plus vrai que si l’Évangile* avait fait entonner au Christ je ne sais quoi de triomphaliste ? Sur les routes de Galilée et de Judée, dans toutes ces villes de Palestine où il a fait halte, Jésus n’a cessé de toucher et de se laisser toucher. Le Noli me tangere marque donc une rupture radicale avec les années de vie publique. C’est une autre signature. Vraiment, les temps ont changé. Noli me tangere, petite fille de Magdala, mais que cela ne t’empêche pas de continuer à me regarder avec tout ton amour…
Il existe de nombreux et admirables tableaux illustrant le Noli me tangere. Il en est un qui m’émeut plus que d’autres – plus joyeusement, surtout : celui de Hans Baldung Grien, daté de 1539, qui montre une Marie-Madeleine toute blonde, en robe blanche et pourpoint de velours pourpre. Au fond, on voit le tombeau où deux petits anges semblent folâtrer comme des chatons dans le sarcophage vide. C’est la fin des ténèbres. Voici que monte un jour radieux, une trouée d’or au milieu des nuées en fuite. Ciel de traîne, c’est le signe que la tempête est passée.
Pendant environ six siècles, depuis le temps d’Abraham* jusqu’à la fin du temps de Moïse*, le peuple d’Israël* a été en état de pérégrination chronique. Parfois en quête de mieux (ailleurs, l’herbe est plus verte…), parfois par punition. Car on oublie trop souvent que si les Hébreux ont erré quarante ans dans le désert*, ce n’est pas parce qu’ils n’avaient pas le sens de l’orientation : c’est parce qu’ils étaient punis.
Redécouvrez l’affaire, si vous l’aviez oubliée : relativement peu de temps après avoir quitté l’Égypte* (quelque chose comme seize mois, ce qui n’est pas tant que ça pour tout un peuple allant à pied, emportant ses biens et ses troupeaux), les enfants d’Israël arrivent à proximité des collines de Canaan, le pays que leur a promis l’Éternel. Moïse envoie alors des explorateurs vers ces terres supposément « gorgées de lait et de miel », avec mission de reconnaître « le pays, ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort ou faible, s’il est en petit ou en grand nombre ; ce qu’est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais ; ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées ; ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y en a point. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays… » (Nb 13, 1-20).
Les explorateurs reviennent au bout de quarante jours en disant que la terre de là-bas a tous les aspects de l’excellence, qu’elle donne une abondance de fruits magnifiques, à preuve les grappes d’énormes raisins qu’ils rapportent. Le problème, c’est que les Cananéens sont à l’image de leurs fruits : d’une force physique colossale (certains sont même carrément des géants), très bien armés, ils possèdent des villes fortifiées qui semblent inexpugnables – bref, d’après les explorateurs, toute tentative de conquérir ce pays est vouée à l’échec et se soldera par un massacre. À l’écoute de ce rapport, les Israélites déchirent leurs vêtements. Ils sont consternés : pourquoi YHVH* les a-t-il fait sortir d’Égypte si c’était pour les jeter dans ce piège ? Ah ! comme ils regrettent déjà le temps de l’esclavage, et comme ils auraient préféré mourir sur la route plutôt que de connaître cette terrible désillusion !…
L’Éternel, alors, laisse éclater sa colère : ce peuple ne fera-t-il donc jamais confiance à son Dieu ? N’a-t-il donc pas encore compris que celui qui a YHVH à ses côtés n’a rien à craindre de qui que ce soit ? Un tel manque de foi mérite une punition exemplaire – et le verdict tombe : aucun des hommes âgés de vingt ans et plus ne connaîtra les délices de la Terre promise. « Vous mourrez dans le désert, leur annonce l’Éternel. […] Vous avez mis quarante jours pour vous renseigner sur le Pays de Canaan ? Eh bien, vous souffrirez à cause de vos fautes pendant quarante ans, c’est-à-dire une année pour un jour. Ainsi, vous saurez que cela coûte cher de vous opposer à moi » (Nb 13 et 14).
Le peuple parti joyeux à la conquête de la Terre promise se transforme en une troupe de prisonniers sans chaînes ni barreaux, mais qui n’en sont pas moins désormais des condamnés à mort. Seuls leurs enfants (ceux que les Israélites ont déjà et ceux qu’ils ne manqueront pas d’engendrer au cours de leur errance) et les femmes (du moins les plus jeunes d’entre elles), ainsi que Josué* et Caleb qui ne se sont pas montrés aussi pusillanimes que les autres, entreront en Canaan.
Curieusement, après l’énoncé de ce verdict, les récits de l’Exode ne reviendront plus sur les prolégomènes de la longue errance. On ne fait pas appel des jugements de Dieu, alors bon, c’est parti pour quarante ans de marche et de mort ; les rédacteurs de l’épopée en oublient complètement qu’il s’agit d’une espèce de marche au supplice (ou à tout le moins d’une marche suppliciante) pour ne plus s’intéresser qu’aux péripéties du voyage, lesquelles ne manquent pas de piquant grâce aux incessantes jérémiades des nomades-jusqu’à-ce-que-mort-s’ensuive, lesquelles vont de récriminations à propos du boire ou du manger à des rebellions plus sérieuses, comme celle de Korah contre le leadership de Moïse et la primauté du grand-prêtre Aaron.
Pendant ces quarante années, Israël n’a évidemment pas de temple*, pas de lieu fixe pour adorer Dieu. C’est alors Dieu qui se nomadise pour accompagner son peuple. Lui aussi a sa tente : la Tente de la rencontre ou Tente du rendez-vous, un espace mobile délimité par une enceinte formée de quatre (riches) tentures superposées et de poteaux, dont Dieu lui-même, à la fois architecte et décorateur, fournit à Moïse une description détaillée : « Les Israélites me feront une tente sacrée pour que je puisse habiter au milieu d’eux. Vous fabriquerez la tente et tous les objets sacrés conformément au plan et aux modèles que je vais te montrer » (Ex 25, 8-9). La précision divine s’étend aux dimensions, aux textures, aux couleurs, aux matières, rien n’est laissé au hasard. C’est sur le plan de cette Tente que sera très fidèlement calqué celui du Temple de Jérusalem*.
Le nomadisme est à ce point inscrit dans la culture des enfants d’Israël qu’après l’arrivée des survivants du désert en Terre promise, certains d’entre eux firent sécession. Sous l’influence d’un certain Jonadab ben Rekab, ils refusèrent d’adopter une vie sédentaire. Ne bâtissant pas de maisons, ne semant pas de graines (ils craignaient que la culture du sol ne fît d’eux des paysans plus attachés au culte de leur champ qu’à celui de YHVH), ils continuèrent à vivre sous la tente, à l’écart des villes. Ils s’abstenaient de tout ce qui vient de la vigne (vin, vinaigre, jus de raisin, raisin lui-même, etc.) de peur de se laisser entraîner dans les orgies liées au culte du dieu Baal, ce vieux paganisme qui prédominait en Canaan, et auquel les Israélites s’abandonnaient parfois, lorsque l’ivresse et la débauche leur faisaient oublier qui ils étaient.
Le nomadisme est inséparable de la Bible*, comme le déplacement et la dispersion sont les thèmes récurrents – et tragiques – d’Israël. L’Exode dans le désert, les Exils* babyloniens annoncent la Déportation, dont une des images les plus insoutenables est pour moi celle dont l’écrivain bouleversant que fut Jean Cayrol s’est fait le parolier dans Nuit et Brouillard, le film d’Alain Resnais : « Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d’herbe, même une route où passent des voitures, des paysans et des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration… »
On mange beaucoup et souvent, dans la Bible*. Les Juifs aiment à se régaler, comme d’ailleurs le leur prescrit sagement leur chère (et sage) Torah* : « Tu mangeras à satiété… » Dans le Nouveau Testament, où le Christ lui-même se fait nourriture, la félicité suprême est souvent présentée comme une noce où le repas, bien sûr, tient une place prépondérante.
L’Ancien Testament est délibérément carnivore. Des cailles de l’Exode aux viandes sacrificielles du Temple*, la Bible hébraïque fleure bon la grillade, le rissolé. Ce qui n’empêche pas d’apprécier aussi les produits de la terre – légumes, fruits, et surtout céréales : le bibliste suisse Paul Bruin a dénombré plus de deux cents mentions du mot pain.

À l’époque du prophète Jérémie, il existait même tout un quartier de Jérusalem* entièrement dédié aux boulangers. Mais en cas de famine, notamment lorsqu’une ville est assiégée comme ce fut le cas de Samarie (capitale du royaume d’Israël*, bâtie vers l’an 800 av. J.-C.), on savait se contenter de nourritures à la fois moins roboratives, et surtout moins gustatives, comme la fiente de pigeon qui se négociait alors autour de cinq sicles d’argent les cinquante grammes – je vous laisse à penser ce que pouvait valoir le pigeon lui-même…
Parmi les rites du shabbat, les trois repas pris en famille, entre amis, sont primordiaux. Ils ne manquent d’ailleurs pas d’être délicieux, aussi est-il recommandé de manger modérément la veille afin de garder bon appétit pour shabbat ; pour avoir eu le bonheur d’être quelquefois convié à partager un de ces repas, je confirme l’excellence du conseil !
À lire la Bible, on trouverait presque chaque jour une occasion de festoyer pour célébrer ceci ou cela. Parmi les « petites » fêtes, il en est une que je trouve particulièrement charmante : Tou Bichevat, le nouvel an des Arbres, qui marque la fin de l’hiver. L’essentiel du menu se compose de quinze sortes de fruits, dont en priorité sept espèces cultivées en Israël : d’abord le blé, l’orge, puis le raisin, la grenade, la figue, la datte et l’olive, auxquels s’ajoutent le fruit du caroubier, emblématique d’Erets Israël, et l’amandier, premier arbre dont la floraison signe la fin des froidures et des ciels gris. On boit aussi quatre coupes de vin (la première de vin rouge, la deuxième comportant deux tiers de vin rouge et un tiers de blanc, dans la troisième on mêle un tiers de rouge et deux tiers de blanc, et la quatrième est remplie seulement du vin blanc) qui symbolisent le changement de couleur des arbres, ainsi que le combat entre la saison froide représentée par le vin blanc, et le renouveau de la nature personnifié par le vin rouge.
Pour la pâque juive (Pessah), on consomme le pain azyme qui rappelle ce pain de misère, ce pain sans levain confectionné dans la précipitation la veille de la sortie d’Égypte*. On chasse de la maison tout aliment contenant du levain, ainsi que tout produit qui renferme, même à dose infinitésimale, du hamets, c’est-à-dire de la farine de blé, d’orge, d’avoine, d’épeautre ou de seigle. Et non seulement il est hors de question d’en consommer, mais il est même interdit d’en voir. C’est une traque acharnée à laquelle on se livre, quitte à mettre la maison sens dessus dessous. D’aucuns voient dans ce rituel l’origine de l’incontournable grand nettoyage de printemps chez les non-juifs.
La Bible accorde une importance toute particulière au miel : la Terre promise est le pays du miel et du lait, l’amant du Cantique des Cantiques* susurre à la Sunamite : « Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait », tandis que les Proverbes mettent en garde : « Les lèvres de la dévergondée distillent le miel et sa bouche est plus onctueuse que l’huile ! » (Pr 5, 3). Le miel de la Bible n’est pas qu’une métaphore : en 2007, à Tel Rehov, ville « biblique » située dans la vallée du Jourdain*, des fouilles dirigées par Amichaï Mazar, de l’Institut d’archéologie* de l’Université hébraïque de Jérusalem, ont mis au jour une trentaine de ruches qui sont les plus anciennes découvertes à ce jour – elles datent de Salomon* ! Des apiculteurs qui les ont examinées estiment qu’elles devaient produire environ une demi-tonne de miel par an.
Que sont les agapes bibliques devenues (je rappelle en passant que le mot agapè, en grec, veut dire amour, et qu’il a été choisi de préférence à éros pour qualifier l’amour chrétien) ? Eh bien, l’Église catholique les a vilipendées. Manger ? Pouah ! Et de surcroît en se régalant ? Horreur ! La damnation est au bout de notre fourchette… laquelle n’est pas sans rappeler les fourches dont usent les démons pour asticoter les damnés et les pousser plus avant dans la fournaise. Les protestants n’ont pas la même répulsion de la gourmandise qu’ils ont supprimée de la liste des « péchés capitaux » – recommandant tout de même de s’abstenir de viande le vendredi saint. Cela dit, la Réforme a longtemps manifesté une indifférence un peu méprisante vis-à-vis des nourritures terrestres, ce qui a fait dire à certains que, pour les protestants, la pénitence alimentaire était en quelque sorte chronique. Ainsi le sociologue belge Léo Moulin, spécialiste des pratiques alimentaires et historien de la vie religieuse, fait-il remarquer dans son ouvrage Liturgies de la table1 que ce n’est peut-être pas un hasard si la plupart des pays sociologiquement protestants ont une cuisine que l’auteur qualifie de « décapitée », tandis que les pays sociologiquement catholiques ont une cuisine infiniment savoureuse. La Bible, en tout cas, avait – et a toujours – sacrément bon goût, comme en témoigne le grand prophète Ézéchiel : « Celui qui parle me dit : “Toi, l’homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce rouleau [de la Torah, donc de la Bible] puis va parler aux Israélites.” J’ouvre la bouche, et il me fait manger le rouleau. Ensuite, il me dit : “Toi, l’homme, remplis ton ventre, nourris-toi avec ce rouleau que je te donne.” Je le mange donc. Dans ma bouche, il est doux comme du miel » (Ez 3, 1-3).
1- Albin Michel, 1989.