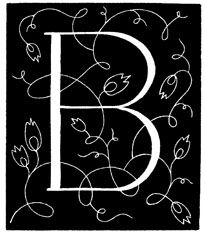
B
Au cœur d’une plaine de sables jaunes et de boues grises, arrosée par l’Euphrate, rafraîchie (et en partie nourrie) par une palmeraie irriguée selon un système de vis hydrauliques que même les Égyptiens, pourtant imbattables en la matière, n’avaient pas imaginé, la Babylone du VIe siècle av. J.-C. était plus grande que le Paris d’Henri IV. Protégée par des douves, ceinte de murailles défendues par deux cent cinquante tours de guet et percées de portes de bronze (emporté par son enthousiasme, Hérodote, père des historiens et des explorateurs, en a compté cent ; mais il ne devait guère y en avoir plus de huit ou neuf, dont la principale, la porte d’Ishtar, recouverte de briques à la glaçure bleu cobalt, ornée de dragons et de taureaux, était d’une extraordinaire splendeur), la cité monumentale abritait une telle densité de population que l’habitat s’était en partie développé à la verticale et que les « immeubles » de quatre ou cinq étages n’étaient pas rares.
Ces hautes maisons faisant obstacle à la lumière du soleil, ces rues encaissées et tortueuses où stagnaient comme un brouillard les fumées grasses des échoppes et des ateliers, ce grouillement humain avec ses excès et ses violences inévitables, tout cela conférait à Babylone la réputation d’une ville à la fois fascinante et sulfureuse.
Hérodote raconte qu’une loi obligeait toutes les femmes à se livrer à la prostitution au moins une fois dans leur vie. Prostitution d’autant mieux considérée que la déesse Ishtar elle-même avait un temple* spécifique où elle était adorée comme patronne et protectrice des prostituées. Ce détail suffit-il à justifier que la Bible* ait fait de Babylone la Grande Prostituée alliée de l’Antéchrist dont parle l’Apocalypse* (Ap 17) ? Certes non, et d’autant moins que les Chaldéens (autre nom des Babyloniens) avaient des règles morales assez strictes. Ce qui ne veut pas dire qu’ils les aient pratiquées. Mais avant d’être un lieu de perversité, la cité était un centre intellectuel et spirituel, et l’un des plus importants de l’époque. Les cerveaux qu’elle rassemblait formaient une véritable encyclopédie vivante d’à peu près toutes les connaissances du temps. On y trouvait les scribes qui étaient seuls à savoir manier l’écriture très complexe inventée par les Sumériens plus de trois mille ans auparavant, les lettrés tenant le registre des lois, des savoirs et des échanges commerciaux, les savants astrologues et astronomes, les prêtres-médecins qui traitaient les malades à la fois par la magie et par la pharmacopée (ils disposaient d’environ cinq cents remèdes), voire par la chirurgie.
Babylone battait aussi des records dans le domaine religieux : ses temples, chapelles et autels dédiés à une multitude de dieux, se comptaient par centaines, même si le clergé avait fait de Mardouk le dieu majeur de la cité, le souverain de tous les autres divinités. C’était bien la ville du paganisme triomphant.
Or Jean Bottéro, qui fut l’un des grands spécialistes des religions sémitiques, affirme, et il n’est pas le seul, que « c’est là qu’ont puisé les Israélites auteurs de la Bible… ».
En – 586, après un siège de dix-huit mois, Jérusalem* tombe en effet aux mains de Nabuchodonosor II. La ville mise à sac, le Temple pillé et incendié, le roi de Juda, Sédécias, choisit alors la fuite. Mais il est repris dans les environs de Jéricho et ramené devant Nabuchodonosor. Lequel, après avoir forcé Sédécias à assister à la mise à mort de ses fils, lui crève les yeux et l’emmène en exil* à Babylone. Avec le souverain mutilé sont également déportées les élites du royaume : dix mille notables et leur famille, ce n’est pas rien ! Ne restent dans le royaume de Juda, avec pour horizon les ruines longtemps fumantes de Jérusalem, que quelques modestes cultivateurs, vignerons et petits artisans.
On se fait souvent une idée fausse de cet exil. Le (très long) séjour des Israélites en Mésopotamie ne fut pas aussi calamiteux qu’ils le redoutaient, du moins pour ceux qui firent contre mauvaise fortune bon cœur et mirent en pratique les paroles du prophète Jérémie : « Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez leurs fruits… Cherchez la paix de la ville où je vous ai fait déporter, et priez Yahvé pour elle, car sa paix sera votre paix » (Jr 29, 5-7).
Les jardins* préconisés par Jérémie ne sont pas les illustres jardins suspendus de Babylone, chef-d’œuvre botanique et architectural que Nabuchodonosor II aurait fait aménager pour rappeler à son épouse Amytis, fille du roi des Mèdes, la végétation des montagnes de son pays d’origine. Certes, les dates concordent, et les prisonniers juifs auraient pu apporter la compétence et la main-d’œuvre nécessaires à une pareille entreprise. Mais aucun historien ni voyageur dignes de confiance – pas même Hérodote – n’a rapporté avoir vu ces jardins qui ne devaient pourtant pas passer inaperçus puisqu’ils constituaient une des sept merveilles du monde. Réputés présenter plusieurs étages en terrasses, de larges voûtes et de forts piliers en brique, accessibles grâce à un monumental escalier de marbre, ils auraient dû laisser des vestiges plus concluants que ceux découverts lors des fouilles. Les archéologues ont tendance à penser que ces jardins ont existé, mais qu’ils se situaient plutôt à Ninive (aujourd’hui Mosul).
Les « déportés » s’installèrent donc dans leur nouvelle vie, s’intégrant du mieux qu’ils pouvaient – et ce mieux dépassa souvent leurs espérances : des tablettes font état de familles juives s’enrichissant de façon spectaculaire à la suite d’affaires rondement menées. Pour nombre d’exilés, le cauchemar fut un beau rêve.
Pourtant le véritable trésor de Babylone, ce n’était pas son or : c’étaient ses légendes.
En effet, de plus en plus nombreux sont les historiens biblistes qui, à l’exemple de Finkelstein et de Silberman (voir Archéologie), pensent que les livres les plus fondateurs de la Bible, ceux qui fixent l’Histoire et les lois d’Israël*, ont été révisés et récrits à cette période de grande humiliation, ou peu de temps après, dans un but politique : au milieu de la tourmente qui risquait de faire voler en éclats l’identité nationale, il fallait revisiter les événements passés pour leur donner la grandeur et la cohérence qui aideraient le peuple dérouté (au propre comme au figuré) à comprendre, à déchiffrer, et donc à supporter les désastres présents. Dieu ne pouvant s’être trompé, et encore moins mentir, il fallait faire coïncider la tragique réalité – destruction du Temple et perte de Jérusalem, dispersion, exil, soumission à un roi étranger, situation d’esclavage, etc. – avec la promesse faite à son peuple par l’Éternel.
Pour nourrir leur inspiration, les rédacteurs – ou plus exactement les rewriters – de la Bible ont infusé dans leurs textes des éléments issus des plus beaux mythes babyloniens, tels le Poème de la Création (Enuma Elish) qui raconte comment le dieu Mardouk fit le monde, ou la formidable Épopée de Gilgamesh où l’on trouve la description d’un déluge* dont les analogies avec celui de la Bible sont aveuglantes. Sans oublier tout ce que le récit de la captivité en Égypte* et de l’Exode dans le désert* doit à l’expérience de l’exil à Babylone – cet emprunt expliquerait en tout cas pourquoi on n’a retrouvé, dans le désert du Sinaï, aucune trace des quarante années de campement et d’errance d’une immense troupe estimée à deux millions d’individus…
On reconnaît là la confrontation entre une Bible supposée dire l’Histoire, et qu’on a du mal à croire, et une histoire qui prétend expliquer – mais aussi ébranler, bousculer – la Bible, et qu’on a du mal à aimer. Mais peut-être la Bible doit-elle se lire en vision stéréoscopique : le regard de la raison d’un côté, le regard de la foi de l’autre. Alors, et alors seulement, se révèle tout son relief.
Comme le rappelle Claude Lévi-Strauss dans sa réflexion sur les mythes et le structuralisme, « ce ne sont pas les vérités* symboliques ou historiques qui donnent aux mythes leur importance, mais ce qu’ils nous dévoilent sur la pensée humaine ».
Porté par le tollé, le tapage, le tumulte d’une ville en ébullition – et de l’ébullition à la révolte, il n’y a pas long –, il fut choisi par les habitants de Jérusalem* pour être gracié à la place de Jésus*, au prétexte que c’était la tradition de libérer un condamné à l’époque de la Pâque. Pour l’historien, le problème est qu’on ne trouve nulle part trace d’un tel usage. Ce qui fait peser l’ombre d’un doute sur l’historicité du sieur Barabbas. À moins que Ponce Pilate n’ait inventé cette prétendue coutume pour se dépêtrer d’une situation où il se sentait mal à l’aise : en offrant au peuple le choix entre Jésus de Nazareth accusé d’être religieusement incorrect, ce dont Pilate n’a que faire, et Jésus Barabbas (oui, ils ont le même prénom) au pedigree chargé de sang, le procurateur romain est sûr de la réponse : les Juifs sauveront le Nazaréen. Soulagement pour Pilate qui a épousé une femme d’origine gauloise, et donc superstitieuse en diable, laquelle l’a prévenu qu’il attirerait le malheur sur lui s’il condamnait à mort l’homme de Nazareth.
Sauf que le peuple, conditionné par des membres du Sanhédrin qui noyautent la foule et l’incitent à perdre Jésus, demande, réclame, exige la grâce de Barabbas.
On ne sait pas vraiment qui fut Barabbas. D’après les évangélistes Marc et Luc, il aurait tué une ou plusieurs personnes lors d’une émeute à laquelle il participait comme résistant juif à l’occupation romaine, ce qui pourrait en partie justifier sa violence. Selon l’apôtre Jean, c’était un bandit.
En fait, dans l’affaire Barabbas, le plus intéressant n’est pas tant l’homme qu’il est que l’homme qu’il va être après. Un très beau roman du prix Nobel suédois Pär Lagerkvist, intitulé sobrement Barabbas, scrute l’avenir du bandit miraculé. Roman qui fit l’admiration d’André Gide (« C’est bien là le tour de force de Lagerkvist, de s’être maintenu sans défaillance sur cette corde raide tendue à travers les Ténèbres, entre le monde réel et le monde de la foi… »), et dont s’inspira Richard Fleischer pour son péplum* éponyme (et plutôt réussi) où Anthony Quinn campe un Barabbas inquiet, indécis, « hanté par la personnalité écrasante de cet homme mort à sa place, note avec beaucoup de pertinence le critique Denis Brusseaux, qui ajoute : Barabbas, c’est l’Homme dans toutes ses contradictions, incapable de choisir entre son matérialisme et son envie, confuse, de croire ».
Ô Barabbas, notre frère…
Mais le vrai, le beau, le grand mystère de Barabbas, c’est son nom : tout incite à penser qu’il s’appelait en réalité Jésus Bar-Abbas, ce qui veut dire Jésus Fils du Père. Ce qui est très précisément le nom sous lequel le Christ aime à se faire reconnaître. Rien que pour cette coïncidence – qui certainement n’en est pas une – il fallait sauver le bandit Barabbas.
Le Paradis*, c’est comme midi : chacun le voit à sa porte. Dans son Dictionnaire amoureux de l’Islam, Malek Chebel rappelle que « le Paradis musulman est une géographie inspirée, presque littéraire, une sorte de promesse infinie. […] Il se définit comme ce jardin large comme le ciel et la terre, […] un éden où coulent les ruisseaux, où les croyants trouveront une eau incorruptible, un lait au goût inaltérable, un vin délicieux, un miel purifié […], des épouses pures appelées houris, et des jeunes gens [appelés] ghilman ». Dans le judaïsme, le Paradis est une notion floue, imprécise. « À l’Éternel ce qui est caché, dit Moïse, à nous et à nos enfants ce qui est dévoilé » (Dt 29, 28). Sous-entendu : s’il existe un paradis, il sera toujours temps de découvrir à quoi il ressemble quand nous en pousserons la porte. Ce qui n’empêche pas certains de s’en faire déjà une petite idée où le délicieux humour juif donne toute sa mesure : « Une tradition, raconte le rabbin Philippe Haddad, décrit le Paradis juif : une maison de bois vétuste, des meubles usés, des ustensiles vieillis, un étudiant penché sur un livre. Quelle différence avec ce monde-ci ? Au Paradis, l’homme comprend enfin ce qu’il lit… ! »
Le chrétien, lui aussi, doit apparemment se contenter de rêver. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », dit Jésus* (Jn 14, 2) sans détailler davantage, laissant entendre qu’il pourrait s’agir d’un Paradis à la (dé)mesure de chacun, où l’élu jouira de la plénitude d’être et d’aimer qui pourra le mieux dilater son âme et la faire jubiler.
Pour moi, le Paradis a pourtant déjà son ambassade, sa chancellerie sur la terre : une colline de Galilée*, entre Capharnaüm et Tabgha, sur la rive nord du lac de Tibériade. On l’appelle le « mont des Béatitudes ». Ce n’est pas l’endroit le plus éblouissant des terres bibliques, même si la nature y déploie cette luxuriance policée, cette trichromie propre aux paysages galiléens, verts profonds et vernissés, gris en camaïeux argentés, ocres légers comme ceux qui poudrent les ailes de certains papillons, la lumière y est très belle, avec quelque chose de bleuté dû sans doute à sa réflexion sur les eaux du lac en forme de lyre – je ne suis pas sûr d’apprécier autant l’église octogonale, basalte noir et calcaire blanc, qu’on y a dressée. Mais c’est là que Jésus a prononcé les Béatitudes. Et celles-ci ont quelque chose du Paradis, quelque chose d’indicible qui fait battre le cœur, et qui mouille les yeux, car elles sont la réponse aux aspirations de l’homme à la fois les plus essentielles et les plus utopiques, les plus simples et les plus impossibles à combler. Elles sont le catalogue exact de nos vraies faims, de nos vraies soifs. Si elles ne sont pas le Paradis, elles en sont peut-être la description apéritive la plus juste qui en ait été donnée :
« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, car ils posséderont la terre,
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira faussement contre vous toute sorte d’infamie à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. »
Si j’avais vécu au temps du Christ, c’est à Capharnaüm que j’aurais installé mes pénates – et j’aurais eu pour voisin Jésus* lui-même, qui fit de cette bourgade le cœur du rayonnement de sa vie publique.
Habiter un port me semble en effet le comble du bien-être terrestre. Même si Capharnaüm n’était alors qu’un modeste havre aux tristounettes maisons de basalte noir, niché au bord d’une prétendue « mer » de Galilée* qui n’était en réalité que le lac de Tibériade, on devait y trouver ce pittoresque grouillement des ports, les enivrantes (pour moi, en tout cas) senteurs du goudron, du bois, du chanvre mouillé, des poissons séchant au soleil.
À défaut de Capharnaüm, j’aurais opté pour Bethléem. Contrairement à celles de Capharnaüm, ses maisons étaient blanches, faites d’une pierre locale qui devenait éblouissante sous le soleil de Judée. Jolie petite ville en vérité, que la Bethléem de l’an zéro et des poussières. Nullement effarouchée par le désert* de Juda campant à sa porte, la bourgade, perchée à 800 mètres d’altitude, jouissait d’une fertilité surprenante. Encouragés par un climat délicieux, oliviers et figuiers* colonisaient la moindre échancrure entre deux murets pierreux, tandis que les vignes épousaient les plis et replis des vallons.
Est-ce à cause de la douceur du climat sur les collines de Bethléem qu’on y cultivait aussi de bien belles histoires ? L’une d’elles est celle de Ruth, la Moabite. Elle est relatée en quelques pages dans le Livre de Ruth, un de ces jolis textes brefs et incisifs comme des nouvelles – ainsi en est-il du Livre d’Esther* ou de ce chef-d’œuvre qu’est le Cantique des Cantiques* – qui aèrent la Bible* entre les « blockbusters » que sont le Livre de Job*, d’Isaïe ou d’Ézéchiel.
« Au temps du gouvernement des juges, la famine s’étant abattue sur la terre d’Israël, un homme de Bethléem émigra au pays de Moab, accompagné de sa femme et de ses deux fils. La femme [s’appelait] Noémi » (Rt 1, 1-2).
Élimélec, mari de Noémi, mourut. La veuve resta avec ses deux fils, qui épousèrent des femmes moabites. L’une se nommait Orpa, et l’autre Ruth. Au bout d’une dizaine d’années, les fils moururent à leur tour. Plus rien ne la retenant au pays de Moab, Noémi décida de rendre leur pleine liberté à ses brus et de s’en retourner à Bethléem. Orpa sanglota à l’idée de devoir quitter sa belle-mère, mais elle finit par y consentir. Ruth, quant à elle, refusa absolument de se séparer de Noémi : « Où tu iras [lui dit-elle], j’irai. Où tu passeras la nuit, je veux passer la nuit. Désormais, ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Je veux mourir où tu mourras, et y être ensevelie avec toi » (Rt 1, 16-17).
Les deux femmes reprirent la route de la Judée en direction de Bethléem, où elles arrivèrent au début de la moisson des orges. Les deux pauvres veuves n’ayant même plus de quoi manger, Ruth se résigna à aller dans les orges cueillir les épis oubliés par les moissonneurs. Le hasard voulut qu’elle se trouvât un jour à glaner dans un champ qui appartenait à un homme du nom de Booz, lequel était apparenté au défunt mari de Noémi. Ce Booz était ce qu’on appelle un type bien : ayant remarqué cette jolie femme courbée vers la terre sous le soleil de feu, œuvrant sans repos à récolter les quelques grains que les moissonneurs et les oiseaux négligeaient, Booz s’enquit de savoir qui elle était. Ayant appris la fidélité dont elle faisait preuve envers Noémi, et comment elle avait quitté sa famille et sa terre natale pour un pays et un Dieu inconnus, il ordonna à ses serviteurs non seulement de ne pas chasser Ruth, mais de laisser tomber derrière eux de pleines poignées d’épis afin qu’elle puisse en ramasser à satiété.
Lorsque le temps de la moisson fut échu, Noémi dit à Ruth de se coiffer, de se parfumer, de s’envelopper de son manteau et de s’enfoncer dans la nuit jusqu’à trouver Booz endormi près d’un tas d’orge qu’il aurait vanné : « Alors, petite Ruth, tu ôteras ton vêtement et tu te coucheras près de lui… »
La fin de l’histoire est un conte de fées : se réveillant et découvrant la si docile et si ravissante Ruth endormie tout contre ses pieds pour les lui réchauffer (les nuits sont parfois très fraîches à 800 mètres d’altitude, et l’Éternel, qui veille à tout, avait dû faire en sorte que cette nuit-ci fût particulièrement froide), Booz décida de la prendre pour épouse. Et comme dans les contes, ils vécurent heureux longtemps et eurent, sinon beaucoup d’enfants, au moins un garçon, Obed, qui fut le père de Jessé, qui lui-même fut rien de moins que le père de David*…
Être la ville natale de David, ce prophète et roi dont le nom apparaît plus de mille fois dans la Bible, ce n’est déjà pas si mal pour un quasi-village, et Bethléem aurait pu en rester là. Mais la bourgade s’appelait aussi Ephrata, ce qui veut dire la féconde, et elle allait justifier (ô combien !) son toponyme associé.
À la fin du VIIIe siècle avant notre ère, Michée, un prophète issu de la classe paysanne, avait clairement désigné Bethléem comme le berceau du futur Messie : « Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours de l’éternité » (Mi 5, 1).
Bethléem – Beit Lehem – signifie maison du pain. Mais de là à prétendre nourrir l’espérance des hommes à travers les siècles des siècles en se posant comme la ville d’où se lèverait le Messie, l’Oint de Yahvé*, celui à travers qui l’Éternel exercerait son autorité, le vainqueur ultime du combat du Bien et du Mal, il y avait un pas. Ou plutôt, autant de pas que nécessaire pour couvrir les cent treize kilomètres séparant Nazareth de Bethléem.
La lumineuse et douce histoire est connue, mais d’aucuns – et j’en suis – ne se lassent pas de l’entendre répéter : « Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l’époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville ; Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David qui s’appelle Bethléem en Judée, parce qu’il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva ; elle accoucha de son fils premier-né, l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire… » (Lc 2, 1-5).
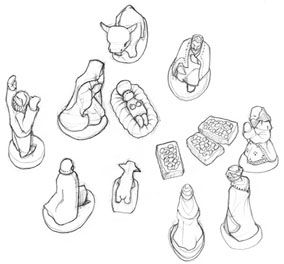
J’ai été longtemps sans m’intéresser à ce gouverneur Quirinius. J’avais tort. Dans ses Antiquités judaïques, l’historien Flavius Josèphe (37-100) écrit : « Quirinius vint aussi dans la Judée, puisqu’elle était annexée à la Syrie, pour recenser les fortunes. […] Après avoir liquidé les biens […] et terminé le recensement, ce qui eut lieu la trente-septième année après la défaite d’Antoine par César à Actium… » Cette double évocation du recensement de Publius Sulpicius Quirinius et de la bataille d’Actium – terrible combat entre plus de cinq cents navires, qui, le 2 septembre de l’an 31 de notre ère, opposa la flotte d’Octave, fils adoptif de César, à celle de Marc Antoine et Cléopâtre – est à la fois précise et précieuse. Car si le recensement de Quirinius, dont Luc affirme qu’il a parfaitement coïncidé avec la naissance du Sauveur, a eu lieu trente-sept ans après Actium, alors le Christ est né en l’an 6 ou 7… après Jésus-Christ ! Bien sûr, Luc a pu se tromper. Mais il est difficile d’imaginer une erreur de cette importance – et plus difficile encore d’admettre qu’elle n’ait pas été repérée, relevée, claironnée haut et fort par les innombrables adversaires du christianisme naissant, et donc rapidement corrigée par les copistes des premiers exemplaires de l’Évangile lucanien.
Mais si Luc est dans le vrai en précisant que Jésus est né pendant le recensement de Quirinius, et si Flavius Josèphe a raison de situer ce recensement trente-sept ans après Actium, comment expliquer que l’année zéro de l’apôtre soit l’année 6 ou 7 de l’historien ? Les explications le plus souvent avancées sont qu’il aurait pu y avoir deux recensements, l’un concernant la province de Syrie et l’autre la Judée, ou que Quirinius aurait à deux reprises gouverné la Syrie (et la Judée) comme Legatus Augusti pro praetore…
Au fond, qu’importe ? Cette petite obscurité-là n’est rien à côté du vertigineux et tendre mystère de la Nativité.
Le 29 mars 1894, Pierre Loti*, parti pérégriner en Terre sainte à la recherche de la foi de sa jeunesse, parvient en vue de Bethléem : « Oh ! Bethléem, s’écrie-t-il, il y a une telle magie autour de ce nom que nos yeux se voilent. Je retiens mon cheval parce que je pleure en contemplant l’apparition soudaine, attirante comme une suprême patrie… » Mais plus il approche, et plus il éprouve l’impression « d’une rafale de grêle chassant de son âme un monde de rêves longuement caressés » : Bethléem, sa grotte matricielle, sa crèche adorable, c’est donc cette ville bruyante, malodorante, indifférente, plus acharnée à commercer qu’à prier ? Non seulement Bethléem n’apporte aucune réponse à sa quête – « oh ! nul ne m’entend, nul ne me voit ! » – mais il en repart plus désenchanté que jamais. La certitude atroce du ciel* vide, de la mort débouchant sur le néant, le brûle comme un acide.
Aujourd’hui encore, aujourd’hui surtout, le « syndrome de Loti » guette le visiteur de Bethléem. Ce n’est décidément pas une ville pour Peter Pan : la ville de l’Enfant n’est pas faite pour les âmes aux nostalgies d’enfances. Il faut en effet lâcher tous les chiens de l’imagination pour coudre, fût-ce à très lâches sutures, la ville au songe qu’on s’en faisait. Ce n’est pas dans l’architecture lourde et solennelle des lieux de dévotion que l’on retrouvera la grotte sainte des cartes postales, les odeurs piquantes de la paille, du suint, des laitages, la caverne tout embuée par les haleines de l’âne et du bœuf, le sourire bouleversant de la Vierge encore dolente, déjà reine. On le sait, pourtant : les boutiques de Bethléem ont beau aligner des santons en bois d’olivier, des mangeoires de poupée garnies de real straw from Bethléem, la crèche n’est pas d’ici – elle est de Greccio, sur les pentes du mont Lacerone, dans les Appenins, « inventée » là-bas en 1223 par saint François d’Assise qui, pour rappeler la naissance de l’Enfant à Bethléem, avait eu cette inspiration touchante d’en reconstituer la scène dans une grotte de la montagne, utilisant les villageois de Greccio pour interpréter les personnages de la Nativité.
Gavée d’enfants, hantée d’hommes en armes – et quelquefois leurs visages, qui autrement pourraient être très beaux, sont masqués par une cagoule –, parcourue comme à petits frissons par des femmes inquiètes, mais d’autant plus braves et aimantes, taguée de mots de haine et d’amour, défigurée, déchirée, partagée, et que je te tire à hue, et que je te tire à dia, et que finalement je te tire en plein cœur – oh ! ma Bethléem des humiliés, des foudroyés…
Ainsi donc, le berceau du Christ serait devenu cette grande prison surpeuplée ? N’empêche, quand le vent ne lève pas trop l’odeur recuite des bennes à ordures, la prison continue de sentir rudement bon le citron vert, la figue chaude, les pêches, les falafels, l’hummous, les poulets grillés et le shawarma…
D’après le père Guth, vieux protestant suisse-allemand qui l’habita jusqu’à sa mort, la maison faisant face à notre demeure familiale, juste de l’autre côté de la rue, avait été un relais de poste. Et pas n’importe lequel : s’y arrêta Charlotte Corday, en route pour Paris où elle devait rencontrer Marat dans les circonstances « piquantes » que l’on sait ; et, de fait, j’ai pu voir le registre dudit relais, sur lequel il était inscrit qu’un carafon de vin rouge avait été porté au débit de la belle assassine. Toujours selon le père Guth, une autre particularité de cette maison était la présence d’un trésor dissimulé quelque part dans ses murs.
Ni le fantôme de la petite Charlotte, ni le spectre d’un trésor n’influèrent sur la décision que prit mon père, à la mort de monsieur Guth, d’acheter la maison de ce dernier – laquelle lui parut simplement un prolongement idéal de la propriété familiale.
Toutefois, l’hypothèse du passage de la demoiselle Corday dans notre village s’étant révélée historiquement fondée, mon père ne tarda pas à se demander si, par extraordinaire, l’histoire du trésor n’aurait pas, elle aussi, quelque chance d’être authentique. Alors, avant que les corps de métier ne prissent possession de la maison pour une révision complète, il en scruta les planchers, sonda les murs, ausculta les conduits de cheminée, rasa clapier et poulailler, retourna le potager, etc. Mais au lieu du trésor espéré, ce grand chambardement n’apporta que des désillusions : une source glougloutait sous le parquet du salon, la cheminée principale était lézardée, les murs gorgés de salpêtre, et les poutres rongées à cœur par des générations de termites.
La guérison de la maison prit beaucoup plus de temps – et d’argent – que prévu. Ah ! soupirait mon père, quel dommage que le trésor du brave père Guth n’ait existé que dans son imagination ! Un jour, pourtant, notre attention fut attirée par une étroite fenêtre qui s’ouvrait tout en haut du mur pignon. Elle n’avait rien de remarquable, sinon qu’elle ne correspondait à aucune pièce connue de la maison. Si haut perchée, elle ne pouvait éclairer qu’une mansarde ou un petit grenier dont, pour une raison ou pour une autre, l’accès avait été muré. Nous en déduisîmes que cette pièce condamnée ne pouvait être que la chambre où était entreposé le trésor du père Guth…
Il fut décidé d’investir séance tenante dans l’achat d’une échelle assez haute pour grimper jusqu’à la fenêtre (seul moyen d’y accéder), d’un diamant de vitrier pour découper le carreau (le seul mot de diamant nous mettant l’eau à la bouche) et d’une poulie pour redescendre notre butin.
Il ne restait plus qu’à attendre le mitan d’une nuit sans lune, car nous jugions plus prudent d’extraire notre trésor sans le claironner urbi et orbi.
Missionné pour être le premier à escalader l’échelle et à jeter un coup d’œil à l’intérieur, j’attendis que les ténèbres complices recouvrent la terre (ou du moins cette partie d’icelle qui s’appelait encore la Seine-et-Oise), et je m’élevai fébrilement le long du mur pignon. Arrivé là-haut, je braquai ma lampe torche à travers le carreau. Bien qu’assourdi par les innombrables toiles d’araignées qui s’étaient accumulées contre le vitrage, le rayon lumineux révéla, sur le plancher fait de grosses planches engluées de déjections d’oiseaux, la présence d’un objet qui semblait échappé d’un rêve de petit garçon nourri de romans d’aventures : un coffre en bois sombre, clouté, au couvercle bombé, muni de trois imposantes serrures frontales.
— Hourra, criai-je, trésor en vue !
— Moins fort, rugit mon père, tu vas ameuter tout le village. Ça a l’air de quoi, ce trésor ?
— D’un coffre bourré de doublons, papa. Ou de pierres précieuses. Ou peut-être les deux.
Bien entendu, manié par moi, le diamant refusa de découper la vitre (ce qui nous renforça, mon père et moi, dans l’idée qu’un trésor aussi bien protégé devait être vraiment magnifique) et je dus briser le carreau à coups de pied. Après quoi, sous le regard réprobateur de quelques oiseaux nichés dans les anfractuosités de la charpente, je me frayai un chemin à travers les toiles d’araignées jusqu’à tomber à genoux devant le coffre – car il méritait bien qu’on s’agenouillât devant lui, ce bougre-là : il était vraiment énorme, et surtout si lourd que je ne réussis même pas à le soulever.
— Je vois ce que c’est, devina mon père, il n’y a là-dedans ni doublons ni bijoux, mais des lingots d’or. Remarque, je préfère : c’est plus facile à négocier.
Devant l’impossibilité de faire descendre le coffre par le moyen de la poulie, je résolus de l’ouvrir sur place. Je riais tout seul à l’idée que j’allais ensuite devoir, au sens propre du mot, jeter tout cet or par la fenêtre…
Dévorées par la rouille, les trois serrures ne résistèrent pas aux coups de burin que je leur infligeai. Et je pus alors soulever le couvercle bombé et contempler enfin le légendaire magot du père Guth : il consistait en une centaine de grosses bibles protestantes, toutes en allemand, que le coffre en bois avait protégées des attaques des rongeurs.
Un inestimable trésor pour ce luthérien convaincu qu’avait été monsieur Guth. Et il avait raison, l’excellent homme : la Bible est un trésor.
Comme tous les trésors, elle réveille nos instincts comptables. On sait aujourd’hui qu’il fallut environ 50 auteurs travaillant sur près de 1 300 ans pour en rédiger les 1 189 chapitres ; traduite en 2 303 langues et dialectes, on en vend chaque année près de 50 millions à travers le monde – un demi-milliard si l’on tient compte de sa diffusion par extraits. À elle, tous les superlatifs : elle est le livre le plus vendu, le plus lu, le plus répandu à la surface de la terre (bien que d’aucuns prétendent que le catalogue Ikea la surpasse désormais grâce à ses 160 millions d’exemplaires annuels…), le plus offert en cadeau, celui qui a bénéficié du plus grand nombre de traductions*, elle est le plus gros livre commercialisé sous le plus petit volume – l’imprimerie d’Oxford, qui à une époque publiait à elle seule 90 éditions différentes de la Bible, réussit l’exploit d’en fabriquer une, The Mite Bible, dont les 876 pages et 24 gravures hors texte tenaient sur moins de 5 × 3 × 1 centimètres (elle était d’ailleurs vendue avec une loupe de 2 millimètres d’épaisseur, faute de quoi elle eût été à peu près illisible), et dont le poids n’excédait pas 16 grammes ; The Mite Bible est aujourd’hui dépassée : des experts du Technion’s Russel Berrie Nanotechnology Institute ont en effet réussi à transcrire 300 000 mots de la Torah* sur une surface de 0,5 millimètre carré de silicium recouvert d’une couche d’or.
J’ai pu admirer à l’université d’Uppsala, en Suède, une des plus précieuses bibles qui soient, la célèbre Bible d’Argent, ou Codex Argenteus, qui contient les Évangiles* écrits à l’encre d’argent sur des feuilles d’un parchemin teint avec la pourpre du murex. Comble de raffinement : des lettres d’or enluminent les trois premières lignes de chaque Évangile. La Bible d’Argent est aussi un trésor linguistique : traduite au VIe siècle d’une bible établie par l’évêque Wulfila (311-383), elle est rédigée en langue gothe, la plus ancienne des langues germaniques, disparue au VIIe siècle.
Si les bibles de monsieur Guth ne méritaient évidemment pas d’être conservées dans une université, on ne savait pas trop quel sort leur réserver. Mon père ne croyait pas en Dieu, mais il avait cru très fort au trésor de monsieur Guth ; à cause de ces minutes de foi et d’espérance (eh bien, oui, c’est ce qu’il avait éprouvé tandis que je lui criais mes « hourra ! »), il ne pouvait se retenir d’éprouver une sorte de respect pour ces volumes noirâtres qui exhalaient, quand on les ouvrait, des remugles de papier humide, de vieux cuir, de chandelle de suif. Il finit par les porter à un marchand de livres anciens qui les lui acheta au poids. Il m’est arrivé une ou deux fois de retrouver une de ces bibles chez un bouquiniste des quais de la Seine. Me remonte alors en mémoire le souvenir épatant de la nuit de Seine-et-Oise, cette nuit sans lune qui avait fait de moi un émule du jeune Jim Hawkins découvrant, dans le coffre du pirate Billy Bones, la carte indiquant la cachette du trésor du capitaine Flint. Parce que ma bible à moi, en ce temps-là, c’était L’Île au trésor de Stevenson…
Cette bible-là sent le maïs grillé, le T-bone steack, la sauce barbecue, le cheese-cake et le café (très, très) allongé. Bible belt, « ceinture biblique », est une appellation datant des années 1920, et dont on attribue l’invention au journaliste satirique H. L. Mencken. Initialement donnée au Sud et aux plaines du Middle West tenus pour être les champions du fondamentalisme protestant, la formule s’est élargie à l’ensemble du monde rural conservateur.
La Bible* a été, et continue d’être, la référence d’une part importante de la société américaine, et de la quasi-totalité des rednecks (les « cous rouges », surnom donné aux fermiers et assimilés). Et ça ne date pas d’hier, comme pourraient le confirmer, si l’Éternel n’avait pas limité leur vocabulaire aux gloussements, les quelque 45 millions de ces autres « cous rouges » que sont les dindes que l’on rôtit chaque année pour célébrer le Thanksgiving Day, jour où l’on remercie le Seigneur d’avoir protégé les Puritains débarqués en 1620 dans la baie de Cape Cod.
Ces protestants très pieux (cent deux hommes, femmes et enfants, entassés à bord du Mayflower, un navire de moins de trente mètres de long !) qui affrontèrent les périls d’une traversée de l’Atlantique pour échapper à l’intransigeance religieuse du roi d’Angleterre Jacques Ier, voyaient dans leur périple une réplique de l’Exode biblique. Dans les premières colonies qu’ils établirent sur les terres encore vierges du futur Massachusetts, il n’y avait d’ailleurs que la Bible pour code légal. Et des siècles après la traversée du Mayflower, les nouveaux immigrants gardaient encore la conviction qu’ils vivaient une épopée comparable à celle des Hébreux marchant vers la Terre promise. Michel Tournier le montre parfaitement dans son roman Éléazar, la source et le buisson, qui décrit l’exode d’un pasteur et de sa famille fuyant l’Irlande affamée (l’action se passe en 1845, lors de la crise de la pomme de terre) pour gagner la Californie : Éléazar trouve le sens de sa vie lorsqu’il comprend que son destin est comparable à celui de Moïse*. Pétris de biblisme, lui et les siens ne peuvent que se sentir en osmose avec cette Amérique dont, dix ans plus tôt, Tocqueville notait que « les références à la Bible [font] partie du langage courant dans toutes les classes de la société ».
Le coton (du Sud) et le maïs (du Middle West) ne sont donc pas seuls à s’épanouir dans la Bible belt : on y cultive aussi, et sous forme de culture intensive, l’alliance avec Dieu telle qu’elle figure dans la devise des États-Unis : In God we trust, c’est-à-dire : en Dieu nous mettons notre confiance, ce qui est le fondement même du judaïsme et le leitmotiv de la Bible.
Le premier projet de sceau officiel de la jeune Amérique (soutenu notamment par Benjamin Franklin) représentait les Hébreux traversant la mer Rouge avec l’affirmation que « la résistance aux tyrans est une obéissance à Dieu ». Si grand était l’engouement pour tout ce qui était hébraïque que des membres du Congrès allèrent jusqu’à proposer l’interdiction pure et simple de l’anglais et son remplacement par l’hébreu. La motion échoua, ce qui n’empêcha pas que des cours dispensés dans des universités parmi les plus réputées (Yale, Princeton, Columbia, etc.) fussent donnés en hébreu*, de même que c’est aussi l’hébreu que choisissaient certains étudiants* pour prononcer leur allocution de fin d’études.

Ici, dans la « ceinture », il fait bible comme ailleurs il fait beau. Pour le redneck d’aujourd’hui, le cliquetis de sa vieille éolienne à ailettes évoque irrésistiblement le bruit de castagnettes des branches de palmiers de Terre sainte, les nuées de poussière (dust bowls) capables d’ensevelir de vastes territoires agricoles font penser aux vents de sable du Néguev, les granges qui pointent au-dessus des maïs ont la blancheur mate et sèche des petites maisons nazaréennes, et le panneau décoloré par le jeu des pluies et du soleil, qui accueille le voyageur à l’orée de tel ou tel village du Tennessee ou de Pennsylvanie, ne fait pas la réclame pour une marque de bière mais pour les Dix Commandements – en commençant d’ailleurs curieusement par « D’adultère tu ne commettras point ».
Quelques fausses notes viennent évidemment troubler le cantique de la Bible belt. La pire étant que le Texas, qui s’enorgueillit d’être une des plus authentiques « boucles » de la « ceinture biblique », soit aussi l’État le plus acharné à prononcer et à appliquer la peine de mort.
Si l’Esprit de Dieu visite la Belt, je doute que ce soit pour assister à l’exécution d’un condamné qui va mourir les bras en croix (pas de clous dans les poignets, mais les aiguilles d’une perfusion létale dans chaque bras – ce que l’homme appelle s’améliorer…), ou à l’élection d’une Miss Bible belt choisie chaque année parmi les plus jolies des demoiselles rednecks – non, je l’imagine plutôt planant au-dessus de ces champs de maïs où les fermiers tracent d’immenses labyrinthes reproduisant, sur de vastes surfaces de cinq à dix hectares, les visages de Barack Obama, d’Oprah Winfrey, de John Wayne, ou la bouille de Charlie Brown, ou la silhouette de Muhammad Ali en train de boxer.
Tout cela n’est visible que du ciel* – par Dieu, donc, par ses anges* et par ses saints, et accessoirement par les pilotes qui, à bord de leurs vieux biplans, épandent des pesticides sur la Bible belt.
De même que Satan* a ses Évangiles du Diable, publiés en 1964 par l’écrivain et folkloriste Claude Seignolle qui avait pour ce faire dressé le catalogue des faits et gestes du Malin dans la France paysanne, le Diable a sa Bible*. Elle date du XIIIe siècle, et il n’en existe qu’un seul exemplaire – mais quel exemplaire ! Également connu sous le nom de Codex Gigas, son manuscrit, l’un des plus grands du monde, mesure 92 × 50 × 22 centimètres, et pèse 75 kilos. La fabrication de ses 312 feuilles de parchemin (soit 624 pages) a requis l’emploi de 160 peaux d’ânes. Au Moyen Âge, on n’hésitait pas à comparer la Bible du Diable aux sept merveilles du monde.
Si Seignolle consacra vingt-cinq ans de sa vie à recenser pour ses Évangiles du Diable des milliers de récits démoniaques appartenant au fonds inépuisable du folklore français, l’énorme Bible du Diable, qui contient – entre autres – plusieurs ouvrages dont la Vulgate (la Bible en latin), les Antiquités judaïques de Flavius Josèphe et des traités savants et ésotériques, aurait, elle, été écrite, enluminée, illustrée en une seule nuit…
Son copiste était un moine du monastère bénédictin de Podlažice, en Bohême. Ayant gravement manqué à la Règle, le religieux avait été condamné à être emmuré vivant. Pour échapper à cette mort atroce, il s’était engagé à composer, en l’espace d’une seule nuit, un livre tout à la gloire de son monastère, qui recenserait toutes les connaissances des hommes. Mais au milieu de la nuit, il lui apparut clairement qu’il ne viendrait jamais à bout d’un tel challenge. Du moins, pas tout seul. Il proposa alors au Diable de lui vendre son âme en échange d’un sérieux coup de main. Satan accepta le marché, et, avant qu’il fît jour, il avait achevé de calligraphier l’énorme ouvrage. Éperdu de soulagement (même s’il était assuré désormais d’aller en enfer), le moine tint à manifester sa gratitude envers Satan en dessinant et en enluminant le portrait de celui-ci sur une page entière, et en l’incluant dans cette Bible à laquelle le Prince des Ténèbres avait si bien collaboré. C’est à cette image satanique que la Bible de Podlažice doit son appellation de Bible du Diable. Sa présence dans le livre saint n’a jamais pu être expliquée autrement…
Biblia pauperum (Bible des pauvres)
Il existe aujourd’hui des bibles low cost. « La Bible* pour le prix d’un café ! » proclame la Société biblique de Genève qui vend la sienne dans les grandes surfaces pour 1,50 euro.
Autrefois, une bible était un objet qui, selon la façon dont elle était imprimée, illustrée, et surtout reliée, pouvait en dire long sur le rang social et la piété de celui qui la possédait. Doit-on en déduire que la fameuse Biblia pauperum – Bible des pauvres –, apparue à la fin du Moyen Âge, fut une bible au rabais ? Certes non, même si son impression présentait un aspect plutôt fruste – on gravait texte et illustrations sur un bloc de bois, on badigeonnait d’encre, et on appuyait là-dessus une feuille de papier. Système basique, qui coûtait évidemment moins cher que l’impression avec des caractères en plomb mise au point par Gutenberg.
En fait, ce qui démarquait la Bible des pauvres des autres bibles, c’était d’abord son concept. Pour un ouvrage du XVe siècle, elle était en effet furieusement originale : écrite le plus souvent en langue vernaculaire, elle comportait au moins autant (sinon davantage) d’illustrations que de texte, ce dernier pouvant être condensé en quelques mots qui sortaient de la bouche des personnages de l’illustration, exactement comme les « bulles » d’une BD. Tout cela parce qu’elle se voulait un ouvrage d’enseignement avant que d’être un livre de dévotion : ses nombreuses images* particulièrement « parlantes » étaient en effet destinées à aider ceux qui ne savaient pas lire à comprendre néanmoins les grandes lignes de l’Histoire sainte*.
Les pauvres auxquels s’adressait la Biblia pauperum n’étaient donc pas ceux qui n’étaient pas assez fortunés pour acquérir une bible, mais ceux qui n’avaient pas reçu assez d’instruction pour la lire. Les analphabètes ne sont pas tout à fait les pauvres en esprit auxquels les Béatitudes* promettent le Royaume des Cieux, mais ils s’en approchent…
Je n’en suis pas à imaginer, sous le clapotis des vaguelettes léchant la Cad’Oro, le grincement de la vis en bois d’une antique presse à bras, ni à traquer, derrière le subtil parfum des glycines frôlant les eaux du Grand Canal, la réminiscence de l’odeur de lin et de suie d’épineux des anciennes encres grasses. Mais le fait est : une de mes innombrables raisons d’aimer (que dis-je, aimer ! le mot juste est adorer) Venise, c’est l’imprimerie.
Non seulement c’est à Venise que les frères Wendelin de Spire, puis le Français Nicolas Jenson, mirent au point le caractère romain pour remplacer le gothique que sa rigidité et sa compression rendaient difficile à lire, mais c’est aussi sur la lagune vénitienne qu’Alde Manuce, le prince des typographes, inventa l’italique.
Et puis encore, la Sérénissime fut la capitale du livre hébraïque imprimé.
Natif d’Anvers, un chrétien, Daniel Bomberg, débarqua à Venise en 1515 pour y assouvir sa double passion de l’imprimerie et de l’hébreu* – qu’il avait appris tout seul. Il se fit appeler Daniel « ben Corniel » Bomberg et installa ses presses à bras (le modèle Gutenberg, inspiré des pressoirs des vignerons) dans le Ghetto. Car c’était l’époque où le Sénat de Venise avait décidé de confiner les Juifs dans le quartier de Cannaregio. Le Ghetto, dont toutes les fenêtres donnant sur la Venise extérieure avaient été aveuglées, était fermé la nuit. Le jour, les Juifs étaient libres d’en sortir à condition d’arborer une rouelle (petite roue) jaune cousue sur la poitrine, rappel des trente deniers qu’avait reçus Judas* pour livrer le Christ, ou de coiffer un chapeau, jaune lui aussi, cette couleur étant alors celle, infamante, de la folie, du crime, du soufre supposé empuantir les brasiers de l’Enfer. Déroger à cette obligation coûtait cher : une forte amende ou un mois de prison – et on n’était jamais assuré de ressortir indemne des cachots vénitiens particulièrement insalubres.
En dépit de ces brimades, les Juifs de Venise ne s’estimaient pas malheureux. Malgré l’exiguïté du Ghetto, ils disposaient de cinq synagogues pour célébrer leur culte. De plus en plus nombreux (tant par les naissances que par l’afflux de nouveaux arrivants), ils augmentaient leur espace vital en bâtissant désormais les logements les uns sur les autres jusqu’à atteindre sept, huit, voire neuf étages. On a parlé d’un « petit Manhattan du Moyen Âge », mais j’y verrais plutôt une sorte de Babylone* recommencée : les langages se mêlaient, les savoirs se croisaient, s’échangeaient, s’enrichissaient, les kabbalistes le disputaient aux gnostiques, lesquels s’affrontaient avec les alchimistes, eux-mêmes en grand palabre avec les talmudistes, et les ruelles encaissées bruissaient d’histoires merveilleuses, de récits secrets comme au temps de l’Exil* où les Juifs avaient découvert les prodigieuses légendes mésopotamiennes sur la Création* du monde ou le déluge selon Gilgamesh*.
Daniel Bomberg se sentait chez lui dans ce monde juif. Il aimait la langue, la culture, la pensée hébraïques. Fondant ses propres caractères selon la recette de Gutenberg (un alliage de plomb, d’étain et d’antimoine), fabriquant lui-même son papier, il imprima en 1517 une Bible* rabbinique – le texte hébreu au centre de la page, accompagné sur le pourtour de commentaires de rabbins qui en dégageaient et éclairaient le sens – qui fait encore autorité. Trois ans plus tard, il s’attela à la première impression de la version complète du Talmud* de Babylone. Un travail si abouti que toutes les éditions qui se succédèrent depuis ont adopté rigoureusement la même numérotation des pages que celle initiée par Bomberg.
Il faut dire que Daniel ben Corniel Bomberg avait su s’entourer des meilleurs ouvriers imprimeurs du Ghetto. Non seulement parce qu’il les payait bien, mais aussi parce qu’il leur avait obtenu un privilège tenu alors pour exorbitant : sur requête de leur cher patron, ils furent en effet les seuls Juifs à être dispensés d’arborer la rouelle ou le chapeau jaunes…