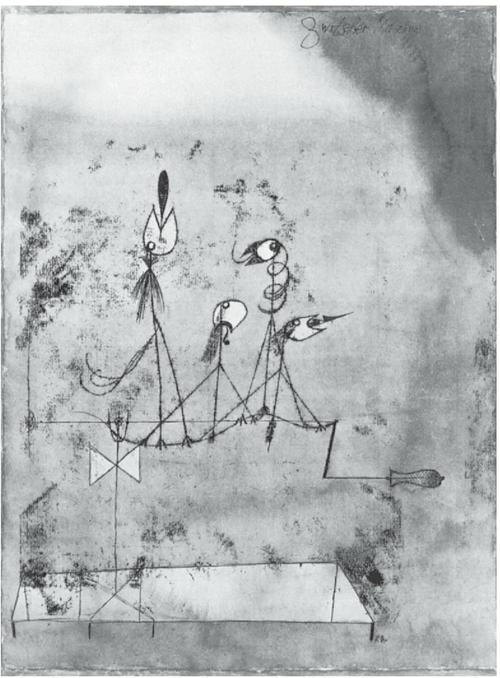
La machine à gazouiller
I. Un enfant dans le noir, saisi par la peur, se rassure en chantonnant. Il marche, s’arrête au gré de sa chanson. Perdu, il s’abrite comme il peut, ou s’oriente tant bien que mal avec sa petite chanson. Celle-ci est comme l’esquisse d’un centre stable et calme, stabilisant et calmant, au sein du chaos. Il se peut que l’enfant saute en même temps qu’il chante, il accélère ou ralentit son allure ; mais c’est déjà la chanson qui est elle-même un saut : elle saute du chaos à un début d’ordre dans le chaos, elle risque aussi de se disloquer à chaque instant. Il y a toujours une sonorité dans le fil d’Ariane. Ou bien le chant d’Orphée.
II. Maintenant, au contraire, on est chez soi. Mais le chez-soi ne préexiste pas : il a fallu tracer un cercle autour du centre fragile et incertain, organiser un espace limité. Beaucoup de composantes très diverses interviennent, repères et marques de toutes sortes. C’était déjà vrai dans le cas précédent. Mais maintenant ce sont des composantes pour l’organisation d’un espace, non plus pour la détermination momentanée d’un centre. Voilà que les forces du chaos sont tenues à l’extérieur autant qu’il est possible, et l’espace intérieur protège les forces germinatives d’une tâche à remplir, d’une œuvre à faire. Il y a là toute une activité de sélection, d’élimination, d’extraction, pour que les forces intimes terrestres, les forces intérieures de la terre, ne soient pas submergées, qu’elles puissent résister, ou même qu’elles puissent emprunter quelque chose au chaos à travers le filtre ou le crible de l’espace tracé. Or les composantes vocales, sonores, sont très importantes : un mur du son, en tout cas un mur dont certaines briques sont sonores. Un enfant chantonne pour recueillir en soi les forces du travail scolaire à fournir. Une ménagère chantonne, ou met la radio, en même temps qu’elle dresse les forces anti-chaos de son ouvrage. Les postes de radio ou de télé sont comme un mur sonore pour chaque foyer, et marquent des territoires (le voisin proteste quand c’est trop fort). Pour des œuvres sublimes comme la fondation d’une ville, ou la fabrication d’un Golem, on trace un cercle, mais surtout on marche autour du cercle comme dans une ronde enfantine, et l’on combine les consonnes et les voyelles rythmées qui correspondent aux forces intérieures de la création comme aux parties différenciées d’un organisme. Une erreur de vitesse, de rythme ou d’harmonie serait catastrophique, puisqu’elle détruirait le créateur et la création en ramenant les forces du chaos.
III. Maintenant enfin, on entrouvre le cercle, on l’ouvre, on laisse entrer quelqu’un, on appelle quelqu’un, ou bien l’on va soi-même au-dehors, on s’élance. On n’ouvre pas le cercle du côté où se pressent les anciennes forces du chaos, mais dans une autre région, créée par le cercle lui-même. Comme si le cercle tendait lui-même à s’ouvrir sur un futur, en fonction des forces en œuvre qu’il abrite. Et cette fois, c’est pour rejoindre des forces de l’avenir, des forces cosmiques. On s’élance, on risque une improvisation. Mais improviser, c’est rejoindre le Monde, ou se confondre avec lui. On sort de chez soi au fil d’une chansonnette. Sur les lignes motrices, gestuelles, sonores qui marquent le parcours coutumier d’un enfant, se greffent ou se mettent à bourgeonner des « lignes d’erre », avec des boucles, des nœuds, des vitesses, des mouvements, des gestes et des sonorités différents1.
Ce ne sont pas trois moments successifs dans une évolution. Ce sont trois aspects sur une seule et même chose, la Ritournelle. On les retrouve dans les contes, de terreur ou de fées, dans les lieder aussi. La ritournelle a les trois aspects, elle les rend simultanés, ou les mélange : tantôt, tantôt, tantôt. Tantôt, le chaos est un immense trou noir, et l’on s’efforce d’y fixer un point fragile comme centre. Tantôt l’on organise autour du point une « allure » (plutôt qu’une forme) calme et stable : le trou noir est devenu un chez-soi. Tantôt on greffe une échappée sur cette allure, hors du trou noir. C’est Paul Klee qui a montré si profondément ces trois aspects, et leur lien. Il dit « point gris », et non trou noir, pour des raisons picturales. Mais justement le point gris est d’abord le chaos non dimensionnel, non localisable, la force du chaos, faisceau embrouillé de lignes aberrantes. Puis le point « saute par-dessus lui-même » et fait rayonner un espace dimensionnel, avec ses couches horizontales, ses coupes verticales, ses lignes coutumières non écrites, toute une force intérieure terrestre (cette force apparaît aussi bien, avec une allure plus déliée, dans l’atmosphère ou dans l’eau). Le point gris (trou noir) a donc sauté d’état, et représente non plus le chaos, mais la demeure ou le chez-soi. Enfin, le point s’élance et sort de lui-même, sous l’action de forces centrifuges errantes qui se déploient jusqu’à la sphère du cosmos : « On exerce un effort par poussées pour décoller de la terre, mais à l’échelon suivant on s’élève réellement au-dessus d’elle (...) sous l’empire de forces centrifuges qui triomphent de la pesanteur2. »
On a souvent souligné le rôle de la ritournelle : elle est territoriale, c’est un agencement territorial. Les chants d’oiseaux : l’oiseau qui chante marque ainsi son territoire... Les modes grecs, les rythmes hindous, sont eux-mêmes territoriaux, provinciaux, régionaux. La ritournelle peut prendre d’autres fonctions, amoureuse, professionnelle ou sociale, liturgique ou cosmique : elle emporte toujours de la terre avec soi, elle a pour concomitant une terre, même spirituelle, elle est en rapport essentiel avec un Natal, un Natif. Un « nome » musical est un petit air, une formule mélodique qui se propose à la reconnaissance, et restera l’assise ou le sol de la polyphonie (cantus firmus). Le nomos comme loi coutumière et non écrite est inséparable d’une distribution d’espace, d’une distribution dans l’espace, par là il est ethos, mais l’ethos est aussi bien la Demeure3. Et tantôt l’on va du chaos à un seuil d’agencement territorial : composantes directionnelles, infra-agencement. Tantôt l’on organise l’agencement : composantes dimensionnelles, intra-agencement. Tantôt l’on sort de l’agencement territorial, vers d’autres agencements, ou encore ailleurs : inter-agencement, composantes de passage ou même de fuite. Et les trois ensemble. Forces du chaos, forces terrestres, forces cosmiques : tout cela s’affronte et concourt dans la ritournelle.
Du chaos naissent les Milieux et les Rythmes. C’est l’affaire des cosmogonies très anciennes. Le chaos n’est pas sans composantes directionnelles, qui sont ses propres extases. Nous avons vu dans une autre occasion comment toutes sortes de milieux glissaient les uns par rapport aux autres, les uns sur les autres, chacun défini par une composante. Chaque milieu est vibratoire, c’est-à-dire un bloc d’espace-temps constitué par la répétition périodique de la composante. Ainsi le vivant a un milieu extérieur qui renvoie aux matériaux ; un milieu intérieur, aux éléments composants et substances composées ; un milieu intermédiaire, aux membranes et limites ; un milieu annexé, aux sources d’énergie, et aux perceptions-actions. Chaque milieu est codé, un code se définissant par la répétition périodique ; mais chaque code est en état perpétuel de transcodage ou de transduction. Le transcodage ou transduction, c’est la manière dont un milieu sert de base à un autre, ou au contraire s’établit sur un autre, se dissipe ou se constitue dans l’autre. Justement la notion de milieu n’est pas unitaire : ce n’est pas seulement le vivant qui passe constamment d’un milieu à un autre, ce sont les milieux qui passent l’un dans l’autre, essentiellement communiquants. Les milieux sont ouverts dans le chaos, qui les menace d’épuisement ou d’intrusion. Mais la riposte des milieux au chaos, c’est le rythme. Ce qu’il y a de commun au chaos et au rythme, c’est l’entre-deux, entre deux milieux, rythme-chaos ou chaosmos : « Entre la nuit et le jour, entre ce qui est construit et ce qui pousse naturellement, entre les mutations de l’inorganique à l’organique, de la plante à l’animal, de l’animal à l’espèce humaine, sans que cette série soit une progression... » C’est dans cet entre-deux que le chaos devient rythme, non pas nécessairement, mais a une chance de le devenir. Le chaos n’est pas le contraire du rythme, c’est plutôt le milieu de tous les milieux. Il y a rythme dès qu’il y a passage transcodé d’un milieu à un autre, communication de milieux, coordination d’espaces-temps hétérogènes. Le tarissement, la mort, l’intrusion prennent des rythmes. On sait bien que le rythme n’est pas mesure ou cadence, même irrégulière : rien de moins rythmé qu’une marche militaire. Le tam-tam n’est pas 1-2, la valse n’est pas 1, 2, 3, la musique n’est pas binaire ou ternaire, mais plutôt 47 temps premiers, comme chez les Turcs. C’est qu’une mesure, régulière ou non, suppose une forme codée dont l’unité mesurante peut varier, mais dans un milieu non communiquant, tandis que le rythme est l’Inégal ou l’Incommensurable, toujours en transcodage. La mesure est dogmatique, mais le rythme est critique, il noue des instants critiques, ou se noue au passage d’un milieu dans un autre. Il n’opère pas dans un espace-temps homogène, mais avec des blocs hétérogènes. Il change de direction. Bachelard a raison de dire que « la liaison des instants vraiment actifs (rythme) est toujours effectuée sur un plan qui diffère du plan où s’exécute l’action4 ». Le rythme n’a jamais le même plan que le rythmé. C’est que l’action se fait dans un milieu, tandis que le rythme se pose entre deux milieux, ou entre deux entre-milieux, comme entre deux eaux, entre deux heures, entre chien et loup, twilight ou zwielicht, Heccéité. Changer de milieu, pris sur le vif, c’est le rythme. Atterrir, amerrir, s’envoler... Par là, on sort facilement d’une aporie qui risquait de ramener la mesure dans le rythme, malgré toutes les déclarations d’intention : en effet, comment peut-on proclamer l’inégalité constituante du rythme, alors qu’on se donne en même temps les vibrations sous-entendues, les répétitions périodiques des composantes ? C’est qu’un milieu existe bien par une répétition périodique, mais celle-ci n’a pas d’autre effet que de produire une différence par laquelle il passe dans un autre milieu. C’est la différence qui est rythmique, et non pas la répétition qui, pourtant, la produit ; mais, du coup, cette répétition productive n’avait rien à voir avec une mesure reproductrice. Telle serait la « solution critique de l’antinomie ».
Il y a un cas particulièrement important de transcodage : c’est lorsqu’un code ne se contente pas de prendre ou recevoir des composantes autrement codées, mais prend ou reçoit des fragments d’un autre code en tant que tel. Le premier cas renverrait au rapport feuille-eau, mais le deuxième au rapport araignée-mouche. On a souvent remarqué que la toile d’araignée impliquait dans le code de cet animal des séquences du code même de la mouche ; on dirait que l’araignée a une mouche dans la tête, un « motif » de mouche, une « ritournelle » de mouche. L’implication peut être réciproque, comme dans la guêpe et l’orchidée, la gueule de loup et le bourdon. J. von Uexküll a fait une admirable théorie de ces transcodages, en découvrant dans les composantes autant de mélodies qui se feraient contrepoint, l’une servant de motif à l’autre et réciproquement : la Nature comme musique5. Chaque fois qu’il y a transcodage, nous pouvons être sûrs qu’il n’y a pas une simple addition, mais constitution d’un nouveau plan comme d’une plus-value. Plan rythmique ou mélodique, plus-value de passage ou de pont, – mais les deux cas ne sont jamais purs, se mélangent en réalité (ainsi le rapport de la feuille, non plus avec l’eau en général, mais avec la pluie...).
Toutefois, nous ne tenons pas encore un Territoire, qui n’est pas un milieu, pas même un milieu de plus, ni un rythme ou passage entre milieux. Le territoire est en fait un acte, qui affecte les milieux et les rythmes, qui les « territorialise ». Le territoire est le produit d’une territorialisation des milieux et des rythmes. Il revient au même de demander quand est-ce que les milieux et les rythmes se territorialisent, ou quelle est la différence entre un animal sans territoire et un animal à territoire. Un territoire emprunte à tous les milieux, il mord sur eux, il les prend à bras le corps (bien qu’il reste fragile aux intrusions). Il est construit avec des aspects ou des portions de milieux. Il comporte en lui-même un milieu extérieur, un milieu intérieur, un intermédiaire, un annexé. Il a une zone intérieure de domicile ou d’abri, une zone extérieure de domaine, des limites ou membranes plus ou moins rétractiles, des zones intermédiaires ou même neutralisées, des réserves ou annexes énergétiques. Il est essentiellement marqué, par des « indices », et ces indices sont empruntés à des composantes de tous les milieux : des matériaux, des produits organiques, des états de membrane ou de peau, des sources d’énergie, des condensés perception-action. Précisément, il y a territoire dès que des composantes de milieux cessent d’être directionnelles pour devenir dimensionnelles, quand elles cessent d’être fonctionnelles pour devenir expressives. Il y a territoire dès qu’il y a expressivité du rythme. C’est l’émergence de matières d’expression (qualités) qui va définir le territoire. Prenons un exemple comme celui de la couleur, des oiseaux ou des poissons : la couleur est un état de membrane, qui renvoie lui-même à des états intérieurs hormonaux ; mais la couleur reste fonctionnelle, et transitoire, tant qu’elle est liée à un type d’action (sexualité, agressivité, fuite). Elle devient expressive au contraire lorsqu’elle acquiert une constance temporelle et une portée spatiale qui en font une marque territoriale, ou plutôt territorialisante : une signature6. La question n’est pas de savoir si la couleur reprend des fonctions, ou en remplit de nouvelles au sein du territoire même. C’est évident, mais cette réorganisation de la fonction implique d’abord que la composante considérée soit devenue expressive, et qu’elle ait pour sens, de ce point de vue, de marquer un territoire. Une même espèce d’oiseau peut comporter des représentants colorés ou non ; les colorés ont un territoire, tandis que les blanchâtres sont grégaires. On sait le rôle de l’urine ou des excréments dans le marquage ; mais justement, les excréments territoriaux, par exemple chez le lapin, ont une odeur particulière due à des glandes anales spécialisées. Beaucoup de singes, en sentinelles, exposent leurs organes sexuels aux couleurs vives : le pénis devient un porte-couleurs expressif et rythmé qui marque les limites du territoire7. Une composante de milieu devient à la fois qualité et propriété, quale et proprium. En beaucoup de cas, on constate la vitesse de ce devenir, avec quelle rapidité un territoire est constitué, en même temps que les qualités expressives, sélectionnées ou produites. L’oiseau Scenopoïetes dentirostris établit ses repères en faisant chaque matin tomber de l’arbre des feuilles qu’il a coupées, puis en les tournant à l’envers, pour que leur face interne plus pâle contraste avec la terre : l’inversion produit une matière d’expression...8.
Le territoire n’est pas premier par rapport à la marque qualitative, c’est la marque qui fait le territoire. Les fonctions dans un territoire ne sont pas premières, elles supposent d’abord une expressivité qui fait territoire. C’est bien en ce sens que le territoire, et les fonctions qui s’y exercent, sont des produits de la territorialisation. La territorialisation est l’acte du rythme devenu expressif, ou des composantes de milieux devenues qualitatives. Le marquage d’un territoire est dimensionnel, mais ce n’est pas une mesure, c’est un rythme. Il conserve le caractère le plus général du rythme, de s’inscrire sur un autre plan que celui des actions. Mais, maintenant, les deux plans se distinguent comme celui des expressions territorialisantes et des fonctions territorialisées. C’est pourquoi nous ne pouvons pas suivre une thèse comme celle de Lorenz, qui tend à mettre l’agressivité à la base du territoire : ce serait l’évolution phylogénétique d’un instinct d’agression qui ferait le territoire, à partir du moment où cet instinct deviendrait intra-spécifique, tourné contre les congénères de l’animal. Un animal à territoire, ce serait celui qui dirige son agressivité contre d’autres membres de son espèce ; ce qui donne à l’espèce l’avantage sélectif de se répartir dans un espace où chacun, individu ou groupe, possède son propre lieu9. Cette thèse ambiguë, aux résonances politiques dangereuses, nous paraît mal fondée. Il est évident que la fonction agressive prend une nouvelle allure quand elle devient intra-spécifique. Mais cette réorganisation de la fonction suppose le territoire, et ne l’explique pas. Au sein du territoire, il y a de nombreuses réorganisations, affectant aussi bien la sexualité, la chasse, etc., il y a même de nouvelles fonctions, comme construire un domicile. Mais ces fonctions ne sont organisées ou créées qu’en tant qu’elles sont territorialisées, et non l’inverse. Le facteur T, le facteur territorialisant, doit être cherché ailleurs : précisément dans le devenir-expressif du rythme ou de la mélodie, c’est-à-dire dans l’émergence des qualités propres (couleur, odeur, son, silhouette...).
Peut-on nommer Art ce devenir, cette émergence ? Le territoire serait l’effet de l’art. L’artiste, le premier homme qui dresse une borne ou fait une marque... La propriété, de groupe ou individuelle, en découle, même si c’est pour la guerre et l’oppression. La propriété est d’abord artistique, parce que l’art est d’abord affiche, pancarte. Comme dit Lorenz, les poissons de corail sont des affiches. L’expressif est premier par rapport au possessif, les qualités expressives, ou matières d’expression sont forcément appropriatives, et constituent un avoir plus profond que l’être10. Non pas au sens où ces qualités appartiendraient à un sujet, mais au sens où elles dessinent un territoire qui appartiendra au sujet qui les porte ou qui les produit. Ces qualités sont des signatures, mais la signature, le nom propre, n’est pas la marque constituée d’un sujet, c’est la marque constituante d’un domaine, d’une demeure. La signature n’est pas l’indication d’une personne, c’est la formation hasardeuse d’un domaine. Les demeures ont des noms propres, et sont inspirées. « Les inspirés et leur demeure... », mais c’est avec la demeure que surgit l’inspiration. C’est en même temps que j’aime une couleur, et que j’en fais mon étendard ou ma pancarte. On met sa signature sur un objet comme on plante son drapeau sur une terre. Un surveillant général de lycée tamponnait toutes les feuilles qui jonchaient le sol dans la cour, et les remettait sur place. Il avait signé. Les marques territoriales sont des ready-made. Et, aussi, ce qu’on appelle art brut n’est rien de pathologique ou de primitif, c’est seulement cette constitution, cette libération de matières d’expression, dans le mouvement de la territorialité : le socle ou le sol de l’art. De n’importe quoi, faire une matière d’expression. Le Scenopoïetes fait de l’art brut. L’artiste est scenopoïetes, quitte à déchirer ses propres affiches. Certes, à cet égard, l’art n’est pas le privilège de l’homme. Messiaen a raison de dire que beaucoup d’oiseaux sont non seulement virtuoses, mais artistes, et le sont d’abord par leurs chants territoriaux (si un voleur « veut occuper indûment un endroit qui ne lui appartient pas, le véritable propriétaire chante, chante si bien que l’autre s’en va (...). Si le voleur chante mieux, le propriétaire lui cède la place11 »). La ritournelle, c’est le rythme et la mélodie territorialisés, parce que devenus expressifs, – et devenus expressifs parce que territorialisants. Nous ne tournons pas en rond. Nous voulons dire qu’il y a un auto-mouvement des qualités expressives. L’expressivité ne se réduit pas aux effets immédiats d’une impulsion qui déclenche une action dans un milieu : de tels effets sont des impressions ou des émotions subjectives plutôt que des expressions (ainsi, la couleur momentanée que prend un poisson d’eau douce sous telle impulsion). Les qualités expressives au contraire, les couleurs des poissons corail, sont auto-objectives, c’est-à-dire trouvent une objectivité dans le territoire qu’elles tracent.
Quel est ce mouvement objectif ? Qu’est-ce que fait une matière comme matière d’expression ? Elle est d’abord affiche ou pancarte, mais elle n’en reste pas là. Elle passe par là, c’est tout. Mais la signature va devenir style. En effet, les qualités expressives ou matières d’expression entrent, les unes avec les autres, dans des rapports mobiles qui vont « exprimer » le rapport du territoire qu’elles tracent avec le milieu intérieur des impulsions, et avec le milieu extérieur des circonstances. Or exprimer n’est pas dépendre, il y a une autonomie de l’expression. D’une part, les qualités expressives entrent les unes avec les autres dans des rapports internes qui constituent des motifs territoriaux : tantôt ceux-ci surplombent les impulsions internes, tantôt les superposent, tantôt fondent une impulsion dans une autre, tantôt passent et font passer d’une impulsion à une autre, tantôt s’insèrent entre les deux, mais ils ne sont pas eux-mêmes « pulsés ». Tantôt ces motifs non pulsés apparaissent sous une forme fixe, ou semblent apparaître ainsi, mais tantôt aussi les mêmes, ou d’autres, ont une vitesse et une articulation variables ; et c’est aussi bien leur variabilité que leur fixité qui les rend indépendants des pulsions qu’ils combinent ou neutralisent. « De nos chiens, nous savons qu’ils exécutent avec passion les mouvements de flairer, lever, courir, traquer, happer et secouer à mort une proie imaginaire, sans avoir faim. » Ou bien la danse de l’Épinoche, son zigzag est un motif où le zig épouse une pulsion agressive vers le partenaire, le zag une pulsion sexuelle vers le nid, mais où le zig et le zag sont diversement accentués, et même diversement orientés. D’autre part, les qualités expressives entrent également dans d’autres rapports internes qui font des contre-points territoriaux : cette fois, c’est la manière dont elles constituent dans le territoire des points qui prennent en contre-point les circonstances du milieu externe. Par exemple, un ennemi approche, ou fait irruption, ou bien la pluie se met à tomber, le soleil se lève, le soleil se couche... Là encore, les points ou contre-points ont leur autonomie, de fixité ou de variabilité, par rapport aux circonstances du milieu extérieur dont ils expriment le rapport avec le territoire. Car ce rapport peut être donné sans que les circonstances le soient, tout comme le rapport avec les impulsions peut être donné sans que l’impulsion le soit. Et même quand les impulsions et circonstances sont données, le rapport est original par rapport à ce qu’il rapporte. Les rapports entre matières d’expression expriment des rapports du territoire avec les impulsions internes, avec les circonstances externes : ils ont une autonomie dans cette expression même. En vérité, les motifs et les contre-points territoriaux explorent les potentialités du milieu, intérieur ou extérieur. Les ethologues ont cerné l’ensemble de ces phénomènes sous le concept de « ritualisation », et ont montré le lien des rituels animaux avec le territoire. Mais ce mot ne convient pas forcément à ces motifs non pulsés, à ces contre-points non localisés, et ne rend compte ni de leur variabilité ni de leur fixité. Car ce n’est pas l’un ou l’autre, fixité ou variabilité, mais certains motifs ou points ne sont fixes que si d’autres sont variables, ou bien ils ne sont fixés dans une occasion que pour être variables dans une autre.
Il faudrait dire plutôt que les motifs territoriaux forment des visages ou personnages rythmiques, et les contre-points territoriaux des paysages mélodiques. Il y a personnage rythmique lorsque nous ne nous trouvons plus dans la situation simple d’un rythme qui serait lui-même associé à un personnage, à un sujet ou à une impulsion : maintenant, c’est le rythme lui-même qui est tout le personnage, et qui, à ce titre, peut rester constant, mais aussi bien augmenter ou diminuer, par ajout ou retrait de sons, de durées toujours croissantes et décroissantes, par amplification ou élimination qui font mourir et ressusciter, apparaître et disparaître. De même, le paysage mélodique n’est plus une mélodie associée à un paysage, c’est la mélodie qui fait elle-même un paysage sonore, et prend en contre-point tous les rapports avec un paysage virtuel. C’est par là que nous sortons du stade de la pancarte : car si chaque qualité expressive, si chaque matière d’expression considérée en elle-même est une pancarte ou une affiche, cette considération n’en reste pas moins abstraite. Les qualités expressives entrent les unes avec les autres dans des rapports variables ou constants (c’est ce que font les matières d’expression), pour constituer, non plus des pancartes qui marquent un territoire, mais des motifs et des contre-points, qui expriment le rapport du territoire avec des impulsions intérieures ou des circonstances extérieures, même si celles-ci ne sont pas données. Non plus des signatures, mais un style. Ce qui distingue objectivement un oiseau musicien d’un oiseau non musicien, c’est précisément cette aptitude aux motifs et aux contre-points qui, variables ou même constants, en font autre chose qu’une affiche, en font un style, puisqu’ils articulent le rythme et harmonisent la mélodie. On peut dire alors que l’oiseau musicien passe de la tristesse à la joie, ou bien qu’il salue le lever du soleil, ou bien qu’il se met lui-même en danger pour chanter, ou bien qu’il chante mieux qu’un autre, etc. Aucune de ces formules ne comporte le moindre danger d’anthropomorphisme, ou n’implique la moindre interprétation. Ce serait plutôt du géomorphisme. C’est dans le motif et dans le contre-point qu’est donné le rapport avec la joie et la tristesse, avec le soleil, avec le danger, avec la perfection, même si le terme de chacun de ces rapports n’est pas donné. C’est dans le motif et dans le contre-point que le soleil, la joie ou la tristesse, le danger, deviennent sonores, rythmiques ou mélodiques12.
La musique de l’homme, aussi, passe par là. Pour Swann amateur d’art, la petite phrase de Vinteuil agit souvent comme une pancarte associée au paysage du bois de Boulogne, au visage et au personnage d’Odette : c’est comme si elle apportait à Swann l’assurance que le bois de Boulogne fut bien son territoire, et Odette sa possession. Il y a déjà beaucoup d’art dans cette manière d’entendre la musique. Debussy critiquait Wagner en comparant les leitmotive à des poteaux indicateurs qui signaleraient les circonstances cachées d’une situation, les impulsions secrètes d’un personnage. Et il en est ainsi, à un niveau ou à certains moments. Mais plus l’œuvre se développe, plus les motifs entrent en conjonction, plus ils conquièrent leur propre plan, plus ils prennent d’autonomie par rapports à l’action dramatique, aux impulsions, aux situations, plus ils sont indépendants des personnages et des paysages, pour devenir eux-mêmes paysages mélodiques, personnages rythmiques qui ne cessent d’enrichir leurs relations internes. Alors ils peuvent rester relativement constants, ou au contraire augmenter ou diminuer, croître et décroître, varier de vitesse de déroulement : dans les deux cas ils ont cessé d’être pulsés et localisés, même les constantes sont pour la variation, et se durcissent d’autant plus qu’elles sont provisoires et font valoir cette variation continue à laquelle elles résistent13. Précisément, Proust fut parmi les premiers à souligner cette vie du motif wagnérien : au lieu que le motif soit lié à un personnage qui apparaît, c’est chaque apparition du motif qui constitue elle-même un personnage rythmique, dans « la plénitude d’une musique que remplissent en effet tant de musiques dont chacune est un être ». Et ce n’est pas par hasard si l’apprentissage de la Recherche poursuit une découverte analogue à propos des petites phrases de Vinteuil : elles ne renvoient pas à un paysage, mais emportent et développent en elles des paysages qui n’existent plus en dehors (la blanche sonate et le rouge septuor...). La découverte du paysage proprement mélodique et du personnage proprement rythmique marque ce moment de l’art en tant qu’il cesse d’être une peinture muette sur un panonceau. Peut-être n’est-ce pas le dernier mot de l’art, mais l’art est passé par là, tout comme l’oiseau, motifs et contre-points qui forment un auto-développement, c’est-à-dire un style. L’intériorisation du paysage sonore ou mélodique peut trouver sa forme exemplaire chez Liszt non moins que celle du personnage rythmique chez Wagner. Plus généralement, le lied est l’art musical du paysage, la forme la plus picturale de la musique, la plus impressionniste. Mais les deux pôles sont tellement liés que, dans le lied aussi, la Nature apparaît comme personnage rythmique aux transformations infinies.
Le territoire, c’est d’abord la distance critique entre deux êtres de même espèce : marquer ses distances. Ce qui est mien, c’est d’abord ma distance, je ne possède que des distances. Je ne veux pas qu’on me touche, je grogne si l’on entre dans mon territoire, je mets des pancartes. La distance critique est un rapport qui découle des matières d’expression. Il s’agit de maintenir à distance les forces du chaos qui frappent à la porte. Maniérisme : l’ethos est à la fois demeure et manière, patrie et style. On le voit bien dans les danses territoriales dites baroques, ou maniéristes, où chaque pose, chaque mouvement instaure une telle distance (sarabandes, allemandes, bourrées, gavottes...14). Il y a tout un art des poses, des postures, des silhouettes, des pas et des voix. Deux shizophrènes se parlent, ou déambulent, suivant des lois de frontière et de territoire qui peuvent nous échapper. À quel point il est important, quand le chaos menace, de tracer un territoire transportable et pneumatique. Au besoin, je prendrai mon territoire sur mon propre corps, je territorialise mon corps : la maison de la tortue, l’ermitage du crustacé, mais aussi tous les tatouages qui font du corps un territoire. La distance critique n’est pas une mesure, c’est un rythme. Mais justement le rythme est pris dans un devenir qui emporte les distances entre personnages, pour en faire des personnages rythmiques, eux-mêmes plus ou moins distants, plus ou moins combinables (intervalles). Deux animaux de même sexe et d’une même espèce s’affrontent ; le rythme de l’un « croit » lorsqu’il approche de son territoire ou du centre de ce territoire, le rythme de l’autre décroît quand il s’éloigne du sien, et entre les deux, sur les frontières, une constante oscillatoire s’établit : un rythme actif, un rythme subi, un rythme témoin15 ? Ou bien l’animal entrouvre son territoire au partenaire de l’autre sexe : se forme un personnage rythmique complexe, en duos, chants alternés ou anti-phoniques, comme chez les pies-grièches africaines. Bien plus, il faut tenir compte simultanément de deux aspects du territoire : non seulement il assure et règle la coexistence des membres d’une même espèce, en les séparant, mais il rend possible la coexistence d’un maximum d’espèces différentes dans un même milieu, en les spécialisant. C’est en même temps que les membres d’une même espèce entrent dans des personnages rythmiques et que les espèces diverses entrent dans des paysages mélodiques, les paysages étant peuplés de personnages, les personnages appartenant à des paysages. Ainsi la Chronochromie, de Messiaen, avec dix-huit chants d’oiseaux, à la fois formant des personnages rythmiques autonomes et réalisant un extraordinaire paysage en contre-points complexes, accords sous-entendus ou inventés.
Non seulement l’art n’attend pas l’homme pour commencer, mais on peut demander si l’art apparaît jamais chez l’homme, sauf dans des conditions tardives et artificielles. On a souvent remarqué que l’art humain restait longtemps pris dans les travaux et des rites d’une autre nature. Toutefois, cette remarque n’a peut-être pas plus de portée que celle qui ferait commencer l’art avec l’homme. Car il est très vrai que, dans un territoire, deux effets notables ont lieu : une réorganisation des fonctions, un regroupement des forces. D’une part, des activités fonctionnelles ne sont pas territorialisées sans prendre une nouvelle allure (création de nouvelles fonctions comme construire un logis, transformation d’anciennes fonctions, telle l’agressivité qui change de nature en devenant intra-spécifique). Il y a là comme le thème naissant de la spécialisation ou de la profession : si la ritournelle territoriale passe si souvent dans les ritournelles professionnelles, c’est que les professions supposent que des activités fonctionnelles diverses s’exercent dans un même milieu, mais aussi que la même activité n’a pas d’autres agents dans le même territoire. Des ritournelles professionnelles se croisent dans le milieu, comme les cris des marchands, mais chacune marque un territoire où ne peut pas s’exercer la même activité ni retentir le même cri. Chez l’animal comme chez l’homme, ce sont les règles de distance critique pour l’exercice de la concurrence : mon coin de trottoir. Bref, il y a une territorialisation des fonctions qui est la condition de leur surgissement comme « travaux » ou « métiers ». C’est en ce sens que l’agressivité intra-spécifique ou spécialisée est nécessairement d’abord une agressivité territorialisée, qui n’explique pas le territoire, puisqu’elle en découle. Du coup, on reconnaîtra que dans le territoire toutes les activités prennent une allure pratique nouvelle. Mais ce n’est pas une raison pour en conclure que l’art n’y existe pas pour lui-même, puisqu’il est présent dans le facteur territorialisant qui conditionne l’émergence de la fonction-travail.
Et il en est de même si l’on considère l’autre effet de la territorialisation. Cet autre effet, qui ne renvoie plus à des travaux, mais à des rites ou religions, consiste en ceci : le territoire regroupe toutes les forces des différents milieux en une seule gerbe constituée par les forces de la terre. C’est seulement au plus profond de chaque territoire que se fait l’attribution de toutes les forces diffuses à la terre comme réceptacle ou socle. « Le milieu environnant étant vécu comme une unité, on ne saurait que difficilement distinguer dans ces intuitions primaires ce qui appartient à la terre proprement dite de ce qui est seulement manifesté à travers elle, montagnes, forêts, eaux, végétation. » Les forces de l’air ou de l’eau, l’oiseau et le poisson, deviennent ainsi forces de la terre. Bien plus, si le territoire en extension sépare les forces intérieures de la terre et les forces extérieures du chaos, il n’en est pas de même en « intension », en profondeur, où les deux types de forces s’étreignent et s’épousent en un combat qui n’a que la terre comme crible et comme enjeu. Dans le territoire, il y a toujours un lieu où toutes les forces se réunissent, arbre ou bocage, dans un corps-à-corps d’énergies. La terre est ce corps-à-corps. Ce centre intense est à la fois dans le territoire même, mais aussi hors de plusieurs territoires qui convergent vers lui à l’issue d’un immense pèlerinage (d’où les ambiguïtés du « natal »). En lui ou hors de lui, le territoire renvoie à un centre intense qui est comme la patrie inconnue, source terrestre de toutes les forces, amicales ou hostiles, et où tout se décide16. Là aussi donc, nous devons reconnaître que la religion, commune à l’homme et à l’animal, n’occupe le territoire que parce qu’elle dépend, comme de sa condition, du facteur brut esthétique, territorialisant. C’est lui qui, tout ensemble, organise les fonctions de milieu en travaux, et lie les forces de chaos en rites et religions, forces de la terre. C’est en même temps que les marques territorialisantes se développent en motifs et contrepoints, et qu’elles réorganisent les fonctions, qu’elles regroupent les forces. Mais, par là même, le territoire déchaîne déjà quelque chose qui va le dépasser.
Nous sommes toujours ramenés à ce « moment » : le devenir-expressif du rythme, l’émergence des qualités-propres expressives, la formation de matières d’expression qui se développent en motifs et contre-points. Il faudrait alors une notion, même d’apparence négative, pour saisir ce moment, brut ou fictif. L’essentiel est dans le décalage que l’on constate entre le code et le territoire. Le territoire surgit dans une marge de liberté du code, non pas indéterminée, mais autrement déterminée. S’il est vrai que chaque milieu a son code, et qu’il y a perpétuellement transcodage entre les milieux, il semble au contraire que le territoire se forme au niveau d’un certain décodage. Les biologistes ont souligné l’importance de ces marges déterminées, mais qui ne se confondent pas avec des mutations, c’est-à-dire avec des changements intérieurs au code : il s’agit cette fois de gènes dédoublés ou de chromosomes surnuméraires, qui ne sont pas pris dans le code génétique, sont fonctionnellement libres et offrent une matière libre à la variation17. Mais qu’une telle matière puisse créer de nouvelles espèces indépendamment des mutations reste très improbable, si les événements d’un autre ordre ne s’y joignent pas, capables de multiplier les interactions de l’organisme avec ses milieux. Or la territorialisation est précisément un tel facteur qui s’établit sur les marges de code d’une même espèce, et qui donne aux représentants séparés de cette espèce la possibilité de se différencier. C’est parce que la territorialité est en décalage par rapport au code de l’espèce qu’elle peut induire indirectement de nouvelles espèces. Partout où la territorialité apparaît, elle instaure une distance critique intra-spécifique entre membres d’une même espèce ; et c’est en vertu de son propre décalage par rapport aux différences spécifiques qu’elle devient un moyen de différenciation indirect, oblique. En tous ces sens le décodage apparaît bien comme le « négatif » du territoire ; et la distinction la plus évidente entre les animaux à territoire et les animaux sans territoire, c’est que les premiers sont beaucoup moins codés que les autres. Nous avons dit assez de mal du territoire pour évaluer maintenant toutes les créations qui y tendent, qui s’y font ou qui en sortent, qui vont en sortir.
Nous sommes allés des forces du chaos aux forces de la terre. Des milieux au territoire. Des rythmes fonctionnels au devenir-expressif du rythme. Des phénomènes de transcodage aux phénomènes de décodage. Des fonctions de milieu aux fonctions territorialisées. Il s’agit moins d’évolution que de passage, de ponts, de tunnels. Déjà les milieux ne cessaient pas de passer les uns dans les autres. Mais voilà que les milieux passent dans le territoire. Les qualités expressives, celles que nous appelons esthétiques, ne sont certes pas des qualités « pures », ni symboliques, mais des qualités-propres, c’est-à-dire appropriatives, des passages qui vont de composantes de milieu à des composantes de territoire. Le territoire est lui-même lieu de passage. Le territoire est le premier agencement, la première chose qui fasse agencement, l’agencement est d’abord territorial. Mais comment ne serait-il pas déjà en train de passer en autre chose, dans d’autres agencements ? C’est pourquoi nous ne pouvions pas parler de la constitution du territoire sans parler déjà de son organisation interne. Nous ne pouvions pas décrire l’infra-agencement (affiches ou pancartes) sans être déjà dans l’intra-agencernent (motifs et contre-points). Nous ne pouvons rien dire non plus sur l’intra-agencement sans être déjà sur la voie qui nous mène à d’autre agencements, ou ailleurs. Passage de la Ritournelle. La ritournelle va vers l’agencement territorial, s’y installe ou en sort. En un sens général, on appelle ritournelle tout ensemble de matières d’expression qui trace un territoire, et qui se développe en motifs territoriaux, en paysages territoriaux (il y a des ritournelles motrices, gestuelles, optiques, etc.). En un sens restreint, on parle de ritournelle quand l’agencement est sonore ou « dominé » par le son – mais pourquoi cet apparent privilège ?
Nous sommes maintenant dans l’intra-agencement. Or il présente une organisation très riche et complexe. Non seulement il comprend l’agencement territorial, mais aussi les fonctions agencées, territorialisées. Soit les Troglodytes, famille de passereaux : le mâle prend possession de son territoire, et produit une « ritournelle de boîte à musique », comme une mise en garde contre les intrus possibles ; il construit lui-même des nids dans ce territoire, parfois une douzaine ; lorsqu’une femelle arrive, il se met devant un nid, l’invite à visiter, laisse pendre ses ailes, baisse l’intensité de son chant qui se réduit alors à un seul trille18. Il apparaît que la fonction de nidification est fortement territorialisée, puisque les nids sont préparés par le mâle tout seul avant l’arrivée de la femelle, qui ne fait que les visiter et les achever ; la fonction de « cour » est également territorialisée, mais à un moindre degré, puisque la ritournelle territoriale change d’intensité pour se faire séductrice. Dans l’intra-agencement, toutes sortes de composantes hétérogènes interviennent : non seulement les marques de l’agencement qui réunissent des matériaux, des couleurs, des odeurs, des sons, des postures, etc., mais les divers éléments de tel ou tel comportement agencé qui entrent dans un motif. Par exemple, un comportement de parade se compose de danse, claquement de bec, exhibition de couleurs, posture du cou allongé, cris, lissage de plumes, courbettes, ritournelle... Une première question serait de savoir ce qui fait tenir ensemble toutes ces marques territorialisantes, ces motifs territoriaux, ces fonctions territorialisées dans un même intra-agencement. C’est une question de consistance : le « tenir-ensemble » d’éléments hétérogènes. Ils ne constituent d’abord qu’un ensemble flou, un ensemble discret, qui prendra consistance...
Mais une autre question semble interrompre ou recouper celle-ci. Car, en beaucoup de cas, une fonction agencée, territorialisée, acquiert assez d’indépendance pour former elle-même un nouvel agencement, plus ou moins déterritorialisé, en voie de déterritorialisation. Il n’y a pas besoin de quitter effectivement le territoire pour entrer dans cette voie ; mais ce qui, tout à l’heure, était une fonction constituée dans l’agencement territorial, devient maintenant l’élément constituant d’un autre agencement, l’élément de passage à un autre agencement. Comme dans l’amour courtois, une couleur cesse d’être territoriale pour entrer dans un agencement de « cour ». Il y a une ouverture de l’agencement territorial à un agencement de cour, ou à un agencement social autonomisé. C’est ce qui arrive lorsque se fait une reconnaissance propre du partenaire sexuel, ou des membres du groupe, qui ne se confond plus avec la reconnaissance du territoire : on dit alors que le partenaire est un Tier mit der Heimvalenz, « un animal valant le chez-soi ». Dans l’ensemble des groupes ou des couples, on pourra donc distinguer des groupes et couples de milieu, sans reconnaissance individuelle, des groupes et couples territoriaux, où la reconnaissance ne s’exerce que dans le territoire, enfin des groupes sociaux et des couples amoureux, quand la reconnaissance se fait indépendamment du lieu19. La cour, ou le groupe, ne font plus partie de l’agencement territorial, mais il y a autonomisation d’un agencement de cour ou de groupe – même si l’on reste à l’intérieur du territoire. Inversement, au sein du nouvel agencement, une reterritorialisation se fait, sur le membre du couple ou les membres du groupe qui valent-pour (valence). Une telle ouverture de l’agencement territorial sur d’autres agencements peut être analysée en détail, et varie beaucoup. Par exemple, quand ce n’est pas le mâle qui fait le nid, quand le mâle se contente de transporter les matériaux ou de mimer la construction, comme chez les Pinsons d’Australie, tantôt il fait la cour à la femelle avec un brin de chaume dans le bec (genre Bathilda), tantôt il utilise un autre matériau que celui du nid (genre Neochmia), tantôt le brin d’herbe ne sert que dans les phases initiales de la cour ou même avant (genres Aidemosyne ou Lonchura), tantôt l’herbe est picorée sans être offerte (genre Emblema20). On peut toujours dire que ces comportements de « brin d’herbe » ne sont que des archaïsmes, ou des vestiges d’un comportement de nidification. Mais c’est la notion de comportement qui se révèle insuffisante par rapport à celle d’agencement. Car, lorsque le nid n’est pas déjà fait par le mâle, la nidification cesse d’être une composante de l’agencement territorial, elle décolle en quelque sorte du territoire ; bien plus, la cour, qui précède alors la nidification, devient elle-même un agencement relativement autonomisé. Et la matière d’expression « brin d’herbe » agit comme une composante de passage entre l’agencement territorial et l’agencement de cour. Que le brin d’herbe, alors, ait une fonction de plus en plus rudimentaire chez certaines espèces, qu’il tende à s’annuler dans une série considérée, ne suffit pas à en faire un vestige, encore moins un symbole. Jamais une matière d’expression n’est vestige ou symbole. Le brin d’herbe est une composante déterritorialisée, ou en voie de déterritorialisation. Ce n’est pas un archaïsme, ni un objet partiel ou transitionnel. C’est un opérateur, un vecteur. C’est un convertisseur d’agencement. C’est à titre de composante de passage, d’un agencement à un autre, que le brin s’annule. Et ce qui confirme ce point de vue, c’est qu’il ne tend pas à s’annuler sans qu’une composante de relais ne le remplace et ne prenne de plus en plus d’importance : à savoir la ritournelle, qui n’est plus seulement territoriale, mais devient amoureuse et sociale, et change en conséquence21. Pourquoi la composante sonore « ritournelle » a-t-elle, dans la constitution de nouveaux agencements, une valence plus forte que la composante gestuelle, « brin d’herbe », c’est une question qu’on ne pourra considérer que plus tard. L’important pour le moment est de constater cette formation de nouveaux agencements dans l’agencement territorial, ce mouvement qui va de l’intra-agencement à des inter-agencements, avec composantes de passage et de relais. Ouverture innovatrice du territoire vers la femelle, ou bien vers le groupe. La pression sélective passe par les inter-agencements. C’est comme si des forces de déterritorialisation travaillaient le territoire lui-même, et nous faisaient passer de l’agencement territorial à d’autres types d’agencement, de cour ou de sexualité, de groupe ou de société. Le brin d’herbe et la ritournelle sont deux agents de ces forces, deux agents de déterritorialisation.
L’agencement territorial ne cesse de passer dans d’autres agencements. De même que l’infra-agencement n’est pas séparable de l’intra-agencement, l’intra-agencement ne l’est pas davantage des inter-agencements, et pourtant les passages ne sont pas nécessaires, et se font « suivant le cas ». La raison en est simple : l’intra-agencement, l’agencement territorial, territorialise des fonctions et des forces, sexualité, agressivité, grégarité, etc., et les transforme en les territorialisant. Mais ces fonctions et ces forces territorialisées peuvent du coup prendre une autonomie qui les fait basculer dans d’autres agencements, composer d’autres agencements déterritorialisés. La sexualité peut apparaître comme une fonction territorialisée dans l’intra-agencement ; mais elle peut également tracer une ligne de déterritorialisation qui décrit un autre agencement ; d’où les rapports très variables sexualité-territoire, comme si la sexualité prenait « sa distance »... La profession, le métier, la spécialité impliquent des activités territorialisées ; mais elles peuvent aussi bien décoller du territoire pour construire autour d’elles, et entre professions, un nouvel agencement. Une composante territoriale ou territorialisée peut se mettre à bourgeonner, à produire : c’est tellement le cas de la ritournelle qu’il faut peut-être appeler ritournelle tout ce qui est dans ce cas. Cette équivoque entre la territorialité et la déterritorialisation, c’est l’équivoque du Natal. Elle se comprend d’autant mieux si l’on considère que le territoire renvoie à un centre intense au plus profond de soi ; mais précisément, nous l’avons vu, ce centre intense peut être situé hors territoire, au point de convergence de territoires très différents ou très éloignés. Le Natal est dehors. On peut citer un certain nombre de cas célèbres et troublants, plus ou moins mystérieux, illustrant de prodigieux décollements de territoire, nous faisant assister à un vaste mouvement de déterritorialisation en pleine prise sur les territoires, et les traversant de fond en comble : 1) les pèlerinages aux sources comme ceux des saumons ; 2) les rassemblements surnuméraires, comme ceux des sauterelles, des pinsons, etc. (des dizaines de millions de pinsons près de Thoune en 1950-1951) ; 3) les migrations solaires ou magnétiques ; 4) les longues marches, comme celles des langoustes22.
Quelles que soient les causes de chacun de ces mouvements, on voit bien que la nature du mouvement change. Il ne suffit même plus de dire qu’il y a inter-agencement, passage d’un agencement territorial à un autre type, on dirait plutôt qu’on sort de tout agencement, qu’on excède les capacités de tout agencement possible, pour entrer sur un autre plan. Et, en effet, ce n’est plus un mouvement ni un rythme de milieu, pas davantage un mouvement ni un rythme territorialisants ou territorialisés, il y a maintenant du Cosmos dans ces mouvements plus amples. Les mécanismes de localisation ne cessent pas d’être extrêmement précis, mais la localisation est devenue cosmique. Ce ne sont plus les forces territorialisées, réunies en forces de la terre, ce sont les forces retrouvées ou libérées d’un Cosmos déterritorialisé. Dans la migration, le soleil n’est plus le soleil terrestre qui règne sur le territoire, même aérien, c’est le soleil céleste du Cosmos, comme dans les deux Jérusalem, Apocalypse. Mais, en dehors de ces cas grandioses, où la déterritorialisation se fait absolue, sans rien perdre de sa précision (puisqu’elle épouse des variables cosmiques), il faut déjà constater que le territoire ne cesse pas d’être parcouru par des mouvements de déterritorialisation relative et même sur place, où l’on passe de l’intra-agencement à des inter-agencements, sans qu’il y ait besoin de quitter le territoire, ni de sortir des agencements pour épouser le Cosmos. Un territoire est toujours en voie de déterritorialisation, au moins potentielle, en voie de passage à d’autres agencements, quitte à ce que l’autre agencement opère une reterritorialisation (quelque chose qui « vaut » le chez-soi)... Nous avons vu que le territoire se constituait sur une marge de décodage affectant le milieu ; nous voyons qu’une marge de déterritorialisation affecte le territoire en lui-même. C’est une série de décrochages. Le territoire n’est pas séparable de certains coefficients de déterritorialisation, évaluables dans chaque cas, faisant varier les rapports de chaque fonction territorialisée avec le territoire, mais aussi les rapports du territoire avec chaque agencement déterritorialisé. Et c’est la même « chose » qui apparaît ici comme fonction territorialisée, prise dans l’intra-agencement, et là-bas comme agencement autonome ou déterritorialisé, inter-agencement.
C’est pourquoi une classification des ritournelles pourrait se présenter ainsi : 1) les ritournelles territoriales, qui cherchent, marquent, agencent un territoire ; 2) les ritournelles de fonctions territorialisées, qui prennent une fonction spéciale dans l’agencement (la Berceuse qui territorialise le sommeil et l’enfant, l’Amoureuse qui territorialise la sexualité et l’aimé, la Professionnelle qui territorialise le métier et les travaux, la Marchande qui territorialise la distribution et les produits...) ; 3) les mêmes, en tant qu’elles marquent maintenant de nouveaux agencements, qu’elles passent à de nouveaux agencements, par déterritorialisation-reterritorialisation (les comptines seraient un cas très compliqué : ce sont des ritournelles territoriales, qu’on ne chante pas de la même manière d’un quartier à l’autre, parfois d’une rue à l’autre ; elles distribuent des rôles et des fonctions de jeu dans l’agencement territorial ; mais aussi elles font passer le territoire dans l’agencement de jeu qui tend lui-même à devenir autonome23) ; 4) les ritournelles qui ramassent ou rassemblent les forces, soit au sein du territoire, soit pour aller au-dehors (ce sont des ritournelles d’affrontement, ou de départ, qui engagent parfois un mouvement de déterritorialisation absolue, « Adieu, je pars sans détourner les yeux ». À l’infini, ces ritournelles doivent rejoindre les chansons de Molécules, les vagissements de nouveau-nés des Éléments fondamentaux, comme dit Millikan. Elles cessent d’être terrestres pour devenir cosmiques : quand le Nome religieux s’épanouit et se dissout dans un Cosmos panthéiste moléculaire ; quand le chant des oiseaux fait place aux combinaisons de l’eau, du vent, des nuages et des brouillards. « Dehors le vent, la pluie... » Le Cosmos comme immense ritournelle déterritorialisée).
Le problème de la consistance concerne bien la manière dont tiennent ensemble les composantes d’un agencement territorial. Mais il concerne aussi la manière dont des agencements différents tiennent, avec composantes de passage et de relais. Il se peut même que la consistance ne trouve la totalité de ses conditions que sur un plan proprement cosmique, où tous les disparates et les hétérogènes sont convoqués. Cependant, chaque fois que des hétérogènes tiennent ensemble dans un agencement ou dans des inter-agencements, un problème de consistance se pose déjà, en termes de coexistence ou de succession, et les deux à la fois. Même dans un agencement territorial, c’est peut-être la composante la plus déterritorialisée, le vecteur déterritorialisant, ainsi la ritournelle, qui assure la consistance du territoire. Si nous posons la question générale « Qu’est-ce qui fait tenir ensemble ? », il semble que la réponse la plus claire, la plus facile, soit donnée par un modèle arborescent, centralisé, hiérarchisé, linéaire, formalisant. Par exemple, le schéma de Tinbergen, qui montre un enchaînement codé de formes spatio-temporelles dans le système nerveux central : un centre supérieur fonctionnel entre automatiquement en acte et déclenche un comportement d’appétence, à la recherche de stimuli spécifiques (centre de migration) ; par l’intermédiaire du stimulus, un second centre jusque-là inhibé se trouve libéré, qui déclenche un nouveau comportement d’appétence (centre de territoire) ; puis d’autres centres subordonnés, de combat, de nidification, de cour..., jusqu’aux stimuli qui déclenchent les actes d’exécution correspondants24. Une telle représentation toutefois est construite sur des binarités trop simples : inhibition-déclenchement, inné-acquis, etc. Les éthologues ont un grand avantage sur les ethnologues : ils ne sont pas tombés dans le danger structural qui divise un « terrain » en formes de parenté, de politique, d’économie, de mythe, etc. Les éthologues ont gardé l’intégralité d’un certain « terrain » non divisé. Mais, à force de l’orienter quand même avec des axes d’inhibition-déclenchement, d’inné-acquis, ils risquent de réintroduire des âmes ou des centres en chaque lieu et à chaque étape des enchaînements. C’est pourquoi même les auteurs qui insistent beaucoup sur le rôle du périphérique et de l’acquis au niveau des stimuli de déclenchement ne renversent pas vraiment le schéma linéaire arborescent, même s’ils inversent le sens des flèches.
Il nous semble plus important de souligner un certain nombre de facteurs aptes à suggérer un tout autre schéma, en faveur d’un fonctionnement rhizomatique et non plus arbrifié, qui ne passerait plus par ces dualismes. En premier lieu, ce qu’on appelle un centre fonctionnel met en jeu, non pas une localisation, mais la répartition de toute une population de neurones sélectionnés dans l’ensemble du système nerveux central, comme dans un « réseau de cablage ». Dès lors, dans l’ensemble de ce système considéré pour lui-même (expériences où les voies afférentes sont sectionnées), on parlera moins de l’automatisme d’un centre supérieur que de coordination entre centres, et de groupements cellulaires ou de populations moléculaires opérant ces couplages : il n’y a pas une forme ou une bonne structure qui s’impose, ni du dehors ni par en haut, mais plutôt une articulation par le dedans, comme si des molécules oscillantes, des oscillateurs, passaient d’un centre hétérogène à l’autre, même pour assurer la dominance de l’un25. Ce qui exclut évidemment la relation linéaire d’un centre à l’autre, au profit de paquets de relations pilotés par les molécules : l’interaction, la coordination, peut être positive ou négative (déclenchement ou inhibition), jamais elle n’est directe comme dans une relation linéaire ou une réaction chimique, elle se fait toujours entre des molécules à deux têtes au moins, et chaque centre séparément26.
Il y a là toute une « machinique » biologique-comportementale, tout un engineering moléculaire qui doit nous faire mieux comprendre la nature des problèmes de consistance. Le philosophe Eugène Dupréel avait proposé une théorie de la consolidation ; il montrait que la vie n’allait pas d’un centre à une extériorité, mais d’un extérieur à un intérieur, ou plutôt d’un ensemble flou ou discret à sa consolidation. Or celle-ci implique trois choses : qu’il y ait non pas un commencement d’où dériverait une suite linéaire, mais des densifications, des intensifications, des renforcements, des injections, des truffages, comme autant d’actes intercalaires (« il n’y a de croissance que par intercalation »). En second lieu, et ce n’est pas le contraire, il faut qu’il y ait aménagement d’intervalles, répartition d’inégalités, au point que, pour consolider, il faut parfois faire un trou. En troisième lieu, superposition de rythmes disparates, articulation par le dedans d’une inter-rythmicité, sans imposition de mesure ou de cadence27. La consolidation ne se contente pas de venir après, elle est créatrice. C’est que le commencement ne commence qu’entre deux, intermezzo. La consistance est précisément la consolidation, l’acte qui produit le consolidé, de succession comme de coexistence, avec les trois facteurs : intercales, intervalles et superpositions-articulations. L’architecture en témoigne, comme art de la demeure et du territoire : s’il y a des consolidations par-après, il y en a aussi qui sont parties constituantes de l’ensemble, du type clef de voûte. Mais, plus récemment, des matières comme le béton armé ont donné à l’ensemble architectural la possibilité de se dégager des modèles arborescents, qui procédaient par piliers-arbres, poutres-branches, voûte-feuillage. Non seulement le béton est une matière hétérogène dont le degré de consistance varie avec les éléments de mélange, mais le fer y est intercalé suivant un rythme, bien plus, il forme dans les surfaces auto-porteuses un personnage rythmique complexe, où les « tiges » ont des sections différentes et des intervalles variables d’après l’intensité et la direction de la force à capter (armature et non structure). C’est en ce sens aussi que l’œuvre musicale ou littéraire a une architecture : « saturer l’atome », disait Virginia Woolf ; ou bien, selon Henry James, il faut « commencer loin, aussi loin que possible », et procéder par « blocs de matière travaillée ». Il ne s’agit plus d’imposer une forme à une matière, mais d’élaborer un matériau de plus en plus riche, de plus en plus consistant, apte dès lors à capter des forces de plus en plus intenses. Ce qui rend un matériau de plus en plus riche, c’est ce qui fait tenir ensemble des hétérogènes, sans qu’ils cessent d’être hétérogènes ; ce qui fait tenir ainsi, ce sont des oscillateurs, des synthétiseurs intercalaires à deux têtes au moins ; ce sont des analyseurs d’intervalles ; ce sont des synchroniseurs de rythmes (le mot « synchroniseur » est ambigu, puisque ces synchroniseurs moléculaires ne procèdent pas par mesure égalisante ou homogénéisante, et opèrent du dedans, entre deux rythmes). La consolidation n’est-elle pas le nom terrestre de la consistance ? L’agencement territorial est un consolidé de milieu, un consolidé d’espace-temps, de coexistence et de succession. Et la ritournelle opère avec les trois facteurs.
Mais il faut que les matières d’expression présentent elles-mêmes des caractères qui rendent possible une telle prise de consistance. Nous avons vu à cet égard leur aptitude à entrer dans des rapports internes qui forment des motifs et des contre-points : les marques territorialisantes deviennent des motifs ou contre-points territoriaux, les signatures et pancartes font un « style ». C’étaient les éléments d’un ensemble flou, ou discret ; mais elles se consolident, prennent de la consistance. C’est dans cette mesure aussi qu’elles ont des effets, comme réorganiser les fonctions et rassembler les forces. Pour mieux saisir le mécanisme d’une telle aptitude, on peut se fixer certaines conditions d’homogénéité et considérer d’abord des marques ou matières d’une même sorte : par exemple, un ensemble de marques sonores, le chant d’un oiseau. Le chant du Pinson a normalement trois phrases distinctes : la première, de quatre à quatorze notes, en crescendo et diminution de fréquence ; la seconde, de deux à huit notes, de fréquence constante plus basse que précédemment ; la troisième, qui se termine sur une « fioriture » ou un « ornement » complexe. Or, du point de vue de l’acquisition, ce plein-chant (full song) est précédé par un sous-chant (sub-song) qui, dans les conditions normales, implique bien une possession de la tonalité générale, de la durée d’ensemble, et du contenu des strophes, et même une tendance à terminer sur une note plus haute28. Mais l’organisation en trois strophes, l’ordre de succession de ces strophes, le détail de l’ornement ne sont pas donnés ; on dirait précisément que ce qui manque, ce sont les articulations du dedans, les intervalles, les notes intercalaires, tout ce qui fait motif et contre-point. La distinction du sous-chant et du plein-chant pourrait alors être présentée ainsi : le sous-chant comme marque ou pancarte, le plein-chant comme style ou motif, et l’aptitude à passer de l’un à l’autre, l’aptitude de l’un à se consolider dans l’autre. Il va de soi notamment que l’isolation artificielle aura des effets très différents suivant qu’elle survient avant ou après l’acquisition des composantes du sous-chant.
Mais, ce qui nous occupe pour le moment, c’est plutôt de savoir ce qui se passe lorsque ces composantes se sont effectivement développées en motifs et contre-points de plein-chant. Alors, nous sortons nécessairement des conditions d’homogénéité qualitative que nous nous étions données. Car, tant qu’on en reste à des marques, les marques d’un genre coexistent avec celles d’un autre genre, sans plus : des sons coexistent avec des couleurs, avec des gestes, des silhouettes du même animal ; ou bien les sons de telle espèce coexistent avec les sons d’autres espèces, parfois très différentes mais localement voisines. Or, l’organisation de marques qualifiées en motifs et contre-points va nécessairement entraîner une prise de consistance, ou une capture de marques d’une autre qualité, un branchement mutuel de sons-couleurs-gestes, ou bien de sons d’espèces animales différentes..., etc. La consistance se fait nécessairement d’hétérogène à hétérogène : non pas parce qu’il y aurait naissance d’une différenciation, mais parce que les hétérogènes qui se contentaient de coexister ou de se succéder sont maintenant pris les uns dans les autres, par la « consolidation » de leur coexistence et de leur succession. C’est que les intervalles, les intercalaires et les articulations, constitutifs des motifs et contre-points dans l’ordre d’une qualité expressive, enveloppent aussi d’autres qualités d’un autre ordre, ou bien des qualités du même ordre, mais d’un autre sexe ou même d’une autre espèce animale. Une couleur va « répondre » à un son. Il n’y a pas motifs et contre-points d’une qualité, personnages rythmiques et paysages mélodiques dans tel ordre, sans constitution d’un véritable opéra machinique qui réunit les ordres, les espèces et les qualités hétérogènes. Ce que nous appelons machinique, c’est précisément cette synthèse d’hétérogènes en tant que telle. En tant que ces hétérogènes sont des matières d’expression, nous disons que leur synthèse elle-même, leur consistance ou leur capture, forme un « énoncé », une « énonciation » proprement machinique. Les rapports variés dans lesquels entrent une couleur, un son, un geste, un mouvement, une position, dans une même espèce et dans des espèces diverses, forment autant d’énonciations machiniques.
Revenons au Scenopoïetes, l’oiseau magique ou d’opéra. Il n’a pas de vives couleurs (comme s’il y avait inhibition). Mais son chant, sa ritournelle, s’entend de très loin (est-ce une compensation, ou au contraire le facteur primaire ?) Il chante sur son bâton à chanter (singing stick), liane ou rameau, juste au-dessus de la scène qu’il a préparée (display ground), marquée par les feuilles coupées et retournées qui font contraste avec la terre. En même temps qu’il chante, il découvre la racine jaune de certaines plumes sous son bec : il se rend visible en même temps que sonore. Son chant forme un motif complexe et varié, tissé de ses notes propres, et de celles d’autres oiseaux qu’il imite dans les intervalles29. Se forme donc un consolidé qui « consiste » en sons spécifiques, sons d’autres espèces, teinte des feuilles, couleur de gorge : l’énoncé machinique ou l’agencement d’énonciation du Scenopoïetes. Nombreux sont les oiseaux qui « imitent » le chant des autres. Mais il n’est pas sûr que l’imitation soit un bon concept pour des phénomènes qui varient d’après l’agencement dans lequel ils entrent. Le sub-song contient des éléments qui peuvent entrer dans des organisations rythmiques et mélodiques distinctes de celles de l’espèce considérée, et fournir ainsi dans le plein-chant de véritables notes étrangères ou ajoutées. Si certains oiseaux comme le pinson paraissent réfractaires à l’imitation, c’est dans la mesure où les sons étrangers qui surviennent éventuellement dans leur sub-song sont éliminés de la consistance du plein-chant. Au contraire, dans les cas où des phrases ajoutées se trouvent prises dans le plein-chant, ce peut être parce qu’il y a un agencement inter-spécifique du type parasitisme, mais aussi parce que l’agencement de l’oiseau effectue lui-même les contre-points de sa mélodie. Thorpe n’a pas tort de dire qu’il y a là un problème d’occupation de fréquences, comme dans les radios (aspect sonore de la territorialité)30. Il s’agit moins d’imiter un chant que d’occuper des fréquences correspondantes ; car il peut être avantageux tantôt de s’en tenir à une zone très déterminée, quand les contre-points sont assurés d’ailleurs, tantôt au contraire d’élargir ou d’approfondir la zone pour assurer soi-même les contre-points et inventer les accords qui resteraient diffus, comme dans la Rain-forest, où l’on rencontre précisément le plus grand nombre d’oiseaux « imitateurs ».
Du point de vue de la consistance, les matières d’expression ne doivent pas être rapportées seulement à leur aptitude à former des motifs et contre-points, mais aux inhibiteurs et aux déclencheurs qui agissent sur elles, et aux mécanismes d’innéité ou d’apprentissage, d’héréditaire ou d’acquis qui les modulent. Seulement, le tort de l’ethologie est d’en rester à une répartition binaire de ces facteurs, même et surtout quand on affirme la nécessité de tenir compte des deux à la fois, et de les mélanger à tous les niveaux d’un « arbre de comportements ». Il faudrait plutôt partir d’une notion positive apte à rendre compte du caractère très particulier que prennent l’inné et l’acquis dans un rhizome, et qui serait comme la raison de leur mélange. Ce n’est pas en termes de comportement qu’on la trouvera, mais en termes d’agencement. Certains auteurs mettent l’accent sur des déroulements autonomes encodés dans des centres (innéité) ; d’autres sur des enchaînements acquis régulés par sensations périphériques (apprentissage). Mais déjà Raymond Ruyer montrait que l’animal était plutôt en proie à des « rythmes musicaux », à des « thèmes rythmiques et mélodiques » qui ne s’expliquent ni par l’encodage d’un disque de phonographe enregistré, ni par les mouvements d’exécution qui les effectuent et les adaptent aux circonstances31. Ce serait même le contraire : les thèmes rythmiques ou mélodiques précèdent leur exécution et leur enregistrement. Il y aurait d’abord consistance d’une ritournelle, d’un petit air, soit sous forme de mélodie mnémique qui n’aurait pas besoin d’être inscrite localement dans un centre, soit sous forme de motif vague qui n’aurait pas besoin d’être déjà pulsé ou stimulé. Une notion poétique et musicale comme celle du Natal – dans le lied, ou bien chez Hölderlin ou encore chez Thomas Hardy – nous apprendrait peut-être plus que les catégories un peu fades et embrouillées d’inné ou d’acquis. Car, dès qu’il y a agencement territorial, on peut dire que l’inné prend une figure très particulière, puisqu’il est inséparable d’un mouvement de décodage, puisqu’il passe en marge du code, contrairement à l’inné du milieu intérieur ; et l’acquisition prend aussi une figure très particulière, puisqu’elle est territorialisée, c’est-à-dire réglée sur des matières d’expression, non plus sur des stimuli du milieu extérieur. Le natal, c’est précisément l’inné, mais l’inné décodé, et c’est précisément l’acquis, mais l’acquis territorialisé. Le natal, c’est cette nouvelle figure que l’inné et l’acquis prennent dans l’agencement territorial. D’où l’affect propre au natal, tel qu’on l’entend dans le lied, d’être toujours perdu, ou retrouvé, ou de tendre vers la patrie inconnue. Dans le natal, l’inné tend à se déplacer : comme dit Ruyer, il est en quelque sorte plus en avant, en aval de l’acte ; il concerne moins l’acte ou le comportement que les matières d’expression même, la perception qui les discerne, les sélectionne, le geste qui les érige, ou qui les constitue par lui-même (c’est pourquoi il y a des « périodes critiques » où l’animal valorise un objet ou une situation, « s’imprègne » d’une matière d’expression, bien avant d’être capable d’exécuter le comportement correspondant). Ce n’est pas dire pourtant que le comportement soit livré aux hasards de l’apprentissage ; car il est prédéterminé par ce déplacement, et trouve dans sa propre territorialisation des règles d’agencement. Le natal consiste donc en un décodage de l’innéité et une territorialisation de l’apprentissage, l’un sur l’autre, l’un avec l’autre. Il y a une consistance du natal qui ne s’explique pas par un mélange d’inné et d’acquis, puisqu’il rend compte au contraire de ces mélanges au sein de l’agencement territorial et des inter-agencements. Bref, c’est la notion de comportement qui se révèle insuffisante, trop linéaire par rapport à celle d’agencement. Le natal va de ce qui se passe dans l’intra-agencement jusqu’au centre qui se projette au-dehors, il parcourt les inter-agencements, il va jusqu’aux portes du Cosmos.
C’est que l’agencement territorial n’est pas séparable des lignes ou coefficients de déterritorialisation, des passages et des relais vers d’autres agencements. On a souvent étudié l’influence de conditions artificielles sur le chant des oiseaux ; mais les résultats varient d’une part avec les espèces, d’autre part avec le genre et le moment des artifices. Beaucoup d’oiseaux sont perméables au chant d’autres oiseaux qu’on leur fait entendre pendant la période critique, et reproduisent ensuite ces chants étrangers. Toutefois, le pinson semble beaucoup plus voué à ses propres matières d’expression, et, même exposé à des sons synthétiques, garde un sens inné de sa propre tonalité. Tout dépend aussi du moment où l’on isole les oiseaux, après ou avant la période critique ; car dans le premier cas, les pinsons développent un chant presque normal, tandis que, dans le second, les sujets du groupe isolé, qui ne peuvent que s’entendre les uns les autres, développent un chant aberrant, non spécifique, et pourtant commun au groupe (cf. Thorpe). C’est que, de toute façon, il faut tenir compte des effets de la déterritorialisation, de la dénatalisation, sur telle espèce et à tel moment. Chaque fois qu’un agencement territorial est pris dans un mouvement qui le déterritorialise (dans des conditions dites naturelles, ou au contraire artificielles), on dirait que se déclenche une machine. C’est même la différence que nous voudrions proposer entre machine et agencement : une machine est comme un ensemble de pointes qui s’insèrent dans l’agencement en voie de déterritorialisation, pour en tracer les variations et mutations. Car il n’y a pas d’effets mécaniques ; les effets sont toujours machiniques, c’est-à-dire dépendent d’une machine en prise sur l’agencement, et libérée par la déterritorialisation. Ce que nous appelons énoncés machiniques, ce sont ces effets de machine qui définissent la consistance où entrent les matières d’expression. De tels effets peuvent être très divers, mais ne sont jamais symboliques ou imaginaires, ils ont toujours une valeur réelle de passage et de relais.
En règle générale, une machine se branche sur l’agencement territorial spécifique, et l’ouvre sur d’autres agencements, le fait passer par les inter-agencements de la même espèce : par exemple, l’agencement territorial d’une espèce d’oiseau s’ouvre sur ses inter-agencements de cour ou de grégarité, en direction du partenaire ou du « socius ». Mais la machine peut également ouvrir l’agencement territorial d’une espèce sur des agencements inter-spécifiques, comme dans le cas des oiseaux qui prennent des chants étrangers, et à plus forte raison dans les cas de parasitisme32. Ou encore, la machine peut déborder tout agencement pour produire une ouverture sur le Cosmos. Ou bien, inversement, au lieu d’ouvrir l’agencement déterritorialisé sur autre chose, elle peut produire un effet de fermeture, comme si l’ensemble tombait et tournait dans une sorte de trou noir : c’est ce qui se produit dans des conditions de déterritorialisation précoce et brutale, et lorsque les voies spécifiques, inter-spécifiques et cosmiques se trouvent barrées ; la machine produit alors des effets « individuels » de groupe, tournant en rond, comme dans le cas des pinsons précocement isolés, dont le chant appauvri, simplifié, n’exprime plus que la résonance du trou noir où ils sont pris. Il est important de retrouver ici cette fonction « trou noir », parce qu’elle est capable de faire mieux comprendre les phénomènes d’inhibition, et de rompre à son tour avec un dualisme trop strict inhibiteur-déclencheur. En effet, les trous noirs font partie des agencements non moins que les lignes de déterritorialisation : nous avons vu précédemment, qu’un inter-agencement pouvait comporter des lignes d’appauvrissement et de fixation, qui conduisent à un trou noir, quitte à être relayée par une ligne de déterritorialisation plus riche ou positive (ainsi la composante « brin d’herbe », chez les Pinsons d’Australie, tombe dans un trou noir, et se fait relayer par la composante « ritournelle »33). Ainsi le trou noir est un effet de machine dans les agencements, qui est dans un rapport complexe avec les autres effets. Il peut arriver que des processus innovateurs aient besoin, pour se déclencher, de tomber dans un trou noir qui fait catastrophe ; des stases d’inhibition s’associent à des déclenchements de comportements-carrefours. En revanche, quand les trous noirs résonnent ensemble, ou que les inhibitions se conjuguent, se font écho, on assiste à une fermeture de l’agencement, comme déterritorialisé dans le vide, au lieu d’une ouverture en consistance : ainsi pour ces groupes isolés de jeunes pinsons. Les machines sont toujours des clefs singulières qui ouvrent ou qui referment un agencement, un territoire. Bien plus, il ne suffit pas de faire intervenir la machine dans un agencement territorial donné ; elle intervient déjà dans l’émergence des matières d’expression, c’est-à-dire dans la constitution de cet agencement, et dans les vecteurs de déterritorialisation qui le travaillent aussitôt.
La consistance des matières d’expression renvoie donc d’une part à leur aptitude à former des thèmes rythmiques et mélodiques, d’autre part à la puissance du natal. Et il y a enfin un autre aspect, qui est leur rapport très spécial avec le moléculaire (la machine nous met justement sur cette voie). Les mots mêmes « matières d’expression » impliquent que l’expression ait avec la matière un rapport original. Au fur et à mesure qu’elles prennent consistance, les matières d’expression constituent des sémiotiques ; mais les composantes sémiotiques ne sont pas séparables de composantes matérielles, et sont singulièrement en prise sur des niveaux moléculaires. Toute la question est donc de savoir si le rapport molaire-moléculaire ne prend pas ici une figure nouvelle. En effet, on a pu distinguer en général des combinaisons « molaire-moléculaire » qui varient beaucoup d’après la direction suivie. En premier lieu : les phénomènes individuels de l’atome peuvent entrer dans des accumulations statistiques ou probabilitaires qui tendent à effacer leur individualité, déjà dans la molécule, puis dans l’ensemble molaire ; mais ils peuvent aussi se compliquer d’interactions, et garder leur individualité au sein de la molécule, puis de la macro-molécule, etc., en composant des communications directes d’individus de différents ordres34. En second lieu : on voit bien que la différence n’est pas entre individuel et statistique ; en fait, il s’agit toujours de populations, la statistique porte sur des phénomènes individuels, tout comme l’individualité anti-statistique n’opère que par populations moléculaires ; la différence est entre deux mouvements de groupe, comme dans l’équation de l’Alembert, où un groupe tend vers des états de plus en plus probables, homogènes et équilibrés (onde divergente et potentiel retardé), mais l’autre groupe vers des états de concentration moins probables (onde convergente et potentiel anticipé)35. En troisième lieu : les forces internes intramoléculaires, qui confèrent à un ensemble sa forme molaire, peuvent être de deux types, ou bien relations localisables, linéaires, mécaniques, arborescentes, covalentes, soumises aux conditions chimiques d’action et de réaction, de réactions enchaînées, ou bien liaisons non localisables, surlinéaires, machiniques et non mécaniques, non covalentes, indirectes, opérant par discernement ou discrimination stéréospécifique plutôt que par enchaînement36.
Il y a là plusieurs manières d’énoncer une même différence, mais cette différence semble beaucoup plus large que celle que nous cherchons : elle concerne en effet la matière et la vie, ou plutôt même, puisqu’il n’y a qu’une seule matière, elle concerne deux états, deux tendances de la matière atomique (par exemple, il y a des liaisons qui immobilisent l’un par rapport à l’autre les atomes associés, et d’autres liaisons qui permettent une libre rotation). Si l’on énonce la différence sous sa forme la plus générale, on dira qu’elle s’instaure entre systèmes stratifiés, systèmes de stratification d’une part, et d’autre part ensembles consistants, auto-consistants. Mais justement la consistance, loin d’être réservée à des formes vitales complexes, concerne déjà pleinement l’atome et les particules les plus élémentaires. Il y a système de stratification codé chaque fois qu’il y a, dans le sens horizontal, des causalités linéaires entre éléments ; et, verticalement, des hiérarchies d’ordre entre groupements ; et, pour tout faire tenir ensemble en profondeur, une succession de formes encadrantes dont chacune informe une substance, et sert à son tour de substance à l’autre. Ces causalités, ces hiérarchies, ces encadrements, constitueront aussi bien une strate que le passage d’une strate à une autre et les combinaisons stratifiées du moléculaire et du molaire. On parlera au contraire d’ensembles de consistance quand on se trouvera devant des consolidés de composantes très hétérogènes, des courts-circuits d’ordre ou même des causalités à l’envers, des captures entre matériaux et forces d’une autre nature, au lieu d’une succession réglée formes-substances : comme si un phylum machinique, une transversalité déstratifiante passait à travers les éléments, les ordres, les formes et les substances, le molaire et le moléculaire, pour libérer une matière et capter des forces.
Or, si nous nous demandons quelle est la « place de la vie » dans cette distinction, nous voyons sans doute qu’elle implique un gain de consistance, c’est-à-dire une plus-value (plus-value de déstratification). Par exemple, elle comporte un plus grand nombre d’ensembles auto-consistants, de processus de consolidation, et leur donne une portée molaire. Elle est déjà déstratifiante, puisque son code n’est pas réparti sur la strate entière, mais occupe une ligne génétique éminemment spécialisée. Pourtant, la question est presque contradictoire, parce que demander quelle est la place de la vie revient à la traiter comme une strate particulière, ayant son ordre et venant à point dans l’ordre, ayant ses formes et ses substances. Et c’est vrai qu’elle est les deux à la fois : un système de stratification particulièrement complexe, et un ensemble de consistance bouleversant les ordres, les formes et les substances. Ainsi nous avons vu comment le vivant opérait un transcodage des milieux qui peut être aussi bien considéré comme constituant une strate que comme opérant des causalités à l’envers et des transversales de déstratification. Du coup, la même question peut être posée quand la vie ne se contente plus de brasser des milieux, mais agence des territoires. L’agencement territorial implique un décodage, et n’est pas lui-même séparable d’une déterritorialisation qui l’affecte (deux nouveaux types de plus-value). On comprend dès lors que l’« éthologie » soit un domaine molaire très privilégié pour montrer comment les composantes les plus diverses, biochimiques, comportementales, perceptives, héréditaires, acquises, improvisées, sociales, etc., peuvent cristalliser dans des agencements qui ne respectent ni la distinction des ordres ni la hiérarchie des formes. Ce qui fait tenir ensemble toutes les composantes, ce sont les transversales, et la transversale elle-même est seulement une composante qui prend sur soi le vecteur spécialisé de déterritorialisation. En effet, ce n’est pas par le jeu des formes encadrantes ou des causalités linéaires qu’un agencement tient, mais par sa composante la plus déterritorialisée, par une pointe de déterritorialisation, actuellement ou potentiellement : par exemple la ritournelle, plus déterritorialisée que le brin d’herbe, ce qui ne l’empêche pas d’être « déterminée », c’est-à-dire en prise sur des composantes biochimiques et moléculaires. L’agencement tient par sa composante la plus déterritorialisée, mais celle-ci ne veut pas dire indéterminé (la ritournelle peut être étroitement connectée à des hormones mâles)37. Une telle composante entrant dans un agencement peut être la plus déterminée, et même mécanisée, elle n’en donne pas moins du « jeu » à ce qu’elle compose, elle favorise l’entrée de nouvelles dimensions des milieux, elle déclenche des processus de discernabilité, de spécialisation, de contraction, d’accélération qui ouvrent de nouveaux possibles, qui ouvrent l’agencement territorial sur des inter-agencements. Revenons au Scenopoïetes : son acte, un de ses actes, consiste à discerner et faire discerner les deux faces de la feuille. Cet acte est en prise sur le déterminisme du bec dentelé. En effet, ce qui définit les agencements, c’est tout à la fois des matières d’expression qui prennent consistance indépendamment du rapport forme-substance ; des causalités à l’envers ou des déterminismes « avancés », des innéismes décodés, qui portent sur des actes de discernement ou d’élection, non plus sur des réactions enchaînées ; des combinaisons moléculaires qui procèdent par liaisons non covalentes et non par relations linéaires ; bref, une nouvelle « allure » produite par le chevauchement du sémiotique et du matériel. C’est en ce sens qu’on peut opposer la consistance des agencements à ce qui était encore la stratification des milieux. Mais, là encore, cette opposition n’est que relative, est toute relative. Tout comme les milieux oscillent entre un état de strate et un mouvement de déstratification, les agencements oscillent entre une fermeture territoriale qui tend à les re-stratifier, et une ouverture déterritorialisante qui les connecte au contraire au Cosmos. Dès lors, il n’est pas étonnant que la différence que nous cherchions soit moins entre les agencements et autre chose qu’entre les deux limites de tout agencement possible, c’est-à-dire entre le système des strates et le plan de la consistance. Et l’on ne doit pas oublier que c’est sur le plan de consistance que les strates durcissent et s’organisent, et que c’est dans les strates que le plan de consistance travaille et se construit, tous les deux pièce à pièce, coup pour coup, opération par opération.
Nous sommes allés des milieux stratifiés aux agencements territorialisés ; et, en même temps, des forces du chaos, telles qu’elles sont ventilées, codées, transcodées par les milieux, jusqu’aux forces de la terre, telles qu’elles sont recueillies dans les agencements. Puis nous sommes allés des agencements territoriaux aux inter-agencements, aux ouvertures d’agencement suivant des lignes de déterritorialisation ; et en même temps, des forces recueillies de la terre jusqu’aux forces d’un Cosmos déterritorialisé, ou plutôt déterritorialisant. Comment Paul Klee présente-t-il ce dernier mouvement, qui n’est plus une « allure » terrestre, mais une « échappée » cosmique ? Et pourquoi un mot si énorme, Cosmos, pour parler d’une opération qui doit être précise ? Klee dit qu’on « exerce un effort par poussées pour décoller de la terre », qu’on « s’élève au-dessus d’elle sous l’empire de forces centrifuges qui triomphent de la pesanteur ». Il ajoute que l’artiste commence par regarder autour de lui, dans tous les milieux, mais pour saisir la trace de la création dans le créé, de la nature naturante dans la nature naturée ; et puis, s’installant « dans les limites de la terre », il s’intéresse au microscope, aux cristaux, aux molécules, aux atomes et particules, non pas pour la conformité scientifique, mais pour le mouvement, rien que pour le mouvement immanent ; l’artiste se dit que ce monde a eu des aspects différents, qu’il en aura d’autres encore, et qu’il y en a déjà d’autres sur d’autres planètes ; enfin, il s’ouvre au Cosmos pour en capter les forces dans une « œuvre » (sans quoi l’ouverture au Cosmos ne serait qu’une rêverie incapable d’élargir les limites de la terre), et pour une telle œuvre il faut des moyens très simples, très purs, presque infantiles, mais il faut aussi les forces d’un peuple, et c’est cela qui manque encore, « il nous manque cette dernière force, nous cherchons ce soutien populaire, nous avons commencé au Bauhaus, nous ne pouvons faire plus...38 ».
Quand on parle de classicisme, on entend un rapport forme-matière, ou plutôt forme-substance, la substance étant précisément une matière informée. Une succession de formes compartimentées, centralisées, hiérarchisées les unes par rapport aux autres, viennent organiser la matière, chacune se chargeant d’une partie plus ou moins importante. Chaque forme est comme le code d’un milieu, et le passage d’une forme à une autre est un véritable transcodage. Même les saisons sont des milieux. Il y a là deux opérations coexistantes, l’une par laquelle la forme se différencie suivant des distinctions binaires, l’autre par laquelle les parties substantielles informées, les milieux ou saisons, entrent dans un ordre de succession qui peut être le même dans les deux sens. Mais, sous ces opérations, l’artiste classique risque une aventure extrême, dangereuse. Il ventile les milieux, les sépare, les harmonise, règle leurs mélanges, passe de l’un à l’autre. Ce qu’il affronte ainsi, c’est le chaos, les forces du chaos, les forces d’une matière brute indomptée, auxquelles les Formes doivent s’imposer pour faire des substances, les Codes, pour faire des milieux. Prodigieuse agilité. C’est en ce sens qu’on n’a jamais pu tracer de frontière bien nette entre le baroque et le classique39. Tout le baroque gronde au fond du classique ; la tâche de l’artiste classique est celle de Dieu même, organiser le chaos, et son seul cri est Création ! la Création ! l’Arbre de la Création ! Une flûte de bois millénaire organise le chaos, mais le chaos est là comme la Reine de la nuit. L’artiste classique procède avec l’Un-Deux : l’un-deux de la différenciation de la forme en tant qu’elle se divise (homme-femme, rythmes masculins et féminins, les voix, les familles d’instruments, toutes les binarités de l’Ars Nova) ; l’un-deux de la distinction des parties en tant qu’elles se répondent (la flûte enchantée et la clochette magique). Le petit air, la ritournelle d’oiseau, est l’unité binaire de création, l’unité différenciante du commencement pur : « D’abord le piano solitaire se plaignit, comme un oiseau abandonné de sa compagne ; le violon l’entendit, lui répondit comme d’un arbre voisin. C’était comme au commencement du monde, comme s’il n’y avait eu qu’eux deux sur la terre, ou plutôt dans ce monde fermé à tout le reste, construit par la logique d’un créateur et où ils ne seraient jamais que tous les deux : cette sonate40. »
Si l’on essaie de définir aussi sommairement le romantisme, on voit bien que tout change. Un cri nouveau retentit : la Terre, le territoire et la Terre ! C’est avec le romantisme que l’artiste abandonne son ambition d’une universalité de droit, et son statut de créateur : il se territorialise, il entre dans un agencement territorial. Les saisons sont maintenant territorialisées. Et sans doute la terre n’est pas la même chose que le territoire. La terre, c’est ce point intense au plus profond du territoire, ou bien projeté hors de lui comme point focal, et où se rassemblent toutes les forces en un corps-à-corps. La terre n’est plus une force parmi les autres, ni une substance informée ou un milieu codé, qui aurait son tour et sa part. La terre est devenue ce corps-à-corps de toutes les forces, celles de la terre comme celles des autres substances, si bien que l’artiste ne se confronte plus au chaos, mais à l’enfer et au souterrain, au sans-fond. Il ne risque plus de se dissiper dans les milieux, mais de s’enfoncer trop loin dans la Terre, Empédocle. Il ne s’identifie plus à la Création, mais au fondement ou à la fondation, c’est la fondation qui est devenue créatrice. Il n’est plus Dieu, mais Héros qui lance à Dieu son défi : Fondons, fondons, et non plus Créons. Faust, surtout le second Faust, est porté par cette tendance. Au dogmatisme, au catholicisme des milieux (code), s’est substitué le criticisme, le protestantisme de la terre. Et certes la Terre comme point intense en profondeur ou en projection, comme ratio essendi, est toujours en décalage par rapport au territoire ; et le territoire, comme condition de « connaissance », ratio cognoscendi, est toujours en décalage par rapport à la terre. Le territoire est allemand, mais la Terre est grecque. Et, justement, c’est ce décalage qui fait le statut de l’artiste romantique, en tant qu’il n’affronte plus la béance du chaos, mais l’attirance du Fond. Le petit air, la ritournelle d’oiseau a changé : elle n’est plus le commencement d’un monde, elle trace sur la terre l’agencement territorial. Du coup, elle n’est plus faite de deux parties consonantes qui se cherchent et se répondent, elle s’adresse à un chant plus profond qui la fonde, mais aussi la heurte, l’emporte et la fait dissonner. La ritournelle est constituée indissolublement par la chanson territoriale et le chant de la terre qui s’élève pour la couvrir. Ainsi, à la fin du Chant de la terre, la coexistence des deux motifs, l’un mélodique évoquant les agencements de l’oiseau, l’autre rythmique, profonde respiration de la terre, éternellement. Mahler dit que le chant des oiseaux, la couleur des fleurs, l’odeur des forêts ne suffisent pas à faire la Nature, il y faut le dieu Dionysos ou le grand Pan. Une Ur-ritournelle de la terre capte toutes les ritournelles territoriales ou autres, et toutes celles des milieux. Dans Wozzeck, la ritournelle berceuse, la ritournelle militaire, la ritournelle à boire, la ritournelle de chasse, la ritournelle enfantine à la fin sont autant d’agencements admirables emportés par la puissante machine de la terre, et par les pointes de cette machine : la voix de Wozzeck par laquelle la terre devient sonore, le cri de mort de Marie qui file sur l’étang, le Si redoublé, quand la terre hurla... C’est ce décalage, ce décodage, qui fait que l’artiste romantique vit le territoire, mais le vit nécessairement comme perdu, et se vit lui-même comme exilé, voyageur, déterritorialisé, repoussé dans les milieux, tel le Hollandais volant ou le roi Voldemar (tandis que le classique habitait les milieux). Mais, en même temps, c’est encore la terre qui commande ce mouvement, c’est l’attraction de la Terre qui fait cette répulsion du territoire. Le poteau indicateur n’indique plus que le chemin d’où nul ne revient. Telle est l’ambiguïté du natal, qui apparaît dans le lied, mais aussi dans la symphonie et l’opéra : le lied est à la fois le territoire, le territoire perdu, la terre vectrice. L’intermezzo allait prendre une importance de plus en plus grande, parce qu’il jouait sur tous les décalages entre la terre et le territoire, s’y intercalait, les remplissait à sa manière, « entre deux heures », « midi-minuit ». De ce point de vue, on peut dire que les innovations fondamentales du romantisme ont consisté en ceci : il n’y avait plus des parties substantielles correspondant à des formes, des milieux correspondant à des codes, une matière en chaos qui se trouverait ordonnée dans les formes et par les codes. Les parties étaient plutôt comme des agencements qui se faisaient et se défaisaient à la surface. La forme elle-même devenait une grande forme en développement continu, recueil des forces de la terre qui prenait en gerbe toutes les parties. La matière elle-même n’était plus un chaos à soumettre et organiser, mais la matière en mouvement d’une variation continue. L’universel était devenu rapport, variation. Variation continue de la matière et développement continu de la forme. À travers les agencements, matière et forme entraient ainsi dans un nouveau rapport : la matière cessait d’être une matière de contenu pour devenir matière d’expression, la forme cessait d’être un code domptant les forces du chaos pour devenir elle-même force, ensemble des forces de la terre. Il y avait un nouveau rapport avec le danger, avec la folie, avec les limites : le romantisme n’allait pas plus loin que le classicisme baroque, mais il allait ailleurs, avec d’autres données et d’autres vecteurs.
Ce qui manque le plus au romantisme, c’est le peuple. Le territoire est hanté par une voix solitaire, à laquelle la voix de la terre fait résonance et percussion, plutôt qu’elle ne lui répond. Même quand il y a un peuple, il est médiatisé par la terre, surgi des entrailles de la terre, et prêt à y retourner : c’est un peuple souterrain plus que terrestre. Le héros est un héros de la terre, mythique, et non du peuple, historique. L’Allemagne, le romantisme allemand, a le génie de vivre le territoire natal non pas comme désert, mais comme « solitaire », quelle que soit la densité de population ; c’est que cette population n’est qu’une émanation de la terre, et vaut pour Un Seul. Le territoire ne s’ouvre pas vers un peuple, il s’entrouvre sur l’Ami, sur l’Aimée, mais l’Aimée est déjà morte, et l’Ami, incertain, inquiétant41. À travers le territoire tout se passe, comme dans un lied, entre l’Un-Seul de l’âme et l’Un-Tout de la terre. C’est pourquoi le romantisme prend une autre allure, et même réclame un autre nom, une autre pancarte, dans les pays latins et les pays slaves où tout passe au contraire par le thème d’un peuple, et des forces d’un peuple. Cette fois, c’est la terre qui est médiatisée par le peuple et n’existe que par lui. Cette fois, la terre peut être « déserte », steppe aride, ou bien territoire démembré, ravagé, elle n’est jamais solitaire, mais pleine d’une population qui nomadise, se sépare ou se regroupe, revendique ou pleure, attaque ou subit. Cette fois, le héros est un héros du peuple, et non plus de la terre ; il est en rapport avec l’Un-Foule, non plus avec l’Un-Tout. On ne dira certes pas qu’il y a plus ou moins de nationalisme d’un côté ou de l’autre, car le nationalisme est partout dans les figures du romantisme, tantôt comme un moteur, tantôt comme trou noir (et le fascisme utilisa beaucoup moins Verdi que le nazisme Wagner). Le problème est vraiment musical, techniquement musical, d’autant plus politique par là. Le héros romantique, la voix romantique du héros, agit comme sujet, comme individu subjectivé, ayant des « sentiments » ; mais cet élément vocal subjectif se réfléchit dans un ensemble instrumental et orchestral qui mobilise au contraire des « affects » non subjectivés, et qui prend toute son importance avec le romantisme. Or on ne croira pas que les deux, l’élément vocal et l’ensemble orchestral-instrumental, soient simplement dans un rapport extrinsèque : l’orchestration impose à la voix tel ou tel rôle, autant que la voix enveloppe tel ou tel mode d’orchestration. L’orchestration-instrumentation réunit ou sépare, rassemble ou disperse des forces sonores ; mais elle change, et le rôle de la voix change aussi, suivant que ces forces sont celles de la Terre ou celles du Peuple, de l’Un-Tout ou de l’Un-Foule. Dans un cas, il s’agit d’opérer des groupements de puissances qui constituent précisément les affects ; dans l’autre cas, ce sont des individuations de groupe qui constituent l’affect et font l’objet de l’orchestration. Les groupements de puissance sont pleinement diversifiés, mais ils le sont comme les rapports propres de l’Universel ; tandis que, dans les individuations de groupe, il faudrait invoquer un autre mot, le Dividuel, pour désigner cet autre type de rapports musicaux, et ces passages intra-groupe ou inter-groupes. L’élément subjectif ou sentimental de la voix n’a pas le même rôle et la même position suivant qu’il affronte intérieurement les groupements de puissance non subjectivés ou les individuations non subjectivées de groupe, les rapports de l’universel ou les rapports du « dividuel ». Debussy posait bien le problème de l’Un-Foule lorsqu’il reprochait à Wagner de ne pas savoir « faire » une foule ou un peuple : il faut qu’une foule soit pleinement individuée, mais par des individuations de groupe, qui ne se réduisent pas à l’individualité des sujets qui la composent42. Le peuple doit s’individuer, non pas d’après les personnes, mais d’après les affects qu’il éprouve simultanément et successivement. On rate donc aussi bien l’Un-Foule ou le Dividuel quand on réduit le peuple à une juxtaposition, et quand on le réduit à une puissance de l’universel. Bref, il y a comme deux conceptions très différentes de l’orchestration, et du rapport voix-instrument, suivant qu’on s’adresse aux forces de la Terre, ou bien aux forces du Peuple, pour les rendre sonores. L’exemple le plus simple de cette différence serait sans doute Wagner-Verdi, dans la mesure où Verdi donne de plus en plus d’importance aux rapports de la voix avec l’instrumentation et l’orchestration. Aujourd’hui même, Stockhausen et Berio élaborent une nouvelle version de cette différence, bien qu’ils affrontent un problème musical distinct de celui du romantisme (il y a chez Berio la recherche d’un cri multiple, d’un cri de population, dans le dividuel de l’Un-Foule, et non pas d’un cri de la terre dans l’universel de l’Un-Tout). Or l’idée d’un Opéra du monde, ou d’une musique cosmique, et le rôle de la voix, changent singulièrement suivant ces deux pôles de l’orchestration43. Pour ne pas s’en tenir à une simple opposition Wagner-Verdi, il faudrait montrer comment l’orchestration de Berlioz a su avec génie passer, ou même hésiter, d’un pôle à l’autre, Nature ou Peuple sonores. Comment une musique comme celle de Moussorgski a su faire foule (quoi qu’en dise Debussy). Comment une musique comme celle de Bartók a pu s’appuyer sur des airs populaires ou de population, pour faire des populations elles-mêmes sonores, instrumentales et orchestrales qui imposent une nouvelle gamme du Dividuel, un nouveau prodigieux chromatisme44. L’ensemble des voies non wagnériennes...
S’il y a un âge moderne, c’est, bien sûr, celui du cosmique. Paul Klee se déclare anti-faustien, « les bêtes et toutes les autres créatures, je ne les aime pas avec une cordialité terrestre, les choses terrestres m’intéressent moins que les choses cosmiques ». L’agencement n’affronte plus les forces du chaos, il ne s’approfondit plus dans les forces de la terre ou dans les forces du peuple, mais il s’ouvre sur les forces du Cosmos. Tout cela semble d’une extrême généralité, et comme hégélien, témoignant d’un Esprit absolu. Et pourtant c’est, ce devrait être de la technique, rien que de la technique. Le rapport essentiel n’est plus matières-formes (ou substances-attributs) ; mais il n’est pas davantage dans le développement continu de la forme et la variation continue de la matière. Il se présente ici comme un rapport direct matériau-forces. Le matériau, c’est une matière molécularisée, et qui doit à ce titre « capter » des forces, lesquelles ne peuvent plus être que des forces du Cosmos. Il n’y a plus de matière qui trouverait dans la forme son principe d’intelligibilité correspondant. Il s’agit maintenant d’élaborer un matériau chargé de capter des forces d’un autre ordre : le matériau visuel doit capturer des forces non visibles. Rendre visible, disait Klee, et non pas rendre ou reproduire le visible. Dans cette perspective, la philosophie suit le même mouvement que les autres activités ; alors que la philosophie romantique invoquait encore une identité synthétique formelle assurant une intelligibilité continue de la matière (synthèse a priori), la philosophie moderne tend à élaborer un matériau de pensée pour capturer des forces non pensables en elles-mêmes. C’est la philosophie-Cosmos, à la manière de Nietzsche. Le matériau moléculaire est même tellement déterritorialisé qu’on ne peut plus parler de matières d’expression, comme dans la territorialité romantique. Les matières d’expression font place à un matériau de capture. Dès lors, les forces à capturer ne sont plus celles de la terre, qui constituent encore une grande Forme expressive, ce sont maintenant les forces d’un Cosmos énergétique, informel et immatériel. Il arrive au peintre Millet de dire que ce qui compte en peinture, ce n’est pas ce que porte un paysan, par exemple, objet sacré ou sac de pommes de terre, mais le poids exact de ce qu’il porte. C’est le tournant postromantique : l’essentiel n’est plus dans les formes et les matières, ni dans les thèmes, mais dans les forces, les densités, les intensités. La terre elle-même bascule, et tend à valoir comme le pur matériau d’une force gravifique ou de pesanteur. Peut-être faudra-t-il attendre Cézanne pour que les rochers n’existent plus que par les forces de plissement qu’ils captent, les paysages par des forces magnétiques et thermiques, les pommes par des forces de germination : forces non visuelles, et pourtant rendues visibles. C’est en même temps que les forces deviennent nécessairement cosmiques, et le matériau moléculaire ; une force immense opère dans un espace infinitésimal. Le problème n’est plus d’un commencement, pas davantage celui d’une fondation-fondement. C’est devenu un problème de consistance ou de consolidation : comment consolider le matériau, le rendre consistant, pour qu’il puisse capter ces forces non sonores, non visibles, non pensables ? Même la ritournelle devient à la fois moléculaire et cosmique, Debussy... La musique molécularise la matière sonore, mais devient capable ainsi de capter des forces non sonores comme la Durée, l’Intensité45. Rendre la Durée sonore. Rappelons-nous l’idée de Nietzsche : l’éternel retour comme petite rengaine, comme ritournelle, mais qui capture les forces muettes et impensables du Cosmos. On sort donc des agencements pour entrer dans l’âge de la Machine, immense mécanosphère, plan de cosmicisation des forces à capter. Exemplaire serait la démarche de Varèse, à l’aube de cet âge : une machine musicale de consistance, une machine à sons (non pas à reproduire les sons), qui molécularise et atomise, ionise la matière sonore, et capte une énergie de Cosmos46. Si cette machine doit avoir un agencement, ce sera le synthétiseur. Assemblant les modules, les éléments de source et de traitement, les oscillateurs, générateurs et transformateurs, aménageant les micro-intervalles, il rend audible le processus sonore lui-même, la production de ce processus, et nous met en relation avec d’autres éléments encore qui dépassent la matière sonore47. Il unit les disparates dans le matériau, et transpose les paramètres d’une formule à une autre. Le synthétiseur, avec son opération de consistance, a pris la place du fondement dans le jugement synthétique a priori : la synthèse y est du moléculaire et du cosmique, du matériau et de la force, non plus de la forme et de la matière, du Grund et du territoire. La philosophie, non plus comme jugement synthétique, mais comme synthétiseur de pensées, pour faire voyager la pensée, la rendre mobile, en faire une force du Cosmos (de même on fait voyager le son...).
Cette synthèse des disparates n’est pas sans équivoque. C’est peut-être la même équivoque qu’on trouve dans la valorisation moderne des dessins d’enfant, des textes fous, des concerts de bruits. Il arrive qu’on en fasse trop, qu’on en rajoute, on opère avec un fouillis de lignes ou de sons ; mais alors, au lieu de produire une machine cosmique, capable de « rendre sonore », on retombe dans une machine de reproduction, et qui finit par reproduire seulement un gribouillage effaçant toutes les lignes, un brouillage effaçant tous les sons. On prétend ouvrir la musique à tous les événements, à toutes les irruptions, mais, ce qu’on reproduit finalement, c’est le brouillage qui empêche tout événement. On n’a plus qu’une caisse de résonance en train de faire trou noir. Un matériau trop riche est un matériau qui reste trop « territorialisé », sur les sources de bruit, sur la nature des objets... (même le piano préparé de Cage). On rend flou un ensemble, au lieu de définir l’ensemble flou par les opérations de consistance ou de consolidation qui portent sur lui. Car c’est cela l’essentiel : un ensemble flou, une synthèse de disparates n’est défini que par un degré de consistance rendant précisément possible la distinction des éléments disparates qui le constituent (discernabilité)48. Il faut que le matériau soit suffisamment déterritorialisé pour être molécularisé, et s’ouvrir à du cosmique, au lieu de retomber dans un amas statistique. Or on ne remplit cette condition que par une certaine simplicité dans le matériau non uniforme : maximum de sobriété calculé par rapport aux disparates ou aux paramètres. C’est la sobriété des agencements qui rend possible la richesse des effets de la Machine. On a souvent trop tendance à se reterritorialiser sur l’enfant, le fou, le bruit. À ce moment-là on fait flou, au lieu de faire consister l’ensemble flou, ou de capter les forces cosmiques dans le matériau déterritorialisé. C’est pourquoi Paul Klee se met fort en colère quand on parle de l’« infantilisme » de son dessin (de même Varèse, quand on parle de bruitage, etc.). Selon Klee, il faut une ligne pure et simple, jointe à une idée d’objet, et rien de plus, pour « rendre visible », ou capter du Cosmos : on n’obtient rien, sauf un brouillage, un bruitage visuel, si l’on multiplie les lignes et si l’on prend tout l’objet49. Selon Varèse, il faut une figure simple en mouvement, et un plan lui-même mobile, pour que la projection donne une forme hautement complexe, c’est-à-dire une distribution cosmique ; sinon, c’est du bruitage. Sobriété, sobriété : c’est la condition commune pour la déterritorialisation des matières, la molécularisation du matériau, la cosmicisation des forces. Peut-être l’enfant y arrive-t-il. Mais cette sobriété, c’est celle d’un devenir-enfant, qui n’est pas nécessairement le devenir de l’enfant, au contraire ; celle d’un devenir-fou, qui n’est pas nécessairement le devenir du fou, au contraire. Il est évident qu’il faut un son très pur et simple, une émission ou une onde sans harmoniques, pour que le son voyage, et qu’on voyage autour du son (réussite de La Monte Young à cet égard). Vous trouverez d’autant plus de disparates que vous serez dans une atmosphère raréfiée. Votre synthèse de disparates sera d’autant plus forte que vous opérerez avec un geste sobre, un acte de consistance, de capture ou d’extraction qui travaillera sur un matériau non pas sommaire, mais prodigieusement simplifié, créativement limité, sélectionné. Car il n’y a d’imagination que dans la technique. La figure moderne n’est pas celle de l’enfant ni du fou, encore moins celle de l’artiste, c’est celle de l’artisan cosmique : une bombe atomique artisanale, c’est très simple en vérité, cela a été prouvé, cela a été fait. Être un artisan, non plus un artiste, un créateur ou un fondateur, et c’est la seule manière de devenir cosmique, de sortir des milieux, de sortir de la terre. L’invocation au Cosmos n’opère pas du tout comme une métaphore ; au contraire, l’opération est effective dès que l’artiste met en rapport un matériau avec des forces de consistance ou de consolidation.
Le matériau a donc trois caractères principaux : c’est une matière molécularisée ; il est en rapport avec des forces à capter ; il se définit par les opérations de consistance qui portent sur lui. Il est évident enfin que le rapport avec la terre, avec le peuple, change, et n’est plus du type romantique. La terre, c’est maintenant la plus déterritorialisée : non seulement un point dans une galaxie, mais une galaxie parmi d’autres. Le peuple, c’est maintenant le plus molécularisé : une population moléculaire, un peuple d’oscillateurs qui sont autant de forces d’interaction. L’artiste dépouille ses figures romantiques, il renonce aux forces de la terre non moins qu’aux forces du peuple. C’est que le combat, si combat il y a, est passé ailleurs. Les pouvoirs établis ont occupé la terre, et ils ont fait des organisations de peuple. Les mass media, les grandes organisations du peuple, du type parti ou syndicat, sont des machines à reproduire, des machines à faire le flou, et qui opèrent effectivement le brouillage de toutes les forces terrestres populaires. Les pouvoirs établis nous ont mis dans la situation d’un combat à la fois atomique et cosmique, galaxique. Beaucoup d’artistes ont pris conscience de cette situation depuis longtemps, et avant même qu’elle ne fût installée (par exemple Nietzsche). Et ils pouvaient en prendre conscience parce que le même vecteur traversait leur propre domaine : une molécularisation, une atomisation du matériau jointe à une cosmicisation des forces prises dans ce matériau. Dès lors, la question était de savoir si les « populations » atomiques ou moléculaires de toute nature (mass media, moyens de contrôle, ordinateurs, armes supraterrestres) allaient continuer à bombarder le peuple existant, soit pour le dresser, soit pour le contrôler, soit pour l’anéantir, – ou bien si d’autres populations moléculaires étaient possibles, pouvaient se glisser parmi les premières, et susciter un peuple à venir. Comme dit Virilio, dans son analyse très rigoureuse de la dépopulation du peuple et de la déterritorialisation de la terre, la question est : « Habiter en poète ou en assassin50 ? » L’assassin est celui qui bombarde le peuple existant, avec des populations moléculaires qui ne cessent de refermer tous les agencements, de les précipiter dans un trou noir de plus en plus vaste et profond. Le poète au contraire est celui qui lâche des populations moléculaires dans l’espoir qu’elles ensemencent ou même engendrent le peuple à venir, qu’elles passent dans un peuple à venir, qu’elles ouvrent un cosmos. Et là encore il ne faut pas traiter le poète comme s’il se gorgeait de métaphores : il n’est pas sûr que les molécules sonores de la pop’music n’essaiment pas, ici ou là, actuellement, un peuple d’un nouveau type, singulièrement indifférent aux ordres de la radio, aux contrôles des ordinateurs, aux menaces de la bombe atomique. C’est en ce sens que le rapport des artistes avec le peuple a beaucoup changé : l’artiste a cessé d’être l’Un-Seul retiré en lui-même, mais il a cessé aussi de s’adresser au peuple, d’invoquer le peuple comme force constituée. Jamais il n’a eu autant besoin d’un peuple, mais il constate au plus haut point que le peuple manque, – le peuple, c’est ce qui manque le plus. Ce ne sont pas des artistes populaires ou populistes, c’est Mallarmé qui peut dire que le Livre a besoin du peuple, et Kafka, que la littérature est l’affaire du peuple, et Klee, que le peuple est l’essentiel, et pourtant qu’il manque. Le problème de l’artiste est donc que la dépopulation moderne du peuple débouche sur une terre ouverte, et cela avec les moyens de l’art, ou avec des moyens auxquels l’art contribue. Au lieu que le peuple et la terre soient bombardés de toutes parts dans un cosmos qui les borne, il faut que le peuple et la terre soient comme les vecteurs d’un cosmos qui les emporte ; alors le cosmos sera lui-même art. Faire de la dépopulation un peuple cosmique, et de la déterritorialisation une terre cosmique, tel est le vœu de l’artiste-artisan, ici ou là, localement. Si nos gouvernements ont affaire avec du moléculaire et du cosmique, nos arts aussi y trouvent leur affaire, avec le même enjeu, le peuple et la terre, avec des moyens incomparables, hélas, et pourtant compétitifs. N’est-ce pas le propre des créations d’opérer en silence, localement, de chercher partout une consolidation, d’aller du moléculaire à un cosmos incertain, tandis que les processus de destruction et de conservation travaillent en gros, tiennent le devant de la scène, occupent tout le cosmos pour asservir le moléculaire, le mettre dans un conservatoire ou dans une bombe ?
Ces trois « âges », le classique, le romantique et le moderne (faute d’un autre nom), il ne faut pas les interpréter comme une évolution, ni comme des structures, avec des coupures signifiantes. Ce sont des agencements, qui enveloppent des Machines différentes, ou des rapports différents avec la Machine. En un sens, tout ce que nous prêtons à un âge était déjà présent dans l’âge précédent. Ainsi les forces : la question a toujours été celle des forces, assignées comme forces du chaos, ou comme forces de la terre. De même, c’est de tout temps que la peinture s’est proposée de rendre visible, au lieu de reproduire le visible, et la musique de rendre sonore, au lieu de reproduire le sonore. Des ensembles flous n’ont pas cessé de se constituer, et d’inventer leurs processus de consolidation. Et une libération du moléculaire, on la trouve déjà dans les matières de contenu classiques, opérant par déstratification, et dans les matières d’expression romantiques, opérant par décodage. Tout ce qu’on peut dire, c’est que, tant que les forces apparaissent comme de la terre ou du chaos, elles ne sont pas saisies directement comme forces, mais réfléchies dans des rapports de la matière et de la forme. Il s’agit donc plutôt de seuils de perception, de seuils de discernabilité, qui appartiennent à tel ou tel agencement. C’est seulement quand la matière est suffisamment déterritorialisée qu’elle surgit elle-même comme moléculaire, et fait surgir de pures forces qui ne peuvent plus être attribuées qu’au Cosmos. Cela était déjà présent « de tout temps », mais dans d’autres conditions perceptives. Il faut de nouvelles conditions pour que ce qui était enfoui ou recouvert, inféré, conclu, passe maintenant à la surface. Ce qui était composé dans un agencement, ce qui n’était encore que composé, devient composante d’un nouvel agencement. En ce sens, il n’y a guère d’histoire que de la perception, tandis que ce dont on fait l’histoire est plutôt la matière d’un devenir, non pas d’une histoire. Le devenir serait comme la machine, différemment présente dans chaque agencement, mais passant de l’un à l’autre, ouvrant l’un sur l’autre, indépendamment d’un ordre fixe ou d’une succession déterminée.
Alors nous pouvons revenir à la ritournelle. Nous pouvons en proposer une autre classification : les ritournelles de milieux, avec deux parties au moins, où l’une répond à l’autre (le piano et le violon) ; les ritournelles du natal, du territoire, où la partie est en rapport avec un tout, avec une immense ritournelle de la terre, suivant des rapports eux-mêmes variables qui marquent chaque fois le décalage de la terre au territoire (la berceuse, la chanson à boire, la chanson de chasse, de travail, la militaire, etc.) ; les ritournelles populaires et folkloriques, elles-mêmes en rapport avec un immense chant du peuple, suivant les rapports variables d’individuations de foule qui jouent à la fois des affects et des nations (la Polonaise, l’Auvergnate, l’Allemande, la Magyare ou la Roumaine, mais aussi la Pathétique, la Panique, la Vengeresse..., etc.) ; les ritournelles molécularisées (la mer, le vent) en rapport avec des forces cosmiques, avec la ritournelle-Cosmos. Car le Cosmos est lui-même une ritournelle, et l’oreille aussi (tout ce qu’on a pris pour des labyrinthes, c’étaient des ritournelles). Mais justement, pourquoi la ritournelle est-elle éminemment sonore ? D’où vient ce privilège de l’oreille alors que les animaux déjà, les oiseaux, nous présentent tant de ritournelles gestuelles, posturales, chromatiques, visuelles ? Le peintre a-t-il moins de ritournelles que le musicien ? Y a-t-il moins de ritournelles chez Cézanne ou chez Klee que chez Mozart, Schumann ou Debussy ? Dans les exemples de Proust : le petit pan de mur jaune de Vermeer, ou bien les fleurs d’un peintre, les roses d’Elstir, font-ils moins « ritournelle » que la petite phrase de Vinteuil ? Il ne s’agit certes pas de décerner la suprématie à tel art en fonction d’une hiérarchie formelle et de critères absolus. Le problème, plus modeste, serait de comparer les puissances ou coefficients de déterritorialisation des composantes sonores et des composantes visuelles. Il semble que le son, en se déterritorialisant, s’affine de plus en plus, se spécifie et devienne autonome. Tandis que la couleur colle davantage, non pas forcément à l’objet, mais à la territorialité. Quand elle se déterritorialise, elle tend à se dissoudre, à se laisser piloter par d’autres composantes. On le voit bien dans les phénomènes de synesthésie, qui ne se réduisent pas à une simple correspondance couleur-son, mais où les sons tiennent le rôle-pilote et induisent des couleurs qui se superposent aux couleurs vues, leur communiquant un rythme et un mouvement proprement sonores51. Cette puissance, le son ne la doit pas à des valeurs signifiantes ou de « communication » (qui la supposent, au contraire), ni à des propriétés physiques (qui donneraient plutôt le privilège à la lumière). C’est une ligne phylogénique, un phylum machinique, qui passe par le son, et en fait une pointe de déterritorialisation. Et cela ne va pas sans de grandes ambiguïtés : le son nous envahit, nous pousse, nous entraîne, nous traverse. Il quitte la terre, mais aussi bien pour nous faire tomber dans un trou noir que pour nous ouvrir à un cosmos. Il nous donne l’envie de mourir. Ayant la plus grande force de déterritorialisation, il opère aussi les reterritorialisations les plus massives, les plus hébétées, les plus redondantes. Extase et hypnose. On ne fait pas bouger un peuple avec des couleurs. Les drapeaux ne peuvent rien sans les trompettes, les lasers se modulent sur le son. La ritournelle est sonore par excellence, mais elle développe sa force aussi bien dans une chansonnette visqueuse que dans le motif le plus pur ou la petite phrase de Vinteuil. Et parfois l’un dans l’autre : comment Beethoven devient un « indicatif ». Fascisme potentiel de la musique. On peut dire en gros que la musique est branchée sur un phylum machinique infiniment plus puissant que celui de la peinture : ligne de pression sélective. C’est pourquoi le musicien n’a pas avec le peuple, avec les machines, avec les pouvoirs établis, le même rapport que le peintre. Notamment, les pouvoirs éprouvent un vif besoin de contrôler la distribution des trous noirs et des lignes de déterritorialisation dans ce phylum de sons, pour conjurer ou s’approprier les effets du machinisme musical. Le peintre, au moins dans l’image qu’on s’en fait, peut être beaucoup plus ouvert socialement, beaucoup plus politique, et moins contrôlé du dehors et du dedans. C’est parce qu’il a lui-même à créer ou recréer chaque fois un phylum, et doit chaque fois le faire à partir des corps de lumière et de couleur qu’il produit, tandis que le musicien dispose au contraire d’une sorte de continuité germinale, même latente, même indirecte, à partir de laquelle il produit ses corps sonores. Ce n’est pas le même mouvement de création : l’un va du soma au germen, et l’autre, du germen au soma. La ritournelle du peintre est comme l’envers de celle du musicien, un négatif de la musique.
Mais, de toute façon, qu’est-ce qu’une ritournelle ? Glass harmonica : la ritournelle est un prisme, un cristal d’espace-temps. Elle agit sur ce qui l’entoure, son ou lumière, pour en tirer des vibrations variées, des décompositions, projections et transformations. La ritournelle a aussi une fonction catalytique : non seulement augmenter la vitesse des échanges et réactions dans ce qui l’entoure, mais assurer des interactions indirectes entre éléments dénués d’affinité dite naturelle, et former par là des masses organisées. La ritournelle serait donc du type cristal ou protéine. Quant au germe ou à la structure internes, ils auraient alors deux aspects essentiels : les augmentations et diminutions, ajouts et retraits, amplifications et éliminations par valeurs inégales, mais aussi la présence d’un mouvement rétrograde qui va dans les deux sens, comme « sur les vitres latérales d’un tramway en marche ». L’étrange mouvement rétrogradé de Joke. Il appartient à la ritournelle de se concentrer par élimination sur un moment extrêmement bref, comme des extrêmes à un centre, ou au contraire de se développer par ajouts qui vont d’un centre aux extrêmes, mais aussi de parcourir ces chemins dans les deux sens52. La ritournelle fabrique du temps. Elle est le « temps impliqué » dont parlait le linguiste Guillaume. Alors l’ambiguïté apparaît mieux : car, si le mouvement rétrograde ne forme qu’un cercle fermé, si les augmentations et diminutions se font seulement par valeurs régulières, par exemple du double ou de la moitié, cette fausse rigueur spatio-temporelle laisse d’autant plus dans le flou l’ensemble extérieur, qui n’a plus avec le germe que des rapports associatifs, indicatifs ou descriptifs – « un chantier d’inauthentiques éléments pour la formation d’impurs cristaux » –, au lieu du pur cristal qui capte des forces cosmiques. La ritournelle reste à l’état de formule évoquant un personnage ou un paysage, au lieu de faire elle-même un personnage rythmique, un paysage mélodique. C’est donc comme deux pôles de la ritournelle. Et ces deux pôles ne dépendent pas seulement d’une qualité intrinsèque, mais aussi d’un état de force de celui qui écoute : ainsi la petite phrase de la sonate de Vinteuil reste longtemps associée à l’amour de Swann, au personnage d’Odette et au paysage du bois de Boulogne, jusqu’à ce qu’elle tourne sur elle-même, s’ouvre sur elle-même pour révéler des potentialités jusqu’alors inouïes, entrer dans d’autres connexions, faire dériver l’amour vers d’autres agencements. Il n’y a pas le Temps comme forme a priori, mais la ritournelle est la forme a priori du temps, qui fabrique chaque fois des temps différents.
C’est curieux comme la musique n’élimine pas la ritournelle médiocre ou mauvaise, ou le mauvais usage de la ritournelle, mais l’entraîne au contraire, ou s’en sert comme d’un tremplin. « Ah vous dirai-je maman... », « Elle avait une jambe de bois... », « Frère Jacques... ». Ritournelle d’enfance ou d’oiseau, chant folklorique, chanson à boire, valse de Vienne, clochettes à vache, la musique se sert de tout et emporte tout. Ce n’est pas qu’un air d’enfant, d’oiseau ou de folklore, se réduise à la formule associative et fermée dont nous parlions tout à l’heure. Il faudrait plutôt montrer comment un musicien a besoin d’un premier type de ritournelle, ritournelle territoriale ou d’agencement, pour la transformer du dedans, la déterritorialiser, et produire enfin une ritournelle du second type, comme but final de la musique, ritournelle cosmique d’une machine à sons. D’un type à l’autre, Gisèle Brelet a bien posé le problème à propos de Bartók : comment, à partir des mélodies territoriales et populaires, autonomes, suffisantes, fermées sur soi comme des modes, construire un nouveau chromatisme qui les fasse communiquer, et créer ainsi des « thèmes » qui assurent un développement de la Forme ou plutôt un devenir des Forces ? Le problème est général puisque, dans beaucoup de directions, des ritournelles vont être ensemencées par un nouveau germe qui retrouve les modes et les rend communiquants, défait le tempérament, fond le majeur et le mineur, fait fuir le système tonal, passe à travers ses mailles plutôt que de rompre avec lui53. On peut dire : vive Chabrier contre Schoenberg, comme Nietzsche disait vive Bizet, et pour les mêmes raisons, dans la même intention musicale et technique. On va du modal à un chromatisme élargi non tempéré. On n’a pas besoin de supprimer le tonal, on a besoin de le faire fuir. On va des ritournelles agencées (territoriales, populaires, amoureuses, etc.) à la grande ritournelle machinée cosmique. Mais le travail de création se fait déjà dans les premières, il est là tout entier. Dans la petite forme-ritournelle ou rondeau, s’introduisent déjà les déformations qui vont capter une grande force. Scènes d’enfance, jeux d’enfant : on part d’une ritournelle enfantine, mais l’enfant a déjà des ailes, il devient céleste. Le devenir-enfant du musicien se double d’un devenir-aérien de l’enfant, dans un bloc indécomposable. Mémoire d’un ange, c’est plutôt devenir pour un cosmos. Cristal : le devenir-oiseau de Mozart ne se sépare pas d’un devenir initié de l’oiseau, et fait bloc avec lui54. C’est le travail extrêmement profond sur le premier type de ritournelles qui va créer le second type, c’est-à-dire la petite phrase du Cosmos. Dans un concerto, Schumann a besoin de tous les agencements de l’orchestre pour faire que le violoncelle erre, comme une lumière s’éloigne ou s’éteint. Chez Schumann, c’est tout un travail mélodique, harmonique et rythmique savant, qui aboutit à ce résultat simple et sobre, déterritorialiser la ritournelle55. Produire une ritournelle déterritorialisée, comme but final de la musique, la lâcher dans le Cosmos, c’est plus important que de faire un nouveau système. Ouvrir l’agencement sur une force cosmique. De l’un à l’autre, de l’agencement des sons à la Machine qui rend sonore – du devenir-enfant du musicien au devenir-cosmique de l’enfant –, beaucoup de dangers surgissent : les trous noirs, les fermetures, les paralysies du doigt et les hallucinations de l’ouïe, la folie de Schumann, la force cosmique devenue mauvaise, une note qui vous poursuit, un son qui vous transperce. Et pourtant l’une était déjà dans l’autre, la force cosmique était dans le matériau, la grande ritournelle dans les petites ritournelles, la grande manœuvre dans la petite manœuvre. Seulement on n’est jamais sûr d’être assez fort, puisqu’on n’a pas de système, on n’a que des lignes et des mouvements. Schumann.