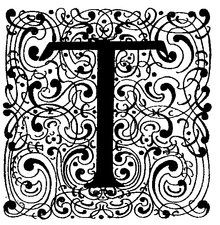
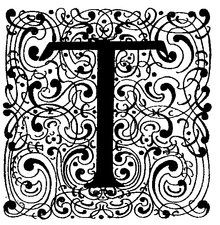
Tapis volant
Tapis volant ou, comme le note en particulier Stendhal, « tapis magique » : « avoir le tapis magique… », in Romans et Nouvelles. Et le prince Hassan, à son tour, prit la parole et dit : « En vérité, ô mon frère, ce tapis volant est une chose prodigieuse et, de ma vie, je n’en ai vu de semblable ! » (Histoire de la Princesse Nour An-Nahar et la belle Gennia, trad. Mardrus). Je pense que nous n’en avons pas encore fini avec l’aviation, une jeune industrie qui fera encore de nombreuses prouesses, comme la poussée thermonucléaire, l’énergie éolienne et solaire, ou les deux combinées. Toutes sortes de machines plus futuristes les unes que les autres ou, version écolo, plus épurées les unes que les autres, verront incessamment le jour, car pour toute industrie humaine, le développement est une nécessité vitale. Et, pourquoi pas, un jour, rattraper le génie des Mille et Une Nuits, leur imaginaire tout au moins, et créer des tapis volants, avec une pile minuscule, peut-être un moteur qui se déploie après une première propulsion ou encore une aile delta retenue par des fils à un tapis immense. D’autant que les dessins existent déjà, et pas seulement pour les tapis, car les lits, les canapés, les chevaux et même les palais se donnent eux aussi des ailes et volent au-dessus des vallées, franchissent les montagnes et perturbent la cérémonie des royaumes voisins. Dans une gravure de Maurand (Paris, 1865), on voit très clairement deux personnages en train de deviser sur un tapis volant extrêmement vif qui franchissait de grandes distances. Dans une illustration de Dulac (Londres 1907), un cheval ailé, dit Cheval d’Ébène, dispose de deux voiles nervurées qui n’ont rien à envier aux innovations des parachutistes d’aujourd’hui. En 1915, à Londres, Charles Robinson peint un tapis volant collectif puisqu’il est la monture choisie par deux princes affublés de leur serviteur. Enfin, plusieurs films comme Le Voleur de Bagdad, de Ludwig Berger, ou Les Mille et Une Nuits, de Philippe de Broca, ont popularisé cet accessoire magique.

Le tapis volant est la version arabe du mythe d’Icare. L’imagination du conteur trouve ici un cadre majeur où elle peut s’illustrer et donner sa pleine mesure, car le transport magique est un ingrédient très apprécié des conteurs. Huit cas sont identifiés dans Les Mille et Une Nuits : un tapis magique transporte Hossaïn et ses deux frères ; un cheval enchanté transporte Bolouqiya ; un oiseau fantastique, Rokh, transporte Sindbad vers la vallée de diamants ; la mule de Jaudar fait en un jour le trajet d’une année entière. « Sache, dit le crieur, dans l’histoire de la princesse Nour An-Nahar, que ce tapis est doué d’une vertu invisible qui fait qu’en s’y asseyant on est aussitôt transporté où l’on souhaite aller, et avec une rapidité telle qu’on n’a pas le temps de fermer un œil et d’ouvrir l’autre ! » Les transports magiques sont un avatar de la montée au ciel du Prophète. C’est ce que les Arabes appellent le mi’raj. À la suite d’un rêve prémonitoire, Mohammed a enfourché Bouraq, son cheval ailé, et quitté La Mecque dans un voyage qui allait d’abord le transporter à Jérusalem, puis au septième ciel. Ce voyage céleste est l’ancêtre de tous les voyages réalisés depuis dans l’espace musulman. Pour leur inspiration, les conteuses des Mille et Une Nuits s’inspirent aussi du matériau religieux, des mythes, des croyances et des pratiques collectives de l’Islam.
Tawaddoud
Parmi tous les personnages féminins des Mille et Une Nuits, celui de Tawaddoud, « merveille des esclaves de l’Orient et de l’Occident », me plaît à ravir. Il s’agit d’une servante qui appartient à Aboul-Hassan, un enfant de riche désargenté depuis la mort de son vénérable père. Aussi, Tawaddoud (également transcrit Tawaddûd), en esclave vertueuse et aussi parfaite que la lettre alif de l’alphabet arabe – la plus noble des lettres de l’alphabet, parce qu’elle symbolise l’unicité divine –, décide de se proposer au calife pour une vente qu’elle estime rapporter plus de dix mille dinars d’or. Pris à la gorge par son infortune, le dispendieux Aboul-Hassan finit par accéder à la demande de la dernière personne « solaire » qui souhaite le sortir de son impasse en orchestrant elle-même ses enchères. Mais, quand ils furent arrivés devant le calife Haroun Rachid, celui-ci appela l’ensemble des savants attachés à sa cour pour éprouver les dires de la servante, qui se présente comme la plus docte de tout le royaume, et cela dans tous les domaines de la science, de la philosophie et même de l’amour. Belle et instruite, ce n’est plus une esclave mais un parfait commensal qui ornera son harem, ou encore un membre actif des controverses de salon, les fameux diwan, que le calife organise fréquemment. Le calife se dit aussi que, si elle n’est pas à la hauteur de ses espérances, il pourra toujours lui payer la somme qu’elle réclame et la laisser à son ancien propriétaire. Commence alors un interrogatoire en règle qui se développe sur tout le conte et qui implique le grammairien, le sophiste, le théologien, le médecin, l’astronome, le géomètre, le poète : « Ô Sympathie, es-tu versée dans les connaissances, et peux-tu m’énumérer le titre des diverses branches du savoir que tu as cultivées ? – Ô mon maître, j’ai étudié la syntaxe, la poésie, le droit civil et le droit canon, la musique, l’astronomie, la géométrie, l’arithmétique, la jurisprudence au point de vue des successions, et l’art de déchiffrer les grimoires et de lire les anciennes inscriptions. Je connais par cœur le Livre Sublime, et je puis le lire de sept manières différentes […] Je ne suis point étrangère à la logique, à l’architecture et à la philosophie, non plus qu’à l’éloquence, au beau langage, à la rhétorique et aux règles des vers […] Avec tout cela, je sais parfaitement chanter, et danser comme un oiseau, et jouer du luth et de la flûte, de même que je manie tous les instruments à cordes, et cela sur plus de cinquante modes différents… » (Histoire de la Docte Sympathie, trad. Mardrus).
Un feu roulant de plus de quatre-vingt-dix questions fondamentales allait mettre en lumière la puissance et l’étendue des savoirs de la jeune savante. Parmi les réponses les plus détaillées, celles qui touchent à la religion, au Coran et à la quiddité divine viennent en premier. Ensuite, les questions relatives à l’astronomie reçoivent, elles aussi, des réponses très fouillées. Lorsque le médecin de la Cour se leva, c’était pour poser une question sur le corps et sa formation. À cela, Tawaddoud, toujours fluide et précise dans ses réponses, lorsqu’elle n’est pas enjouée et dominatrice, répond : « Allah composa le corps en y ménageant sept portes d’entrée et deux portes de sortie : les deux yeux, les deux oreilles, les deux narines et la bouche, et, de l’autre côté, un devant et un anus. Ensuite, le Créateur, pour donner un tempérament à Adam, réunit en lui les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et l’air… » Puis viennent les conduits, les os, le cœur, les poumons, le foie, les reins, la cervelle, les instincts, ainsi que les maladies qui les affectent selon la dynamique des tempéraments, le bilieux, le nerveux, le lymphatique et le sanguin. Tawaddoud est magistrale dans toutes les disciplines, mais là où sa maîtrise est époustouflante, presque cruelle étant donné son jeune âge, c’est dans le domaine de la copulation, qu’elle décrit aussi légèrement que si elle parlait de cuisine ou de poésie. Elle conclut : « Toute copulation complète est suivie d’humidité. Cette humidité est produite chez la femme par l’émotion que ressentent ses parties honorables, et chez l’homme par le suc que sécrètent ses deux œufs. Ce suc suit un chemin fort compliqué. En effet, l’homme possède une grosse veine qui donne naissance à toutes les autres veines. Le sang qui arrose toutes ces veines, au nombre de trois cent soixante, finit par se canaliser en un tuyau qui aboutit à l’œuf gauche. Après quoi, le sang ayant suffisamment tourné, il produit un suc blanc et épais qui a l’odeur “du lait de palme”. »
Tout porte à croire que cette Tawaddoud remplit un rôle de femme idéale, dès lors qu’elle bat le cénacle des vieux mandarins séniles, au port de tête empesé et qui, du haut de leur supposé savoir, regardent de manière goguenarde la nouvelle arrivée. « Quoi, une esclave qui sait plus de choses que nous ! » Or, cette esclave est le miroir même de Schahrazade, la narratrice. Elle dit des choses au roi, son époux, qu’aucun autre argument ne peut rendre plus intelligibles. Elle éduque en douceur, lui montre les fastes, sinon de la femme – ce qui est ma conviction –, du moins ceux de l’humain dans sa diversité. L’histoire se termine on ne peut mieux, puisque la robe du savant revêtit depuis lors Tawaddoud qui gagna dans sa bataille épique les dix mille dinars d’or auxquels vinrent se rajouter cinq mille autres, tant la satisfaction du calife fut à son comble.
Traduire les Nuits
Longtemps, le mot français que l’on employait pour signifier « traduction » était « truchement ». Or, le mot truchement vient directement de l’arabe Tûrdjûman (arabe : tarjama, traduire), qui a donné aussi drogman, officier interprète au temps de la Turquie ottomane ou en Perse, comme ce fut le cas avec le drogman Padery (1719-1725). Le mot remonterait à l’assyrien ragamon, parler. Le problème de la traduction est récurrent. Il est surtout aigu pour ce qui est des livres saints, la Bible et le Coran, mais la transmission des textes fondateurs de la littérature ont eux aussi exigé une méthode scrupuleuse. Il fut un temps, il est vrai, où la traduction des Mille et Une Nuits, comme d’ailleurs celle du Coran, n’était pas d’une précision renversante. Et le traducteur n’hésitait pas à se substituer à son public, choisir pour lui les passages qu’il désirait lui faire connaître et refuser ceux qui lui paraissaient peu dignes d’éloges. Telles sont les « Belles étrangères » ! Aussi ne faut-il pas s’étonner si Antoine Galland, le premier traducteur des Nuits et, à ce titre, un peu le garant de l’orthodoxie dans le domaine, décide de ne pas traduire tel ou tel poème, parce qu’il n’en aimait pas la poésie, ou telle ou telle scène érotique que ses lecteurs auraient pu trouver scandaleuse ou seulement choquante. Il arrive aussi que la censure et l’autocensure des traducteurs (voir Censure) se cachent derrière leur ennui : un passage trop long des contes originaux ne plaît pas au traducteur qui passe outre. Parfois, il le note clairement dans le texte ou dans une note de bas de page, ou fait appel au latin pour évoquer des notions trop crues. En vérité, on quitte un mal pour un mal plus grand, le traducteur continuant à manœuvrer à vue, pris en tenaille entre Charybde et Scylla, et ne sachant plus ce qui plaît ni ce qui déplaît. Dans l’Histoire de Nour-Eddin Ali, une mariée devait se changer plusieurs fois, comme il se fait encore de nos jours dans les cérémonies citadines, ce qui satisfait la coquetterie personnelle de la femme et glorifie au passage la fortune familiale. Or, pour ne pas répéter les mêmes phrases sur plusieurs pages, Antoine Galland décide de supprimer deux Nuits, avec ce mot étonnant : « La cent et unième et la cent deuxième Nuit sont employées dans l’original à la description des sept robes et des sept parures différentes dont la fille du vizir Schams-Eddin Mohamed changea au son des instruments. Comme cette description ne m’a point paru agréable [sic !] et que d’ailleurs elle est accompagnée de vers qui ont, à la vérité, leur beauté en arabe, mais que les Français ne pourraient goûter, je n’ai pas jugé à propos de traduire ces Nuits. » Une telle déclaration a le mérite d’être franche et sans détours, aussi le lecteur des Mille et Une Nuits n’aura-t-il pas à chercher vainement les deux Nuits en question, mais que dire des traducteurs de mauvaise foi qui procèdent à des suppressions ou des inventions pures et simples, à ceux qui se sentent autorisés à compliquer le style pour le rendre moins accessible, à rajouter aux contes originaux leurs propres fantaisies littéraires, dès lors que le droit d’auteur n’est pas respecté, ni le volume, ni les sections des contes, ni évidemment l’alternance régulière que le récit arabe ménage entre le récit en prose et le récit en vers. Une manière encore plus subtile de traduire – ou de ne pas traduire – certains termes des Mille et Une Nuits est signalée par Jorge Luis Borges qui note à propos de Burton, traducteur anglais des Nuits, le laisser-aller, l’imprécision et toutes sortes de substitutions de sens, tandis que « son vocabulaire n’est pas moins disparate que ses notes : l’archaïsme y voisine avec l’argot, le jargon des marins et des prisons avec le terme technique ». Visiblement, l’auteur argentin n’aime pas la traduction de l’Anglais Burton, dont il pointe les « obscurités érudites », et alors même qu’elle passe, à d’autres aunes, pour être la meilleure. Borges n’est pas non plus très tendre avec Mardrus qui, selon lui, « ne manque jamais de s’étonner de la pauvreté de la couleur locale des Mille et Une Nuits » et doit, pour ce faire, et avec une « constance digne de Cecil B. DeMille », prodiguer vizirs, baisers, palmiers et clair de lune afin de rehausser le réel décrit dans les contes au niveau du mythe, alors triomphant, d’un Orient de pacotille. Charge assez rude pour Mardrus, mais on peut objecter qu’aucun traducteur – j’en ai sélectionné plus de vingt-deux dans cette étude (voir Bibliographie) – ne s’est privé de rajouter telle ou telle notion d’ambiance ou de couleur. On est presque autorisé à établir le même constat pour les éditions en arabe, ou certes la traduction est secondaire, mais dont le péché mignon est l’inexactitude. Le public arabophone ayant découvert l’existence des Nuits pratiquement un siècle après son homologue européen, 1814 pour l’édition intégrale des Nuits à Calcutta (1835, pour celle de Boulaq, non loin du Caire) au lieu de 1714 pour ce qui est de la traduction de Galland, il a pu en même temps vérifier que son patrimoine oral avait subi d’autres manipulations, dont la plus patente est la censure. Pour retenir l’essentiel : la traduction de Galland est la première. À ce titre, elle joue le mauvais rôle d’être trop parfaite pour les uns et trop incomplète pour les autres, des puristes qui cherchent davantage à la dénigrer pour assurer un meilleur succès à la leur que de lui trouver des arguments à décharge, notamment le contexte historique et littéraire d’une Europe découvrant avec gourmandise l’Orient et ses envoûtements. Qu’en est-il des autres traductions en français, celles au moins que l’on peut encore trouver en librairie ? La traduction de Mardrus est écrite dans une langue moins ronde et moins corsetée que celle de Galland. Elle est aussi plus libre vis-à-vis de l’original et gagne, à ce titre, l’attribut de « belle étrangère ». Il faut dire que la passion de l’Orient, qui était encore au sommet pour ce qui est de la peinture et des relations de voyage, est très largement revenue à une bonne toise à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Moins littéraire que sa consœur du siècle d’avant, la traduction de Mardrus manque de la préciosité de la langue autant que des images qui ont fait la réputation de la traduction de Galland. En revanche, elle est plus « naturaliste » chaque fois qu’elle aborde les questions de mœurs, ce que Galland ne semble pas manier avec aisance. Les esprits chagrins ne manqueront d’ailleurs pas de vilipender l’apport de Mardrus pour cette même raison qui les attire le plus, l’érotisme un peu échevelé qu’ils espèrent trouver dans son œuvre. Et qu’ils trouvent en effet, en abondance, au risque de douter de la verdeur réelle des Nuits.
La traduction de Bencheikh et Miquel a rétabli la plupart des poèmes que les autres traductions ont ignorés, exception faite de celle de René R. Khawam, et redonné au contexte la dimension arabo-musulmane que les autres ont à peine esquissée. Elle pèche cependant par un défaut qui tient à la nature du travail, sa technicité, ce qui laisse une impression de « fermeture définitive » du processus vivant de la traduction, le lecteur se sentant par ailleurs projeté dans un univers élitiste qui, par essence, exclut toute identification aux personnages du conte. Faut-il de nouveau traduire Les Mille et Une Nuits ?
Transformations (voir Déguisements, transformations, métamorphoses)
Trésor caché
On devrait mettre le mot au pluriel, trésors, car dans les Nuits, il y a un trésor à chaque coin de rue, dans chaque souk, dans les calles, dans les cimetières, dans les châteaux et au fond de chaque cruche cassée. Le prototype de tous ces trésors est sans doute la caverne d’Ali Baba, que celui-ci découvre et dont il s’empare au grand dam du chef des voleurs. Les rêveurs, les aventuriers, les pêcheurs, voilà ceux qui découvrent des trésors, et lorsque les portefaix sont chanceux, la belle dame de Bagdad les cherche et les trouve dans le fouillis des ruelles les plus sombres : « Portefaix, prends ta hotte et suis-moi. » Ils sont mis sur la trace de ces amoncellements d’or et d’argent à la suite d’un rêve, d’une prémonition, d’un code à déchiffrer ou d’une lettre anonyme. Faire naufrage est parfois le début d’un enrichissement subi. Très curieusement, les trésors sont toujours au bout d’une vallée encaissée et difficile à prendre, au fond d’une mer dangereuse, au sommet d’une montagne, comme la montagne Qaf, où seul l’oiseau mythologique Rokh est en mesure de se rendre, dans une ville d’airain, dans un palais lugubre ou en retournant la terre. Les paravents sont nombreux et mortels : des cyclones, des tourbillons, des vents de sable, des tunnels et, surtout, un nombre incalculable de pièges posés là de main d’homme, et des adversaires farouches.
Terreurs et ambitions (voir Vie et mort dans les Nuits)
HISTOIRE PRODIGIEUSE DE LA VILLE D’AIRAIN
« On raconte qu’il y avait sur le trône des califes omeyyades, à Damas, un roi – Allah seul est roi ! – qui s’appelait Abdelmalek Ben Marwan. Il aimait souvent à s’entretenir avec les sages de son royaume, de notre maître Soulayman Ibn Daoud, sur lui la prière et le salut !, de ses vertus, de sa puissance et de son pouvoir illimité sur les fauves des solitudes, les éfrits qui peuplent l’air et les génies maritimes et souterains. Un jour le calife, au récit qu’on lui faisait de vases de cuivre ancien dont le contenu était une étrange fumée noire aux formes diaboliques, s’étonnait à l’extrême et avait l’air de mettre en doute la réalité de faits si avérés. D’entre les assistants se leva Taleb ibn Sahl, le voyageur fameux, qui confirma le récit que l’on venait d’entendre et ajouta : “En effet, ô émir des Croyants, ces vases de cuivre ne sont autres que ceux où furent enfermés dans les temps anciens les génies rebelles aux ordres de Soulayman et qui furent jetés, une fois scellés du sceau redoutable, au fond de la mer mugissante, aux confins du Maghreb, dans l’Afrique occidentale. La fumée qui s’en échappe est tout simplement l’âme condensée des éfrits, lesquels ne manquent pas de reprendre à l’air libre leur première forme formidable.”
« À ces paroles, la curiosité et l’étonnement du calife Abdelmalek augmentèrent considérablement, et il dit à Taleb Ibn Sahl : “Ô Taleb, je désire beaucoup voir l’un de ces vases de cuivre qui renferment les éfrits en fumée ! Crois-tu la chose possible ?” Il répondit : “Ô émir des Croyants, tu peux avoir cet objet ici même, sans te déplacer, et sans fatigues pour ta personne vénérée. Tu n’as pour cela qu’à envoyer une lettre à l’émir Moussa, ton lieutenant au pays du Maghreb. Car la montagne au pied de laquelle se trouve la mer qui renferme ces vases est reliée au Maghreb par une langue de terre qu’on peut traverser à pied sec. L’émir Moussa, au reçu de la lettre, ne manquera pas d’exécuter les ordres de notre maître le calife !” »
On consulta un vieillard sur le meilleur chemin pour arriver à ces montagnes.
« Le vieillard se tut, réfléchit un moment, et ajouta : “Je ne dois pas te cacher, ô émir Moussa que cette route est semée de dangers et de choses pleines d’effroi et qu’il y a un désert à traverser qui est peuplé par les éfrits et les génies, gardiens de ces terres vierges de pas humains depuis l’Antiquité. Sache en effet, ô [Moussa] Ibn Nossayr, que ces contrées de l’extrême Occident africain sont interdites aux fils des hommes ; deux d’entre eux ont pu seuls les traverser, l’un est Soulayman ibn Daoud et, l’autre, Al-Iskandar aux Deux-Cornes (Alexandre). Et, depuis ces époques abolies, le silence est devenu le maître introublé de ces vastitudes désertes…” »
L’émir Moussa fit les préparatifs du voyage et réunit, pour l’occasion, mille chameaux chargés d’eau et mille autres chameaux chargés de vivres et de provisions. La caravane marcha dans les solitudes pendant des jours et des mois. De nombreuses épreuves se présentèrent devant la délégation de l’émir Moussa.
« L’émir Moussa et ses compagnons se mirent à marcher sur les murs pendant quelque temps, et finirent par arriver devant deux tours reliées entre elles par une porte d’airain dont les deux battants étaient fermés et joints d’une façon si parfaite qu’on n’aurait pu introduire la pointe d’une aiguille dans leur interstice. Sur cette porte était gravée l’image en relief d’un cavalier d’or qui avait le bras tendu et la main ouverte. Et sur la paume de cette main, des caractères ioniens étaient tracés, que le cheikh Abd Us-Samad, le conseiller, déchiffra aussitôt et traduisit ainsi : “Frotte douze fois le clou qui est dans mon nombril.” Alors, l’émir Moussa, bien que fort surpris par ces paroles, s’approcha du cavalier et remarqua qu’en effet un clou d’or se trouvait enfoncé juste au milieu de son nombril. Il tendit la main et frotta ce clou douze fois. Et au douzième frottement les deux battants s’ouvrirent dans toute leur largeur sur un escalier de granit rouge qui s’enfonçait en tournant. Aussitôt l’émir Moussa et ses compagnons descendirent les marches de cet escalier qui les conduisit au centre d’une salle donnant de plain-pied sur une rue où stationnaient des gardes armés d’arcs et de glaives […] Alors, l’émir Moussa, voyant que ces gardes ne comprenaient pas l’arabe, dit au cheikh Abd Us-Samad : “Ô cheikh, adresse-leur la parole dans toutes les langues que tu connais !” Et le cheikh commença à leur parler d’abord en langue grecque ; puis, voyant l’inanité de sa tentative, il leur parla en indien, en hébreu, en persan, en éthiopien et en soudanais ; mais nul d’entre eux ne comprit un mot de ces langues et ne fit un geste quelconque d’intelligence… À cette vue, l’émir Moussa, à la limite de l’étonnement, ne voulut pas davantage insister. Il dit à ses compagons de le suivre et continua sa route, ne sachant à quelle cause attribuer un tel mutisme […] Lorsqu’ils eurent admiré tout cela, ils songèrent à revenir sur leurs pas, quand ils furent tentés de relever un immense rideau de soie et d’or qui couvrait l’un des murs de la salle. Et ils virent derrière ce rideau une grande porte ouvragée de fines marqueteries d’ivoire et d’ébène et fermée par des verrous massifs d’argent […] Aussitôt la porte tourna d’elle-même et donna libre accès aux voyageurs dans une salle miraculeuse creusée entièrement en dôme dans un marbre si poli qu’il semblait être un miroir d’acier. Des fenêtres de cette salle filtrait, à travers des treillis d’émeraudes et de diamants, une clarté qui nimbait les objets d’une splendeur inouïe. Au centre se dressait, soutenu par des pilastres d’or sur chacun desquels se tenait un oiseau au plumage d’émeraude et au bec de rubis, une sorte d’oratoire tendu d’étoffe de soie et d’or qui venait lentement, par une suite de degrés d’ivoire, prendre contact avec le sol où se trouvait un magnifique tapis aux couleurs glorieuses […] L’émir Moussa et ses compagnons montèrent les degrés de cet oratoire et, arrivés sur la plate-forme, ils s’arrêtèrent dans une surprise qui les cloua muets. Sous un dais de velours piqué de gemmes et de diamants, sur un large lit de tapis de soie surperposés reposait une adolescente au teint éblouissant, aux paupières alanguies de sommeil sous leurs longs cils recourbés, et dont la beauté se rehaussait du calme admirable de ses traits, de la couronne d’or qui retenait sa chevelure, du diadème de pierreries qui étoilait son front et du collier humide de perles qui caressait de leur chair sa peau dorée. À droite et à gauche du lit se tenaient deux esclaves, l’un blanc et l’autre noir, armés d’un glaive nu et d’une pique d’acier. Au pied du lit, il y avait une table de marbre sur laquelle ces paroles étaient gravées : “Je suis la vierge Tadmor, fille du roi des Amalécites. Cette ville est ma ville ! Toi, voyageur, qui as pu pénétrer jusqu’ici, tu peux emporter tout ce qui plaît à ton désir, mais prends garde d’oser, attiré par mes charmes et la volupté, de porter sur moi une main violatrice !” […] À cette vue, l’émir Moussa ne voulut pas stationner un moment de plus dans ce palais et ordonna à ses compagnons d’en sortir à la hâte pour prendre le chemin de la mer. Lorsqu’ils furent arrivés sur le rivage, ils virent une quantité d’hommes noirs occupés à sécher leurs filets de pêche et qui leur rendirent, en arabe, leurs salams, selon la formule musulmane. Et l’émir Moussa dit à celui qui était le plus âgé d’entre eux et qui paraissait être leur chef : “Ô vénérable cheikh, nous venons de la part de notre maître, le calife Abdelmalek ibn Marwan, chercher dans cette mer des vases où se trouvent des éfrits du temps du prophète Soulayman […]” Le vieillard répondit : “Sache, mon fils, que nous tous ici, les pêcheurs de ce rivage, nous sommes des croyants à la parole d’Allah et à celle de Son Envoyé, sur Lui la paix et le salut ; mais tous ceux qui se trouvent dans cette Ville d’airain sont enchantés depuis l’Antiquité et resteront dans cet état jusqu’au jour du Jugement dernier. Mais pour ce qui est des vases où ce trouvent les éfrits, rien n’est plus facile que de vous les procurer, puisque nous en avons là une provision dont nous nous servons, une fois débouchés, pour faire cuire nos poissons et aliments. Nous pouvons vous en donner tant que vous voudrez.” […] Le calife Abdelmalek fut charmé à la fois et émerveillé du récit que lui fit l’émir Moussa de cette aventure et s’écria : “Mon regret est extrême de n’avoir pas été avec vous à cette Ville d’airain. Mais avec la permission d’Allah, j’irai bientôt moi-même admirer ces merveilles et essayer d’éclaircir le mystère de cet enchantement !” Puis il voulut ouvrir de sa propre main les douze vases de cuivre. Il les ouvrit donc l’un après l’autre. Et, chaque fois, il en sortait une fumée fort dense qui se muait en un éfrit épouvantable, lequel se jetait aux pieds du calife et s’écriait : “Je demande pardon à Allah et à toi de ma rebellion, ô notre maître Soulayman !” Et il disparaissait à travers le plafond, à la surprise des assistants. »
(Traduction Mardrus.)