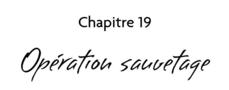
J’ai ramené Renaud à la maison et je sentais que nous étions tous les deux au bout de nos forces. Il avait tant pleuré, il m’avait dit des choses vraiment douloureuses, je le sentais tellement écorché que son désespoir m’étouffait autant que la corde avait été sur le point de le faire pour lui. Il m’avait fait lire la lettre d’adieu qu’il avait commencé à écrire et qu’il avait fourrée dans sa poche sans la terminer et ça me fit vraiment mal. C’était totalement incohérent, une foule de sentiments jetés sur du papier ; mais même la confusion qui s’en dégageait était pénible à constater. Plusieurs choses étaient lancées un peu n’importe comment, des regrets envers ce qu’il avait fait à d’autres, envers son père pour ne pas avoir été le fils qu’il aurait voulu, envers moi, même. Il disait encore qu’il ne méritait pas de vivre, qu’il ne voulait pas être comme il était, mais qu’il ne pouvait le nier plus longtemps. Il ne voulait pas vivre comme ça.
Mes parents, morts d’inquiétude, comprirent rapidement que quelque chose de grave s’était produit en nous voyant arriver. Ma mère était au téléphone et raccrocha en nous voyant arriver. Je crois qu’elle me cherchait partout. Renaud arrivait à peine à se tenir debout et il pleurait toujours. Mon père l’installa sur le divan, lui apporta un verre d’eau que Renaud but d’un trait et je racontai tant bien que mal à mes parents ce qui s’était passé. Mon récit était entrecoupé de sanglots et j’avais autant de mal à parler que mes parents à comprendre, mais je finis par y arriver.
Mes parents étaient désemparés et ne savaient comment réagir ni quoi faire. Mon père voulait emmener Renaud à l’hôpital, mais celui-ci refusait catégoriquement. Malgré l’heure avancée, ma mère téléphona à Francesca qui arriva chez nous à peine quelques instants plus tard.
Prenant une longue inspiration, ma mère s’approcha de Renaud et lui dit tout doucement :
— Mon grand, je pense qu’il est temps pour toi d’accepter un peu d’aide. Tu peux pas passer à travers ça tout seul et même si Caro veut t’aider, elle le peut seulement jusqu’à un certain point. Mon amie Francesca a survécu à ce que tu vis maintenant, ou quelque chose de ressemblant. Elle est aussi bénévole pour un centre d’écoute et je pense qu’elle pourra peut-être faire quelque chose. Ce qui est arrivé ce soir, Renaud, ça prouve que t’es rendu au bout du rouleau, et ça se comprend. Mais y a toujours moyen de regarder la vie en face et de continuer à l’aimer, aussi épeurante et dégoûtante qu’elle peut paraître…
Francesca vint remplacer ma mère auprès de Renaud et lui parla tout doucement, comme une maman l’aurait fait. Puis, ils partirent tous les deux au sous-sol. Malgré le froid de ce soir de novembre, ma mère et moi sommes allées nous asseoir sur notre balançoire, avec mon père, cette fois. Nous n’avons rien dit. J’ai laissé ma mère flatter mes cheveux, mon père caressait mon dos. Je les ai laissés me dorloter, car j’en avais réellement besoin. Ma tête était pleine de tellement d’émotions qu’elle me faisait mal. Je n’arrêtais pas de penser à Camille ; j’aurais aimé qu’elle sache. Qu’elle se sente aussi mal que moi, qu’elle souffre, elle aussi. Je savais que ça n’aurait rien changé, mais il me semblait que ça m’aurait fait du bien… Comme quoi il restait en moi un peu de méchanceté : apparemment, je n’étais pas totalement arrivée à me débarrasser de la Miss Parfaite d’autrefois.

Francesca remonta enfin, mais seulement pour nous informer qu’elle passerait la nuit chez nous, elle aussi. Elle voulait en quelque sorte surveiller Renaud, mais surtout lui montrer qu’elle était là. Elle n’était qu’une étrangère pour lui, mais elle avait réussi à l’atteindre, à lui faire promettre au moins de voir quelqu’un dès le lendemain. Elle connaissait des gens disponibles pour ça, et c’était urgent. Selon elle, son état physique n’était pas inquiétant — il aurait sûrement des douleurs musculaires, surtout au cou et à la gorge —, mais elle le ferait examiner en même temps, juste par précaution. Je lui étais tellement reconnaissante ! C’était un soulagement incroyable parce que je savais depuis un moment que le problème de Renaud était trop gros pour moi, trop gros pour lui. C’était facile de dire que tout finirait par s’arranger, qu’il arriverait à être heureux ; tout ce qu’il voyait, lui, c’était combien il serait toujours un fif de qui on se moquerait, qu’on exclurait, et qu’il aurait toujours à se cacher ou à se défendre d’être ce qu’il était. Ses « amis » lui avaient déjà laissé des tonnes de messages d’insultes sur sa page Facebook, et les pages personnelles de tous mes amis à moi débordaient d’un débat sans fin à son sujet, qui parfois m’incluait. C’était décourageant et assez épeurant.
Parmi plusieurs autres choses, Renaud me raconta que Francesca lui avait donné plusieurs exemples d’hommes aimés et respectés qui vivaient leur homosexualité tout en étant heureux. Elle lui avait aussi dit que s’il sentait qu’il lui fallait quitter le village pour un temps afin de s’éloigner des rumeurs, des regards, c’était son choix. J’arrivais très bien à comprendre qu’il veuille partir, quitte à revenir un jour, le temps réglant bien des choses. Tout ce qui importait, c’était qu’il avait enfin l’air de croire qu’une vie normale était possible, mais il ressentait le besoin de faire ça ailleurs, là où personne ne le connaissait. Pas évident à dix-sept ans ! Encore une fois, je bénis mes parents et remerciai Francesca d’être là en lui demandant ce qui serait arrivé si nous n’avions pas été là, si elle, surtout, n’avait pas été là. Elle me rassura en me disant :
— Tu sais, il existe une multitude de ressources disponibles et, même si chaque cas est différent, il y a des gens merveilleux qui travaillent pour des organismes, dans les CSSS, les écoles, les maisons de jeunes, aussi, et dont la principale préoccupation est d’aider tous ceux qui en ont besoin. Il suffit qu’ils tendent la main…
Justement, j’avais l’impression que Renaud ne l’aurait peut-être pas tendue, la main. Aurait-il même su comment ? Je frissonnai en songeant que sans nous, sans moi, il aurait peut-être réussi à s’enlever la vie…

Dès le lendemain, Francesca emmena Renaud voir un intervenant qu’elle connaissait bien. Mes parents étaient d’accord pour qu’il reste chez nous le temps qu’il fallait et ma mère téléphona à celle de Renaud pour l’informer de ça, espérant ne pas tomber sur son père. Elle n’avait pas l’intention de lui raconter ce qui s’était passé, jugeant que ce n’était pas à elle de le faire, et j’étais d’accord avec elle.
La mère de Renaud apprit à la mienne en pleurant qu’elle quittait son mari. Elle était tout simplement incapable de vivre avec lui après qu’il ait osé jeter son fils à la rue. C’était la goutte d’eau qui avait fait déborder un vase qui s’emplissait lentement depuis des années. Elle lui confia qu’elle aurait dû poser ce geste bien avant, mais qu’elle endurait la situation pour que les garçons aient une vie de famille stable. Elle se trouvait ridicule d’avoir attendu aussi longtemps et demanda à ma mère de ne pas en parler à Renaud tout de suite afin qu’il ne s’en sente pas responsable. Elle avait l’intention de lui en parler elle-même quelques jours plus tard, quand tout serait officialisé. « Il en a bien assez comme ça ! » avait-elle conclu. Ma mère accepta donc cette idée et lorsqu’elle me dit : « Ouf, tant de secrets ! C’est tellement dommage ! » je fus, là aussi, tout à fait d’accord.
J’étais fière de mes parents et de Francesca ; je les admirais. Ils s’étaient vraiment mobilisés pour venir en aide à Renaud dans un geste purement généreux. Mon père avait téléphoné à un de ses amis, propriétaire d’une grande pharmacie en ville, et avait ainsi trouvé à Renaud un travail de commis pas trop exigeant physiquement, offrant même de le conduire matin et soir. Renaud pourrait donc économiser de l’argent en attendant de savoir ce qu’il voulait faire, tant en ce qui concernait le cégep que le reste. Il n’était pas en état de prendre des décisions. Il fallait d’abord qu’il se remette complètement sur pied. Il était suffisamment guéri pour travailler même si sa jambe, surtout, le faisait encore souffrir, mais il ne se plaignait pas.
C’est à peu près à cette époque-là que j’ai commencé à entendre chanter Sarah-Jeanne à la radio ; ma station préférée avait lancé son concours annuel de groupes de musique et faisait jouer les chansons de ceux qui avaient été retenus dont Existence, le groupe de Sarah-Jeanne. C’était une chanson que je l’avais déjà entendue chanter la première fois pendant ses cours de chant puis, au spectacle du Festival des arts ; je m’en souvenais très bien puisqu’elle m’avait d’abord mise hors de moi. En vérité, elle m’avait bouleversée, mais je ne l’aurais jamais admis à l’époque. Existence, le titre de la chanson tout comme le nom du groupe, parlait de choses trop vraies, et chaque fois que je l’entendais, je découvrais un sens nouveau pour moi. Je me réjouis qu’on ait choisi ce groupe, cette chanson. Ce sentiment d’être heureuse de la chance des autres était encore nouveau pour moi, mais il faisait un bien énorme !
Bien au-delà des paroles, cette pièce avait quelque chose de poignant. Les arrangements de piano et de guitare étaient fantastiques, mais lorsque la chanteuse entamait la mélodie, tout devenait irrésistible, presque envahissant. On ne pouvait rester insensible à ce qu’elle chantait, aux mots qu’elle semblait nous confier comme si, elle aussi, avait vécu des choses difficiles. J’avais l’impression que tout le monde pouvait se sentir touché par ces mots si justes, que chaque personne de la terre s’était dit, un jour ou l’autre, la même chose. C’était vrai pour moi, vrai pour Renaud aussi, qui aima aussitôt la chanson lorsque je la lui fis écouter :
Ça rime à quoi ma vie mes larmes, mon existence ?
Je peux rien changer de mes erreurs, de mes malchances
Je veux plus regarder en arrière, maintenant il faut que j’avance
Je savais bien que c’était ridicule, mais je m’imaginais que cette chanson avait été écrite pour moi, ou pour Renaud, ou pour nous deux. Comment de simples paroles avaient-elles le pouvoir de changer tant de choses ? Moi qui avais toujours tripé sur des tounes insignifiantes ne recherchant qu’un bon beat, je découvrais la puissance de la musique, des paroles. C’était sans doute de ce genre de chanson qu’on parlait lorsqu’on qualifiait quelque chose de « rassembleur ». Il se forma dans ma tête une image où toutes les personnes qui se sentaient concernées ou touchées par ces paroles se rassemblaient quelque part, dans un parc ou une salle de spectacle ; il y en avait des milliers, peut-être même des millions. J’veux vivre ma vie, celle à laquelle j’ai toujours rêvé, et y a juste moi qui peux décider si je vais y arriver…
Je le voulais pour moi, ça, mais je le voulais aussi pour Renaud. Même si j’avais souffert à cause de lui, tout comme plusieurs autres, je voulais qu’il puisse trouver le moyen d’être heureux. Me semble que j’mériterais d’avoir une deuxième chance, disait Existence. C’est ce qu’on mérite tous, non ?
Pendant cette période, Renaud et moi avons parlé plus que jamais. Je sentais que nous avions une connexion bien particulière et ça me plaisait. Quand je lui en faisais part, il me répondait :
— C’est pas tout le monde qui se fait sauver la vie deux fois par une belle fille… C’est sûr qu’y a une connexion. On se croirait dans un roman !
Et là, je sentais qu’il était heureux de l’être encore, en vie, et ça me suffisait. Il rencontrait des thérapeutes régulièrement et je devinais qu’il émergeait tout doucement du gouffre où il s’était trouvé. Le soir, je descendais le voir au sous-sol et il me racontait tant de choses que parfois je me demandais s’il réalisait qu’il les exprimait à voix haute tant il avait l’air perdu au plus profond de ses pensées.
Il parlait du cégep, me disait qu’il voulait y aller l’an prochain quand il saurait plus précisément quelle matière il voulait étudier. Tout ce qu’il avait fait avant, le football autant que le reste, lui apparaissait futile. Les sports l’intéressaient encore, mais pas pour en faire une carrière. Il voulait trouver ce dans quoi il aurait envie de travailler, dans quoi il serait bon.
Il me racontait ses regrets d’avoir agi comme il l’avait fait, d’avoir blessé et harcelé tant de monde, et je le croyais. Il pleurait beaucoup, aussi. J’appris qu’il m’avait réellement aimée, qu’il n’avait jamais connu qui que ce soit d’autre qu’il avait aimé autant. Il me parla de Jo, aussi, mais ça me mettait un peu mal à l’aise. Ils ne se connaissaient pas beaucoup, mais c’était la première fois qu’il allait aussi loin, qu’il se laissait toucher par un gars. Oui, il avait aimé l’expérience, c’était même cent fois mieux que ce qu’il avait espéré. Il avait su, ce soir-là, que c’était ce qu’il attendait depuis toujours. Si c’était à refaire, il s’y prendrait autrement, mais le ferait quand même.
Il se disait fâché d’avoir été confronté à la vérité aussi brutalement, mais finalement, soulagé aussi. Ça faisait des années qu’il savait, mais qu’il refusait de l’admettre. Il me raconta combien c’était difficile pour lui de se regarder dans le miroir et de dire : « Je suis gai. » Il avait tant essayé de ne pas y penser, s’était dit que s’il le refusait, ça passerait, que ce n’était que temporaire. Il me raconta que chaque fois qu’il fantasmait sur un gars, il le haïssait autant qu’il le désirait, lui en voulait de faire naître ce genre de désir en lui. Le pire, selon lui, c’était au football : « T’as pas idée comment ça peut être con, une gang de gars dans un vestiaire ! Ils étaient tous là, nus devant moi à faire toutes sortes de niaiseries et des fois, souvent en fait, je bandais. Mais il fallait que je me cache ou, si je pouvais pas, je disais que c’était parce que je pensais à toi. » Il disait si souvent à quel point il regrettait de m’avoir blessée que je ne pouvais faire autrement que lui pardonner.
J’étais tellement mélangée dans toutes mes émotions que je craignais de ne jamais arriver à les démêler. Le seul encouragement que je trouvais était que pour Renaud, ça devait être cent fois pire et depuis beaucoup plus longtemps…
Effectivement, il avait trouvé cet état épuisant, disait-il, comme s’il s’était constamment battu contre lui-même. Le fait que je l’avais surpris et que Camille s’était sentie obligée de dévoiler son secret à tout le monde l’avait brutalement forcé à faire face à la situation plus tôt que prévu, mais il commençait à comprendre que ça avait peut-être été une bonne chose : il avait souvent eu peur de lui-même, pour lui et pour d’autres ; ça n’aurait pas pu continuer comme ça longtemps.
Enfin, il me confia un soir qu’il n’avait plus envie de mourir, et cette confidence me rendit heureuse. Selon lui, grâce aux personnes à qui il parlait et qui l’écoutaient, qui intervenaient, qui l’aidaient à voir les choses d’une autre façon que celle, sombre et sans issue qu’il croyait être la seule, il reprenait espoir et ça, c’était merveilleux et j’espérais surtout que ce soit durable. Nous passions parfois la nuit entière ensemble, collés l’un tout contre l’autre et c’était fantastique. Je n’étais plus amoureuse de lui de la même façon que je l’avais été, mais je l’aimais, ça oui. Je n’étais plus certaine de l’avoir aimé autant que je l’avais prétendu ; tout me semblait assez confus. Ce dont j’étais absolument certaine, cependant, c’était que je voulais qu’il soit bien et que… il fallait bien qu’il soit gai pour que ma mère me permette de dormir avec lui, chez nous, dans le même lit !
Je n’avais toujours pas adressé la parole à Camille depuis l’été et je n’en avais pas l’intention. J’avais songé à lui raconter ce que Renaud avait tenté de faire, mais j’avais changé d’idée. Elle n’aurait pas compris, n’aurait vu là qu’une marque de faiblesse ou quelque autre platitude du genre.
Les fêtes approchaient et je voyais Renaud devenir de plus en plus triste à la pensée de passer Noël tout seul avec sa mère. Elle était venue chez nous, nous avait remerciés pour tout ce que nous avions fait et avait emmené Renaud souper pour lui raconter ce qui se passait à la maison. Elle avait quitté son père et s’en trouvait libérée. Elle venait de commencer à travailler et, en attendant de pouvoir se payer un appartement, elle vivait chez une amie. Elle aurait bien aimé que Renaud choisisse d’aller vivre avec elle, mais il voulait s’éloigner du village, ce qui était bien compréhensible. Il ne sortait pratiquement pas depuis son séjour à l’hôpital, craignant sans cesse de tomber sur des gars qu’il connaissait ou quelqu’un de l’école qui lui aurait fait un commentaire ou posé un geste blessant. Il ne voulait pas sentir les regards posés sur lui, voir les gens chuchoter sur son passage ni lire le dégoût dans leur visage, le même dégoût qu’il avait vu trop souvent dans les yeux de son père, et que d’autres avaient sans doute vu dans ses propres yeux à lui. Il n’avait pourtant pas envie de se terrer dans notre sous-sol éternellement. Les seuls moments où il se sentait « libre » et où il arrivait à sourire et à oublier tout ce qui s’était passé, c’était à la pharmacie où il travaillait ; une belle camaraderie régnait entre les employés. Personne ne le connaissait ; on ne savait rien de lui. Des filles avaient bien sûr essayé de l’approcher, mais il avait répondu qu’il avait une blonde, moi. Il avait eu peur que je sois fâchée, mais au contraire, ça me flattait. Il n’était pas prêt à avouer ouvertement à ces quasi-étrangers qu’il était gai, pas encore, et je le respectais.
De notre côté, pendant les vacances, on est allés skier quelques jours avec Francesca et son amie. Puis, en janvier, juste avant que l’école recommence, j’ai demandé à ma mère de me conduire chez le père de Cassandra. J’avais bien trop attendu, mais je devais m’excuser en repensant à tout ce qui s’était passé.
Dans l’auto, j’étais nerveuse et j’essayais de pratiquer ce que j’allais dire à Cassandra. Finalement, je décidai d’improviser. Ma mère me laissa au coin de la rue ; elle en avait pour environ une heure chez sa coiffeuse, qui n’était pas tellement loin. J’irais la rejoindre ou, si je n’avais pas terminé une heure plus tard, je lui téléphonerais.
Plus j’approchais de l’appartement du père de Cassandra, plus mon cœur cognait dans ma poitrine. Je savais qu’elle pourrait très bien refuser de me parler, me claquer la porte au nez, et je ne pourrais pas lui en vouloir. J’avais noté l’adresse sur un bout de papier qui était maintenant tout chiffonné dans ma main, mais ce n’était pas grave : je la connaissais par cœur. Au moment où j’allais m’engager dans l’allée menant chez eux, je vis sortir trois personnes, dont elle, Cassandra. Je fis mine de lacer mes bottines et attendis en espérant qu’elle ne me voit pas. Pas tout de suite. Elle riait aux éclats, et ceux que je devinais être son père et son frère en faisaient autant. Cassandra se pencha et fit une boule de neige qu’elle lança à son frère. Il répliqua aussitôt et leurs rires se mirent à résonner partout. Cassandra était belle, elle avait l’air heureuse et ça me fit chaud au cœur. Je me demandai tout à coup pour qui je me prenais pour interrompre une si belle soirée, faire renaître une foule de si mauvais souvenirs avec mes excuses qui arrivaient presque un an trop tard. La honte refit surface une fois de plus et je décidai que je pourrais lui envoyer une carte ou quelque chose du genre, maintenant que je connaissais son adresse. Je me relevai donc et continuai tout droit sans m’arrêter et sans regarder en arrière.
Tout le long du trajet du retour, je me traitai de poule mouillée. Cot-cot-cot.