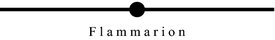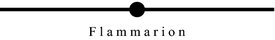
TABLE ANALYTIQUE
ADOPTION. L’adoption a eu pour principe le devoir de perpétuer le culte domestique : 89, 90 ; – n’était permise qu’à ceux qui n’avaient pas d’enfants : 90, 91 ; ses effets religieux et civils : 122, 123
AFFRANCHIS : 168. Droit que les patrons conservaient sur eux : 374, 375 ; leur analogie avec les anciens clients : 374, 375
AGNATION. Quelle sorte de parenté c’était, chez les Romains et chez les Grecs : 92, 93, 94, 95, 96, 571, 572 (note 21)
AGNI. Divinité des vieux âges dans toute la race indo-européenne : 56, 57
AÎNESSE (Droit d’). Établi à l’origine des sociétés anciennes : 126, 127, 128 ; disparaît peu à peu : 357, 358
AMBARVALES : 225
AMPHICTYONIES. Nombreuses dans l’ancienne Grèce : 297 ; étaient des assemblées religieuses plus que politiques : 297, 298, 299
ANCÊTRES (Culte des) : 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
ANNALES. Usage général des annales chez les anciens ; elles étaient rédigées par les prêtres et faisaient partie de la religion : 239, 240, 241, 242, 243, 244
APPLICATIO. Jus applicationis : 323, 573 (note 32)
ARCHIVES des villes : 241
ARCHONTES des γένη : 154, 187, 188, 339, 340 ; archontes des villes : 253 ; le titre d’archonte était d’abord synonyme de celui de roi : 245, 246 ; fonctions religieuses des archontes : 253 ; leur pouvoir judiciaire : 263 ; comment ils étaient élus : 594, 595 (note 14) ; leur autorité est peu à peu réduite : 442, 443 ; ce qu’ils deviennent sous l’empire romain : 520
ARISTOCRATIE. Aristocratie héréditaire des patriciens, des eupatrides, des βασιλεῖς, des géomores, etc. : 321, 322, 323, 324, 325, 326, 349, 350, 351, 352, 353, 354 ; la distinction des classes est d’abord fondée sur la religion : 332 ; l’aristocratie de naissance s’appuie sur le sacerdoce héréditaire : 349, 350 ; cette aristocratie disparaît plus tard : 396 ; il se forme une aristocratie de richesses : 446, 447 ; aristocratie spartiate : 336, 337, 338, 339, 477, 478, 479, 480, 481, 482
ARMÉE. Actes religieux qui s’accomplissaient dans les armées grecques et romaines : 232, 233 ; l’armée était organisée primitivement comme la cité, en gentes et en curies, en γένη et en phratries : 186 ; changements opérés par Servius Tullius dans la constitution de l’armée : 376, 400, 401 ; sens du mot classis : 615 (note 26) ; en Grèce, comme à Rome, la cavalerie était un corps aristocratique : 384, 385 ; la nature de l’armée change avec la constitution de la cité : 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451 ; l’armée romaine forme une assemblée politique : 401 ; pendant la domination de la classe riche, en Grèce, comme à Rome, les rangs dans l’armée furent fixés d’après la richesse : 448
ASILE. Ce que c’était à Rome : 195, 329
ASSEMBLÉES du peuple. Elles commençaient par une prière et un acte sacré : 230, 231, 458 ; assemblées par curies : 325, 344 ; assemblées par centuries, comment on y votait : 257, 347, 348, 447 ; l’assemblée centuriate n’était pas autre chose que l’armée : 401 ; assemblées par tribus : 412 ; assemblées athéniennes : 458, 459, 460
ATHÈNES. Formation de la cité athénienne : 187, 188, 189, 339, 340 ; œuvre de Thésée : 339, 340 ; royauté primitive : 248, 249, 251 ; aristocratie des eupatrides : 320, 337 ; abolition de la royauté politique : 341 ; domination de l’aristocratie : 341, 349, 350, 351, 368, 369 ; archontat viager, et archontat annuel : 341, 342 ; l’archonte-roi : 342 ; caractère athénien : 308 et suiv., 457 ; superstitions athéniennes : 309, 310 ; tentative de Cylon : 390 ; œuvre législative de Dracon : 434 ; œuvre de Solon : 371, 372, 373, 391, 392, 435, 436, 437, 438, 439, 441 ; Pisistrate : 393 ; œuvre de Clisthènes : 393, 394, 395, 396 ; domination de l’aristocratie de richesse : 446, 447, 448, 449 ; progrès des classes inférieures : 450 et suiv. ; les magistratures athéniennes : 455, 456, 457 ; l’assemblée du peuple : 458, 459, 460 ; les orateurs : 461 ; l’armée athénienne : 448 ; caractère de la démocratie athénienne : 622, note 10
ἈΤΙΜÍΑ. Perte des droits civils, politiques et religieux : 276, 277
AUSPICES. Mode d’élection des magistrats par les auspices : 256, 257, 258 ; deviennent une pure formalité : 445
CALENDRIER chez les anciens : 226, 227
CAMILLE, présenté comme type du guerrier-prêtre : 304, 305, 306, 307
CÉLIBAT. Interdit par la religion : 84, 143 ; interdit par les lois de Sparte et de Rome : 84, 314
CENS, recensement, lustration : 227, 228, 229 ; transformation du cens par Servius : 399, 400, 401, 402, 403, 404
CENSEURS. Origine et nature de leur pouvoir : 225 ; leurs fonctions religieuses : 249
CHEVALIERS. Classe aristocratique : 447, 448 ; en Eubée : 321 ; à Rome : 400, 401, 447
CHRISTIANISME. Son action sur les idées politiques et sur le gouvernement des sociétés : 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
CITÉ. La cité se forme par l’association des tribus, des curies, des gentes : 184 et suiv. ; elle est une confédération : 185, 186 ; exemple de la cité athénienne : 187, 188, 189 ; religion propre à chaque cité : 209 et suiv. ; ce que l’on entendait par l’autonomie de la cité : 285, 286, 287 ; pourquoi les anciens n’ont pas pu fonder de société plus large que la cité : 283, 284, 285 ; puissance absolue de la cité sur le citoyen : 313 et suiv. ; affaiblissement du régime de la cité : 508 et suiv. ; la conquête romaine détruit le régime municipal : 517 et suiv.
CITOYEN. Ce qui distinguait le citoyen du non-citoyen : 271, 272, 273, 274, 275, 276, 522, 523, 524, 525 ; comment s’acquérait le droit de cité à Athènes : 272, 273, 274
CLIENTS. Ce que c’était à l’origine : 168, 169, 170, 322, 323, 325, 326 ; étaient distincts des plébéiens : 327, 328, 362 ; leur condition : 323, 324, 325, 362 ; ils figuraient dans les comices par curies : 265 ; leur analogie avec les serfs du moyen âge : 363 ; leur affranchissement progressif : 361, 365 et suiv. ; ils deviennent peu à peu propriétaires du sol : 364, 368 ; comment ils le sont devenus à Athènes : 368, 369, 370, 372, 373 ; comment ils le sont devenus à Rome : 374, 377 ; disparition de la clientèle primitive : 368, 377, 378 ; le patriciat essaye en vain de la rétablir : 404, 405 ; clientèle des âges postérieurs : 374, 375, 376, 377, 378
COGNATIO. Parenté par les femmes, en Grèce et à Rome : 96 ; elle pénètre peu à peu dans le droit : 429, 436
COLONIES. Comment elles étaient fondées : 299 ; lien religieux entre la colonie et la métropole : 300
CONDITIONS économiques des sociétés anciennes : 466, 469, 470
CONFARREATIO. Cérémonie religieuse usitée dans le mariage romain et dans le mariage grec : 78, 80
CONFÉDÉRATIONS : 296 et suiv.
CONNUBIUM. Droit de mariage entre deux cités : 274, 283, 504
CONQUÊTE romaine : 507 et suiv.
CONSCRIPTI. Sénateurs, distincts des patres : 359
CONSULAT. Fonctions religieuses des consuls : 254 ; quelle idée l’on se faisait primitivement du consul : 255 ; quelle idée on s’en fit plus tard : 444 ; avec quelles formalités religieuses les consuls étaient élus : 256, 257, 258, 259 ; changements dans le mode d’élection : 445 ; consuls plébéiens : 420, 421
COURONNE. Son usage dans les cérémonies religieuses : 222, 223 ; dans le mariage : 77, 78 ; dans quel cas les magistrats portaient la couronne : 254, 255
CROYANCES. Croyances primitives des anciens : 39 et suiv. ; leur rapports avec le droit privé : 98, 99, 112, 130, 131, 264, 265, 266, 267, 268, 269 ; leurs rapports avec la morale primitive : 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148 ; intolérance des anciens au sujet des croyances : 313, 314 ; leur puissance sur l’homme : 190 ; changements dans les croyances : 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 488 et suiv.
CULTE DES MORTS, chez tous les peuples anciens : 46, 47, 210, 211, 212, 219 ; relation de ce culte avec le culte du foyer : 61, 62 ; culte des héros indigètes : 211, 212, 213 ; culte du fondateur : 204, 205, 225, 226
CURIES et phratries : 172, 174
DÉCLARATION DE GUERRE (Rites de la) : 232
DÉMAGOGUES. Sens de ce mot : 460
DÉMOCRATIE. Comment elle s’établit : 450 et suiv. ; règles du gouvernement démocratique : 455 et suiv.
DÉMONS. Âmes des morts : 47, 51
DETESTATIO SACRORUM : 91
DETTES. Pourquoi le corps de l’homme et non sa terre répondait de sa dette : 110, 111 ; les dettes à Athènes : 372
DEVINS. À Athènes : 310 ; dans les armées grecques : 233
DIEUX. Dieux domestiques : 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 179, 180 ; divinités po-liades : 210 et suiv. ; les dieux de l’Olympe ont été d’abord des dieux domestiques et des divinités poliades : 179, 180, 181, 182, 183 ; idée que les anciens se faisaient des dieux : 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 236, 238, 288, 293, 294 ; alliance des divinités poliades : 295 ; évocation des dieux : 218, 219 ; prières et formules qui les contraignaient à agir : 219, 289, 307 ; peur des dieux : 236, 308 ; nouvelles idées sur la divinité : 493, 494 ; le christianisme : 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545
DIFFARREATIO : 80
DIVORCE : 80 ; était obligatoire dans le cas de stérilité de la femme : 86
DOT. Droit ancien : 137 ; droit nouveau, restitution de dot : 438
ΔΟΚΙΜΑΣÍΑ. Examen que subissaient les magistrats, les sénateurs, les orateurs : 460, 463
DOUZE TABLES : 429, 430, 432, 433
DROIT. Le droit ancien est né dans la famille : 129 ; il a été en rapport avec les croyances et avec le culte : 131, 266, 269, 274 ; droit de propriété : 97, 98 ; droit de succession : 112 et suiv. ; idée que les anciens se faisaient du droit : 267, 268, ; droit civil, jus civile : 269 ; interdit au non-citoyen : 275 ; changements dans le droit privé d’Athènes : 434, 435, 436, 437, 438 ; de Rome : 429, 433 ; droit des Douze Tables : 430, 431, 432, 433 ; lois de Solon : 435, 436, 437 ; droit prétorien : 523, 524
DROIT DE CITÉ. En quoi il consistait : 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ; comment il était conféré à Athènes : 274 ; importance du droit de cité aux époques anciennes : 274, 276, 277, 278 ; sous la domination romaine : 529 ; le droit de cité romaine est peu à peu étendu aux Latins : 530 ; aux Italiens : 532, 533 ; aux provinciaux : 537
DROIT DES GENS, entre les cités : 286, 288, 290, 291, 293
ἘΓΓΎΗΣΙΣ. Acte du mariage grec correspondant à la traditio in manum : 76, 77, 78
ÉDUCATION. L’État la dirigeait en Grèce : 315
ÉLECTION. Mode d’élection des rois : 247, 248, 345 ; des consuls : 256, 258, 445 ; des archontes : 256
ÉMANCIPATION du fils : 91 ; ses effets en droit civil : 122
EMPIRE de Rome, imperium romanum : 518 ; condition des peuples qui y étaient sujets : 519, 524
ÉNÉE (Légende d’) : 205, 206, 207, 208, 500, 501, 502, 503 ; sens de l’Énéide : 206, 207, 208, 209
ÉPHORES à Sparte : 337, 478, 482
ἘΠΙΓΑΜÍΑ, jus connubii : 283
ἘΠÍΚΛΗΡΟΣ : 117, 119, 441
ἘΠÍΣΤΙΟΝ. Famille : 73
ἝΡΚΕΙΟΣ ΖΕΎΣ. Divinité domestique : 100
ἝΡΚΟΣ, herctum, enceinte sacrée du domicile : 100
ESCLAVES. Comment ils étaient introduits dans la famille et initiés à son culte : 167
ἙΣΤÍΑ, Vesta, foyer : 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
ÉTRANGER. Ce qui le distinguait du citoyen : 272 ; l’étranger ne pouvait être ni propriétaire ni héritier : 274, 275 ; n’était pas protégé par le droit civil : 275, 276 ; était jugé par le préteur pérégrin ou par l’archonte polémarque : 274, 279, 280 ; sentiment de haine pour l’étranger : 288, 289
EUPATRIDES. Analogues aux patriciens : 321 ; luttent contre les rois : 340, 341 ; gouvernent la cité : 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 ; sont attaqués par les classes inférieures : 368, 369, 370, 371, 372, 390, 391
EXIL. Interdiction du culte national et du culte domestique, analogue à l’excommunication : 280, 281
FAMILIA. Sens de ce mot : 157
FAMILLE. Sa religion : 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ; son indépendance religieuse : 67 ; ce qui en faisait le lien : 71, 72, 73 ; avait l’obligation de se perpétuer : 82 ; noms de famille chez les Romains et les Grecs : 162 ; changements dans la constitution de la famille : 355, 356 ; division de la gens en familles : 356, 357, 359
FÉCIAUX dans les villes italiennes, ϰήρυϰες et spendophores dans les villes grecques : 232, 292, 293, 294
FEMME. Son rôle dans la religion domestique : 69, 73, 130, 132, 145 ; son rôle dans la famille : 131 ; le régime dotal fut longtemps inconnu : 137 ; la femme toujours en tutelle : 131 ; elle ne pouvait paraître en justice : 138 ; n’était pas justiciable de la cité : 139 ; était jugée, d’abord par son mari, plus tard par un tribunal domestique : 139 ; son titre de mater familias : 145 ; la femme obtient peu à peu des droits à l’héritage : 436 ; et la possession de sa dot : 438 ; parenté par les femmes : 96, 436
FÉRIES LATINES : 306
FEU SACRÉ : 52 et suiv.
FILLE. La fille, d’après les anciennes croyances, était réputée inférieure au fils : 87 ; mariée, elle n’héritait pas de son père : 114, 117 ; la fille ἐπίϰληρος : 119
FONDATION des villes, cérémonie religieuse : 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202
FONDATEUR (Culte du) : 204 et suiv.
FORMULES. Puissance des formules : 219 ; formules magiques : 328 ; formules d’évocation des dieux : 219
FOYER. Le foyer était un autel, un objet divin : 52 et suiv. ; rites prescrits pour l’entretien du feu sacré : 52, 53 ; le foyer ne pouvait pas être changé de place : 99 ; prières qu’on lui adressait : 52, 53 ; antiquité de ce culte : 55 ; sa relation avec le culte des morts : 61, 62 ; influence que ce culte a exercée sur la morale : 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ; foyer public ou prytanée : 209, 210 ; foyer transporté dans les armées : 232, 233 ; le culte du foyer perd son crédit : 488, 489, 490
ΓÉΝΟΣ grec analogue à la gens romaine : 149, 151 ; le γένος à Athènes : 153 ; γένος des Brytides : 150 ; culte intérieur du γένος : 152 ; son tombeau commun : 153 ; son chef : 154 ; le γένος perd son importance politique : 400
GENS. Sens de ce mot : 158 ; la gens était la vraie famille : 158, 159, 160, 161 ; culte intérieur de la gens : 152 ; son tombeau commun : 153 ; solidarité de ses membres : 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ; le nomen gentilitium : 162 ; le chef de la gens : 154 ; comment la gens s’est démembrée : 160, 355, 356 ; les gentes plébéiennes : 149, 150, 420, 609 (note 6) ; transformations successives et disparition du régime de la gens : 355 et suiv.
GENTILES. Lien de culte entre eux : 152, 153 ; lien de droit : 153 ; le gentilis était plus proche que le cognat : 153 ; dii gentiles : 152
GENTILITÉ : 430, 571 (note 16)
GUERRE. Caractères de la guerre chez les anciens : 288, 290
HÉLIASTES à Athènes : 621 (note 12)
HERES suus et necessarius. Sens de ces mots en droit romain : 113
HÉROS, âmes des morts : 51 ; étaient les mêmes que les Lares et les Génies : 51 ; héros éponymes : 174, ; héros nationaux : 211, 212, 213, 225
HOSPITALITÉ : 182, 575 (note 8)
HOSTIS. Sens de ce mot : 599 (note 8) ; pourquoi les idées d’étranger et d’ennemi se sont confondues à l’origine : 272, 273, 274, 275
HYMÉNÉE. Chant sacré : 77, 78
HYPOTHÈQUE. Inconnue dans le droit primitif : 563, 564 ; quand et sous quelle forme elle s’est introduite dans le droit attique : 372, 613 (note 11)
IMPERIUM. Ce mot désigne le pouvoir civil aussi bien que l’autorité militaire : 349 ; l’imperium romanum : 522, 523, 525
JOURS NÉFASTES chez les Romains et chez les Grecs : 232, 309
JUS ITALICUM : 529, 530 ; Jus latii : 526, 527, 528, 529, 530
LARES. Étaient les mêmes que les mânes et les Génies : 51
LARVES. Génies malfaisants : 42, 43, 49, 50, 51, 302
LECTISTERNIUM : 302
LÉGENDES. Leur importance en histoire : 240, 241, 242 ; légende d’Énée : 205 et suiv. ; légende de l’enlèvement des Sabines : 504
LÉGISLATEURS. Les anciens législateurs : 263, 264
LIBERTÉ. Comment les anciens la comprenaient, absence de garantie pour la liberté individuelle : 313, 317, 318, 453, 474
LIVRES liturgiques des anciens : 238, 239, 241, 242, 309 ; livres sibyllins à Athènes et à Rome : 306, 310
LOI. Loi faisait partie de la religion : 261, 262 ; respect des anciens pour la loi : 265, 266 ; la loi était réputée sainte : 265 ; elle venait des dieux : 264 ; les lois primitives n’étaient pas écrites : 266, 267 ; elles étaient rédigées sous forme de vers et chantées : 267 ; importance du texte de la loi : 267, 268, 269 ; la plèbe réclame la rédaction d’un Code de lois : 417 ; lois des Douze Tables : 418, 426 ; changement dans la nature et le principe de la loi : 428, 429 ; comment on faisait les lois à Athènes : 460, 461
LUSTRATIO. Cérémonie religieuse : 227, 289
LYCURGUE. Œuvre de Lycurgue à Sparte : 337, 476
MAGISTRATS. Ce qu’étaient les magistrats dans la première époque de l’existence des cités : 253 et suiv. ; ce qu’ils furent dans la seconde : 443, 444, 456, 457
MANCIPATIO : 110, 268
MÂNES. Étaient les âmes des morts : 51 ; correspondent aux θεοὶ χθονίοι des Grecs : 51
MANUS. Sens de ce mot dans le droit romain : 131, 132, 570 (note 12) ; relation entre la puissance maritale et le culte domestique : 143 ; effets de la manus en droit civil : 432 ; comment on évite ces effets : 433
MARIAGE. Le mariage sacré : 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80 ; ses effets religieux : 80, 85 ; était interdit entre habitants de deux villes : 274, 275, 276, 277, 280, 281, 282, 283 ; légende de l’enlèvement des Sabines : 504 ; interdit, puis autorisé entre patriciens et plébéiens : 419 ; mariage par mutuus consensus : 431 ; usus, coemptio : 433, 434 ; effets de la puissance maritale : 131, 145 ; manière d’échapper à la puissance maritale : 433
MATERFAMILIAS : 131, 145
MORALE primitive : 141, 142, 145, 146, 147, 228, 289
MUNDUS. Sens spécial de ce mot : 196
NATAL (Jour) des villes : 198
NEXUM : 405
ΝΟΘΟI. Ce que les anciens comprenaient dans la catégorie des νοθοί : 145, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282
NOMS de famille en Grèce et à Rome : 162
ODYSSÉE. La société qui y est dépeinte est une société aristocratique : 351
ὍΜΟΙΟΙ. Classe aristocratique à Sparte : 481, 482
ORATEURS. Leur rôle dans la démocratie athénienne : 459, 460
ὌΡΚΙΑ ΤÉΜΝΕΙΝ, ferire fœdus, σπένδεσθαι : 292
ὍΡΟΙ, ΘΕΟῚ ὍΡΙΟΙ, dieux termes : 107
OSTRACISME dans toutes les villes grecques : 316, 317
PARASITES. Sens ancien de ce mot : 222
PARENTÉ. Comment les anciens la comprenaient : 92 ; se marquait par le culte : 72, 93 ; il n’y avait pas de parenté par les femmes : 96 ; comment la parenté par les femmes s’est introduite dans le droit athénien : 436
PATERFAMILIAS. Sens de ce mot : 134
ΠΑΤΡΙÁΖΕΙΝ, parentare : 118
PATRICIENS. Origine de la classe des patriciens : 321, 322, 323, 324 ; leur privilège sacerdotal : 322 ; leurs privilèges politiques : 322, 324, 350, 401, 402, 424 ; leur lutte contre les rois : 343, 344 ; leur résistance aux efforts de la plèbe : 401, 402 ; leurs idées politiques : 403, 404, 425
PATRIE. Sens de ce mot : 278 ; ce qu’était primitivement l’amour de la patrie : 278, 279, 280, 281 ; ce que ce sentiment devint plus tard : 507 et suiv.
PATRONS : 168, 222, 322
PATRUUS et avunculus. Différence radicale entre la parenté que ces deux mots exprimaient : 121, 560
PÈRE. Sens originel du mot pater : 133, 134 ; autorité religieuse du père : 66, 131, 134, 135 ; sa puissance dérivait de la religion domestique : 72 ; son autorité sur ses enfants : 135, 137 ; ce qu’il faut entendre par le droit qu’il avait de vendre son fils : 137 ; de tuer son fils et sa femme : 139 ; son droit de justice : 138, 139 ; il était responsable de tous les délits commis par les siens : 140 ; la puissance paternelle d’après la loi des Douze Tables : 429 ; d’après la loi de Solon : 438
PHRATRIES. Analogues aux curies : 172 ; culte spécial de la phratrie : 172, 173 ; comment le jeune homme était admis dans la phratrie : 173, 174 ; les phratries perdent leur importance politique : 396
PHILOSOPHIE. Son influence sur les transformations de la politique : 491, 492, 493 ; Pythagore : 491 ; Anaxagore : 491 ; les sophistes : 492 ; Socrate : 493, 494 ; Platon : 494 ; Aristote : 494, 495 ; politique des épicuriens et des stoïciens : 495, 496 ; idée de la cité universelle : 496, 623
PIETAS. Sens complexe de ce mot : 146
PINDARE. Poète de l’aristocratie : 353
PLÉBÉIENS. Cette classe d’hommes existait dans toutes les cités : 327, 388, 389 ; ils étaient distincts des clients : 327, 328, 379 ; à l’origine, ils n’étaient pas compris dans le populus : 609 (note 4) ; comment la plèbe s’était formée : 328 ; comment elle s’est augmentée plus tard par l’adjonction des vaincus et des étrangers : 397, 398 ; les plébéiens n’avaient à l’origine ni religion, ni droits civils, ni droits politiques : 328, 330 ; leur lutte contre la classe supérieure : 382, 383 ; ils soutiennent les rois : 380 ; ils créent des tyrans : 381, 382 ; efforts et progrès de la plèbe romaine sous les rois : 398 et suiv. ; sous la République : 405 et suiv. ; sa sécession au mont Sacré : 406, 407, 408 ; le tribunat de la plèbe : 408, 409, 410, 411, 413 ; la plèbe entre dans les cités : 378 et suiv.
PLÉBISCITES : 413
PONTIFES. Surveillaient les cultes domestiques : 67 ; pontifes patriciens : 324 ; pontifes plébéiens : 425
PRÉTEURS. Avaient quelques fonctions religieuses : 255
PROCÉDURE antique : 268
PROPRIÉTÉ. Droit de propriété chez les anciens : 97 et suiv. ; relation entre le droit de propriété et la religion : 99 ; la propriété fut d’abord inaliénable : 108 ; indivisible : 110 ; ce que devint le droit de propriété aux époques postérieures : 468, 519, 523, 545
PROVINCIA. Sens de ce mot : 521 ; comment Rome administrait les provinces : 521 et suiv. ; les provinciaux n’avaient aucun droit : 522, 523, 524
PRYTANÉE. Foyer de la cité : 189 ; analogue au temple de Vesta : 209
PRYTANES. Les prytanes étaient à la fois des prêtres et des magistrats : 253 ; prytanes et sénateurs : 457
REPAS. Le repas était un acte religieux : 55 ; repas funèbres offerts aux morts : 44, 45, 46, 47, 64, 82 ; les repas publics étaient des cérémonies religieuses : 221, 222, 223, 224, 225 ; repas publics à Athènes : 222 ; en Italie et à Rome : 223
RELIGION. La religion domestique : 63 ; comment les anciens comprenaient la religion : 238, 239 ; religion particulière à chaque cité : 209 ; la religion romaine n’a pas été établie par calcul : 235, 236, 304 ; influence de la religion dans l’élection des magistrats : 248, 255, 256, 257 ; transformation du sentiment religieux : 537, 538
RESPUBLICA, τὸ ϰοινόν : 441
RÉVOLUTIONS. Caractères essentiels et causes générales des révolutions dans les cités anciennes : 319 ; première révolution qui enlève à la royauté sa puissance politique : 334, 335 ; révolution dans la constitution de la famille par la séparation des branches de la gens et par l’affranchissement des clients : 355, 356 ; révolution dans la cité par les progrès de la plèbe : 379, 380 ; révolutions de Rome : 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 358, 359, 360, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 ; révolutions d’Athènes : 339, 368 et suiv., 390 et suiv. ; révolutions de Sparte : 336, 337, 475 et suiv. ; disparition de l’ancien régime et nouveau système de gouvernement : 439 ; l’aristocratie de richesse : 446, 447, 448, 449, 450 ; la démocratie : 451 et suiv. ; luttes entre les riches et les pauvres, en Grèce : 465 ; à Rome : 514
RITUELS, dans toutes les cités anciennes : 238, 239, 240, 241
ROME. Formation de la cité romaine : 194 ; cérémonie de la fondation : 194, 195, 196, 197, 198 ; nature de l’asile ouvert par Romulus : 194 ; le caractère romain : 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ; superstitions romaines : 301, 302, 303 ; le patriciat : 323 et suiv. ; la plèbe : 327 et suiv. ; le Sénat : 231, 325 ; l’assemblée par curies : 231, 325 ; la royauté : 247, 249, 343, 344, 345, 346 ; lutte des rois contre l’aristocratie : 344 ; révolution qui supprime la royauté : 346, 347, 348 ; domination du patriciat : 350, 401, 402, 403, 404 ; efforts et progrès de la plèbe : 405 et suiv. ; le tribunat : 408, 410, 411, 412 ; les assemblées par tribus et les plébiscites : 413 ; la plèbe acquiert l’égalité civile, politique, religieuse : 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 ; pourtant, les procédés du gouvernement et les mœurs restent aristocratiques : 513 ; formation d’une nouvelle noblesse : 515 ; conquêtes des Romains : 503 et suiv. ; relations d’origine et de culte entre Rome et les cités de l’Italie et de la Grèce : 499, 501, 503, 506 ; premiers agrandissements : 503 et suiv. ; sa suprématie religieuse sur les cités italiennes : 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514 ; Rome se fait partout la protectrice de l’aristocratie : 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 ; imperium romanum : 521, 522, 523 ; comment elle traite ses sujets : 523, 525 ; elle accorde le droit de cité romaine : 524 et suiv.
ROYAUTÉ. Ce qu’était la royauté primitive : 246, 247 ; les rois-prêtres : 247 ; avec quelles formes liturgiques ils étaient élus : 247, 248 ; leurs attributions judiciaires et militaires : 249, 250 ; la royauté héréditaire comme le sacerdoce : 249, 250 ; Βασιλεῖς ἱεροί : 251 ; Sanctitas regum : 252 ; N’a pas été abolie à Athènes après Codrus : 341 ; révolution qui supprime partout la royauté : 334, 335, 336 ; magistrats annuels appelés rois : 253, 337, 342 ; rex sacrorum : 348 ; le mot appliqué, durant l’âge aristocratique, aux chefs des gentes : 352
SACERDOCES. Dans les anciennes cités, les sacerdoces furent longtemps héréditaires : 181 ; sacerdoces réservés au patriciat : 330, 332 ; la plèbe acquiert les sacerdoces : 423, 424, 425
SACROSANCTUS. Sens de ce mot : 409
SECONDE VIE. On a cru d’abord qu’elle se passait dans le tombeau : 40 ; quelle idée on s’en est faite plus tard : 44, 489
ΣΕΙΣΑΧΘΕÍΑ. Œuvre de Solon : 377
SÉNAT. Le Sénat se réunissait dans un lieu sacré : 231 ; il était composé des chefs des gentes : 325 ; introduction des sénateurs conscripti : 358 ; le sénat d’Athènes : 457, 458 ; le sénat de Rome : 513, 515
SÉPULTURE. Ses rites et les croyances qui s’y rattachaient : 40, 41, 42, 43 ; pourquoi la privation de sépulture était redoutée des anciens : 40, 41, 43
SERVIUS TULLIUS. Ses réformes : 398, 399, 400, 401, 447
SHRADDA. Chez les Hindous, analogue au repas funèbre des Grecs et des Romains : 49
SŒUR. Elle est subordonnée au frère, pour le culte : 87 ; pour l’héritage : 114, 115, 116, 117, 118
SOLON. Son œuvre : 368, 369, 370, 371, 372, 373, 435, 436, 437, 438
SORT. Quelle idée les anciens s’en faisaient : 256 ; ce qu’était le tirage au sort des magistrats : 256, 444
SPARTE. La royauté à Sparte : 336, 337, 338 ; le caractère spartiate : 307, 308, 451, 452, 460 ; l’aristocratie gouverne à Sparte : 477, 478 ; série des révolutions de Sparte : 475, 476 ; les rois démagogues et les tyrans populaires : 480, 481
STRATÈGES à Athènes : 443, 444, 456 ; ce qu’ils deviennent sous la domination de Rome : 520
SUCCESSION. La règle pour le droit de succession était la même que pour la transmission du culte domestique : 112, 113, 123 ; pourquoi le fils seul héritait, non la fille : 116 ; succession collatérale : 119, 121 ; l’héritier collatéral devait épouser la fille du défunt : 117, 118 ; droit d’aînesse, privilège de l’aîné : 125, 126, 127, 128 ; le droit de succession d’après les Douze Tables : 429, 430 ; d’après la législation de Solon : 436
SUJÉTION. La sujétion entraînait la destruction des cultes nationaux : 291, 519
TERMES. Limites inviolables des propriétés : 106, 107 ; légende du dieu Terme : 107 ; avec quelles cérémonies le terme était posé : 106
TESTAMENT. Le testament était contraire aux vieilles prescriptions religieuses et fut longtemps inconnu : 123, 124, 125 ; il ne fut permis par Solon qu’à ceux qui n’avaient pas d’enfants : 123, 436 ; formalités difficiles dont il était entouré dans l’ancien droit romain : 125 ; il est autorisé par les Douze Tables : 430
THÈTES (les) à Athènes : 368
TIRAGE au sort pour l’élection des magistrats : 256, 594, 595 (note 14)
TOMBEAUX. Les tombeaux de famille : 65, 66 ; l’étranger n’avait pas le droit d’en approcher : 64 ; ni d’y être enterré : 102 ; le tombeau était placé, à l’origine, dans le champ de chaque famille : 103 ; le tombeau était inaliénable : 103
TRADITIONS. Quelle valeur on peut accorder aux traditions et aux légendes des anciens : 243
TRAITÉS. Les traités de paix étaient des actes religieux : 291, 292
TRIBUNAT de la plèbe : 408 ; nature particulière de cette sorte de magistrature : 408, 409, 410, 412
TRIBUNAT militaire : 444
TRIBUNE. La tribune était un lieu sacré, un templum : 231
TRIBUS. Les tribus de naissance : 174, 175 ; ces tribus sont supprimées par Clisthènes et par d’autres dans toutes les cités grecques : 393, 394, 395, 396 ; les tribus de domicile à Athènes : 395, 396 ; à Rome : 402, 403
TRIOMPHE. Cérémonie religieuse chez les Romains et chez les Grecs : 233, 234, 307
TYRANS. En quoi ils différaient des rois : 252, 381, 382 ; ils étaient les chefs du parti démocratique : 382, 383, 384, 385 ; politique habituelle des tyrans : 471, 472, 473
VESTA. N’était autre que le feu du foyer : 52, 58 ; se confondait avec les Lares : 61 ; légende de Vesta : 60 ; le temple de Vesta était analogue au prytanée des Grecs : 209 ; croyances qui s’y rattachaient : 209, 210, 211
VILLE. La ville était distincte de la cité : 193, 194 ; ce que c’était que la ville dans les idées des anciens : 326 ; comment on choisissait l’emplacement de la ville : 204 ; rites de la fondation des villes : 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 ; les villes étaient réputées saintes : 202, 203