

Le dimanche est un jour particulier en France. Les magasins sont fermés, mais les boulangeries redoublent d’activité. Pendant toute la matinée, chacun s’y rend pour acheter une baguette bien fraîche ou les pâtisseries qui seront servies en dessert le midi. Les fleuristes ne chôment pas non plus car le dimanche, c’est le jour des repas en famille et il serait impoli d’arriver les mains vides …
Quand j’étais enfant, je redoutais les dimanches parce que je savais que ce jour-là, je passerais avec mes parents plusieurs heures à table chez l’une de mes grands-mères. D’abord, il y avait l’apéritif : pastis, porto ou kir pour les grands, jus d’orange pour les enfants et, pour tout le monde, cacahuètes, olives, petits cubes de fromage à grignoter.
Le repas suivait avec une entrée, (des fruits de mer, par exemple), un plat principal, (de la viande et des légumes, généralement), du fromage (obligatoirement !), de la salade (presque toujours) et, vers quatre heures de l’après-midi, lorsque les estomacs étaient complètement pleins: le dessert (enfin !).
Le dimanche soir, bien sûr, personne n’avait envie de manger. Il ne restait qu’à aller se coucher en se disant qu’on avait sans doute perdu sa journée.
Et pourtant… Ma maman est aujourd’hui grand-mère et les dimanches chez elle, avec ma femme et mon fils, n’ont rien d’ennuyant. Nous mangeons bien, mais pas trop et, dès le dessert terminé, nous sortons nous promener tous ensemble au bord de la mer ou en forêt. Le dimanche soir, quand je couche mon fils, je me dis que la journée a été magnifique. Pourvu qu’il pense la même chose !

Officiellement, la France est un état laïc, il est d’ailleurs interdit de porter des signes religieux visibles dans les établissements scolaires. Il existe cependant une exception pour une région, c’est l’Alsace-Moselle. En effet, lors de la séparation des pouvoirs politique et religieux en 1905, celle-ci n’était pas encore française, mais allemande. C’est la raison du traitement de faveur dont elle bénéficie, l’état finance même certaines de ses églises.
De manière générale, si on s’intéresse aux religions que les Français pratiquent, on se rend compte que le pays est non seulement multiculturel, mais aussi multiconfessionnel. Ce qui en fin de compte est normal lorsqu’on se souvient du passé colonial de ce pays. D’après les statistiques de l’Institut français d’opinion publique 64% de Français sont catholiques, 27% se considèrent comme athées, 3% sont musulmans, 2,1% sont de confession protestante et 0,6% sont juifs.
Historiquement, la France est un pays catholique tout au moins après les huit guerres de religion qui l’ont ravagée durant le XVIème siècle. Cependant, après la Deuxième Guerre Mondiale, l’engouement pour la religion chute et l’arrivée massive d’immigrés issus des anciennes colonies françaises contribuent à diversifier le climat religieux du pays. Il n’existe pas de conflit entre les différentes religions et chaque Français a le droit de pratiquer la religion de son choix tout en respectant les droits religieux de ses compatriotes.

Quand on pense très fort à la Provence, on peut presque sentir le parfum sucré de la lavande ravivée par le soleil méditerranéen. Le plateau de Valensole, en Drôme provençale, offre les plus belles étendues parme de lavande.
De très grands peintres se sont souvent recueillis sur ces lieux pour capturer au creux de leur œuvre, l’harmonie des couleurs offerte par la nature. Quand le vent souffle à travers les champs, le parfum nous entraine dans une véritable symphonie des sens.
La lavande, véritable mine d’exploitation provençale depuis des millénaires a dans un premier temps fait des adeptes parmi nos plus vieux ancêtres.
Utilisée précieusement tout d’abord par les Romains durant le bain et pour parfumer les linges, elle sera utilisée durant les temps moyenâgeux en tant que plante médicinale qui aurait la réputation de renfermer des vertus calmantes, antiseptiques, cicatrisantes… la lavande a toujours été un ingrédient suprême pour la beauté et l’hygiène.
Son parfum est convoité des savonniers, parfumeurs, créateurs d’ambiance régionaux et il reste un des composants de base de la parfumerie contemporaine. Son parme doux et sa forme atypique se retrouvent sur les vaisselles vendues dans les boutiques et font la joie des potiers, et autres décorateurs de maisons et de linges.
Il existe même du miel de lavande, et c’est un produit très recherché des gens de la région pour la douceur qu’il renferme. Ses étendues cultivées ou sauvages ont révélé les plus grands peintres provençaux.
La cueillette, autrefois réalisée à la faucille, a lieu en été entre le 15 juillet et le 15 août, dans les « baïassières » endroits où poussent les « baïasses » (nom provençal donné aux pieds de lavande) par des travailleurs saisonniers venant de toute la région et parfois même d’autres pays d’Europe.
La lavandiculture prit une grande place dans la vie des Provençaux. Si vous demandez aux cultivateurs de vous parler de lavande, ils vous diront d’abord de faire attention à ne pas confondre lavande et lavandin. La vraie lavande est l’espèce d’origine, elle se reproduit naturellement à l’état sauvage ou cultivé. On peut la reconnaitre à sa taille et sa couleur.
La distillerie de son essence offre un parfum plus fin, plus doux, et elle garde toutes ses vertus thérapeutiques sous forme d’huile essentielle. Le lavandin, lui, est déjà plus grossier par son aspect, plus long et aux bouts plus gros, sa couleur est plus « violette » que celle de la lavande, plutôt mauve. Le lavandin est stérile, il ne se reproduit pas naturellement et sa fabrication est d’origine industrielle. En effet il peut produire beaucoup plus d’essence que la vraie lavande. Son huile essentielle ne préserve aucune vertu et reste rarement utilisée en pharmacopée de nos jours. Son odeur est déjà plus « acre » et moins sucrée.
La lavande pure reste un produit très prisé à l’achat et demeure un véritable produit de luxe. Elle reste le produit de référence quand on parle de la Provence. C’est le parfum de nos enfances.

Visiter les marchés est sans doute le meilleur moyen de s’imprégner de l’ambiance d’une ville. N’hésitez pas à vous enfoncer dans les méandres de leurs étroites ruelles et à slalomer entre les étals, après avoir pris les précautions d’usage contre les pickpockets. C’est sans doute aussi le meilleur moyen d’y apprendre le marchandage.
Les marchés de Dakar
A Dakar, vous en découvrirez plusieurs, avec chacun ses spécialités et son ambiance. Le plus classique est le grand marché Sandaga, au croisement de l’avenue Lamine Gueye et de l’avenue Emile Badiane. Un grand bâtiment de style néo-soudanais abrite, sur deux étages, tous les produits alimentaires: légumes, viande, poisson. L’avenue Emile Badiane est bordée de kiosques tenus en général par des « baol-baol » (originaires de la région de Diourbel) où vous trouverez surtout des appareils électriques, souvent dernier cri: hi-fi, télévision, vidéo, etc. Dans les rues voisines, beaucoup de boutiques de tissus, vendus à la pièce ou assemblés en sacs, vêtements…
Le plus touristique est le marché Kermel, petit marché au cœur du vieux Dakar, entre l’Avenue Sarrault et le port, qui abrite de belles maisons coloniales. Dans un très beau bâtiment de 1860, ravagé par un incendie en 1994, puis reconstruit en 1997, l’on trouve tous les produits alimentaires de type européen, joliment présentés. C’est aux alentours que les vendeuses de fleurs circulent chargées de bouquets, à côté de boutiques d’artisanat (vannerie, sculpture sur bois, maroquinerie) et de magasins modernes: boucheries, épiceries …
Le plus authentique est le marché Tilène, avenue Blaise Diagne, dans le vieux quartier de la Médina. A l’extérieur, des étals de fruits et légumes. A l’intérieur, tous les produits de consommation africaine : alimentation, épices, fruits, bijoux, tissus, friperie, ustensiles de cuisine…

Le plus éclectique est le marché du port, où les marchandises proposées dépendent souvent des arrrivages des bateaux. On y trouve de la quincaillerie, du matériel utilisé par les pêcheurs (bottes, cirés, cordages, pesons), des appareils photos, des cigarettes…
Le plus exotique est le marché « Casamance », situé sur le quai d’embarquement pour Ziguinchor. On y trouve tous les produits du sud du pays, souvent difficiles à trouver ailleurs: huile de palme, crevettes séchées, miel, fruits et légumes.
Le plus vestimentaire est le marché aux fripes, itinérant, que l’on retouve à Gueule Tapée, Grand Mosquée, Front de terre: des centaines de ballots de vêtements et chaussures d’occasion, à tous les prix.
Enfin, si vous êtes en brousse, ne manquez pas les « lumas », les marchés hebdomadaires. Les habitants de tous les villages avoisinants, venus en charrette, se rassemblent pour acheter, vendre, échanger, discuter. Vous y trouverez des produits alimentaires et artisanaux de la région, du bétail, des vêtements, des ustensiles de cuisine… Des gargotes s’y installent pour toute la journée.
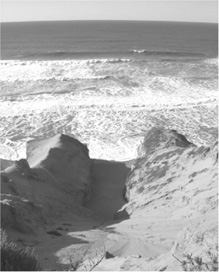
Il y a deux saisons dans l’année en Guadeloupe: l’hivernage, qui va de juillet à décembre et le carême qui commence au mois de janvier pour se terminer en juillet. Ces saisons donnent deux visages totalement différents à l’île: très humide et cyclonique pendant l’hivernage, très sec et chaud pendant le carême.
Le carême est la saison sèche pendant laquelle les catholiques célèbrent deux fêtes religieuses fondamentales: les Pâques et la Pentecôte. Sur l’île, ces deux fêtes religieuses sont l’occasion d’une célébration populaire (et pas vraiment religieuse): camper en famille au bord de la mer et manger le mets de saison, le crabe de terre.
Plusieurs semaines avant la période des vacances de Pâques (en avril) ou de Pentecôte (en mai), les familles commencent à rechercher les meilleurs emplacements où elles pourront installer leur campement. Ainsi, on parcourt des kilomètres de plage ou alors on se dirige vers sa plage habituelle pour y repérer l’endroit où l’on installera le nombre de tentes adéquat, les voitures et surtout tout le nécessaire pour la cuisson des repas. Pour le reste, il s’agit de camping et les conditions de vie restent assez difficiles. C’est pourquoi depuis deux ans, les municipalités de Guadeloupe qui reçoivent des campeurs ont pris la décision d’installer des toilettes ou des douches portables pour les familles qui désirent un peu plus de confort dans leur aventure.
Certaines plages de Guadeloupe, comme le Souffleur à Port-Louis, l’Anse à la Gourde à Saint-François ou la Perle à Deshaies sont prises d’assaut par les campeurs avant le début des vacances car elles sont très accessibles et offrent une végétation accueillante pour les campements. Elles sont si réputées pour leur tradition de camping, qu’elles sont même à éviter à cette période lorsque l’on ne vient pas camper. En effet, les campeurs y prennent leurs aises, y mettent la musique. C’est une véritable vie qui se met en place en quelques jours sur ces plages.
L’autre élément essentiel de cette période pour les Guadeloupéens est le crabe de terre.

Il vit exclusivement dans les mangroves et les lieux humides. Il est très savoureux car il grandit dans les racines des arbres. Il se nourrit de végétaux et de petites crevettes ou de petits poissons de mangrove. Sa chaire est très appréciée et est utilisée dans plusieurs mets caractéristiques de la saison: le matété ou le calalou de crabe.
Les Guadeloupéens apprécient beaucoup cet animal qu’ils ne mangent en général qu’en cette saison car c’est à cette période qu’il arrive à maturité. L’espèce est protégée le reste de l’année. On ne doit alors pas l’« attraper » sous peine de mettre l’espèce en danger.
La vendange est la récolte du raisin qui est destiné à la fabrication du vin. On utilise ce terme en tant que verbe, « vendanger » (récolter le raisin sur les pieds de vignes), comme nom, « la vendange » (pour désigner la récolte), ou au pluriel pour évoquer la période de la récolte ; on parle alors du temps, ou de la période, « des vendanges ».
Les vendanges ont traditionnellement lieu en France entre fin août/début septembre et octobre selon les régions. Les viticulteurs emploient des saisonniers pour récolter les raisins. La plupart du temps, ce sont des étudiants qui effectuent ces travaux car cela leur procure un revenu intéressant sur un temps très court, tout en les aidants pour le financement de leurs études.
Auparavant, les viticulteurs embauchaient régulièrement des vendangeurs au noir. La réglementation actuelle en France est devenue très stricte et a engendré l’élaboration de contrats de travail spécifiques aux vendanges, permettant ainsi de limiter les fraudes et les embauches illégales de travailleurs. Ainsi, les viticulteurs emploient les vendangeurs pour une durée qui varie de 8 à 15 jours. Ils signent un « contrat vendanges », contrat saisonnier particulier qui ne peut dépasser un mois. Il est possible de cumuler ou d’enchaîner plusieurs contrats vendanges, mais la durée totale de tous les contrats réunis ne peut excéder deux mois. La durée de travail hebdomadaire varie selon les exploitations de 35 à 39 heures. Ce travail est rémunéré sur la base du Smic, c’est-à-dire autour de 8 euros de l’heure, (soit 50 à 60 euros nets pour une journée).
Le travail de base consiste à couper les grappes de raisin avec un sécateur et à les déverser dans une grande hotte où sont stockés les grains. Les hottes sont ensuite vidées pour effectuer un tri des grains, ce qui permet par exemple d’éliminer les grains abimés qui auraient pu être cueillis. Le raisin est ensuite amené en cuve où pourra commencer le processus de vinification (macération du moût et fermentation alcoolique qui aura lieu sous l’action des levures qui transforment les sucres en alcool puis mise en fût de chêne).
Le travail de vendange peut être fait à la main (avec un sécateur), mais également par l’intermédiaire de machines spécifiques. Dans ce cas, la récolte ne permet pas une sélection des grappes aussi rigoureuse que celle effectuée avec la récolte manuelle, et cela engendre forcément une qualité moindre du vin car les grappes qui seront cueillies seront plus ou moins mûres et/ou plus ou moins abîmées.
Chaque méthode de vendanges comporte pourtant ses avantages et ses inconvénients. Avec une machine, on peut vendanger aussi bien le jour que la nuit et réduire le coût d’intervention du personnel qui n’est pas négligeable. C’est par ailleurs particulièrement intéressant pour vendanger le raisin blanc, plus fragile, qui sera récolté plus frais pendant la nuit. La durée d’une vendange effectuée à la machine est bien-sûr beaucoup plus courte qu’à la main. En moyenne, il faudra 2 heures pour vendanger un hectare contre 70 heures pour la même superficie à la main. Le coût de la vendange réalisée avec une machine est à peu près de 50% du coût de la vendange effectuée manuellement.
En revanche, avec une machine, il faut que la vigne soit assez haute car les grappes situées à moins de 30 cm du sol ne seront pas récoltées et les grains sont plus facilement écrasés que lorsqu’ils sont cueillis manuellement. La vendange manuelle est une méthode utilisée pour la production de vins de qualité supérieure et des vins effervescents, car cela exige une sélection très rigoureuse des meilleures grappes. La cueillette à la machine n’atteint jamais la précision d’une cueillette manuelle.
Enfin, quelle que soit la méthode utilisée, il faut éviter de vendanger pendant les heures les plus chaudes de la journée car cela peut déclencher une fermentation précoce du raisin avant son transfert dans la cave de vinification. Cela pourrait avoir des répercussions sur la qualité du produit final. En tant que vendangeur, faire les vendanges reste une expérience enrichissante et bien que cela nécessite une certaine résistance physique, elle permet de faire de belles rencontres et de se faire un salaire non négligeable dans un laps de temps assez court.

Ah, la France et ses marchés ! Qui n’a jamais entendu parler de ces fameux marchés hebdomadaires, où se vendent pêle-mêle fruits, légumes, fromages, charcuteries, poissons, épices et plats à emporter ? Si ces marchés font la joie des visiteurs et de mes grands-mères, c’est un tout autre genre de marché que j’apprécie. Des marchés qu’on attend toute l’année, car ils n’ont lieu qu’ en décembre: les marchés de Noël.
Ouverts tous les jours en décembre, les marchés de Noël sont originaires d’Allemagne et d’Alsace et remontent au XIVème siècle. Aujourd’hui, ils se sont répandus dans toute l’Europe, depuis les grandes villes jusqu’à certains villages de campagne. Pourquoi autant de succès ? Parce que ces marchés mêlent avec brio traditions, ambiance de fête et joies de l’hiver.
Semblant sortir tout droit d’une carte postale, les marchés de Noël ressemblent à de petits villages. Les chalets en bois se serrent les uns contre les autres, comme pour se protéger du froid. Les guirlandes, lumières, sapins et décorations contribuent à donner un air féerique à la scène. Promenez-vous dans les allées … Sentez-vous cette bonne odeur ? Ce sont des gaufres accompagnées de vin chaud à la cannelle, une spécialité de ces marchés. Plus loin, vous trouverez probablement des crêpes ou d’autres pâtisseries, des châtaignes grillées ou des plats bien hivernaux, comme la tartiflette.
Mais vous n’êtes pas venus seulement pour manger, n’est-ce pas ? Avancez encore un peu et regardez autour de vous. Les marchands, bien emmitouflés dans leurs manteaux, bonnets et mitaines, n’attendent que vous. Les étals débordent d’artisanats locaux et exotiques: santons provençaux, poteries, bougies, bijoux originaux, ponchos péruviens, sculptures et bibelots divers, décorations de Noël, jouets traditionnels en bois…
Avec un peu de chance, vous pourriez même voir les artisans à l’œuvre, sculptant un morceau de bois ou tricotant une paire de moufles. Il devient souvent difficile de choisir ses cadeaux, tant le choix est grand !
Si vous êtes fatigués de vous promener, venez donc profiter des spectacles organisés. Emmenez vos enfants admirer la crèche grandeur nature ou faites leur faire un tour de manège. Ici, tout est prévu pour faire le bonheur des petits et des grands.
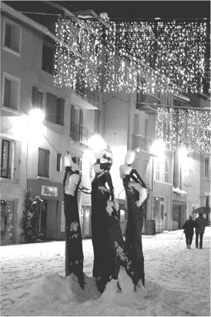
Envie de le voir pour de vrai ? Les marchés de Strasbourg, d’Alsace, de Paris et de Provence sont parmi les plus réputés de France. En Europe, essayez donc celui d’Aix-la-Chapelle en Allemagne ou de Vienne en Autriche. Et pour nos amis nord-américains, tout a été prévu à Québec, pour les Marchés de Noël Joliette-Lanaudière. Alors amusez-vous bien !
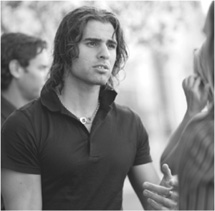
À l’étranger, les Français ont encore une image de personnes un peu rustres avec des clichés datant de l’époque de la Deuxième Guerre mondiale. Afin de sortir la France de ce stéréotype, il faut prendre plusieurs faits en considération.
Les Français attachent énormément d’importance à l’Histoire et la Culture de leur pays qui sont d’une grande richesse. C’est un pays très ancien, avec une Histoire remplie de conquêtes, de découvertes et régi par des rois influents. Avec la gastronomie, cela fait partie dela grande fierté française. Certains étrangers arrivent en France en pays « conquis » et peuvent avoir une attitude méprisante vis-à-vis d’un pays qu’ils ne comprennent pas toujours, car culturellement très différent. Ce que l’on peut prendre comme de l’impolitesse peut être une simple réaction de fierté vis-à-vis de ce qui est non compris et d’une histoire qui n’est pas considérée comme importante. La France ne se limite pas à Paris et ses restaurants ou à la Côte d’Azur. Le Français y est très attaché, et les étrangers ne peuvent pas toujours comprendre ce concept, qui peut parfois engendrer des quiproquos.
Comme dans chaque pays étranger, tout dépend également de la façon dont le touriste aborde sa visite sur le territoire. Aller dans un pays sans chercher à comprendre les coutumes locales exposera le visiteur à des réticences de la part du peuple hôte, quel qu’il soit. La France ne déroge pas à cette règle.
Vis-à-vis des personnes anglophones, les Français ont souvent subi des moqueries sur leur accent lorsqu’ils parlent anglais. Il est donc peu étonnant que le Français soit ensuite réticent à s’exprimer dans cette langue quand il est sujet à moqueries. Pourtant, si vous abordez une personne dans la rue et lui demandez de façon polie, en français, s’il peut vous renseigner en anglais, il est fort à parier qu’il cherchera à vous aider du mieux qu’il peut. Par contre, si vous vous exprimez de façon un peu brusque sans faire un minimum d’effort et en considérant que la personne à qui vous vous adressez parlera forcément anglais, ne vous étonnez pas de vous voir répondre de la même façon.

Les Français enfin sont considérés comme étant râleurs et exigeants. Comme dans tous les peuples, on ne peut faire d’une minorité une généralité ; au sein des Français comme de toutes les autres nationalités, il y a de nombreuses personnalités différentes, des gens charmants, des idiots, des râleurs, des gentils et des méchants…, c’est ce qui fait la variété et l’intérêt d’une population. Ne dit-on pas qu’ « il faut de tout pour faire un Monde » ?
Le Canada est un pays bilingue et près de 6,5 millions de Canadiens sont francophones. Ils vivent principalement dans la province de Québec, mais on retrouve aussi des populations francophones dans les provinces du Nord et les provinces qui sont encore appelées « provinces maritimes » du Canada.
Les populations francophones avaient du mal à s’imposer dans un pays en majorité anglophone, mais depuis les années soixante on observe une tendance inverse. Les pouvoirs publics qui comprennent l’intérêt à préserver la culture francophone mettent en place des programmes qui ont pour but de mieux la faire connaître non seulement à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du pays.
Depuis 1974, le français est désormais la langue officielle du Québec, bien que l’anglais reste la langue officielle du reste du pays. Les Canadiens francophones sont les héritiers d’une culture très riche de leurs aïeuls originaires de France et n’hésitent pas la faire connaître à tous ceux qui le souhaitent. L’art, la musique, la gastronomie ne représentent que certains aspects de cette culture.
Comme leurs ancêtres, beaucoup de Canadiens francophones prennent au petit-déjeuner du café ou du thé avec un croissant. Ils aiment aussi des sandwichs faits avec des baguettes de pain, du fromage et du jambon. Parmi les spécialités culinaires que les Canadiens francophones aiment, on peut aussi citer la soupe de pois et le ragoût de boulettes. Dans la rue, les vendeurs proposent la poutine. Ce sont des pommes frites arrosées de sauce.
Cette émancipation culturelle et linguistique ne se passe pas sans retombées sensibles, un mouvement séparatiste qui exige l’indépendance du Québec vis-à-vis du reste du Canada est né dans les années soixante-dix et malgré quelques échecs politiques cuisants, il continue d’exister, car la préoccupation essentielle de beaucoup de Canadiens francophones est la préservation de la culture et la langue française.
Qui ne s’est jamais extasié devant l’élégance des femmes françaises, devant leur allure sobre et raffinée ou devant cette petite touche d’excentricité que l’on retrouve dans les détails d’une chaussure ou d’une écharpe savamment disposée sur une petite robe toute simple? La mode est indissociable de la culture française, et à chaque saison les regards se tournent vers Paris où les grands couturiers recréent les tendances qu’imiteront avec plus ou moins de succès toutes les femmes du monde.
Des belles de l’Antiquité aux égéries de notre époque, les femmes, et dorénavant les hommes, cherchent à confirmer leur pouvoir de séduction ou parfois même l’appartenance à leur génération ou à un groupe particulier, en adoptant un style vestimentaire qui les définit et dont ils peuvent être fiers. Au XVIIIème siècle, ce sont plutôt les hiérarchies sociales qui étaient mises en scène avec excès et parfois même ostentation par le biais du costume. De nos jours, même si c’est l’individualisme qui prime, la mode demeure l’expression de conventions sociales auxquelles nous adhérons tous plus ou moins.
En France, Coco Chanel a été l’une des premières créatrices de mode. S’inspirant des lignes dépouillées des costumes masculins et mettant le corset au rancart, elle a libéré le corps de la femme si longtemps emprisonné, en créant un style élégant et épuré. Des couturiers comme Cacharel, Yves St-Laurent, Dior et Jean-Paul Gaultier ont conquis la seconde moitié du vingtième siècle en élevant la confection au rang de l’art, et en faisant des mannequins qui présentent leurs modèles des célébrités à part entière.
Quelques exceptions cependant : le jeans - né du bleu de travail porté par les fermiers et les ouvriers américains vers 1870 - le t-shirt et le col roulé représentent le style décontracté qui domine depuis la fin des années cinquante et échappe à tous les diktats de la mode, que ceux-ci viennent de Paris ou d’ailleurs.
Un dimanche en France, page 4
1. What shops might you visit on a Sunday in France?
2. What is the typical activity and destination on this day or in this story?
3. List some of the food enjoyed on this day.
Parfum de nos enfances, page 6
1. When and for what purpose was lavender first used?
2. When is the lavender harvest?
3. What are some characteristics of the “real” lavender?
Les marchés du Sénégal, page 8
1. In what city and what setting will you find the most touristy market?
2. Where will you find dried shrimp, palm oil, and honey?
3. Describe les lumas. What kind of business is typically conducted here?
Les mois du camping et du crabe, page 10
1. What was added to the campgrounds to add more comfort?
2. Where does le crabe de terre live? What does it eat?
3. Why do the people of Guadeloupe catch and eat this crab only one season per year?
Les vendanges, page 12
1. When are the vendanges ?
2. Who do the winemakers hire to do the work?
3. What are some of the hiring rules for seasonal workers?
4. What are some of the advantages of harvesting with a machine?
Noël sur les marchés, page 14
1. Where did the markets originate?
2. What kind of food or drink might you enjoy at the markets?
3. What gifts might you find?
Francophonie canadienne, page 18
1. When did French become the official language of Quebec?
2. What typical French food can you buy from street vendors?
La mode, reflet de la culture, page 19
1. Who was one of the first fashion designers in France?