

Pour jouir d’une vie heureuse
et accomplie, la clé est l’état d’esprit.
C’est là l’essentiel.
Sa Sainteté le XIVe dalaï-lama
Les sources de la méditation sont multiples, orientales aussi bien qu’occidentales. À l’origine, la méditation est intimement liée à la spiritualité.
Toutes les voies traditionnelles recourent à la méditation. Chacune possède des techniques propres, mais on trouve un tronc commun à ces techniques : la concentration ou capacité à maintenir son attention pendant un certain temps sur un point particulier qui peut être la pensée, le souffle...
Une présentation de diverses voies où la méditation est au cœur de la pratique donnera au lecteur un aperçu de quelques techniques, de leurs différences et ressemblances. Il pourra saisir comment la méditation conduit non seulement vers un état intérieur de calme et d’apaisement du corps et de l’esprit, mais aussi vers une profonde connaissance de soi.
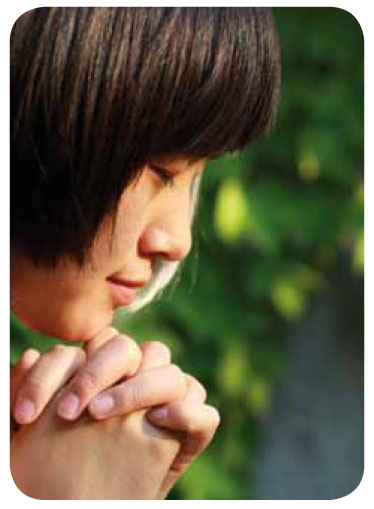
Enracinée dans la tradition ancestrale de la prière, c’est par le silence que la méditation, encore appelée « prière contemplative » va nous faire accéder à l’harmonie du corps et de l’esprit.
Le but essentiel de la méditation
chrétienne est de permettre à la
présence mystérieuse de Dieu en
nous de devenir non seulement une
réalité, mais la réalité qui donne sens,
forme et direction à tout ce que nous
faisons, tout ce que nous sommes...
John Main osb
Elle demandera temps, effort et persévérance et a pour but de conduire notre mental distrait vers l’immobilité, le silence et l’attention, comme nous le rappelle ce verset des psaumes : « Arrête et sache que je suis Dieu. »
La méditation chrétienne possède plusieurs variantes, dont celle qui consiste à méditer sur un passage des Évangiles. On lit le texte lentement pour s’en imprégner et l’attention est fixée non sur les mots mais sur leur contenu. Saint Ignace de Loyola propose des exercices spirituels où méditations, contemplations et répétitions se déroulent au cours d’une démarche progressive lors de retraites silencieuses.
Chez les orthodoxes, dans la prière du cœur, on invoque en silence, au rythme de la respiration, le nom de Jésus afin d’atteindre la paix de l’âme.
À SAVOIR
Prière et méditation se superposent dans la tradition chrétienne, la méditation étant plutôt apparentée à la prolongation d’une pensée orientée autour d’un sujet.
Les Pères du désert constituent une tradition où Orient et Occident se rejoignent.
Au IVe siècle, Jean Cassien (qui influença plus tard saint Benoît) diffusa en Occident les enseignements des Pères du désert. Il préconisait la répétition incessante d’un verset court pour favoriser l’attention et le retour au centre. Cet exercice conduit le pratiquant à un état intérieur de plus en plus profond jusqu’à se perdre lui-même et être absorbé en Dieu.
À cette époque, des moines chrétiens partent dans les déserts d’Égypte, de Palestine et de Syrie afin de pouvoir, par l’expérience du désert, discerner l’authentique de l’apparence. Les croyances populaires voulaient que les démons vivent dans les déserts. Ainsi ce lieu devenait privilégié pour la méditation car il permettait de se confronter à ses ténèbres intérieures et de faire face aux tentations extérieures. Méditation et activité manuelle constituaient leur ascèse.
L’un des enseignements rapporte qu’un éminent professeur égyptien vint rendre visite à saint Macaire dans le désert afin d’y recevoir son enseignement. Saint Macaire reçut son visiteur et lui offrit une tisane. Il emplit la tasse entièrement et continua de verser la tisane alors que la tasse débordait. Le professeur lui dit : « La tasse déborde, il n’est plus possible d’en verser une goutte de plus. » Alors le sage lui répondit : « De même que cette tasse est remplie, tu es empli de tes propres opinions et spéculations, comment pourrais-je te faire entendre une parole de vie sans que tu ne vides d’abord ta tasse ? »
La méditation en Orient, quel que soit le pays, est un exercice millénaire qui chez la plupart des personnes imprègne le quotidien.
Cependant, plusieurs voies et par conséquent plusieurs techniques parfois opposées se côtoient. Parmi les plus connues on citera le yoga, la méditation transcendantale, le zen, la méditation vipassana, le bouddhisme tibétain.
On connaît surtout le yoga par les postures, mais on méconnaît bien souvent ses différentes étapes, parmi lesquelles la méditation.
Comme toutes les disciplines orientales, le yoga s’appuie sur différents textes. Il s’insère dans une tradition universelle, très poussée, présentée notamment dans le traité intitulé Yoga sutra de Patanjali (datant environ du IIe siècle avant notre ère).
Le yoga y est développé en huit étapes, encore appelées « membres », et constitue la voie royale ou Raja yoga.
Chacun des aspects, s’il peut être envisagé de manière individuelle, n’en reste pas moins partie intégrante de la totalité et par conséquent devient un des éléments qui permettront d’aborder la méditation, dernière étape du yoga. Chaque étape découle de la précédente.


Les deux premières en constituent les bases et sont plutôt d’ordre « externe » dans la mesure où il s’agit de manières d’être dans le quotidien, sortes de règles morales, dont l’observance aura des répercussions sur la vie du pratiquant. On y relève les principes de non-violence, de vérité, d’abstention du vol, de contentement, d’effort sur soi... Ces deux étapes se nomment yama et nyama.
La troisième étape est constituée par la posture, asana. Particulièrement développée dans la forme que nous connaissons, le Hatha yoga, on y distingue deux types de postures. Les premières ont pour but d’assouplir le corps, d’affermir la colonne vertébrale, axe du corps et canal de l’énergie nerveuse. Elles préparent le corps aux secondes, les postures méditatives, postures assises dont la plus célèbre est celle du lotus (jambes croisées).
EN PRATIQUE
Envisager la pratique du yoga exclusivement au niveau postural la sortirait d’un contexte et la réduirait à une gymnastique.
L’aisance et la stabilité dans la posture sont primordiales pour atteindre un état de relaxation profond tant au niveau du corps que de l’esprit et poursuivre vers les autres étapes.
La quatrième étape, pranayama, s’articule autour du souffle. Lorsque la posture est acquise, on y ajoute le travail respiratoire propre au yoga. Plus qu’une simple respiration, il s’agit du contrôle du souffle et de l’énergie vitale appelée prana. Des courants d’énergie animent le corps et la respiration n’est que l’un deux. L’étude du pranayama se développe au fur et à mesure de la pratique. Le principe en est le suivant : lorsque le corps est stable et que le rythme respiratoire est ample, alors le psychisme, l’esprit, s’apaise. Cette corrélation étroite entre le souffle et l’esprit est l’un des éléments importants pour la phase ultérieure de méditation.
Lors de la cinquième étape, pratyara ou retrait des sens, le pratiquant doit porter son attention sur ce qui se passe à l’intérieur de lui. Le mental commence à être discipliné et l’on a la capacité à ne plus être « happé » par les distractions pouvant émerger de l’extérieur. La conscience de soi commence à apparaître. Jusque-là, nous voyons que dans une posture confortable, quand le souffle est régulier et que l’esprit s’apaise, on peut tourner son attention vers l’intérieur.
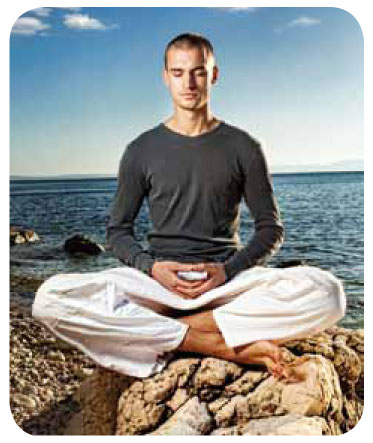
De là on parvient tout naturellement à la sixième étape, dharana, la concentration. On fixe l’attention sur un lieu (soit à l’intérieur du corps : lieu du corps ou souffle ; soit à l’extérieur : objet support de concentration). C’est à cette étape que l’on voit que nos pensées naissent et disparaissent, les unes après les autres. Le contenu de la conscience est un flot constant, changeant, composé de pensées et impressions diverses. Si, au départ, on observera ce mouvement, on cherchera par la suite à ramener son esprit sur un point afin de conserver la stabilité du mental. Peu à peu, l’attention est parfaitement centrée et immobile.
Nous arrivons à la septième étape, dhyana, la méditation. La difficulté étant de prolonger cet état d’immobilité du mental. La méditation est le perfectionnement de la fixation de l’attention.
Enfin, lorsque cet état est atteint, on parle d’une huitième étape, nommée samadhi. La tradition la considère comme l’étape finale du yoga qui consiste à « se fondre » dans l’objet de méditation. Le samadhi comporte lui-même plusieurs étapes au développement de la conscience, jusqu’à ce que le pratiquant soit ce que l’on nomme un « délivré vivant ».
Il faudra comprendre, dans cette approche de la méditation yogique, que les deux premières étapes s’insèrent tout au long du développement. Ainsi, la notion de non-violence concernera non seulement une attitude par rapport aux autres, mais aussi à l’égard de soi-même en trouvant l’attitude juste dans la posture, sans se faire violence. Celle de contentement pourra notamment concerner le fait d’accepter le flot de nos pensées jusqu’à ce qu’il se calme. L’effort juste sera en jeu pour tout le travail et la patience nécessaires à chaque étape.

Dans la voie hindoue, on trouvera également la méditation transcendantale qui s’enracine dans les Vedas et le Vedanta, textes de la philosophie hindoue. Cette méditation s’appuie à la fois sur des versets de la Bhagavad Gita et sur le yoga de Patanjali.
Son initiateur, Maharishi Mahesh Yogi, la présente de la manière suivante : « La méditation transcendantale permet à l’esprit conscient de s’ouvrir au “réservoir” infini d’énergie, de créativité et d’intelligence qui réside en chacun de nous. »
Son enseignement est fondé sur la conscience et permet au corps d’atteindre une détente profonde et d’apaiser l’esprit. Elle utilise la répétition de mantras (sons ou phrases).
Le bouddhisme est né en Inde, où le prince Siddharta Gautama a eu l’illumination sous l’arbre de la Bodhi (figuier des pagodes). Il est devenu le Bouddha, signifiant l’Éveillé.
À Bénarès, il prodigua ses enseignements à ses disciples qui ensuite les diffusèrent. Le boud dhisme est donc parti de l’Inde et a émigré dans les différents pays orientaux. Diverses écoles virent le jour, mais la méditation et les concepts philosophiques de base restent les éléments clés.
Chaque voie s’appuie sur des textes, possède des techniques qui varient les unes des autres, mais les questions fondamentales restent les mêmes : celles de la souffrance, de la détresse et de la mort, la nôtre comme celle d’autrui. La méditation est une technique parmi les enseignements des diverses voies.
Des programmes de méditation issus de pratiques bouddhistes sont enseignés dans des hôpitaux dans certains pays (aux États-Unis notamment) et s’insèrent dans des techniques de psychothérapie. Quelques projets commencent également à voir le jour en France depuis quelques années.
Développé en Occident depuis environ quarante ans, le zen est l’une des formes qu’a prises le bouddhisme en Chine, en Corée et au Japon. Il insiste sur la méditation, dhyana, pour cheminer vers l’illumination intérieure. On le pratique assis, en posture dite de zazen : jambes croisées, les paumes des mains posées l’une sur l’autre, les pouces joints face à face. En zazen, les yeux entrouverts, la concentration se fait sur le souffle et la posture. On est également attentif à la position des mains, notamment des pouces qui ne sont plus face à face lorsque le pratiquant a tendance à s’endormir ou à se perdre dans ses pensées.
EN PRATIQUE
Dans la pratique du zen alternent des temps assis et des temps de marche silencieuse.
On trouve dans le zen deux grandes voies : le zen soto et le zen rinzaï. Le zen rinzaï met l’accent sur la méditation de petites phrases paradoxales, les koan, que le maître propose.
Exemples de koan :
Quel est le bruit d’une seule main qui applaudit ?
J’éteins la lumière, où va-t-elle ?
Quel était votre visage avant la naissance de vos parents ?
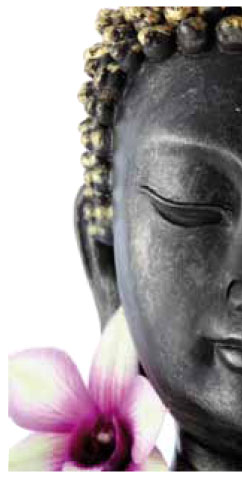
À travers la méditation, discipline spirituelle et corporelle, le pratiquant découvre les trois éléments fondamentaux de la libération intérieure : la respiration juste, l’état d’esprit juste, la posture juste.
L’objet du zen est d’arriver au satori ou illumination, mais l’Éveil ne saurait être un but en soi.
Elle est apparentée à la voie la plus ancienne du bouddhisme, la voie Theravada. La tradition décrit deux techniques : samatha ou concentration et tranquillité de l’esprit et vipassana ou claire conscience. C’est la voie du bouddhisme pratiquée en Asie du Sud et du Sud-Est. On l’appelle encore « méditation de la voie intérieure ».
La concentration est l’outil utilisé pour ce travail de conscience. De nombreux sujets de méditation sont recommandés comme supports de concentration et mènent à la vision intérieure. La respiration y occupe une place centrale.
L’objet de la pratique est d’accéder à une vision intérieure de la nature de la réalité et à une compréhension exacte des choses par l’exercice de l’attention. On parle encore d’attention vigilante.
Il s’agit d’une investigation approfondie de la réalité et des processus de la perception.
EN PRATIQUE
La pratique, comme toutes les pratiques de méditation, s’inscrit dans le temps et conduit le pratiquant à sortir des illusions qui constituent la manière dont nous percevons le monde et à révéler la réalité ultime.
La méditation vipassana est une méthode efficace pour explorer la profondeur de l’esprit, jusqu’à la racine de la conscience. On peut résumer vipassana par la conscience claire et exacte de ce qui se passe pendant que cela se passe. Le pratiquant apprend à observer les changements qui se produisent sur les plans physique, émotionnel, mental.
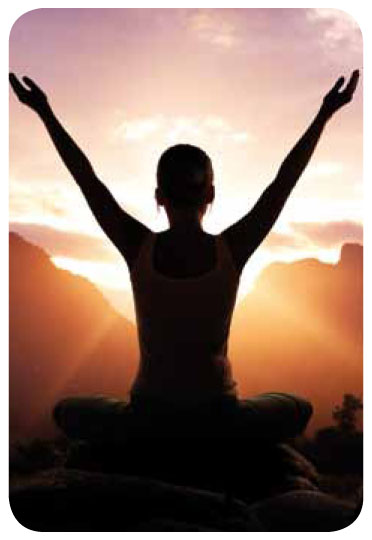
Pour ce qui est de la technique, cette méditation est, par la posture, assez proche du zen. L’établissement du calme mental et la vue profonde sont les éléments clés. La forme de la pratique va de l’attention portée au souffle pour stabiliser la pensée à l’utilisation d’éléments plus élaborés comme des visualisations sur certaines images ou couleurs ainsi que la répétition de mantras. On pratique également une forme de méditation appelée « méditation analytique ».
Après avoir posé l’esprit sur le souffle, sont proposés des sujets comme la souffrance, la vacuité, l’impermanence, l’amour... Le pratiquant laisse venir les idées qui se présentent. Ce type de méditation permet de travailler en profondeur sur la connaissance de soi, sur l’évolution intérieure, sur les émotions, et de traiter les difficultés avec une vision différente lorsqu’elles se présentent dans le quotidien.
À SAVOIR
La méditation va entraîner le calme mental. Il ne s’agit pas de laisser son esprit s’établir dans la torpeur ou un état proche du sommeil, mais d’obtenir la clarté de l’esprit.
La méditation tibétaine s’appuie sur des techniques précises qui permettent au pratiquant de progresser dans la voie de la méditation et de la compréhension de la nature de l’esprit.
La notion de détachement y occupe une place importante.
