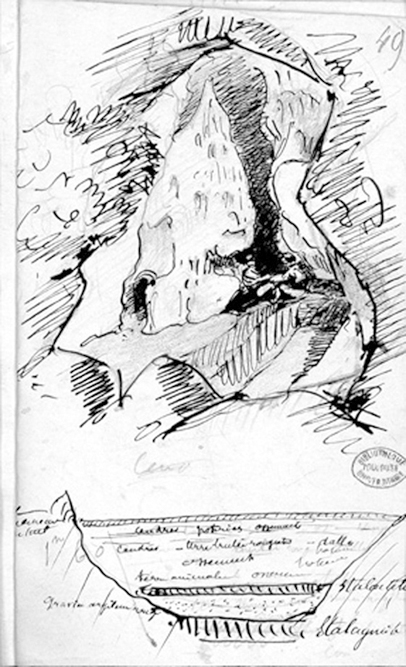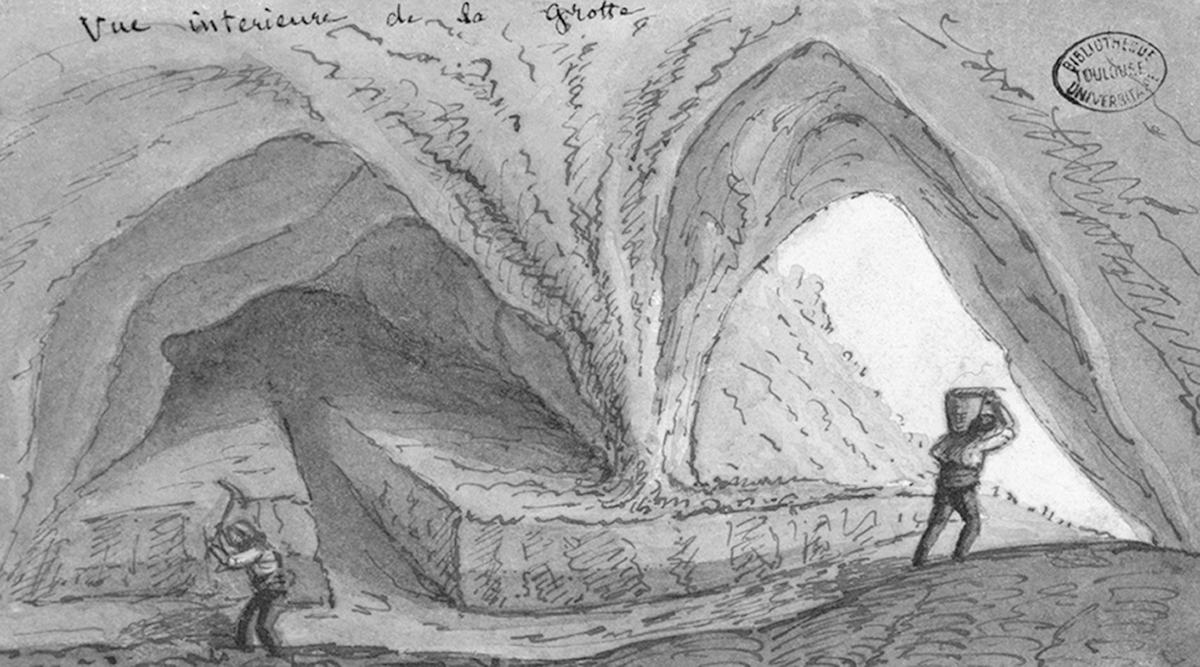INTRODUCTION
Sapiens ou la quête des origines de la modernité
À quoi sert la Préhistoire1 ? Face à cette question comme face à toutes les autres, cette immense période fossile reste désespérément muette. Contrairement aux voix imaginées par Joseph Conrad et entendues par son Marlow le long du fleuve du temps, aucun message ne sort de sa bouche de pierre – qui plus est dans un continent comme l’Europe, où son souvenir s’est évaporé depuis bien longtemps, recouvert par les millénaires d’une histoire lentement construite, pour sa part, comme fondement d’une certaine mémoire. Posons la question autrement : quelle est la signification qui lui est donnée aujourd’hui, supportant le vif intérêt qu’elle suscite ? La Préhistoire est-elle un simple objet de curiosité, un objet exotique plus ou moins effrayant ou occupe-t-elle une place riche de sens, plus ou moins consciemment, dans notre représentation de nous-mêmes ?
Homo sapiens est un enfant du Paléolithique. Ce dernier représentant de la lignée des hominidés est apparu environ 200 000 ans avant notre ère – au cours du Paléolithique « moyen ». Son origine est vraisemblablement africaine, bien qu’il soit aussi plausible que l’évolution dont il est issu ait été plus globale, embrassant les populations d’autres continents, en particulier celles du Proche-Orient et d’Asie. Car, au moment où apparaissent les premiers Sapiens, il y a bien longtemps qu’une large partie du monde est peuplée par des hominidés. La Préhistoire se compte déjà en millions d’années et beaucoup de changements ont vu le jour depuis les premiers outils de pierre taillée, aux alentours de 2,6 millions d’années, tant dans le domaine de la fabrication d’outils que dans celui de la chasse ou encore, pour citer une « invention » célèbre, au travers de l’usage du feu, attesté dès 500 000 ans avant notre ère.
Quoi qu’il en soit, à partir de 200 000 ans, l’histoire de l’homme est entre les mains d’Homo sapiens, du moins en Afrique et en certaines parties de l’Asie. Ailleurs et notamment en Europe, d’autres représentants continuent eux aussi à l’incarner pour quelques temps encore. Une période très complexe d’un point de vue anthropologique s’ouvre alors. Pendant plusieurs dizaines de milliers, d’années l’humanité demeure plurielle. Ainsi, tandis que l’Afrique et sans doute l’Asie sont occupées par les premiers Sapiens, l’Europe héberge des Néandertaliens, fruits d’une évolution parallèle puisant ses racines parmi des Ergaster qui ont, quelques centaines de milliers d’années auparavant, atteint cette partie du monde2. Et il faudra attendre la période comprise entre 40 000 et 20 000 ans avant notre ère pour que Sapiens achève sa dispersion dans l’espace et devienne simultanément le seul et ultime représentant de la lignée des Homo. Cette dispersion rencontre des situations radicalement différentes : tandis qu’Homo sapiens découvre des territoires vierges, pénétrant tour à tour en Australie et en Amérique, il s’immisce également dans des espaces occupés de longue date, à l’exemple de l’Europe. C’est dans ce contexte que, vers 35 000 ans, l’homme de Neandertal lui cède la place, lors d’un épisode coïncidant avec les débuts du Paléolithique « supérieur »3 dans cette partie du monde.
Projetons-nous quelques milliers d’années plus tard, c’est-à-dire aujourd’hui. Toutes les populations contemporaines descendent de ces Sapiens dont nous venons de brosser la trajectoire paléolithique en quelques lignes. Leur parenté se borne-t-elle à cette histoire biologique commune ? Non, bien sûr. Depuis longtemps, l’anthropologie sociale a montré que, au-delà des différences entre chaque société humaine – plus accusées, notamment sur un plan socio-économique, entre les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles et les sociétés industrialisées –, toutes se rejoignent sur des registres fondamentaux définissant l’homme en profondeur. Partout, l’adaptation repose sur le rôle de la culture ; partout, les structures sociales, dans toute leur complexité, nous définissent en tant qu’individus ; partout, l’homme interprète le monde qui l’entoure grâce aux richesses de son imaginaire et élabore de multiples expressions symboliques qui en sont la traduction. Et partout, au-delà des disparités de « niveau technologique » pouvant exister entre les produits de telle ou telle société, comme par exemple entre l’arc d’un chasseur bushmen et le véhicule conduit par l’ethnologue venu à sa rencontre, il s’avère que la culture matérielle de ces protagonistes est un vecteur privilégié pour exprimer un monde de valeurs, un univers de sens. Aucun critère ne permet de placer ces univers de sens sur une quelconque échelle de complexité. Car si l’on peut donner des bases objectives à une comparaison de leurs attributs techniques, à l’image du degré de complexité dont bénéficie l’élaboration technologique de l’arc bushmen vis-à-vis de la voiture de son interlocuteur occidental, dès lors que l’on aborde le sens que l’un et l’autre leur donnent, cette objectivité s’effondre. Il en est ainsi des expressions artistiques, des structures de la parenté, de l’univers des croyances : qui peut dire qu’un conte inuit est plus subtil qu’un récit d’Andersen, qu’une fresque aborigène est plus simple que la décoration d’une église ou d’un temple ? Si leur comparaison peut se révéler fructueuse, elle ne saurait s’interpréter en termes de degré de complexité, leurs différences se moquant d’un tel jugement de valeur.
On comprend mieux, dès lors, l’une des raisons pour lesquelles les yeux des préhistoriens se tournent fréquemment vers ce continent lorsqu’il s’agit de relater l’accession de l’homme à une pleine modernité comportementale Outre un certain « européocentrisme », les modalités supposées du phénomène dans cette partie du monde, où le passage du Paléolithique moyen au Paléolithique supérieur est couramment présenté comme la conséquence d’un remplacement de populations, en font un événement fondateur. Sapiens ou la longue marche d’une humanité nouvelle et conquérante, tandis que s’abat le crépuscule de cette « proto- » ou « para-humanité » incarnée par Neandertal.
Il faut bien reconnaître que nous souffrons d’un déficit explicatif dans ce domaine. Pourtant, la préhistoire moderne n’est plus seulement – et ce depuis longtemps – une préhistoire « naturaliste », faite de listes d’attributs – tels types d’outils ou d’instruments patiemment collectés et décrits, mais toujours un peu désincarnés – placés sur une échelle des temps géologiques plus ou moins précise. En d’autres termes, elle a dépassé son ambition première, celle de l’établissement d’une chronologie alimentée à l’aide de « fossiles directeurs » paléontologiques ou industriels pour devenir une préhistoire des comportements et des modes de vie. Elle tend par là à éclairer, par exemple, la façon dont les groupes humains organisent leur espace grâce à l’exploitation des ressources animales ou minérales. Elle s’oriente vers la description précise de leurs savoir-faire techniques et artistiques, de leurs habitats ou encore de leurs pratiques funéraires. Beaucoup d’efforts ont été déployés depuis une cinquantaine d’années pour répondre à ces objectifs : les méthodes de fouilles ont évolué, de même que l’analyse des vestiges, où archéozoologie, technologie des équipements, relevés d’art concourent à restituer une vision « ethnologique » des peuples préhistoriques. Cependant, cette remarquable documentation n’est pas toujours mise à contribution afin d’envisager en profondeur les mécanismes évolutifs des sociétés humaines de cette période. En effet, lorsqu’il s’agit d’interpréter les inflexions majeures survenues au cours de la Préhistoire, on préfère encore souvent faire appel à des facteurs biologiques et climatiques plutôt qu’aux dynamiques proprement sociologiques. Ce faisant, les récits sur l’évolution humaine présentent des sociétés paléolithiques chahutées par des logiques et des conditions extérieures qui leur échappent en grande partie, ou bien qui donnent l’impression d’être le jouet de compétitions implacables (conquête territoriale). Ces dernières, mises en scène dans le récit de telle ou telle migration, offrent une vision en trompe l’œil d’éventuelles dynamiques sociales : leurs motivations demeurent presque toujours obscures et l’on en est souvent réduit pour les expliquer à évoquer un essor démographique, lui-même fréquemment indexé sur des causes biologiques et climatiques. Mais en définitive, est-ce bien cette image de l’homme – donc, dans une certaine mesure, de nous-mêmes – que ces sociétés de la Préhistoire nous renvoient ?
Les trois premiers chapitres constituent une entrée en matière, destinée à adopter un certain recul historique et à analyser la genèse des conceptions appliquées au Paléolithique supérieur par les préhistoriens, en faisant la part entre leurs attentes à l’égard de cette période et la réalité des documents archéologiques à leur disposition. Conjointement, ces premiers chapitres éclairent certains concepts clés et, plus précisément, l’imbrication de notions centrales que l’on retrouvera tout au long de l’ouvrage : « Évolution et évolutionnisme » (chapitre I), « Temps et espace » (chapitre II), « Espace et environnement » (chapitre III). Des origines des études préhistoriques jusqu’à leur définition actuelle, une première esquisse des modèles interprétatifs convoqués dans la suite du livre s’ébauche.
Ce chapitre s’achève sur le constat déjà exprimé dans cette introduction : celui d’un relatif déficit explicatif lorsque l’on aborde l’évolution des comportements sous un angle plus sociologique, en dépit des ambitions affichées des études préhistoriques contemporaines. En effet, lorsque l’on traite de l’évolution des industries humaines, la logique du « progrès technique », quel que soit le cadre d’analyse, demeure souvent la principale clé d’interprétation. Or d’autres centres de gravité peuvent être invoqués, relevant d’orientations plus explicitement sociologiques, tels le caractère plus ou moins collectif régissant la vie des groupes, la répartition de leurs activités, la nature de leurs relations… Autant de facteurs dont nous tenterons d’analyser la portée pour expliquer les choix mis en œuvre dans différents domaines de la culture matérielle. Dans quelle mesure cette perspective sociologique s’écarte-t-elle de la question du « progrès technique », laquelle paraît pourtant relever de la plus stricte évidence ? Ces différentes discussions ordonnent le champ investi au cours des trois derniers chapitres, qui constituent en quelque sorte un essai de « paléosociologie » au service d’une réflexion consacrée aux mécanismes de changements à l’œuvre au cours des phases récentes du Paléolithique. Le chapitre V, « Les rouages du changement : les métamorphoses du chasseur », traite ainsi de la place des équipements de chasse dans la culture matérielle des groupes de cette période et de la portée sociale des observations à ce sujet. Cette discussion, qui lie information technique et structuration sociale, se prolonge du point de vue de l’économie dans le chapitre VI, « Esquisse de géographie humaine préhistorique », qui revient sur la relation des groupes humains avec leur environnement.
Un dédoublement de sens entoure le terme « préhistoire », celui-ci désignant à la fois la période considérée et la discipline qui l’étudie. Afin de tâcher de distinguer l’un et l’autre des sens donnés à ce mot, la période est désignée avec une majuscule tandis que la discipline n’en prend pas.
Peut-être un phénomène comparable s’est-il déroulé en certaines parties de l’Asie, où des paléontologues considèrent que des populations d’Ergaster (rebaptisé Erectus dans ce contexte géographique) auraient perduré au-delà de 200 000 ans, avant d’être à leur tour supplantées par des Homo sapiens originaires d’Afrique.
Précisons que la chronologie présentée dans cet ouvrage, inspirée des données africaines pour ses dates les plus anciennes (c’est là qu’apparaissent les premiers outils de pierre taillée aux environs de 2,6 millions d’années et que débute alors le Early Stone Age, ou Paléolithique inférieur), fait explicitement référence aux cadres européens et proche-orientaux lorsque l’on aborde les divisions du Paléolithique moyen (300 000 à 40 000 ans) et du Paléolithique supérieur (40 000 à 12 000 ans). Toutefois, en raison de leurs nombreuses similitudes, il est possible d’établir un parallèle entre celles-ci et le Middle Stone Age d’une part, les phases anciennes du Late Stone Age d’autre part, telles qu’elles sont définies sur le continent africain. Le Middle Stone Age débute également aux alentours de 300 000 ans pour s’achever entre 40 000 et 20 000 ans, lorsque lui succède le Late Stone Age. Ces précisions ont toutes leur importance puisque, comme nous l’avons évoqué, Sapiens et Neandertal sont l’un et l’autre acteurs du Middle Stone Age et/ou du Paléolithique moyen, selon le contexte géographique où l’on se situe, alors que les divisions du Paléolithique supérieur et du Late Stone Age semblent être partout exclusivement l’œuvre de Sapiens.