8. Destruction des habitats aquatiques
Les marais sont la jeunesse de la terre.
Jacques Perret
Il convient de faire une mention spéciale aux habitats aquatiques, qui dans le monde entier, mais surtout dans les zones tempérées, se rangent parmi les plus menacés à l’heure actuelle. Ces milieux, d’une importance primordiale pour la préservation d’un grand nombre d’espèces animales et végétales et pour celles de communautés biologiques tout entières, sont d’une très grande diversité, allant des lagunes côtières saumâtres aux marais d’eau douce et aux étendues lacustres. Si certains d’entre eux sont d’une grande pauvreté biologique (on les dit oligotrophes), d’autres qualifiés d’eutrophes sont au contraire d’une richesse extrême du fait de la multiplicité des chaînes alimentaires et d’une très grande productivité. Ces circonstances découlent du véritable mélange des milieux terrestres et des milieux aquatiques ; leur contact engendre des productions végétales et animales d’un volume considérable. Ceci est particulièrement vrai des habitats côtiers, où la mer, les eaux douces et les terres se mêlent d’une manière complexe ; il en résulte un « rendement » biologique inégalé ailleurs.
Négligeant complètement l’interaction de ces milieux différents, l’activité de l’homme a consisté précisément à les séparer, comme s’il voulait appliquer des principes cartésiens à la nature ! Nous voulons écarter les eaux de la terre ; le milieu marin des eaux douces. Ce qui se traduit par la construction de digues, la canalisation et la rectification des cours d’eau, et surtout le drainage et l’assèchement de tous les milieux humides.
Cette action est sans aucun doute ancienne, car même les manuels scolaires nous rapportent que depuis la plus haute Antiquité, l’homme a pour objectif l’assèchement des marais. Cela a conduit notamment dans les pays de vieille civilisation à une réduction extrême des milieux aquatiques qui n’occupent plus à l’heure actuelle qu’une surface proportionnellement minime par rapport à l’ensemble des terres. Peu bénéficient du statut de réserves (environ 10 % aux États-Unis, moins de 2 % en France où à elle seule la Camargue représente les deux tiers de cette évaluation), et tous sont gravement menacés par les plans d’aménagement.
Dans la plupart des cas, des raisons esthétiques et morales suffiraient à justifier la préservation dans leur état naturel de certains biotopes aquatiques. La plupart d’entre eux sont très pittoresques et leur préservation peut maintenir en vie un grand nombre d’animaux et de végétaux dont la survie dépend de conditions écologiques strictes et bien déterminées. De très nombreux arguments jouent en faveur de leur conservation, et notamment diverses raisons économiques. Il ne faut pas oublier avant tout que les zones marécageuses ont un rôle très important dans l’équilibre hydrique de régions tout entières, en y régularisant le débit des rivières et en restituant des volumes d’eau importants pendant les périodes sèches. Par ailleurs elles contribuent à fertiliser les districts vers lesquels sont drainées leurs eaux en y transportant des matières organiques. Enfin – et ce fait est prouvé dans de nombreux cas précis – le rendement économique (chasse, pêche, et pâturage) des marécages est souvent plus important avant qu’après leur transformation faite généralement au prix d’investissements considérables.
On dispose maintenant de bases solides pour affirmer que dans un certain nombre de cas, la transformation brutale des habitats naturels comporte autant d’erreurs sur le plan économique que sur le plan scientifique. Une étroite collaboration entre les économistes, les ingénieurs et les biologistes est de ce fait à préconiser. Aucun projet de drainage ne devrait être effectué sans enquête préalable où les naturalistes ont un rôle important, en vue d’arriver à une planification où la conservation à l’état naturel de certaines zones aurait sa place.
Comme en tout ce qui touche la conservation de la nature, un équilibre doit intervenir entre les différents intérêts. Il est incontestable que le drainage de certaines zones marécageuses se justifie par des raisons économiques. La mise en culture de zones inondées peut être d’un excellent rapport agricole et les exigences de la santé publique, en particulier la lutte contre la malaria, imposent parfois l’assèchement de districts où prolifèrent les Moustiques.
Mais il serait tout aussi faux de proclamer que le seul avenir des marécages est un assèchement systématique que l’on considère encore maintenant comme un titre de gloire pour ceux qui l’ont entrepris.
Dans beaucoup de cas, de solides arguments plaident en faveur du maintien des conditions naturelles et de la préservation d’une série d’habitats aquatiques.
Arguments scientifiques
Il n’est guère besoin de s’étendre sur les arguments de cet ordre. Les communautés animales et végétales établies dans les zones humides doivent en effet être conservées dans leur intégrité si l’on veut préserver les espèces qui les constituent. De longues listes de végétaux et d’animaux de petite taille pourraient être établies, tous menacés de raréfaction voire de disparition, si les habitats qui leur sont indispensables étaient condamnés à disparaître. Même de nombreux Vertébrés sont dans ce cas, chaque espèce étant étroitement spécialisée et occupant une niche écologique particulière dont la suppression entraîne celle de l’animal qui lui est inféodé.
Au point de vue de la végétation, l’un des milieux humides les plus menacés est sans doute celui que constituent les tourbières et les landes tourbeuses. Ces sites d’une grande richesse botanique et d’une originalité biogéographique certaine sont considérés avec irritation par les agriculteurs comme par les économistes. Ils abritent pourtant une flore remarquable, comprenant beaucoup d’espèces étroitement adaptées au milieu, souvent endémiques ou relictuelles, les tourbières ayant constitué des refuges où se sont conservées des espèces aux aires largement disjointes. La transformation même limitée de ce milieu hautement spécialisé entraîne la disparition de toute cette flore sans équivalent dans d’autres habitats (voir notamment M. Bournerias, Rev. Soc. Sav. Haute-Normandie Sci., 37, 1065).
La conservation des milieux aquatiques revêt une importance toute particulière dans le cas de la sauvagine migratrice. Dans l’ensemble les populations d’oiseaux d’eau sont beaucoup plus faibles qu’on ne le croit généralement. L’International Wildfowl Research Bureau, après des années de dénombrements de populations de Palmipèdes à travers l’Europe, signale ainsi que les populations d’Oies rieuses hivernant en Europe occidentale ne comptent pas plus de 70 000 individus ; que l’effectif mondial de l’Oie à bec court est de 40 000 individus, celui de la Bernache nonnette de 30 000 ; et que la population européenne de la Bernache cravant ne dépasse pas 20 000 sujets.
La plupart de ces Palmipèdes nichent sur des aires immenses dans les toundras du Grand Nord où ils sont relativement protégés, du fait de leur large dispersion et du peu de modifications apportées par l’homme à leur habitat. Mais tous sont migrateurs et dès la mauvaise saison viennent se réfugier dans des aires plus méridionales. Au contraire de ce qui se passe pendant la saison de reproduction, leurs populations se concentrent alors sur des aires très limitées, utilisées soit comme étapes de migration, soit comme territoires d’hivernage. Les Canards et les Oies nichant de l’Islande et du nord de l’Europe jusqu’en Sibérie occidentale viennent ainsi séjourner ou hiverner dans un certain nombre de zones privilégiées réparties sur l’Europe occidentale et sur l’Afrique tropicale. Leurs concentrations peuvent alors être considérables. Aux Pays-Bas, on estime qu’il n’est pas exceptionnel de trouver de 500 000 à 600 000 oiseaux migrateurs sur les étendues de vases du Waddensee dans l’île de Vlieland. De très fortes concentrations s’observent dans la baie de l’Aiguillon, sur la côte de Vendée. Il en est de même des zones marécageuses de l’Afrique tropicale. La basse vallée du Sénégal abrite une énorme population de Sarcelles, ainsi que la zone d’inondation du Niger.
Or ces populations d’oiseaux remarquables à tant de points de vue et d’un intérêt cynégétique extrême ne peuvent être protégées efficacement que si l’on aménage sur leurs voies de migration des réserves en nombre suffisant pour leur permettre d’hiverner dans les conditions requises, souvent strictes et variables selon les espèces. Les Oies ont besoin de prés humides largement découverts, les petits échassiers (Charadriidés) affectionnent les vasières et les étendues à haute productivité que le flot découvre à marée basse72.
Il apparaît donc que la sauvegarde de la sauvagine doit comprendre des mesures de préservation des habitats aquatiques d’une ampleur exceptionnelle. Un vaste effort de coopération internationale est à entreprendre dans l’immédiat. La disparition de quelques-uns des maillons essentiels de cette chaîne de relais et d’étapes de migration compromettrait la survie des populations déjà considérablement raréfiées d’oiseaux migrateurs73.
On ne saurait enfin passer sous silence le grand intérêt esthétique des milieux aquatiques, où les peintres ont trouvé d’innombrables thèmes d’inspiration et que les touristes fréquentent de plus en plus. Leur disparition signifierait la perte d’une bonne partie de l’attrait et du charme d’un pays.
Arguments économiques
Un grand nombre d’arguments économiques plaident également dans certains cas au moins en faveur de la conservation des marécages. L’opinion publique a souvent tendance à considérer que les zones marécageuses sont systématiquement improductives et tout juste bonnes à recueillir les déchets industriels ou ménagers. Le plus cher désir de beaucoup est de voir les ingénieurs procéder à leur drainage ; ces derniers ne s’en font pas faute et, comme le souligne Gabrielson (1962), il semble que les marécages n’aient été créés que pour servir aux ingénieurs à faire preuve de leur art. Dans les zones tempérées, ces habitats toujours qualifiés de « malsains » jouissent d’une très mauvaise réputation, à la fois comme terrains perdus pour l’homme et comme berceaux d’innombrables « miasmes » maléfiques, allant du Moustique au farfadet ; cette réputation est ancienne et l’homme moderne n’a pas encore réussi à se débarrasser de ce complexe. Dans les zones tropicales il en va cependant autrement car les marais y constituent de réels dangers pour la santé et l’hygiène publiques. Malaria et bilharziose sont des fléaux très répandus. Le second ne peut pour l’instant être combattu que par des drainages et l’aménagement des eaux, aux dépens de la faune. Il convient donc d’être prudents dans nos jugements et de les nuancer en fonction des régions du globe.
Les marécages n’en ont pas moins souvent une grande importance économique et à ce titre la conservation de certains d’entre eux doit s’intégrer dans la mise en valeur d’un territoire.
Ils fonctionnent avant tout comme régulateurs du débit des eaux courantes, ayant en quelque sorte un rôle d’éponge propre à retenir l’excès d’eau au moment des crues et à la restituer ensuite progressivement. L’assèchement des marais et la colonisation humaine des zones inondables contribuent puissamment à la désorganisation des systèmes fluviaux et au déclenchement d’inondations catastrophiques.
Les marécages sont par ailleurs loin d’être improductifs sur le plan agricole et forestier. Ils fournissent des pâturages appréciés à certaines périodes de l’année, notamment pendant les grandes sécheresses, et leurs ressources en bois et en autres plantes aquatiques ne sont pas négligeables.
Dans l’ensemble la productivité primaire des marais est considérable, particulièrement celle des marais côtiers soumis au jeu des marées ; leur influence fertilisante s’exerce même à grande distance dans la mer (importante dans le rendement des pêcheries au large des côtes, et en ostréiculture).
D’après des études menées aux États-Unis, en Géorgie, les marais des estuaires produisent chaque année une moyenne de 22 t par hectare de matière organique sèche, alors qu’un champ de blé produit environ 3,4 t, paille et racines comprises, dans la même région et pas plus de 14 t dans les régions les plus productives d’Europe occidentale. Bien entendu ces quantités de matières organiques ne sont pas comparables en valeur absolue, car dans le cas des champs une partie importante est directement utilisable par l’homme tandis que dans le cas des marais, seule une fraction relativement faible parvient directement à la consommation humaine. Celle-ci pourrait néanmoins être considérablement augmentée par un aménagement rationnel, en particulier par la pisciculture. On citera à ce point de vue les rendements très élevés en produits organiques obtenus en Chine et en Europe centrale par l’exploitation des poissons, d’une bien meilleure rentabilité que si ces habitats originels avaient été transformés en champs ou en prairies au prix d’énormes investissements74.
Il faut également remarquer que beaucoup de Poissons, spécialement dans les eaux tropicales, se livrent à des migrations locales qui les entraînent vers les zones inondées pendant la saison de pluies. Au moment de ces déplacements saisonniers, les autochtones se livrent à une pêche très fructueuse qui entre pour une part importante dans l’économie locale, par exemple au Kenya, dans les affluents du lac Victoria (Wasawo, 1963) ; l’assèchement des marais nuirait gravement à ces pêcheries en détruisant les frayères et en bouleversant les conditions écologiques.
Les marais saumâtres qui bordent les estuaires sont particulièrement importants au point de vue économique partout à travers le monde. Certains Poissons marins viennent s’y reproduire et les alevins y passent les premiers temps de leur existence, en rapport avec la richesse organique des eaux. D’autres y sont sédentaires et peuvent donner lieu à une exploitation intensive. En fait beaucoup de pêcheries (Poissons et Crustacés) sont établies dans ce milieu. La pêche commerciale, ainsi d’ailleurs que la pêche sportive, lui assure ainsi une haute rentabilité sans investissements de la part de l’homme.
Une autre ressource très importante des zones humides est constituée par les oiseaux d’eau, un des gibiers les plus recherchés des chasseurs. La location des gabions, des huttes et des terrains de chasse est d’un excellent rendement, souvent supérieur à celui des mêmes zones transformées et mises en culture après de coûteux investissements. L’importance économique de la chasse aux Palmipèdes est particulièrement grande aux États-Unis, où près de 2 millions de permis de chasse à la sauvagine sont distribués chaque année ; on estime que les sommes dépensées par les porteurs de ceux-ci sont de l’ordre de 89 millions de dollars. On citera à ce point de vue une organisation privée, le Duck Unlimited, association fondée en 1937 aux États-Unis, pour pallier la diminution très sensible des Palmipèdes en Amérique du Nord. Les fonds sont recueillis par souscription, surtout aux États-Unis (90 % des ressources en proviennent) et servent à l’aménagement des territoires de reproduction au Canada (principalement dans les provinces du Manitoba, du Saskatchewan et de l’Alberta) où nichent 75 % des Canards tués par les citoyens des États-Unis. Cette organisation dispose d’un budget annuel de plus de 500 000 $ et a dépensé 8,5 millions de dollars depuis sa fondation. Ces chiffres témoignent à eux seuls de l’importance économique de telles opérations qui ont le mérite de conserver les habitats dans leur état originel, de préserver les stocks reproducteurs de Canards et d’assurer néanmoins une excellente rentabilité économique.
Par ailleurs les zones marécageuses abritent des Mammifères à fourrure dont la chasse procure des ressources très importantes. Bien que la demande ait baissé au cours des années récentes, en partie en raison de l’élevage en captivité, la valeur des peaux de Vison, de Rat musqué, de Loutre et de Ragondin collectés aux États-Unis est de 10,5 millions de dollars. La collecte des Reptiles, et en particulier des Alligators, procure également des ressources importantes qui se verraient taries si les milieux étaient transformés75.
On signalera enfin que les étendues lacustres peuvent servir à de nombreux sports allant du yachting à la pêche sportive. Par l’industrie et le tourisme auxquels ces activités de plein air donnent naissance, les habitats aquatiques peuvent avoir un excellent rendement économique76.
Les habitats aquatiques doivent donc dans l’ensemble être protégés contre toute transformation abusive. Pendant des siècles, l’homme s’est imaginé que la meilleure manière d’en tirer parti était de les assécher et de détruire ainsi des communautés biologiques tout entières. Il est hors de doute que dans certains cas, ces solutions radicales s’imposent, soit pour des raisons agricoles, pour accroître la production de denrées consommables, soit pour des raisons médicales, seul l’assèchement pouvant mener à l’éradication de certaines maladies.
Mais dans beaucoup d’autres cas, l’homme peut tirer un meilleur parti des zones marécageuses en les conservant dans leur état naturel ou en les aménageant, accroissant ainsi la productivité de ces habitats.
Cette politique permettra d’éviter de nombreuses erreurs dont certaines se sont soldées par la dilapidation de capitaux considérables. Dans de nombreux pays, les plans d’assèchement des marais se sont révélés improductifs et ont mené à la création de terrains de culture inutiles77.
Il en est de même de certains vastes programmes de transformation et d’aménagement de bassins fluviaux pris dans leur ensemble. C’est notamment ce qui se passe pour la Volga, dont 50 % des eaux sont maintenant retenus par des barrages destinés à la production d’énergie électrique et à l’irrigation de districts jusqu’à présent arides. Cela a entraîné une évaporation considérable au niveau des zones irriguées, qui ont reçu en définitive moins d’eau que ne l’escomptaient les auteurs du projet. De plus, cela a provoqué une baisse du niveau de la mer Caspienne (1,8 m entre 1929 et 1946, bien plus depuis) et un assèchement progressif du delta de la Volga. Ces modifications ont eu de profondes répercussions sur les habitats et, partant, sur la faune et la flore de cette région d’un très grand intérêt pour le biologiste ; mais elles ont également provoqué une réduction du rendement des pêcheries et de la production de caviar (les trois quarts de la production russe proviennent de la Volga), d’une grande importance économique ; en 1957, les captures dans la mer Caspienne ont baissé de 65 % par rapport à 1917 (l’esturgeon a baissé de 50 % depuis 1913). Un complexe d’une incroyable richesse est en train de disparaître sous nos yeux par suite d’une série d’erreurs de la part de l’homme (Curry-Lindahl, L’Europe, Paris, 1966).
Des constatations analogues ont été faites à la suite de la construction du barrage d’Assouan, sur le Nil. La production d’énergie électrique et le contrôle du débit du fleuve sont sans doute à inscrire à l’actif de l’opération. Mais il existe un passif dont l’importance avait été sous-estimée faute d’études écologiques. Les plantes aquatiques ont envahi les bords du lac de barrage, augmentant les pertes d’eau par leur transpiration et par le changement des conditions d’évaporation dans les zones peu profondes. Par ailleurs le barrage a profondément modifié le dépôt des limons dont l’arrivée ne compense plus l’érosion par les eaux dans la basse vallée du Nil. Il en résulte une érosion accélérée et une perte des rendements, peut-être supérieure au gain provenant de l’extension des cultures dans la haute vallée. Les terres nouvellement irriguées ne se sont pas toujours révélées propices à l’agriculture, notamment du fait de remontées de sels consécutives à l’irrigation. Le changement du régime des eaux a provoqué la multiplication de Mollusques vecteurs de schistosomiase, dont souffrent les populations du delta. Enfin la diminution massive de l’apport de sels minéraux parmi les alluvions arrivant en Méditerranée orientale a perturbé l’écosystème marin, diminuant largement sa productivité. Les pêcheries s’en sont gravement ressenties. Le tonnage de Sardines pêchées par les Égyptiens a baissé de 18 000 t en 1965 à 500 t en 1968. Il conviendrait donc de faire un bilan avant de modifier aussi profondément un phénomène naturel aussi important que le régime des crues du Nil.
De telles réserves seraient sans aucun doute aussi à faire quant au gigantesque projet du Mékong, qui affecte l’économie de quatre pays de la péninsule indochinoise. Il est douteux que les études écologiques aient été aussi poussées que les projets techniques des barrages. D’amères désillusions sont à attendre du bouleversement du régime des eaux de toute cette partie de l’Asie.
Cela a mené à un véritable retour en arrière ; dans certains cas, on n’a pas hésité à rétablir les conditions antérieures, après des enquêtes économiques et techniques poussées78.
Il conviendrait par ailleurs d’insister sur les dangers que représente l’édification de barrages quant à la conservation de milieux aquatiques. Les aménagements hydroélectriques modifient entièrement le régime des eaux en changeant le débit et ses variations dans les rivières au cours barré par des murs de retenue, pouvant entraîner les répercussions les plus graves sur l’ensemble des bassins. Par ailleurs les lacs artificiels submergent souvent des stations localisées où s’abritent des plantes et des animaux rares. Les barrages empêchent également la migration des poissons, surtout des Saumons, en dépit de la mise au point d’« échelles à poissons » leur permettant de les franchir ; ils modifient les conditions écologiques des frayères et viennent ainsi perturber la reproduction79. Enfin certains barrages ont entièrement défiguré quelques-uns des plus beaux paysages de montagne et sont de véritables défis au tourisme à cause de leurs maçonneries et de l’aspect des bords des lacs de retenue : soumis à des variations rapides de niveau, ces lacs sont entourés d’une ceinture dépourvue de toute vie, recouverte d’une couche de boue sèche, qui achève de déparer le paysage.
Certes nous devons comprendre les nécessités de l’industrie, qui demande de plus en plus d’énergie, procurée à bon compte grâce à la force hydraulique. Notre développement économique est à ce prix. Mais il n’en est pas moins vrai que dans la mesure du possible les intérêts de la conservation de la nature doivent également être pris en considération. Des sites ont été définitivement abîmés sans aucun profit pour l’homme. L’aménagement d’un barrage ne consiste pas seulement en la construction d’un mur de maçonnerie et de quelques centrales électriques ; il implique tout autant l’étude des conditions hydrologiques et du taux d’érosion de tout le bassin. Nous avons évoqué ailleurs ces problèmes, dont le manque de prise en considération a parfois entraîné des catastrophes. La construction d’un barrage aux incidences à court et long terme souvent incalculables doit être conçue comme une partie de vastes plans d’aménagement du territoire, où la conservation des sites et des habitats naturels a sa place. S’il est impensable de renoncer à la construction d’ouvrages hydroélectriques (bien que d’autres sources d’énergie soient bientôt disponibles), il faut préserver un certain nombre de paysages à travers le monde, quitte à renoncer à une fraction de profits matériels vite compensés par ailleurs80.
Ces exemples montrent que l’homme doit une fois de plus s’intégrer dans un équilibre naturel au lieu d’entreprendre la destruction systématique de types d’habitats très caractéristiques, d’une grande importance pour l’homme moderne et d’une valeur incalculable pour la préservation d’une partie notable de la faune et de la flore mondiales. La diminution progressive des zones humides rend les préoccupations des conservateurs de la nature particulièrement d’actualité à l’heure présente81.
9. L’érosion aura-t-elle raison de l’homme
Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles.
Paul Valéry
La superficie des sols cultivables se trouve donc réduite d’année en année par suite de la mauvaise gestion de ce capital d’une valeur inestimable pour l’homme. La dégradation inconsidérée des terres ne date pas des temps actuels, car il est certain que l’homme primitif, qu’il fût chasseur, pasteur ou agriculteur nomade, a commencé la transformation des habitats, souvent sur une très grande échelle grâce au feu, moyen aux effets hors de proportion avec la technicité encore rudimentaire de l’humanité à ses débuts.
Mais le problème a pris à notre époque des proportions de prime abord insoupçonnables. Des besoins croissants en bois, l’établissement de plantations industrielles, l’abandon des méthodes agricoles conservatrices au profit de celles qui assurent un profit immédiat, fût-il sans lendemain, la colonisation du monde entier par la civilisation de type « occidental », ont généralisé le mal à travers la planète et ont accéléré les processus d’érosion dans des proportions gigantesques. Le cultivateur cesse d’être un paysan pour devenir un homme d’affaires, comme la destruction du paysage rural traditionnel, en particulier du bocage, fruit d’une évolution millénaire sous une influence humaine modérée, le démontre avec éloquence. L’évolution économique et politique de certains continents entiers – spécialement l’Afrique, mais aussi l’Amérique tropicale – fait que les nouvelles nations cherchent désespérément à développer leurs ressources pour entrer dans le grand concert des pays « modernes ». Cela risque de se faire au détriment de leur sol. Et cette évolution a lieu à un moment où une partie importante de la superficie cultivable est déjà ruinée et où la population humaine passe par une crise démographique d’une ampleur encore inégalée depuis l’apparition de l’homme sur la terre.
Le « protecteur de la nature » a pu regretter la transformation des habitats sauvages, entraînant la disparition ou du moins la raréfaction des espèces animales et végétales qui font la joie du naturaliste. Mais l’économiste, l’agriculteur et l’industriel n’ont malheureusement pas tardé à se joindre à lui quand ils ont vu les territoires mis en exploitation devenir stériles au bout de quelques années, les terres s’en aller, entraînées par le vent ou les pluies, et la roche apparaître, nue, sur les cuirasses de latérite ou les collines entaillées de ravins.
Les processus d’érosion une fois lancés, il se produit, nous l’avons vu, une accélération du phénomène, une sorte d’autodestruction de la nature, où l’atmosphère, l’eau et la terre réagissent les uns sur les autres pour aboutir à une stérilisation totale des régions où l’homme a imprudemment provoqué une rupture de l’équilibre naturel. S’il reste des zones à haute productivité agricole à travers le monde, le chancre de l’érosion a mordu largement sur la planète. Les terres devenues improductives, le nombre des consommateurs en forte augmentation, la pression des spéculateurs se faisant de plus en plus forte, de nouvelles zones sont sans cesse défrichées. Partout le « front » des cultures avance comme une vague qui déferle à travers les zones demeurées jusqu’à présent peu touchées ; il laisse derrière lui des paysages désolés, des sols marqués d’escarres ou de profondes blessures et une économie en ruine tandis que les tornades achèvent d’enlever la terre en traînées de boue ou en tourbillons de poussière. Le Bassin méditerranéen a depuis longtemps perdu une bonne partie de ses potentialités agricoles. Les grandes plaines de l’Amérique du Nord ont vu leur surface « utile » se réduire dans des proportions inquiétantes. En Amérique latine, les phénomènes d’érosion ont atteint une importance telle qu’ils posent de graves problèmes sociaux et économiques ; et pourtant on continue, en utilisant les mêmes procédés, à « mettre en valeur » les territoires demeurés sauvages.
L’Afrique tropicale est ravagée par l’érosion sur une large partie de sa surface, par les effets conjugués de la déforestation rapide, de la mauvaise gestion des sols par les Africains et par la mise en culture en vue de productions destinées à l’exportation, sans profit pour l’économie biologique locale. L’Asie suit lentement une courbe descendante, bien que l’évolution, amorcée depuis des millénaires, y soit plus lente qu’ailleurs.
Il ne s’agit donc pas d’un problème local, propre à n’intéresser que quelques savants de laboratoire. L’existence même de l’homme sur la terre est en jeu et un mal qui s’étend sur d’immenses territoires préoccupe les économistes tout comme les agronomes et les médecins.
Cette situation a néanmoins provoqué des réactions salutaires de la part des hommes. La pédologie, ou science des sols, née en Russie dans sa forme rationnelle vers la fin du siècle dernier seulement, a pris une énorme importance à l’heure actuelle. Chaque pays possède maintenant des organismes chargés de recherches sur les sols, leur nature et leur évolution, et sur les procédés permettant à la fois leur conservation et leur exploitation. Les États-Unis par exemple ont créé un service aux moyens très puissants (Soil Conservation Service, Department of Agriculture) ; en France et dans les pays francophones, ces services, souvent connus sous le sigle de DRS (défense et restauration des sols), ont fait un travail considérable, notamment en Algérie. Des organismes internationaux assurent l’indispensable coordination, favorisent les échanges de documentation et préparent des programmes de recherches. Des résultats heureux se sont fait sentir, et une exploitation des terres basée sur des connaissances beaucoup plus approfondies a commencé dans maintes régions.
Par ailleurs les exploitants agricoles s’aperçoivent maintenant d’un fait fondamental, que les biologistes connaissent cependant depuis Aristote : l’extraordinaire diversité des habitats naturels à travers le monde, où chaque district comporte un couvert végétal et un peuplement animal en rapport étroit avec la nature géologique de son sol et son climat. Cette leçon a été négligée pendant longtemps, et l’on a cru que les mêmes méthodes pouvaient assurer partout les mêmes rendements quels que soient les facteurs physiques du milieu. On s’aperçoit aussi que si certaines zones ont une nette vocation agricole et sont donc susceptibles d’être mises en culture, même si le naturaliste doit le regretter, d’autres aires ne peuvent pas être modifiées, du moins dans l’état actuel de nos connaissances, sans risquer de les ruiner d’une manière irrémédiable. Ces zones marginales doivent être conservées dans leur état actuel et l’homme ne peut qu’exploiter dans une certaine mesure leurs productions naturelles (par exemple le bois et le gibier).
Ces conceptions ont mené les spécialistes américains à classer les sols en huit catégories, formant en réalité une série continue, selon la nature des terres (composition physique et chimique), leur pente, leur degré d’érosion, le climat et la nature de l’exploitation. Les trois premières comprennent les terrains propres à la culture (avec ou sans procédés spéciaux) ; la quatrième comprend les terrains où la culture momentanée mais non permanente est possible ; les trois suivantes sont constituées par des terres impropres à la culture, mais où l’exploitation du couvert végétal naturel ou aménagé peut être entreprise avec ou sans précautions spéciales (pâturages, forêts, landes) ; la dernière est constituée par des terrains improductifs pour l’homme au moins en ce qui concerne l’agriculture. Cette classification a été adoptée après aménagements par la plupart des spécialistes dans le monde. Elle permet de dresser une carte des vocations des terres, malheureusement encore à établir pour la majeure partie de la surface du globe.
Classement des sols en fonction de leur vocation (d’après la classification de l’USDA Soil Conservation Service, modifiée d’après divers auteurs)
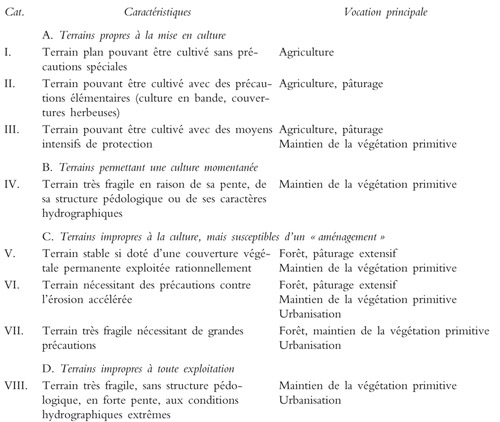
N. B. Un tel classement des terrains est basé sur la nature du sol, la pente, le degré d’érosion, le climat et la nature de l’exploitation. Il est bien évident qu’en réalité les terres forment une série continue, ce qui justifie les sous-catégories proposées par certains auteurs.
Les terrains rangés dans les catégories V à VIII se prêtent particulièrement bien à la mise en réserve pour la préservation de la faune et de la flore sauvages.
On s’aperçoit donc qu’un certain équilibre entre la forêt, la prairie et le champ doit être maintenu, d’une manière très variable suivant les facteurs physiques du milieu82. Cet équilibre agro-sylvo-pastoral a fait la richesse de l’Europe occidentale et moyenne, en même temps que ses paysages harmonieux. Il a fait la prospérité d’une partie de l’Asie et du nord-est de l’Amérique du Nord où ces méthodes ont été appliquées par des colons aux longues traditions agricoles venues d’Europe. C’est pour l’avoir négligé que les agriculteurs devenus des businessmen ont ruiné les grandes plaines du centre des États-Unis et les savanes et forêts claires d’Afrique et d’Amérique tropicale. La monoculture aura été une calamité que nous risquons de payer très cher, tout comme les conséquences des remembrements agricoles qui posent des problèmes géomorphologiques graves s’ils sont faits d’une manière inconsidérée.
Cette conception de l’équilibre a d’ailleurs permis de restaurer certaines régions du monde reboisées et reconverties en prairies sur de larges surfaces, en même temps que des pratiques culturales conservatrices étaient imposées aux agriculteurs. Les exemples pourraient être multipliés. L’un des plus classiques est celui de la Tennessee Valley aux États-Unis. Cette vallée avait été ravagée par le déboisement et les mauvaises pratiques culturales. Sous la direction de David E. Lilienthal a été créé, en 1935, un organisme autonome, la Tennessee Valley Authority, souvent connue sous son sigle TVA, qui réalisa une œuvre de restauration gigantesque, basée sur d’innombrables recherches scientifiques préalables, premier vaste programme de développement intégré. Grâce à des capitaux avancés par l’État, cet organisme a aménagé entièrement ce territoire, n’y construisant pas moins d’une quarantaine de barrages bien disposés, producteurs d’électricité et régulateurs des rivières. Un grand développement agricole a été rendu possible, en même temps que l’érosion accélérée était arrêtée. Le développement harmonieux de cette région a été rendu possible grâce à l’application de principes d’une logique élémentaire : l’équilibre entre les différentes productions naturelles et l’utilisation des terres en fonction de leur vocation propre.
C’est vers une telle compréhension que l’on doit tendre actuellement. Les programmes d’aménagement des territoires et de rénovation agricole ont pour but d’assurer une meilleure utilisation des terres, basée sur des enquêtes écologiques complexes auxquelles doivent se livrer au préalable des équipes de spécialistes appartenant aux disciplines les plus diverses. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point.
Notons aussi que la construction de voies de communication, en entaillant les pentes, l’implantation d’ouvrages d’art (ponts, etc.), sans compter l’extension des villes, des agglomérations, des terrains d’aviation, ont elles aussi infligé des traumatismes aux couches superficielles de l’écorce terrestre, amorces de processus érosifs souvent graves.
Fléaux et remèdes pernicieux
Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action de l’homme sur la nature s’est traduite, nous l’avons vu, par de profonds changements dans les équilibres biologiques. La mise en culture a entraîné un complet bouleversement des états originels. Si elle a provoqué la raréfaction et même la destruction totale d’un grand nombre d’espèces animales et végétales, elle en a par ailleurs favorisé d’autres parmi lesquelles de nombreuses sont devenues des ravageurs ou des parasites des cultures. L’homme se livre à une véritable expérience de sélection en transformant une région. L’introduction, volontaire ou non, d’espèces transportées à partir d’autres parties du globe a entraîné de la même manière de graves ruptures d’équilibre : les parasites les plus nuisibles aux cultures sont souvent des animaux ou des végétaux allochtones ; retranchés de leur milieu naturel, où leurs populations sont limitées par des compétiteurs et des prédateurs, ces êtres sont capables de proliférer au-delà de toute mesure dans les territoires où ils ont été imprudemment acclimatés (voir p. 328).
Loin d’être des calamités accidentelles, les « pestes », et spécialement les Insectes, doivent être au contraire considérées comme les conséquences fondamentales et inévitables des pratiques agricoles et des transformations apportées par l’homme aux habitats naturels (Kuenen, 1960). La multiplication des plantes cultivées met soudain à la disposition de certains animaux une énorme quantité de substances alimentaires ; de cette manière ceux-ci en profitent et leur nombre s’accroît d’une manière parallèle, selon une loi biologique élémentaire, surtout au cours des premiers stades de la mise en valeur. Cela est particulièrement visible pour les céréales. Les insectes jusqu’alors cantonnés aux Graminées sauvages – qualifiées de « plantes hôtes de remplacement », alors qu’en réalité elles constituent les sources d’infestation – trouvent soudain des ressources alimentaires plus régulières, plus sûres et en quantités disproportionnées par rapport à l’état originel. Les associations graminéennes vierges sont ainsi de vastes réservoirs de ravageurs en puissance qui opèrent un transfert vers la plante cultivée dès la mise en exploitation des terres aménagées. Dans les régions semi-arides du sud-est de l’URSS, des observateurs ont noté 312 espèces d’Insectes sur les terrains vierges ; bien que seules 135 d’entre elles se soient retrouvées sur les champs nouvellement créés à leur voisinage, la densité moyenne de la population d’Insectes avait néanmoins presque doublé. Parmi la vingtaine d’Insectes des cultures devenus très abondants, l’Altise est 20 fois et le Thrips du blé 360 fois plus nombreux que sur les Graminées sauvages. Un transfert analogue de l’insecte de la plante hôte autochtone vers la plante cultivée a été observé ailleurs dans le monde, notamment en Afrique dans le cas du Sorgho (Uvarov, 1963).
Pour rétablir un équilibre et pour contrôler ces animaux nuisibles, l’agronome a inventé des moyens de lutte artificiels en puisant dans le vaste arsenal que le chimiste mettait à sa disposition.
Cette bataille est avant tout dirigée contre les Insectes, les animaux les plus menaçants pour l’homme en raison de leur extraordinaire fécondité et de leur pouvoir de destruction occasionnant aux cultures et aux forêts des pertes considérables83. Par ailleurs certains d’entre eux jouent un rôle essentiel comme vecteurs de graves maladies affectant l’homme et les animaux domestiques, parfois les végétaux cultivés.
L’homme a également découvert que la lutte chimique pouvait lui permettre d’éliminer des végétaux indésirables. Un grand nombre d’herbicides ont été mis au point pour contrôler les plantes nuisibles, y compris les Champignons ravageant les cultures (fongicides).
Jusqu’en des temps relativement récents, ces substances appartenaient toutes, ou presque toutes, au domaine de la chimie minérale, et la célèbre « bouillie bordelaise », à base de sulfate de cuivre, dont les viticulteurs aspergeaient leurs vignes pour les protéger des maladies parasitaires en est un exemple classique. Les produits à base d’arsenic – encore en usage – ont également une longue histoire dans la lutte contre les Insectes.
Bientôt cependant, grâce aux progrès sensationnels réalisés en chimie organique, l’homme eut à sa disposition une infinité de corps synthétiques d’une bien plus grande efficacité. Le dichlorodiphényltrichloréthane, connu sous sa classique abréviation de DDT, mis au point et lancé en 1942, fait en quelque sorte figure de précurseur (bien qu’étant encore le plus employé de tous les insecticides ; sa production aux États-Unis dépasse celle des principaux autres insecticides réunis) dans un domaine où les découvertes nouvelles furent et sont encore rapides84. Il est en fait le premier d’une longue série de substances dont le nombre se multiplie à une vitesse accélérée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rien qu’aux États-Unis, 58 831 marques différentes de pesticides – nom général sous lequel on désigne les substances chimiques employées dans la lutte contre les « pestes » animales ou végétales portant préjudice à l’homme et à ses cultures – furent officiellement enregistrées en 1966-1967 sous leurs noms commerciaux (contre 7 851 en 1960) et chaque année de nouveaux produits font l’objet de brevets. Les quantités utilisées en 1966 représentent 587 millions de dollars, et passeront vraisemblablement un milliard de dollars en 1976 ; 350 millions de livres de pesticides sont répandues annuellement sur à peu près 35 à 40 millions d’hectares de terres cultivées. On remarquera toutefois que ces surfaces, considérables en valeur absolue, ne représentent qu’une fraction du territoire national des États-Unis, soit pour 1962 15 % des surfaces cultivées, 0,28 % des forêts et 0,25 % des prairies, en tout 4,62 % de la surface du pays. Si l’Amérique du Nord est largement en tête en ce qui concerne la lutte chimique, beaucoup d’autres pays la suivent de près, en particulier l’Europe occidentale.
L’humanité doit sans aucun doute énormément aux pesticides, notamment aux insecticides. Ces substances ont permis d’obtenir le contrôle de dangereux parasites des cultures, de diminuer leurs dommages dans des proportions importantes sous toutes les latitudes, résultat particulièrement important si l’on prend en considération la pénurie alimentaire dont souffre le monde à l’époque actuelle. De plus ils ont permis d’éliminer ou de limiter considérablement certaines maladies, notamment la malaria85. Plusieurs prix Nobel ont été décernés aux chimistes qui ont découvert et mis au point ces substances ; cet honneur est amplement mérité.
L’emploi de pesticides de synthèse peut donc, à certains points de vue, être considéré comme un progrès dans la défense de l’humanité et de ses moyens de subsistance. Le principe même de cette lutte reste valable. L’usage de ces substances a cependant donné lieu à des abus déplorables. L’homme, tout fier de ses découvertes et de sa technique, a cru qu’il pouvait répandre ces produits à profusion dans la nature et éliminer ainsi sans risques et d’une manière définitive tous les déprédateurs. Il s’agit cependant de poisons violents86, susceptibles de provoquer des ruptures d’équilibre graves en éliminant d’une manière aveugle tous les animaux. Les insecticides connus actuellement ne sont pas sélectifs dans leur quasi-totalité et tuent d’une manière à peu près égale tous les Insectes, les utiles et les indifférents comme les nuisibles. De plus leur action déborde largement en dehors de la classe des Insectes, car pour la plupart ils sont préjudiciables aux autres animaux, en particulier aux Vertébrés à sang froid, aux mammifères et aux oiseaux. Ils sont également toxiques pour l’homme et si les cas d’accidents mortels sont peu nombreux87, nous ne sommes pas renseignés quant à leur éventuelle action pathogène à longue échéance.
Les répercussions de ces substances toxiques se font sentir dans la nature prise dans son ensemble, du sol à l’homme. En fait l’abus des pesticides conduit à un empoisonnement véritable des biocénoses naturelles ou artificielles, dont on commence à mesurer les conséquences.
De nombreuses polémiques et discussions ont eu et ont encore comme thème cet épineux problème, bien en dehors des cercles scientifiques et techniques où elles auraient dû se confiner. Un livre célèbre dû à une biologiste de talent, Rachel Carson, a ébranlé l’opinion publique mondiale en attirant l’attention sur l’intoxication de la planète. La grande presse s’est elle aussi emparée de la question. Comme dans le cas de certains médicaments modernes, des articles coiffés de gros titres ont exposé le problème d’une manière spectaculaire, dramatique et définitive, alors que le lecteur aurait mérité d’être informé d’une manière moins hâtive et plus circonstanciée sur ce grave problème.
La question est en réalité extraordinairement complexe et il est très difficile d’en avoir actuellement une vue sereine et objective. Trop d’intérêts matériels et financiers – industrie chimique, production agricole – et trop de sentimentalisme et de conclusions hâtives ou tendancieuses sont venus embrouiller un problème sur lequel nous avons quand même maintenant des informations provenant d’un nombre croissant d’expériences et d’observations. Les conclusions ont souvent mené à des positions extrêmes où l’impulsivité des uns s’est opposée aux intérêts matériels des autres.
L’abus des pesticides a provoqué des désastres sur le plan biologique et même sur les plans économique et sanitaire. Une fois de plus l’homme a souvent agi avec légèreté en maniant des instruments de destruction puissants.
Car c’est l’abus de ces produits qu’il faut proscrire, le principe même de leur emploi raisonnable pouvant être admis. Il en est des pesticides comme des drogues que l’homme ingère pour se guérir de ses maladies. La plupart sont de dangereux poisons, qui tuent si l’on dépasse une certaine dose, calculée en fonction de la nature du produit, de sa toxicité, et aussi de l’état du patient. Il ne viendrait à l’idée de personne de prendre une dose 10 ou 100 fois supérieure aux prescriptions médicales, en pensant que le médicament agira dix ou cent fois plus vite. C’est pourtant ce que l’homme a fait dans le cas des pesticides, oubliant que la nature forme en quelque sorte un corps vivant, souvent malade et toujours fragile, dans l’équilibre duquel il convient d’agir avec la prudence d’un thérapeute. Cela ne doit pas entraîner une condamnation de principe des pesticides, pas plus qu’il ne viendrait à l’idée de condamner la pharmacopée sous prétexte que son arsenal tue à des doses létales.
La nocivité des pesticides varie à l’infini. Il y a finalement autant de problèmes que d’applications. Leur influence sur la nature varie en fonction de la composition chimique des produits, de leurs conditions d’emploi et de la biocénose dans laquelle ils agissent. Toute généralisation hâtive conduit dans ce domaine comme dans bien d’autres à des erreurs et à de vaines polémiques.
1. Principaux insecticides en usage
Les substances chimiques actuellement employées dans la lutte contre les Insectes sont nombreuses88 ; un inventaire de J. Lhoste (Les insecticides de synthèse, Marseille, 1962) en indiquait plus de 150 dès 1962, et ce nombre s’est accru sans cesse depuis par suite des travaux des chimistes89.
Les insecticides dans leur ensemble se rangent en trois grandes catégories en fonction de leur nature chimique et de leur origine.
1. Insecticides minéraux. Ces produits sont principalement à base d’arsenic (surtout arséniates ou acéto-arséniates, tel le « vert de Paris », un acéto-arséniate de cuivre) et de fluor (fluorures et fluosilicates).
2. Insecticides d’origine végétale. Ce sont principalement la nicotine, extraite du Tabac, le pyrèthre extrait de diverses Composées du genre Chrysanthemun et la roténone, extraite de diverses Papilionacées.
3. Insecticides organiques de synthèse. Ces produits sont nettement les plus importants à l’heure actuelle, car ils sont fabriqués industriellement à grande échelle à un prix de revient relativement bas.
Les insecticides peuvent se diviser selon les familles chimiques auxquelles ils appartiennent ; Lhoste (ibid.) les groupe ainsi en 14 classes dans le détail desquelles il ne peut être question d’entrer ici. Les plus classiques de ces produits sont, parmi les composés chlorés : l’HCH (hexachlorocyclohexane) et un de ses isomères, le lindane, le chlordane, la dieldrine, l’endrine, l’aldrine, le toxaphène, et bien entendu le classique DDT et ses dérivés proches. Les carbamates (par exemple dimetan, sevin, isolan, etc.) ont pris récemment une grande importance. D’autres sont des composés organophosphorés (JETP, TEPP, malathion, mévinphos, parathion, etc.) et c’est dans cette famille chimique qu’apparaît actuellement le plus grand nombre de produits nouveaux. Les insecticides de ces deux dernières familles ont l’avantage de se dégrader rapidement en produits non toxiques, bien qu’eux-mêmes soient souvent de dangereux poisons.
Il est également possible de classer les insecticides suivant leur mode d’action. On distingue ainsi des insecticides de contact, qui pénètrent à travers la cuticule chitineuse de l’Insecte90 (le DDT se comporte véritablement comme si la cuticule n’existait pas pour lui tant il la pénètre facilement) ; les insecticides d’ingestion, qui pénètrent dans le milieu interne par voie digestive ; et les insecticides d’inhalation, pénétrant par voie respiratoire. Notons toutefois que les insecticides agissent le plus souvent d’une manière multiple ; c’est ainsi que l’HCH et l’aldrine agissent par contact, ingestion et inhalation ; la dieldrine et le toxaphène surtout par voie cutanée et digestive.
Le mécanisme d’action vis-à-vis des insectes est lui aussi varié ; ces corps agissent sur le métabolisme (paralysie des mécanismes respiratoires, influence sur la musculature) et surtout sur le système nerveux, avec une vitesse variable suivant les types d’Insectes, puisqu’ils agissent au niveau des mécanismes physiologiques les plus intimes. Ils se comportent également comme des poisons vis-à-vis des animaux supérieurs. Le DDT est en particulier très toxique pour les Vertébrés à sang froid, moins pour les Vertébrés homéothermes. Certains dérivés phosphorés sont des poisons violents91 et la dieldrine et surtout l’endrine sont elles aussi très toxiques. Certains d’entre eux sont aussi plus ou moins phytotoxiques. La toxicité de ces diverses substances chimiques varie cependant très largement en pratique suivant les modalités de l’emploi et les conditions du milieu.
Aux insecticides organochlorés il convient maintenant aussi d’ajouter certains polluants, et notamment les biphényles polychlorés, les PCB des auteurs anglais. Ces produits, utilisés dans l’industrie (plastifiants) ou dispersés lors de la combustion des matières plastiques, ont en effet une structure chimique très semblable et une action nocive du même type que les insecticides.
2. L’abus des insecticides et ses méfaits
Les insecticides sont donc un moyen de destruction extrêmement puissant entre les mains de l’homme, qui dispose maintenant d’une arme chimique susceptible de dévaster la nature sauvage ou transformée. Il faut se garder de proscrire actuellement l’usage des produits de synthèse, en raison de leurs insignes services dans le domaine médical et agricole ; mais on doit reconnaître que ce qui aurait pu être un moyen de lutte efficace, s’il avait été raisonnablement employé, est devenu un véritable fléau aux conséquences multiples, affectant l’ensemble des équilibres naturels. Ce fait provient autant de la toxicité des produits employés que de la généralisation de leur emploi en quantités croissantes.
a) Toxicité vis-à-vis des animaux
Les insecticides, dont l’action n’est pour ainsi dire jamais sélective, ont à des degrés divers des propriétés toxiques vis-à-vis de l’ensemble des animaux. Tous les Insectes sont à un titre variable sensibles à ces produits, qui détruisent donc indistinctement l’entomofaune des aires traitées, y compris les Insectes utiles. En France, lors du traitement contre les Hannetons d’une vaste aire par l’HCH, on a constaté que l’on détruisait simultanément 48 % des espèces de Diptères, 21 % des Hyménoptères, 14 % des Coléoptères, 15 % des Hémiptères et 2 % des Papillons (Grison et Lhoste, 1960). Il se produit très souvent de ce fait des changements d’équilibre entre les différentes espèces, dont les conséquences sont contraires à l’effet recherché. Les Insectes entomophages (parmi lesquels figurent de nombreuses espèces utiles s’attaquant aux ravageurs des cultures) sont fréquemment plus sensibles que les Insectes phytophages que l’on veut détruire. Notons aussi que les Abeilles payent un lourd tribut aux insecticides, notamment en Europe lors du traitement du colza sur lequel ces insectes viennent butiner. En 1954, pas moins de 20 000 ruches ont été ainsi entièrement détruites rien que dans la région parisienne. Depuis cette époque, heureusement, une législation protège plus efficacement l’apiculture en France, en obligeant de traiter les plantes mellifères par des produits non toxiques vis-à-vis des Abeilles (toxaphène, diethion) et si possible en dehors de la période de pleine floraison.
La plupart des insecticides se comportent également comme des poisons dangereux vis-à-vis des autres animaux, parmi lesquels certains ont une grande valeur économique. C’est en particulier ce qui arrive aux animaux à sang froid au cours de la destruction des larves aquatiques de Moustiques ou de Simulies. Les Poissons atteints par certains insecticides, et en particulier le DDT, peuvent mourir immédiatement d’atteintes au système nerveux (central et périphérique) et à l’appareil respiratoire, et du trouble apporté à certains mécanismes métaboliques ; à des doses moins fortes, l’action de ces substances a des séquelles graves entraînant de sérieux désordres physiologiques. On citera également la pollution accidentelle du Rhin par de l’endosulfane au cours de l’été 1969 ; on estime à 40 millions le nombre de Poissons morts en Allemagne et aux Pays-Bas.
Le traitement des zones marécageuses et également des forêts de montagne sillonnées de torrents est souvent très grave pour l’équilibre de ces milieux aquatiques, et en particulier pour les Poissons. Des aspersions aériennes de DDT ont ainsi occasionné dans l’ouest des États-Unis et du Canada la mort de centaines de milliers de Truites et de Saumons, dont on connaît l’importance économique. Dans ce dernier pays, des évaluations numériques étalées sur plusieurs années dans le bassin du Miramichi, Nouveau-Brunswick, ont montré que les pulvérisations d’insecticides (DDT) sur les forêts avoisinantes ont provoqué par empoisonnement direct et privation de nourriture la perte des deux tiers des effectifs de Saumons, les jeunes Poissons étant entièrement éliminés en 1954 et en 1956, tandis que les Insectes ravageurs des bois revenaient de plus belle après chaque traitement. En Colombie britannique, la mortalité des Saumons atteignit presque 100 % dans les mêmes conditions.
En Afrique92, un cas similaire est cité par Blanc (1958) dans la région du Burkina. De larges superficies ont été traitées au lindane pour lutter contre l’onchocercose93, très grave maladie, du groupe des filarioses, qui entraîne la cécité par formation de kystes et de lésions oculaires. Cette affection est transmise par des Simulies, petits Diptères dont les larves aquatiques vivent fixées sur les plantes immergées dans les cours d’eau rapides ; aucun moyen préventif n’existe pour protéger les populations et la thérapeutique actuelle ne donne que des résultats très médiocres. Le seul moyen de lutte consistant donc en une éradication des agents vecteurs, les Simulies, des campagnes de désinsectisation à grande échelle ont été effectuées à partir de 1955, comprenant plusieurs traitements à intervalles réguliers. Ces actions, couronnées d’un succès très relatif sur le plan entomologique, ont entraîné des pertes importantes parmi les Poissons, une forte mortalité étant observée tout de suite après l’aspersion. On a donc dépeuplé les eaux d’une manière très sérieuse, et diminué les ressources alimentaires des populations que l’on veut préserver de l’onchocercose. Des mesures ont heureusement été mises au point pour détruire les Insectes en limitant les dégâts causés aux Poissons (substitution du DDT au lindane, application sélective et localisée dans les biefs à courant rapide) ; sinon on se serait trouvé devant l’alternative de laisser mourir les hommes de faim ou de maladie ! En Asie, le traitement de rizières par des insecticides a protégé les récoltes, mais a exterminé les Poissons élevés dans ce milieu. On a ainsi compromis les ressources en protéines animales pour augmenter celles en hydrates de carbone (Moore).
Les pesticides ont également une action sur les pêcheries au large des côtes. Les quantités de produits déversés en doses croissantes sur les marais côtiers et les étendues d’eau douce ou saumâtre des estuaires sont entraînées vers le large et y ont provoqué des mortalités élevées parmi les organismes marins. Tous les pesticides dont on a pu mesurer les toxicités en laboratoire se sont révélés nocifs aux Crustacés, aux Mollusques94 et aux Poissons marins à des doses comparables à celles de leur emploi. Les oiseaux côtiers sont eux aussi touchés par ces pollutions, comme en témoigne la destruction d’une colonie de Sternes caugek aux Pays-Bas par suite d’insecticides charriés par le Rhin (Koeman). L’homme peut donc également « empoisonner » les eaux côtières par l’abus des insecticides et y entraîner une baisse du rendement des pêcheries, principalement au niveau des estuaires, dont on connaît l’importance à ce point de vue.
Les insecticides ont également une action toxique vis-à-vis des oiseaux et des mammifères, l’homme compris. Les doses létales sont relativement basses pour certains d’entre eux (par exemple la dieldrine dont la dose létale est de 20-30 mg/kg et l’endrine dont la dose létale est de 7,5 mg/kg pour le Rat). Les oiseaux insectivores, en se nourrissant de proies chargées d’insecticides, peuvent en absorber une dose suffisante pour les détruire eux-mêmes et leur nichée95. Si ces effets sont très apparents dans le cas de certains insecticides de synthèse, ils le sont tout autant dans le cas des arséniates et des fluorures, heureusement de moins en moins employés, qui donnent lieu à des phénomènes cumulatifs lourds de conséquences. Des mortalités élevées ont été observées par exemple aux États-Unis au cours des campagnes de lutte contre la Fourmi d’Argentine ; la dieldrine employée entraîna des pertes sérieuses parmi les Vertébrés à sang chaud (jusqu’à 97 % des oiseaux) et dut être remplacée par d’autres insecticides moins toxiques. Dans l’Indiana, un seul traitement au parathion provoqua la mort d’au moins 65 000 Merles migrateurs et autres passereaux. Des pertes atteignant 87 % des populations totales ont été signalées. Des faits analogues ont été constatés en Europe, et notamment en Angleterre (en 1960, pas moins de 10 000 décès d’oiseaux manifestement dus aux insecticides étaient observés dans le seul Lincolnshire) ; les carnivores, en particulier les Rapaces, subissaient simultanément des pertes sensibles après s’être nourris d’oiseaux intoxiqués. Des ravages très sévères sont également à déplorer en raison de l’enrobage des semences dans des pesticides (surtout aldrine, dieldrine et heptachlore, pour lutter contre certains insectes, et composés organo-mercuriels agissant comme fongicides).
Les insecticides provoquent aussi de sérieux désordres physiologiques, notamment dans les mécanismes de la reproduction. Ils se concentrent volontiers dans les glandes sexuelles des oiseaux et entraînent une stérilité partielle ou totale des reproducteurs. Une perturbation profonde de l’équilibre des hormones sexuelles est provoquée par de faibles doses d’insecticides organochlorés, diminuant le nombre d’œufs ou même bloquant la maturation des gonades. Par ailleurs le dépôt de calcaire dans la coquille des œufs est gravement affecté et les œufs deviennent fragiles et même parfois mous, se brisant au moindre choc. On a démontré que la diminution de l’épaisseur des coquilles était directement proportionnelle au niveau de contamination par les métabolites du DDT (Peakall, 1970 ; Ramade, 1970). Ces faits ont été mis en évidence chez de nombreux Passereaux, oiseaux de mer, Palmipèdes et Rapaces, notamment chez les Faucons et les Éperviers et surtout chez l’Aigle à tête blanche Haliaetus leucocephalus, volontiers piscivore et de ce fait susceptible d’absorber de grandes quantités d’insecticides en prélevant Crabes et Poissons. En fait, sur 26 spécimens dont les tissus ont été analysés par les laboratoires du Fish and Wildlife Service des États-Unis, 25 renfermaient du DDT, parfois à des doses reconnues comme mortelles, et l’espèce semble particulièrement sensible à ses effets. La raréfaction accélérée de cet aigle, emblème national, a été de ce fait imputée principalement aux insecticides, comme semble notamment le prouver son déclin rapide dans les régions côtières de l’est des États-Unis, traitées fréquemment en vue de la lutte contre les Moustiques. La réussite des couvées est descendue à des taux particulièrement faibles (très inférieures à la moyenne, notamment dans les États atlantiques).
La situation est tout aussi alarmante pour le Balbuzard (Pandion haliaetus), du fait même d’un régime alimentaire semblable à celui du Pygargue. En 1962, dans la vallée du Connecticut, 18 couples ont pondu 46 œufs dont seuls 3 ont éclos. L’analyse des œufs non développés a révélé la présence de produits de dégradation du DDT. L’abus de cet insecticide est donc un véritable « génocide » vis-à-vis de cet oiseau. Le nombre de couples nicheurs est passé de 150 couples en 1952 à 5 en 1970 le long de la rivière Connecticut.
Des faits tout à fait comparables viennent d’être mis en évidence en Écosse pour l’Aigle royal Aquila chrysaetos. D’après des recensements effectués à travers une vaste aire des Highlands, le nombre de couples reproducteurs a passé de 72 % des effectifs totaux au cours de la période 1937-1960 à 29 % en 1961-1963. Les observations montrent que la baisse du taux de reproduction et le déclin des populations sont manifestement dus aux insecticides de synthèse ingérés avec les proies (divers pesticides ont été mis en évidence dans les œufs des Rapaces) (Lockie et Ratcliffe, 1964 ; voir aussi Cramp, 1963). En Suède également, les Aigles ont beaucoup diminué au cours des dernières années. Le Pygargue (Haliaetus albicilla) comptait 48 couples dont 17 ont eu des jeunes en 1964 ; en 1965, il n’y avait que 42 couples dont seuls 10 ont eu des jeunes.
Signalons que de telles constatations ont été faites chez les Hérons (notamment chez les Hérons cendrés qui ont le taux de résidus d’organochlorés le plus élevé de tous les oiseaux de Grande-Bretagne ; Prestt) et chez les Gallinacés, Faisans et Perdrix (pontes moins nombreuses, œufs infertiles, mortalité élevée des jeunes). En Suède, les Perdrix ont diminué de 50 à 90 % dans les aires traitées, et des constatations de ce genre ont été faites dans maints pays.
Il convient cependant d’être prudent dans les conclusions tirées d’observations sur la mortalité directe due à l’ingestion d’insecticides par les Vertébrés et par l’homme96. Les résultats sont souvent très contradictoires. Dans certains cas la mortalité est très élevée parmi les Vertébrés à sang chaud, dans d’autres elle est bien inférieure aux autres causes de décès (en particulier prédation, chasse, maladies) comme l’ont notamment révélé des enquêtes menées en Grande-Bretagne par des équipes du ministère de l’Agriculture. Ces différences s’expliquent par des modalités d’application très diverses et aussi par les doses employées (elles sont dans l’ensemble nettement plus fortes aux États-Unis qu’en Europe). Il en est de même de l’action cancérigène de certaines substances répandues à profusion dans la nature, et dont on peut penser a priori qu’elles jouent un rôle dans le déclenchement de cancers parmi la population humaine se nourrissant des produits végétaux traités. Il faut toutefois remarquer qu’aucune relation entre les pesticides et le déclenchement de maladies humaines (cancer, leucémie, hépatite, etc.) n’a été mise en évidence dans les conditions d’utilisation de ces produits, en dépit de quelques affirmations. L’action cancérigène de certains insecticides a été démontrée chez le Rat et la Souris, de même qu’une influence sur l’appareil endocrinien, y compris les glandes sexuelles. Il conviendrait de le prouver d’une manière irréfutable chez l’homme, en la dissociant de celles que peuvent avoir simultanément les autres produits toxiques avec lesquels la civilisation moderne nous met en contact : produits de déchets, pollutions atmosphériques, résidus radioactifs, etc.
b) Toxicité vis-à-vis des végétaux
Les insecticides sont également susceptibles de causer des dommages directs aux plantes cultivées ou sauvages sur lesquelles ils sont répandus. C’est ainsi que l’HCH utilisé à haute dose ralentit la croissance des végétaux et agit même profondément sur leur mécanisme héréditaire, en déterminant notamment des polyploïdies. Les organochlorés entraînent un ralentissement de la photosynthèse, surtout chez les Algues marines, ce qui peut agir sur l’équilibre des écosystèmes et de la biosphère tout entière.
c) Action sur le sol
Bien que l’action des insecticides sur la microfaune du sol soit encore mal connue, ceux-ci entraînent sans aucun doute des changements profonds dans l’équilibre des différents éléments biotiques selon leur seuil de sensibilité. En grande quantité, ces substances peuvent provoquer une stérilisation partielle du sol, notamment en ce qui concerne les processus de fixation de l’azote, phénomène d’autant plus lourd de conséquences que les produits répandus s’accumulent et persistent souvent des temps fort longs.
d) Effets à retardement
On a parfois tendance à considérer que les insecticides se bornent à tuer sur-le-champ une certaine proportion d’animaux, et que les individus résistants se trouvent indemnes. Les effets à retardement sont cependant beaucoup plus importants qu’on ne l’a imaginé tout d’abord et peuvent se manifester de diverses manières, principalement dans le cas des dérivés chlorés. Beaucoup sont persistants et vont exercer leurs ravages loin des points d’application. C’est avant tout le cas du DDT.
Tout d’abord les insecticides n’entraînent pas ipso facto la mort immédiate des animaux qui les ont ingérés. Ils peuvent s’accumuler dans leur organisme au niveau des graisses avant d’être libérés à nouveau lors de la mobilisation des réserves, en particulier pendant l’hiver (comme cela a été observé par exemple chez le Rat musqué ; Rudd, 1960). Ces faits sont encore aggravés par suite des effets cumulatifs97, les doses libérées dépassant alors les seuils mortels.
Les insecticides peuvent également passer dans les œufs des Oiseaux et dans le lait des Mammifères dont ils empoisonnent ainsi les jeunes. Cela s’est observé même dans le cas de Vaches laitières dont la production s’est trouvée contaminée quand elles étaient nourries avec du fourrage traité par le DDT.
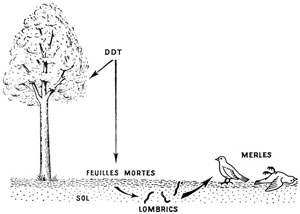
Fig. 38. Concentration le long des chaînes alimentaires de l’insecticide (DDT) répandu sur les arbres.
Le danger le plus grand consiste cependant en une concentration des substances toxiques le long des chaînes alimentaires. Il n’y a en effet pas toujours ingestion ou contact direct de la victime avec le pesticide ; celui-ci est absorbé par un être vivant dans l’organisme duquel il se concentre, sans occasionner de troubles sérieux par suite d’une forte résistance spécifique ; il passe ensuite dans le corps d’un autre animal prédateur du premier, qu’il est susceptible d’intoxiquer si celui-ci est sensible aux doses en question. Le cas le mieux connu est celui des Turdidés, et notamment du Merle migrateur américain Turdus migratorius (Barker, 1958). Des épandages massifs de DDT ont été effectués aux États-Unis pour protéger les ormes de la maladie transmise par des insectes qui les déciment. La fraction de DDT tombée sur le sol est ingérée par des Lombrics, très peu sensibles au DDT, mais qui le concentrent dans leurs tissus. Or les Merles, en consommant ces Vers en abondance, ingèrent donc, très longtemps après le traitement, de grandes quantités de substances toxiques auxquelles leur cerveau et leur système nerveux sont particulièrement sensibles (fig. 38). La mort survient après des paralysies locomotrices et des convulsions, sans que rien ne puisse empêcher l’issue fatale. La mortalité parmi les Merles migrateurs est très élevée, et peut atteindre 86 % dans certains cas, après une période de latence de 3 semaines suivant le traitement. Certains ornithologues n’ont pas craint d’avancer que cette espèce pourtant si commune en Amérique du Nord risque actuellement d’avoir un sort comparable à celui du Pigeon migrateur. Au moins 140 espèces d’oiseaux sont connues aux États-Unis comme étant victimes des effets des pesticides, principalement du fait de la concentration le long des chaînes alimentaires. Il est cependant difficile de rapporter la diminution de certaines populations d’oiseaux à ces seuls effets, car d’autres facteurs viennent s’ajouter (transformation des habitats, fluctuations naturelles des populations).
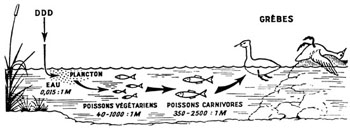
Fig. 39. Concentration le long des chaînes alimentaires de l’insecticide (DDD) répandu sur le Clear Lake, Californie. Voir explications dans le texte.
Une telle concentration de substances toxiques s’opère également dans les biocénoses aquatiques le long des chaînes alimentaires allant des organismes planctoniques aux Poissons, puis aux oiseaux d’eau. C’est notamment ce qu’ont démontré Hunt et Bischoff(1960) dans le cas d’un lac de Californie (Clear Lake) traité au DDD (ou TDE, substance voisine du DDT) à partir de 1949 pour détruire les larves de Moustiques (fig. 39). Appliqué à la dose d’une partie pour 70 millions, le produit se concentra en passant du milieu liquide au plancton (5 pour 1 million), puis aux Poissons planctonophages et aux Poissons carnivores, avant d’atteindre les oiseaux piscivores (Grèbes) à des doses variant de 40 à 2 500 parties pour un million et provoquer une mortalité très élevée parmi leurs populations. L’analyse de la chair des Poissons révéla des doses considérables de DDD et de ses produits de dégradation, que l’on peut ainsi rendre responsables de la mort des oiseaux prédateurs98.
Des quelque 1 000 couples de Grèbes nicheurs, il n’en subsista qu’une vingtaine qui paraissaient stériles. De 1958 à 1963, un seul jeune fut observé sur le lac.
Notons que, depuis, on a supprimé les applications de DDD, aux effets persistants, et remplacé ce produit par du méthyl-parathion rapidement dégradable. On entreprit surtout un vaste programme de lutte biologique en acclimatant des Poissons se nourrissant de larves de Moustiques (Mississippi Silverside), qui redonnèrent vie aux eaux lacustres. Les Grèbes s’y établirent à nouveau et, en 1969, 82 jeunes y furent élevés, soit 4 fois plus que l’année précédente. Il conviendra d’introduire des Poissons prédateurs, de manière à contrôler les mangeurs de Moustiques et à restituer son équilibre à la biocénose.
De tels phénomènes s’observent dans le cas de la plupart des chaînes alimentaires. En plus de la transformation chimique des pesticides pouvant conduire à la formation de dérivés plus toxiques, cette concentration explique l’impossibilité de juger a priori des effets de produits répandus sans contrôle prolongé préalable.
e) Ruptures des équilibres biologiques
L’action des pesticides se traduit également par de profonds changements dans les équilibres biologiques. Le plus simple consiste en une raréfaction accentuée de la quantité de nourriture animale disponible. Dans beaucoup de cas l’ensemble des populations d’Insectes, quelles que soient les espèces auxquelles ils appartiennent, se trouve diminué. Il en résulte des conséquences très graves pour tous les animaux entomophages, Mammifères insectivores (Musaraignes) et surtout oiseaux qui soudainement voient la biomasse aux dépens de laquelle ils vivent considérablement réduite. L’effet sur leurs populations est d’autant plus sensible que la réussite des nichées dépend d’une manière étroite de la quantité de nourriture disponible. En raison de la disparition des Insectes, celle-ci peut être nulle ou en tout cas très inférieure à la normale dans l’habitat considéré.
L’influence des insecticides se traduit par ailleurs par des changements beaucoup plus importants encore qui affectent sérieusement l’équilibre des différentes espèces d’Insectes, souvent au détriment même des intérêts économiques de l’homme.
L’existence d’une population importante d’Insectes parasites des plantes cultivées s’accompagne nécessairement de celle d’Insectes prédateurs qui contribuent, dans une mesure souvent très importante, à limiter le nombre des premiers. Or les traitements chimiques par produits de synthèse aux effets persistants ont comme conséquences de tuer ces alliés de l’homme, en même temps que les Insectes nuisibles. Quand cessent les effets de l’épandage d’insecticides, les populations d’Insectes végétariens, utilisateurs primaires de la production végétale, ont toutes les chances de se reconstituer plus vite et avant les Insectes carnivores auxquels ils servent de proies : ceux-ci ne tenant que la troisième place dans les chaînes alimentaires, l’accroissement de leurs effectifs est de ce fait même plus lent. Il se produit donc un déséquilibre profond, le traitement antiparasitaire profitant assez paradoxalement aux parasites. L’homme détruit ainsi une communauté biologique tout entière, fait particulièrement grave dans des milieux relativement proches d’un équilibre naturel, par exemple certains vergers ou plantations tropicales. Une soudaine pullulation d’Insectes parasites après un traitement par pesticides a été souvent décrite.
D’après Basilewsky, une Punaise parasite du Caféier au Congo et en Ouganda, Habrochila ghesquieri, se met à pulluler dans les plantations après les traitements par DDT, causant des dégâts beaucoup plus graves qu’avant les pulvérisations. Ce ravageur est en effet très peu sensible au DDT, alors qu’une autre Punaise, Apollodotus chinai, prédateur de la première et contribuant donc à en limiter le nombre, est détruite par cet insecticide. Le parasite peut donc proliférer à son aise, l’homme ayant inconsidérément détruit son allié et favorisé l’ennemi de ses cultures.
En Californie, des applications de DDT pour lutter contre la Cochenille du citronnier Coccus pseudomagnoliarum et le Thrips du citron Scirothrips citri, ont eu pour effet de multiplier le nombre des Cochenilles qui se sont mises à pulluler par suite de la disparition des prédateurs (Clausen, 1956). Des infestations massives de ce type ont été observées aux États-Unis dans le cas de nombreux parasites végétaux.
Des cas similaires ont été signalés partout dans le monde, notamment en Europe99, où la destruction des Insectes carnivores s’accompagne toujours d’une prolifération des Insectes nuisibles dont les premiers contribuent à limiter les effectifs. Des parasites jusqu’alors d’importance secondaire peuvent par ailleurs être favorisés lors de la destruction des ravageurs principaux, vraisemblablement du fait de l’élimination des prédateurs qui en limitaient les populations. C’est ainsi qu’en Californie les Acariens sont devenus des parasites dangereux, sans importance avant l’épandage massif de pesticides de synthèse.
3. Résistance des Insectes aux insecticides
Depuis que l’on utilise les insecticides dans la lutte contre les parasites de l’homme et de ses cultures, on s’aperçoit que les Insectes deviennent peu à peu insensibles à leurs effets toxiques. Cette constatation a été faite bien antérieurement à l’emploi de produits organiques de synthèse et, avant 1945, une liste d’une douzaine d’espèces devenues réfractaires aux insecticides jusqu’alors classiques avait déjà été dressée. On crut que l’avènement des produits synthétiques allait permettre de résoudre cet inquiétant problème. Ce fut cependant une déception, car l’homme avait incontestablement chanté trop tôt victoire.
Les premières observations ont été faites dès 1946 en Suède, où les Mouches domestiques semblèrent devenir insensibles au DDT. Puis une résistance semblable apparut dans divers pays, notamment en Italie, au Danemark, en Égypte et aux États-Unis. Bientôt elle se manifesta chez d’autres Insectes, en particulier chez les Moustiques (Culex) en Italie en 1947 et chez les Anophèles (les premières populations résistantes furent observées en Grèce dès 1949, 3 ans seulement après les premières utilisations du DDT dans la lutte antimalarique). Peu à peu ces observations se généralisèrent à travers le monde, avec un nombre croissant d’Insectes, parmi lesquels de dangereux parasites des cultures et des vecteurs de graves maladies (paludisme, fièvre jaune entre autres) dont on observait simultanément la recrudescence.
D’autres insecticides furent alors utilisés pour arriver au contrôle des « pestes ». Mais presque chaque mise au point d’une nouvelle arme chimique était suivie d’une défense de l’Insecte selon un processus devenu classique dans la lutte contre de nombreux fléaux de la nature100.
À l’heure actuelle, une résistance aux insecticides est connue chez plus de 20 espèces d’Arthropodes, la moitié étant des parasites des cultures et les autres des vecteurs de maladies (on compte parmi eux 54 Diptères, 23 Hémiptères et 14 Lépidoptères) (Brown, 1960). L’Araignée rouge offre un tel exemple mondial de la course entre la recherche de nouveaux pesticides et le développement inexorablement rapide de son invulnérabilité. Cette résistance s’exerce aussi bien vis-à-vis du DDT que de la dieldrine, de ses dérivés et des produits organophosphorés.
Cette invulnérabilité croissante des populations repose sur un mécanisme de sélection de mutants résistants, préexistants et préadaptés. Certaines souches sont naturellement immunisées contre un produit toxique déterminé et ce sont leurs descendants qui peu à peu remplacent la population initiale101. Ce phénomène, d’ailleurs invoqué par les généticiens comme une preuve de l’efficacité de la sélection naturelle, est bien entendu en étroite relation avec l’extraordinaire fécondité des Insectes et la rapidité avec laquelle se succèdent leurs générations. Les expériences ont montré que chaque population possède plusieurs « solutions » ou possibilités génétiques pour s’adapter aux insecticides (Lamotte, Rev. Quest. Sci., 1966).
Cette résistance physiologique se complique par ailleurs d’un changement dans le comportement, les Insectes appartenant aux souches nouvellement sélectionnées ayant des mœurs qui les mettent mieux à l’abri des pesticides.
L’apparition de souches résistantes a donc posé de nombreux problèmes à ceux qui se sont préoccupés de la lutte contre les Insectes nuisibles, et avant tout aux autorités sanitaires. L’Organisation mondiale de la santé a réuni plusieurs conférences sur ce thème et sa 8e assemblée générale a préconisé une intensification de la lutte afin d’obtenir l’éradication des Insectes vecteurs de maladies avant l’apparition de la résistance. Récemment encore cet organisme précisait que la presque totalité des principaux vecteurs de germes pathogènes résiste à l’un ou à l’autre des insecticides courants.
Elle est également inquiétante pour ceux qui s’alarment des progrès que fait l’empoisonnement des habitats par les produits chimiques que l’on y déverse. Car la résistance des Insectes a entraîné une augmentation des doses répandues avec un rythme de plus en plus rapide, et aussi la substitution d’insecticides souvent plus toxiques à l’égard des autres animaux102.
La résistance va se développer au fur et à mesure que de nouveaux produits seront mis au point. Il est à souhaiter que cela n’oblige pas l’homme à utiliser des substances à toxicité croissante et à en faire un usage de plus en plus abusif, augmentant ainsi les risques d’empoisonnement véritable de la planète103.
4. La lutte chimique contre les végétaux indésirables
Les animaux ne sont pas les seuls à souffrir de l’abus de produits synthétiques dans la lutte contre les ennemis des cultures. L’emploi de substances chimiques qualifiées d’herbicides, destinées à supprimer un grand nombre de « mauvaises herbes » – terme désignant les plantes parasites ou compétitrices des plantes cultivées –, est lui aussi à blâmer dans certains cas, étant responsable de la destruction de communautés végétales et de la raréfaction de quelques espèces particulières, parmi les messicoles notamment.
L’agriculteur a un grand nombre de griefs à l’égard des adventices. Il leur reproche d’entrer en compétition avec les plantes cultivées en leur prenant une part importante de l’eau, de l’air, de la lumière et des éléments minéraux ; par ailleurs certaines sont toxiques par leur feuillage (par exemple en Europe le Séneçon jacobée ou la Renoncule âcre, pour le bétail) ou par leurs graines (Lychnis githago ou Nielle des blés), servent de réservoirs à des maladies ou d’abri à des Insectes polyphages nuisibles. Les pertes subies de ce fait par l’agriculture sont parfois aussi importantes que celles qu’occasionnent les Insectes, comme cela a été constaté aux États-Unis. Aussi a-t-on mis au point une série de substances actives qui éliminent ces plantes jugées indésirables, bien mieux que les anciennes pratiques manuelles104.
Certaines de ces substances105 sont des herbicides totaux qui détruisent indistinctement tous les végétaux (par exemple chlorates de sodium et de potassium, urées substituées, telles que le Monuron ou CMU). D’autres sont des herbicides sélectifs agissant parfois par contact (comme la cyanamide calcique, agissant par ailleurs comme engrais, et les xanthates), mais souvent d’une manière plus subtile : tels sont les herbicides à translocation ou à action interne, qualifiés de phytohormones ou substances de croissance. Ces substances, souvent des dérivés de l’acide 2,4 phénoxyacétique (2,4-D mis au point en 1942 aux États-Unis ; MCPA mis au point la même année en Angleterre), bien que chimiquement différentes des hormones végétales ou auxines, se comportent comme celles-ci dont elles « caricaturent » l’action. À des doses infinitésimales, elles provoquent une croissance anormale de la plante (malformations diverses, arrêt du développement), désorganisent les tissus et entraînent un flétrissement rapide. La plupart de ces herbicides détruisent les Dicotylédones et respectent en général les Monocotylédones106 en raison de différences histologiques et physiologiques profondes entre ces deux grands groupes végétaux. Notons que ces substances ont une toxicité en général faible vis-à-vis des animaux, donc des risques minimes quant aux biocénoses animales, sauf certaines d’entre elles comme le 2,4-D qui se comporte comme un poison cumulatif vis-à-vis des oiseaux, en particulier des Canards, et même vis-à-vis de l’homme.
Les herbicides ont une action très profonde sur les associations végétales sur lesquelles ils sont répandus. On peut certes admettre que leur nocivité est faible quand il s’agit des champs ou autres milieux entièrement artificiels, où ils détruisent beaucoup de « mauvaises herbes ». Mais parmi ces dernières figurent des messicoles, dont les derniers refuges se trouvent dans les champs de céréales ; les botanistes déplorent la raréfaction avancée de plusieurs d’entre elles, notamment en Europe.
Les effets des herbicides sont beaucoup plus regrettables dans le cas des prairies, où l’élimination des Dicotylédones au profit des Graminées peut conduire à la raréfaction de certaines espèces et même nuire au rendement des pâturages et à la valeur des fourrages. Leur impact est plus sérieux aux yeux du naturaliste, quand ils sont répandus sur les talus, les digues, les remblais de chemin de fer, les bords de route et lieux semblables, ceux-ci constituant souvent les seules stations de certaines plantes qui y ont trouvé refuge alors qu’elles ont disparu partout ailleurs.
Leurs effets sont plus graves encore dans les milieux aquatiques. En voulant éliminer un certain nombre de végétaux réputés nuisibles, l’homme risque de détruire des communautés entières de plantes aquatiques, d’autant plus que les eaux courantes transportent les substances loin de leur point de déversement. D’après Westhoffet Zonderwijk (1960), 17 % des plantes de la flore des Pays-Bas pourraient ainsi être détruites en cas d’usage abusif des herbicides dans les eaux hollandaises. Les effets sont aggravés du fait que les communautés végétales étant changées, l’équilibre de la faune aquatique se trouve à son tour bouleversé ; et certains herbicides ont des effets toxiques non négligeables sur les animaux, en particulier sur les Poissons et le frai.
L’usage des herbicides permet enfin à l’homme de modifier entièrement sans grand travail des associations végétales naturelles tout entières. C’est par exemple ce qui a été tenté aux États-Unis dans les steppes à Armoises, le fameux sagebrush de l’ouest du continent, régions sans doute pauvres quant à leur rendement économique, mais d’un très grand intérêt biologique en raison des communautés animales qui y sont établies (notamment le Pronghorn ou Antilocapre, et le Tétras centrocerque, l’un et l’autre très caractéristiques de cet habitat). Sous la pression des éleveurs, un vaste plan d’aménagement a été entrepris pour éliminer les Armoises et leurs associées à l’aide d’herbicides, et les remplacer par des Graminées ; des millions d’hectares ont déjà été traités. Cependant le régime des pluies et les conditions édaphiques ne semblent pas propices au développement d’une végétation différente de celle qui s’est établie naturellement. On risque donc de détruire un habitat tout entier, avec sa flore et sa faune, sans profit pour l’homme.
Dans l’ensemble donc l’abus des herbicides, surtout dans les habitats relativement peu modifiés par l’homme, est susceptible d’entraîner la raréfaction de certaines espèces et de contribuer à la dégradation de milieux d’un grand intérêt scientifique107.
5. Utilisation rationnelle des moyens de lutte chimique
L’homme a donc entrepris depuis les temps les plus reculés une lutte contre les parasites de ses cultures et contre les Insectes vecteurs de maladies. Il n’avait réussi que très médiocrement à contrôler ces véritables fléaux quand soudain l’industrie chimique mit à sa disposition des moyens extraordinairement puissants, sous forme de produits de synthèse en quantité illimitée et à bas prix de revient. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il a pu contrôler d’une manière efficace la plupart des Insectes nuisibles.
Mais comme chaque fois qu’un nouvel instrument s’est trouvé entre ses mains, il n’a pas su l’utiliser avec mesure. Il a immédiatement abusé des armes chimiques, croyant à leurs vertus universelles et à leur innocuité quelles que soient les doses employées. Cet abus a entraîné la destruction inconsidérée d’animaux inoffensifs ou utiles et déterminé de graves déséquilibres au sein des habitats sauvages ou transformés. En fait le monde entier a risqué et risque encore actuellement d’être empoisonné au sens propre du terme, car cette forme de pollution est maintenant devenue globale.
L’alarme a tout d’abord été donnée par les biologistes ; ils furent pris pour de doux rêveurs préoccupés de la protection de végétaux et d’animaux jugés sans intérêt par le reste de l’humanité. Mais devant l’étendue du péril, l’opinion publique s’est émue à son tour, suivie par les pouvoirs politiques. Le déversement inconsidéré de poisons violents en quantités croissantes sur des aires de plus en plus considérables, aussi bien sur les champs que sur les étendues qui ont conservé un équilibre proche des conditions naturelles, fait maintenant courir des dangers très graves à la nature et même à l’homme, comme le laisse pressentir un faisceau de constatations.
Il convient donc sans tarder de prendre des mesures strictes contre l’abus des produits toxiques utilisés dans la lutte antiparasitaire, bien qu’on ne puisse actuellement en proscrire l’usage. L’homme a provoqué un déséquilibre pour assurer sa subsistance. Avec le champ, il a créé un milieu entièrement artificiel, le seul qui puisse lui assurer sa subsistance ; il a multiplié ipso facto les animaux déprédateurs dont il ne pourra contrôler la pullulation que par des moyens artificiels. L’usage des insecticides est entré dans la pratique agricole ; il n’en sortira pas, car il s’intègre dans tout un ensemble de pratiques concertées dont dépend le rendement de la production agricole. Un moyen naturel ne permettra pas de contrôler la pullulation de nuisibles dans un milieu artificiel.
Mais nous devons chercher de nouveaux moyens de lutte.
Un des premiers à préconiser est la lutte biologique108, avant tout par l’intermédiaire des ennemis naturels autochtones des déprédateurs. Chaque insecte est accompagné dans son aire d’habitat originelle d’un certain nombre d’Arthropodes prédateurs qui en limitent les populations109. Or un traitement par insecticides a pour effet de tuer aussi bien les uns que les autres, ce qui entraîne de graves perturbations dans les équilibres et souvent une pullulation ultérieure des parasites. Il en est de même des oiseaux qui font tous, et principalement les Passereaux entomophages, d’énormes consommations d’insectes surtout au moment de la nidification. Les quantités de parasites ainsi détruites ne sont nullement négligeables comme le laissent entendre certains, les oiseaux ayant en quelque sorte dans les écosystèmes terrestres le rôle de limiter en partie les populations d’Arthropodes110. Ceci ne vaut cependant que dans les habitats conservés dans un état voisin du climax, alors que dans les milieux profondément transformés, jamais un frein naturel ne pourra venir contrebalancer les pullulations des ravageurs.
Pour lutter contre les insectes introduits artificiellement par l’homme et devenus des « pestes » (rappelons qu’une forte proportion des insectes préjudiciables aux cultures a une origine exogène), l’homme a la possibilité d’introduire ensuite les insectes prédateurs pour rétablir en quelque sorte l’équilibre proies-prédateurs du milieu d’origine. Ces principes ont été appliqués à maintes reprises à travers le monde. Dès 1881, aux États-Unis, on acclimatait le Diptère Braconide Apanteles glomeratus pour lutter contre un parasite du chou malencontreusement introduit. À l’heure actuelle pas moins de 95 espèces (81 espèces de parasites, 14 espèces de prédateurs des insectes) constituant des « pestes » aux États-Unis ont fait l’objet de telles acclimatations ; 390 autres espèces ont fait l’objet d’introductions non couronnées de succès (Clausen, 1956). Des essais similaires ont été entrepris dans les autres parties du monde. Il est à souhaiter que cette lutte biologique soit continuée et amplifiée, après de très soigneux travaux préliminaires toutefois, car l’introduction d’un élément exogène dans une faune est toujours à entreprendre avec précaution. Bien menée, cette lutte constitue néanmoins un des moyens efficaces de contrôle des populations de « pestes ».
L’introduction de maladies des insectes est également susceptible de donner de bons résultats. Divers micro-organismes, virus, Bactéries, Champignons111, Protistes et même Nématodes sont susceptibles de déterminer des maladies des insectes et ont fait l’objet de recherches pour contrôler les pestes. Les virus112, souvent très efficaces, et les Bactéries ont l’avantage d’être cultivés sans frais (contrairement aux insectes qui nécessitent un élevage coûteux en insectarium avant d’être libérés), de pouvoir être répandus en pulvérisations comme un insecticide et d’être spécifiques des insectes. Des résultats encourageants ont notamment été obtenus dans le cas des larves du Coléoptère Rutélide Popillia japonica et du Hanneton Melolontha melolontha que l’on détruit en leur communiquant des « maladies laiteuses ». Le Bacille Bacillus thurigiensis a fait l’objet d’utilisation contre les chenilles de divers Lépidoptères ; son action présente la particularité de ne pas infecter les insectes, mais de les tuer par la sécrétion de toxines spécifiques, sans action sur l’homme et les autres animaux, agissant comme un véritable insecticide biologique (Grison et Lhoste, 1960). Des résultats intéressants sont à attendre de cette méthode de contrôle biologique élégante et inoffensive pour les autres animaux.
On notera enfin que des méthodes nouvelles laissent penser que l’homme pourra aboutir à un contrôle de certains ravageurs au moins, par une sorte d’autoextinction de leurs effectifs. Un procédé de lutte consiste à introduire des mâles stérilisés qui entrent en compétition avec les mâles normaux réduisant ainsi le nombre de femelles pondant des œufs fertiles. Cette méthode, mise au point par E. F. Knipling113, a donné lieu à des essais à grande échelle en Floride et dans les Antilles néerlandaises, à Curaçao, dans la lutte contre un Diptère très préjudiciable à l’élevage (Callitroga hominivorax, qui pond dans les plaies du bétail et y provoque une pullulation de larves entraînant des infections graves et une forte mortalité des animaux parasités). Comme le Diptère ne compte pendant quelques mois que des populations réduites servant de point de départ aux invasions estivales114, un calcul théorique montre que s’il est possible d’introduire dans cette population des mâles physiologiquement castrés en nombre 2 fois supérieur à celui des mâles normaux, la réduction du taux de natalité qui en résulte aboutit à une extinction de la population en quatre générations. Si la population n’est pas stationnaire, le même effet peut être obtenu en augmentant la proportion initiale. Les expériences faites en stérilisant des mâles par irradiation, ce qui ne change pas leur comportement reproducteur (fait important, car les femelles ne s’accouplent qu’une fois et les mâles traités et les mâles normaux doivent présenter le même comportement si l’on veut obtenir l’effet désiré sur la fécondité), et en les lâchant ensuite dans la nature montrèrent qu’il en était bien ainsi115 ; les Diptères disparurent pratiquement des aires qui faisaient l’objet des essais.
Cette méthode pourrait sans doute être généralisée en dépit de difficultés nombreuses (dues aux mœurs de certains insectes, à la nécessité de leur monogamie, etc.) ; elle a peut-être un grand avenir dans la limitation des insectes nuisibles. Elle est susceptible d’être considérablement améliorée notamment par la stérilisation des mâles dans la nature sans qu’il soit nécessaire de les capturer (produits chimiques stérilisants mêlés à des appâts116).
Mais en dépit de ces méthodes beaucoup moins dangereuses pour l’équilibre de la nature que l’épandage de pesticides, il est bien évident que ce dernier procédé reste pour le moment le moyen le plus efficace et le meilleur marché dans la plupart des cas. Nous avons déjà dit qu’il faut le considérer comme une thérapeutique, c’est-à-dire étudier chaque cas particulier, en fonction de la nature du milieu, du climat, des animaux à combattre et des autres éléments de la biocénose. Il faut aussi tenir compte de la nature du produit employé, de sa toxicité, de sa vitesse de dégradation et des produits auquel il donne naissance, parfois plus toxiques que le produit initial.
Avant tout il convient de bannir certains insecticides et d’étudier de nouveaux produits synthétiques. La chimie organique est riche de possibilités et des milliers de nouveaux corps sont encore à découvrir. L’arsenal chimique à notre disposition va en s’augmentant. Comme chaque espèce d’insecte a une biologie quelque peu différente, et surtout un « mécanisme » chimique cellulaire particulier, on peut espérer découvrir des pesticides spécifiques, inoffensifs pour tout autre animal que les insectes, et même plus spécialement toxiques pour les espèces à combattre, tout en épargnant les autres. Et en fait les substances récemment mises au point tendent vers une spécificité de plus en plus affirmée.
Les insecticides endothérapiques (Systemic insecticides) sont à ce point de vue d’un grand intérêt. Il s’agit de substances que l’on fait absorber par les végétaux afin de rendre leur sève toxique pour les insectes susceptibles de les attaquer117. Les principaux insecticides de ce type appartiennent à la série des composés organophosphorés. Un des premiers connus est le schradan118, découvert en 1937 par G. Schrader en Allemagne, abandonné à l’heure actuelle en raison de sa haute toxicité, même pour les plantes aux doses efficaces. D’autres corps, comme le déméthon et l’endothion, ont été employés contre les Diptères et les Pucerons. Ces corps sont mis au contact des graines ou des racines (parfois au niveau du feuillage) et se distribuent ensuite dans tout l’appareil végétatif.
D’excellents résultats ont été obtenus lors d’applications de ces insecticides d’un type très particulier, aussi bien sur les plantes tropicales (lutte contre les Punaises du cacaoyer) que sur celles des pays tempérés. Ces produits sont souvent plus efficaces et ont une action plus durable que celle des insecticides pulvérisés. Dans l’ensemble, ils respectent les insectes prédateurs.
La plupart de ces produits sont malheureusement très toxiques pour les animaux à sang chaud119 et on ignore encore leur degré de toxicité sur l’homme et les animaux domestiques ingérant les produits agricoles ainsi traités. Il convient d’être prudent dans leur emploi120 et de rechercher des substances nouvelles susceptibles de ne pas présenter leurs inconvénients, ce qui leur assurerait un grand avenir.
Si le champ d’investigation des chimistes est donc plein de promesses, il faut aussi insister sur le fait qu’aucun produit nouveau ne devrait être employé à grande échelle avant que des essais répétés n’aient été faits dans les conditions de l’emploi réel et que les conséquences à brève et à longue échéance aient été soigneusement analysées. Sans doute de telles précautions sont-elles théoriquement prescrites par les lois et les règlements dans beaucoup de pays ; mais ces dispositions devraient être renforcées et sévèrement appliquées. On reste parfois confondu en voyant avec quelle légèreté des produits nouveaux sont répandus en doses massives sans que l’on connaisse exactement leur impact dans la nature.
Les conditions d’application sont également importantes à considérer. Dans les habitations et aux alentours de celles-ci, n’importe quel produit peut être utilisé sans grand danger dans la nature (par exemple dans la lutte contre les insectes piqueurs, vecteurs de maladies), à condition qu’il ne soit pas toxique pour l’homme à brève ou longue échéance.
Au niveau des champs et des habitats entièrement transformés par l’homme, l’usage des pesticides n’a pas toujours une gravité exceptionnelle dans les limites normales d’utilisation. Dans ces habitats parfaitement artificiels, seuls des insecticides chimiques peuvent contrôler les parasites des cultures. Cela ne veut bien entendu pas dire que l’homme a intérêt à « empoisonner » entièrement ces milieux, ce qui nuirait d’ailleurs à leur rendement en entraînant des conséquences graves, sur les sols en particulier. Il ne faut pas oublier par ailleurs qu’en utilisant des pesticides, l’homme ne s’attaque qu’au mal et non à ses causes ; la limitation brutale des effectifs d’une population animale n’empêche nullement celle-ci de proliférer immédiatement après, selon une loi écologique générale. Un traitement antiparasitaire détruira une forte proportion des déprédateurs, mais les populations survivantes verront leur pouvoir de reproduction accru, leur densité ne dépendant que des conditions du milieu. L’usage de moyens chimiques doit s’accompagner de pratiques culturales favorables à un heureux équilibre biologique.
Il en va tout autrement dans les habitats naturels ou présentant certaines analogies avec ceux-ci. L’écosystème y est beaucoup plus complexe et les différentes espèces s’y trouvent dans un équilibre bien meilleur. Les insecticides doivent y être employés comme de simples adjuvants aux défenses naturelles, et non pas comme les moyens de lutte exclusifs. Ceci est le principe même de la lutte intégrée.
Cette conception s’applique particulièrement aux vergers, qui, au point de vue écologique, sont en quelque sorte les équivalents de forêts claires. Un tel traitement antiparasitaire a été signalé au Canada, parmi les vergers de Pommiers, une des grandes ressources de la Nouvelle-Écosse (Patterson 1956 ; Pickett, 1960). De 1930 à 1949, les populations de ravageurs étaient devenues résistantes à l’arséniate de plomb auquel on substitua alors le DDT et d’autres insecticides de synthèse. Ces produits entraînèrent certes une diminution des effectifs des ravageurs. Mais comme ils exterminaient également les prédateurs des parasites, chaque interruption dans les traitements était immédiatement suivie d’une pullulation des ravageurs responsables de graves dégâts aux fruits.
On modifia alors la méthode même du traitement, en diminuant la nature, les doses et la fréquence des applications d’insecticides, de manière à préserver la faune limitant le nombre d’insectes déprédateurs et à simplement compléter son action. On constata que les attaques étaient néanmoins peu nombreuses en proportion (de 80 à 94 % des fruits étaient indemnes), le même résultat que lors de traitements massifs, onéreux et préjudiciables à longue échéance. L’homme se contentait d’aider les défenses écologiques, au lieu de détruire l’équilibre naturel, et d’être alors obligé de se substituer entièrement aux forces conservatrices du milieu.
Nous ne pouvons manquer de signaler de même les méthodes préconisées en Suisse par la Station fédérale d’essais agricoles de Lausanne (Mathys et Baggiolini, Agriculture romande, 6, no 3, 1967). La lutte intégrée conseillée pour les cultures fruitières constitue un système de régulation des populations d’insectes déprédateurs reposant sur un ensemble de techniques dont l’emploi d’insecticides n’est qu’un élément parmi d’autres. On favorise la faune utile et on fait intervenir les armes chimiques de manière à ne pas contrecarrer la défense naturelle du milieu. La lutte biologique, grâce à des espèces autochtones ou introduites, vient ainsi ajouter ses effets à la lutte chimique. Les résultats de telles méthodes, étudiées et appliquées maintenant dans divers pays européens, sont des plus prometteurs.
Notons que l’homme a parfois intérêt à conserver les habitats mis en exploitation dans un état comparable à un milieu naturel, comme nous avons déjà eu l’occasion de le vérifier dans d’autres domaines. Cela est prouvé notamment par un exemple cité par Grison et Lhoste (1960), montrant combien les méthodes culturales ont d’incidences sur l’abondance des insectes déprédateurs et le contrôle de leurs populations121. En Italie méridionale, comme dans d’autres régions méditerranéennes, on commença à enlever toutes les broussailles et herbes qui embarrassaient jusqu’alors le sol des oliveraies. On constata alors une prolifération de la Mouche de l’olive Dacus oleae, et de sévères attaques des fruits, en dépit de l’usage d’insecticides. En fait on avait éliminé avec les plantes adventices les abris où les insectes parasites de la Mouche se réfugiaient au cours du traitement des Oliviers par insecticides ; ils y trouvaient d’autres insectes à parasiter, ce qui leur permettait de maintenir leurs populations à un niveau élevé. Les procédés de « culture nette » (Clean culture) des Américains sont ainsi, dans certains cas au moins, préjudiciables aux plantes cultivées comme ils le sont aussi par ailleurs à l’équilibre des sols et à la résistance à l’érosion122.
À ce point de vue, la conservation de peuplements végétaux à première vue inutiles, comme les haies, les massifs de Ronces et d’autres plantes de ce type, est en définitive très utile au maintien d’un équilibre entre les différentes populations d’insectes et au contrôle des espèces nuisibles. La monoculture et le remembrement des parcelles mènent ainsi à la suppression de précieux auxiliaires de l’homme.
Ces considérations prennent encore plus de valeur dans le cas d’habitats naturels, tels que les forêts ou les milieux aquatiques. La plus grande prudence est de rigueur quand on se trouve dans l’obligation de les traiter par pesticides. On risque d’y déclencher des réactions en chaîne et d’aboutir à des ruptures d’équilibre graves allant à l’encontre des buts recherchés.
On remarquera que les accidents dus aux pesticides et à leur abus et les destructions injustifiées d’animaux inoffensifs dans la nature ont une fréquence variable selon les pays. Ils sont particulièrement nombreux aux États-Unis, où l’emploi des pesticides a atteint des proportions énormes. Les pays tropicaux ont eux aussi « découvert » ces produits et commencent à en faire une consommation excessive qui risque d’y compromettre les équilibres naturels. En revanche ils se sont révélés moins toxiques dans certains pays européens qui ont su se protéger d’une manière plus efficace contre l’emploi abusif des pesticides et où un meilleur équilibre agricole a contribué à préserver les cultures de la pullulation de parasites dangereux123.
Dans l’ensemble donc, l’homme a intérêt à ne considérer les pesticides que comme un des éléments de la lutte contre les ennemis de ses cultures et de son bien-être. Un aménagement rationnel des habitats, même les plus transformés par ses activités, est de rigueur. Il serait notamment à souhaiter que les indispensables études écologiques qui doivent précéder toute mise en valeur d’un territoire comprennent une analyse de l’entomofaune autochtone, notamment de la fraction susceptible d’un transfert vers les plantes dont on envisage la culture. Cela permettrait de choisir celles qui risquent le moins de se trouver exposées à une pullulation de parasites en puissance.
Par ailleurs les pratiques agricoles les moins favorables à la multiplication des ravageurs doivent être mises en œuvre, en fonction des conditions écologiques locales. Ce n’est qu’alors que l’homme sera en droit d’utiliser les armes chimiques à sa disposition pour combattre ces fléaux sans en engendrer de plus graves.
L’homme ne peut dorénavant assurer sa subsistance qu’en maintenant une partie de la surface de la terre dans des conditions artificielles ; l’emploi de substances chimiques fait partie du maintien d’un haut rendement économique dans ces aires profondément transformées, où l’équilibre naturel ne peut plus s’établir. Il y a un risque certain à courir. C’est de ce risque que dépendent une plus grande abondance de nourriture et de matières premières, primordiales pour l’humanité, et le recul des endémies qui ravagent encore le monde. Mais il convient, comme l’a affirmé dès 1963 un rapport au président des États-Unis124, de réduire ce risque au minimum et de limiter l’emploi des pesticides, en étudiant soigneusement les effets sur la nature, en proscrivant les épandages à grande échelle dès qu’ils ne sont pas indispensables ; en contrôlant en permanence les taux dans l’air, l’eau et le sol ; et en limitant au strict minimum, avant de l’interdire aussi vite que possible totalement, l’emploi de substances stables aux effets persistants. L’emploi d’un pesticide ne devrait pas être autorisé avant que des études sérieuses et objectives n’aient prouvé qu’il n’est pas nocif à long terme et qu’il n’a pas d’effets simultanés sur les terres et les communautés vivantes, naturelles ou artificielles, au voisinage desquelles il est répandu125.
Il faut proportionner l’ampleur de la lutte par pesticides aux buts recherchés. Comme dans le cas de médicaments utilisés dans le traitement des maladies, il y a des indications et des contre-indications. Il appartient à l’homme d’étudier chaque cas et d’établir le traitement sans « dépasser la dose prescrite ». Cette dose varie essentiellement en fonction du milieu et des conditions écologiques, car l’emploi des pesticides ne doit être conçu que comme un adjuvant aux défenses naturelles des habitats126.
L’homme doit comprendre que la lutte chimique qu’il a entreprise sera suivie d’une victoire à la Pyrrhus s’il ne sait pas se garder de l’abus de moyens de destruction d’une puissance insoupçonnée, qui selon sa volonté seront médicaments bénéfiques ou « poisons des Borgia ».
Les déchets de la civilisation industrielle à l’assaut de la planète
L’homme succombera tué par l’excès de ce qu’il appelle la civilisation.
Jean-Henri Fabre
Un problème devenu très sérieux à l’époque actuelle a trait aux résidus des activités humaines d’origine domestique ou industrielle. S’il est au fond très ancien, les grandes collectivités de l’Antiquité se préoccupant déjà de l’évacuation des déchets, il a cependant changé entièrement d’échelle du fait de l’intensification des activités de l’homme moderne.
Alors que jusqu’en des temps relativement récents, en tout cas jusqu’à la révolution industrielle, les déchets étaient principalement organiques, donc aisément attaquables par les agents de destruction et de transformation (Bactéries, Champignons, etc.), l’industrie a soudain répandu sur la planète des produits plus résistants. Leur « durée de vie » souvent considérable rend leur impact beaucoup plus profond, aussi bien au sein des communautés naturelles que vis-à-vis de l’homme lui-même. On citera par exemple les hydrocarbures lourds qu’attaquent seulement avec une lenteur extrême certaines Bactéries hautement spécialisées ; les plages souillées par de longs cordons noirs témoignent de leur persistance. Une mention particulière doit être faite aux corps radioactifs – certains d’entre eux sont entièrement artificiels, comme de nombreux isotopes –, dont les effets peuvent se faire sentir pendant des millions d’années parfois.
La situation s’est aggravée dans les mêmes proportions sur le plan quantitatif, le développement vertigineux des activités industrielles, joint à la forte poussée démographique, ayant entraîné une augmentation considérable du volume des résidus.
Or l’attitude de l’homme vis-à-vis des déchets est restée la même que jadis : il se contente de les déverser dans la nature, dans les airs comme dans les eaux, sans se préoccuper de leur devenir. La situation prise dans son ensemble était restée peu grave tant que la vitesse de déversement était plus ou moins en rapport avec la vitesse de dégradation, un équilibre s’établissant tant bien que mal.
Il n’en est plus de même à l’heure actuelle où la nature et ses forces de destruction ne sont plus en état, ni qualitativement ni quantitativement, de résorber la masse énorme de déchets que l’homme continue à déverser sans leur faire subir parfois de traitement préalable. Ces résidus appartenant à mille espèces chimiques s’accumulent donc et empoisonnent littéralement l’atmosphère, la terre et les eaux.
Il convient de réviser entièrement notre politique à l’égard des résidus et de considérer qu’il ne suffit plus de les déverser sans contrôle dans la nature en laissant à celle-ci le soin de les détruire. On se heurte certes à des difficultés techniques, car l’élimination de certaines substances est loin d’être aisée. Il se présente également des difficultés financières, car l’épuration des eaux usées et la rétention, la transformation et le stockage des déchets industriels sont chers et grèvent les prix de revient apparemment en pure perte : l’homme préfère en conséquence fermer les yeux sur le devenir des déchets et sur leur influence dans la nature.
Si l’on compare un processus industriel avec un système naturel, les différences sont évidentes. Dans la nature, les éléments cheminent d’une manière cyclique ; une fois formés, les matériaux sont utilisés, puis dégradés avant d’être repris au cours du cycle suivant. Les deux phases se déroulent à une vitesse égale. Au contraire un système artificiel, comme la fabrication d’un produit quelconque, est en fait un système ouvert. L’homme ne s’intéresse qu’à la première phase, qui lui rapporte, et néglige la seconde, qui lui coûte de l’énergie sans profit. Le recyclage des éléments ne le préoccupe pas et il s’en remet à la nature. Or celle-ci ne peut pas intervenir avec efficacité, le volume et la qualité des déchets dépassant ses possibilités. C’est cette attitude qu’il faut changer, en passant d’une économie tournée vers l’exploitation des ressources naturelles à une économie de recyclage. L’économie externe n’est plus compatible avec le maintien de conditions décentes pour l’homme. Nous devons être persuadés qu’à partir de maintenant il nous faudra payer pour l’eau et l’air purs, et non plus les trouver gratuitement dans le milieu et les rejeter pollués après usage.
Sans doute des progrès très sensibles ont-ils été réalisés dans divers domaines. La législation de chaque pays s’efforce de protéger les eaux et les terres, souvent aussi l’air ; des conventions internationales concernent la haute mer. Par ailleurs des procédés techniques ont été mis au point pour retenir et filtrer les déchets les plus variés.
Il convient d’appliquer strictement et de renforcer ces mesures, car les pollutions ont une ampleur considérable à l’heure actuelle. Aucun milieu n’en est indemne. Si elles sont bien entendu particulièrement importantes dans les zones industrielles densément peuplées, les fleuves, les courants marins et les vents se chargent de porter les corps délétères loin de leur point de déversement.
Il convient également de mentionner les dépôts d’ordures que l’homme a de plus en plus tendance à disséminer un peu partout et notamment au bord des routes les plus pittoresques. Les corniches d’où l’on jouit des plus beaux panoramas sont choisies avec prédilection pour précipiter en contrebas ordures ménagères, vieilles ferrailles et débris de toutes sortes. Une mention particulière doit être faite aux « cimetières » de voitures. Cette plaie, qui fut longtemps le propre de l’Amérique du Nord du fait de la valeur marchande dérisoire des voitures d’occasion (en 1964, plus de 6 millions de voitures furent ainsi abandonnées, ce qui indique l’ampleur du phénomène), a maintenant atteint l’Europe. Les bords de nos routes sont de plus fréquemment encombrés de carcasses de voitures débarrassées de tout ce qui se démonte. La publicité intempestive le long des routes est également à stigmatiser.
À ces pollutions de type classique est venue depuis quelques années s’ajouter la menace nucléaire, la pire de toutes, car susceptible d’occasionner la ruine totale de notre planète.
C’est à ces empoisonnements véritables qu’il convient de s’arrêter quelque peu, car s’ils portent de sérieux préjudices à l’homme lui-même, ils mettent également en péril l’équilibre des communautés naturelles du monde entier.
1. Pollutions des eaux douces
Le problème de la pollution des eaux douces n’est pas récent, car le Zend-Avesta et les Écritures127 renferment déjà des préceptes relatifs aux déchets et à la manière de les disposer pour ne pas gêner l’homme et compromettre son approvisionnement en eau. Il a cependant conservé jusqu’à des temps récents des proportions peu inquiétantes. Au début du XIXe siècle, les membres du Parlement britannique pêchaient encore le saumon à Londres du pont de Westminster, et jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, l’eau potable des Parisiens fut prélevée dans la Seine sans traitement particulier. Le saumon a hélas disparu de la Tamise128 et à l’heure actuelle, pendant l’été, la Seine roule en aval de Clichy un mélange à parties égales d’eau de rivière et d’eau d’égout.
Les eaux souterraines elles-mêmes ont été gravement polluées, aussi bien par des déchets organiques et les pesticides déversés en trop grandes quantités (saturation des filtres naturels) que par des sels qui atteignent sans encombre la nappe phréatique. Au cours de périodes de basses eaux, des villes importantes ont été privées d’eau potable, et cela se renouvelle de plus en plus fréquemment du fait des prélèvements effectués sur les nappes alluviales, provoquant une réalimentation de celles-ci par les cours d’eau pollués.
Les raisons de la pollution des eaux douces sont évidentes et relèvent de deux ordres de faits différents. Le premier est en rapport avec l’accroissement de la population humaine et le degré élevé d’urbanisation qui en est le corollaire. Les métropoles où se concentrent de nombreux habitants rejettent un énorme volume d’eaux usées incomplètement épurées, qui souillent les biefs des fleuves situés en aval. Le second provient du développement de l’industrie qui exige des quantités d’eau de plus en plus considérables et surtout qui rejette dans les rivières les multiples produits chimiques constituant les déchets de ses activités.
Ces deux facteurs ont pour effet de modifier fondamentalement le problème de la pollution des eaux douces, d’une gravité extrême en Europe et en Amérique du Nord, surtout dans la partie orientale des États-Unis. La Ruhr, le Luxembourg, la Belgique, le nord de la France, l’Angleterre, peuvent être cités comme de lamentables exemples de cette évolution. En URSS, l’industrialisation et le développement des grands centres urbains font qu’en dépit de l’abondance des eaux pas moins de 360 000 km de rivières sont considérés comme gravement pollués.
La situation empire d’année en année, d’autant plus que la tendance actuelle, manifeste en Europe occidentale et singulièrement en France, vise à la décentralisation et à l’implantation d’usines dans des régions jusqu’alors agricoles, d’où une multiplication des foyers de pollution.
Cette situation est d’autant plus grave que les besoins en eau vont également en augmentant. La consommation annuelle par habitant atteint 1 200 m3 aux États-Unis, et l’on estime qu’elle doublera d’ici une quarantaine d’années (production d’énergie hydraulique et navigation exclues). Or la quantité d’eau de surface est limitée, de même que celle des eaux souterraines dont la fraction susceptible d’être prélevée est relativement minime. Le manque d’eau sévit d’ores et déjà, même pour la consommation humaine, dans des régions où pourtant les précipitations atmosphériques sont abondantes129.
La première cause de pollution provient du rejet des résidus de la vie collective par les égouts (Ellis, 1937 ; Klein, 1962 ; Erichsen, 1964 ; Ternisien, 1968 ; Carbenier, 1969). En dépit des procédés perfectionnés d’épandage mis au point, l’accroissement continu des villes, diverses difficultés techniques et le prix élevé des installations dépassant les possibilités d’investissement de certaines collectivités entraînent fréquemment l’inopérance d’installations insuffisantes, ou faisant même parfois totalement défaut. Les cas de déversement des eaux d’égout non ou insuffisamment épurées ont une fâcheuse tendance à se multiplier. Le Rhône en aval de Genève est périodiquement pollué par la vidange du barrage de Verbois (qui reçoit les eaux usées de la ville), dont les effets se font sentir jusqu’à Culoz, à 60 km en aval. La basse vallée de la Seine était réputée jadis pour l’abondance de ses Poissons, et l’on pêchait jusqu’à 58 espèces différentes à Quillebœuf. Cette faune abondante a maintenant disparu, aussi bien par suite de l’industrialisation de cette région qu’en raison des volumes croissants d’eaux usées déversées par les égouts. Les lacs, et en particulier ceux des Alpes suisses et françaises, ne sont pas à l’abri de ce type de pollution, comme le démontrent des observations répétées. Ils y sont même particulièrement sensibles du fait qu’ils constituent des systèmes clos où les apports nuisibles s’accumulent. Les fonds du lac d’Annecy sont dépourvus d’oxygène d’août à décembre, de même que ceux des lacs de Nantua et de Zurich, en raison du déversement des eaux d’égout et des perturbations dans l’équilibre chimique qui en résultent. Les fonds se colmatent, la végétation aquatique disparaît, remplacée par des Champignons et des Bactéries filamenteuses ; les animaux eux-mêmes pâtissent dans une large mesure, notamment l’Omble-chevalier, Poisson renommé des lacs subalpins.
La pollution du lac Léman s’est considérablement aggravée au cours des dernières années (Rapport sur l’état sanitaire du Léman de 1957-1960, Com. Int. Prot. Eaux du Léman et du Rhône, 1964). L’action des eaux ménagères et industrielles a provoqué une diminution de la transparence des eaux (de 2 m en moyenne depuis le début du siècle), une baisse des teneurs en oxygène et l’apparition de substances azotées organiques. De plus le nombre de germes a augmenté d’une manière très inquiétante, surtout ceux d’origine fécale présumée (Coliformes) qui ont envahi tout le Léman. Les modifications chimiques et physiques et la contamination bactérienne montrent clairement que ce lac est en train de devenir un cloaque.
Le second type de pollution, beaucoup plus grave encore, qualifié de pollution de caractère collectif, est une conséquence de l’extension de l’industrie et une rançon du progrès technique130. En fonction de la nature chimique des produits incriminés, on peut diviser les pollutions en diverses catégories. Les hydrocarbures en constituent l’une des plus apparentes. S’étalant à la surface en traînées disgracieuses, ils forment un film superficiel et empêchent la diffusion de l’oxygène dans l’eau. Les détergents synthétiques – dont l’utilisation industrielle, agricole et ménagère s’amplifie131 – sont plus pernicieux encore, car ils changent la tension superficielle en jouant le rôle d’émulsionnant, de moussant et de mouillant132. Leurs effets sont considérables, car ils diminuent la capacité de réoxygénation des eaux, inhibent les Bactéries attaquant les substances organiques (champs d’épandage) et produisent des mousses qui s’accumulent en surface (surtout au niveau des barrages). À certaines doses, ils sont toxiques à l’égard des Poissons et de leurs alevins (les détergents anioniques, les plus répandus, sont toxiques à des doses de 10 à 25 mg/l), et même à l’égard des plantes aquatiques (par exemple la Renoncule aquatique Ranunculus aquatilis ne peut croître quand l’eau contient 1 mg/l de détergent, les Potamogeton 2,5 mg/l). D’autres substances se comportent comme des poisons véritables, tels les déchets de cokeries et d’usines à gaz (phénols, goudrons, dérivés cyanés) et d’innombrables sels de cuivre, de zinc, de plomb, et de nickel133, sans compter les chlorures. D’autres encore ont des propriétés corrosives, en particulier les acides et bases qui changent le pH des eaux et modifient ainsi l’équilibre des micro-organismes. Il ne faut enfin pas oublier les matières répandues volontairement – avant tout insecticides et herbicides – occasionnant de sérieuses perturbations au sein des eaux douces.
Ces substances ont donc une action chimique en introduisant dans les eaux des corps normalement absents ou présents en quantités infinitésimales, parmi lesquels des poisons violents. Elles ont très souvent de plus une action physique ; certaines sont susceptibles de modifier la couleur, la transparence, la tension superficielle, même parfois la viscosité et la température des eaux. Enfin elles changent le goût et l’odeur, pouvant rendre les eaux putrides, donc impropres à la consommation humaine ou à la prospérité de la faune aquatique.
Ces diverses substances agissent donc d’une manière variée dans un milieu naturel d’une complexité extrême. Les eaux douces forment des biocénoses aux éléments très divers, aux multiples chaînes alimentaires, partant d’un grand nombre de micro-organismes, Bactéries, Algues et Champignons qui y transforment la matière organique et la rendent assimilable aux êtres supérieurs. L’équilibre en sels minéraux et en substances organiques y est complexe et le plus souvent très fragile. Il suffit d’un changement minime dans l’équilibre ionique ou dans la teneur en éléments minéraux ou organiques pour que certaines transformations se trouvent inhibées ou au contraire accélérées. Or c’est dans ce milieu fragile que vont agir les substances toxiques imprudemment déversées par l’homme. Leur action est variable suivant qu’il s’agit de pollutions organiques ou de pollutions minérales.
Les substances organiques déversées dans les rivières y sont attaquées par des micro-organismes, et avant tout par des Bactéries aérobies. Si leur concentration ne dépasse pas un certain seuil, les eaux peuvent ainsi se régénérer d’elles-mêmes grâce à l’action des Bactéries en suspension. Il se forme des nitrates, des sulfates et des phosphates, tandis que les composés riches en carbone finissent sous forme de carbonates. Ces transformations exigent cependant de grandes quantités d’oxygène, ce qui fait que le processus n’est possible que dans le cas de faibles concentrations en substances à dégrader et d’une teneur élevée en gaz dissous134.
Dès que la concentration des substances polluantes devient trop élevée, leur dégradation entraîne un épuisement total de l’oxygène dissous dans l’eau, éminemment préjudiciable à un très grand nombre d’animaux aquatiques, d’abord les Poissons qui se trouvent à proprement parler asphyxiés. De plus les réactions de dégradation se passent dorénavant en milieu devenu réducteur, dépourvu d’oxygène, l’action des Bactéries aérobies étant supplantée par celle d’anaérobies135. Les produits de dégradation diffèrent alors largement et comprennent une série de substances toxiques entraînant la putréfaction des eaux, par production de dérivés du méthane, d’amines, et de dérivés sulfurés136 ou phosphorés. La décharge d’une trop forte quantité de produits organiques dans les eaux conduit donc à la fois à un appauvrissement en oxygène et à une intoxication grave par les produits de décomposition. C’est la raison pour laquelle la décharge de substances organiques en apparence inoffensives peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’équilibre chimique et biologique des eaux dont le pouvoir autoépurant se trouve diminué137.
Nous ne reviendrons pas sur la deuxième action des pollutions et principalement des pollutions industrielles. Il est évident que la décharge de produits toxiques entraîne un empoisonnement véritable des rivières, qui se trouvent ainsi stérilisées ; tous les êtres vivants constituant les communautés aquatiques pâtissent de l’action de ces produits qui les éliminent directement ou indirectement.
Leur action est évidente sur les Poissons, singulièrement sensibles à certains produits chimiques et à la teneur des eaux en gaz dissous. Un grand nombre de sels minéraux, et notamment ceux de plomb, de zinc, de cuivre, de mercure, d’argent, de nickel et de cadmium, ont pour effet de précipiter et de rendre compact le mucus qui recouvre les branchies, empêchant ainsi les échanges gazeux dont ces organes vitaux sont le siège. Des expériences ont montré que des Poissons placés dans des eaux ayant une certaine teneur en sels de métaux lourds ou en acides138 manifestent d’abord une accélération notable des mouvements des ouïes. Puis les mouvements deviennent irréguliers, se ralentissent et les Poissons meurent par asphyxie. Les modalités dépendent bien entendu des espèces envisagées et notamment de leurs besoins en oxygène.
L’homme peut être la première victime des pollutions par sels de métaux lourds, comme l’illustre tragiquement l’empoisonnement par le mercure. En 1953, une mystérieuse maladie se répandit dans la baie de Minamata au Japon, entraînant une quarantaine de décès et de nombreuses malformations chez les nouveau-nés. Le mercure était responsable de cette grave affection. Rejeté par une usine de matières plastiques, il s’était concentré le long de chaînes alimentaires jusqu’aux Poissons, dont les populations sont de gros consommateurs. Le mercure métal est aisément méthylé par des Bactéries et entre ainsi dans les cycles biologiques.
D’autres substances communément responsables de la pollution des eaux douces se comportent comme des poisons internes paralysant les réactions biochimiques à divers niveaux, notamment en bouleversant les oxydations cellulaires. C’est notamment le cas des composés cyaniques et des sulfures solubles qui entraînent une réduction massive des échanges respiratoires. Il en est de même de l’ammoniaque et de ses dérivés, qui, traversant les branchies et se répandant dans le sang, y bloquent les phénomènes respiratoires en transformant l’hémoglobine, et selon toute vraisemblance en attaquant les globules eux-mêmes.
Principales causes de pollutions139
POLLUTIONS CHIMIQUES À EFFETS NOCIFS BRUTAUX
Polluants : Produits toxiques minéraux (sels minéraux [sels de métaux lourds, acides, alcalis…] ou organiques [phénols, hydrocarbures, détergents…]).
Responsables : Toutes industries lors de déversements accidentels massifs.
POLLUTIONS CHIMIQUES CHRONIQUES
Polluants : Phénols, hydrocarbures pétroliers, résidus industriels divers. Produits phytosanitaires (insecticides et herbicides). Détergents de synthèse. Engrais de synthèse (nitrates).
Responsables : Industries diverses (dont raffineries, industries des plastiques, du caoutchouc ; gazeries, cokeries, distillation des bois, goudrons…). Agriculture. Usages domestiques et industriels de détergents.
POLLUTIONS BIOLOGIQUES
Polluants : Déchets organiques fermentescibles.
Responsables : Égouts des collectivités urbaines. Industries de la cellulose (scieries, papeteries), textiles et alimentaires (distilleries, brasseries, conserveries, laiteries, sucreries, abattoirs). Tanneries.
POLLUTIONS PHYSIQUES
Pollutions radioactives
Polluants : Déchets radioactifs des explosions nucléaires et des réactions nucléaires contrôlées. Radioactivité induite.
Responsables : Industries nucléaires.
Pollutions mécaniques
Polluants : Matières solides inertes (limons, argiles, scories, poussiers).
Responsables : Grands chantiers, construction routière. Industries d’extraction. Lavage des minerais. Dragages.
Pollutions thermiques
Polluants : Rejet d’eau de refroidissement, élevant la température des rivières.
Responsables : Centrales électriques thermiques et nucléaires. Raffineries. Industries diverses.
Par ailleurs les Poissons sont, à des degrés divers, très sensibles au manque d’oxygène. Si les Anguilles et la plupart des Cyprinidés sont relativement accommodants, il n’en est pas de même pour de nombreux autres, et en particulier des Salmonidés, les plus exigeants de tous, qui meurent par asphyxie dès que la quantité d’oxygène dissous baisse en dessous d’un certain seuil.
Il ne faut de plus pas oublier que les Poissons, pœcilothermes par excellence, présentent un taux métabolique sous la dépendance stricte de la température140. Les effets de la pollution sont donc beaucoup plus sensibles dans les eaux chaudes que dans les eaux froides, en raison de besoins physiologiques accrus. Cela rend particulièrement sérieuse la menace que fait peser sur les communautés aquatiques l’élévation de la température des rivières en raison de l’utilisation de leurs eaux comme agent de refroidissement, ce que l’on appelle la pollution thermique. Nombre d’industries, notamment les centrales thermiques, la sidérurgie et les industries du pétrole, en utilisent déjà de grandes quantités. Les besoins seront décuplés quand les centrales thermonucléaires auront atteint leur plein développement. On prévoit que d’ici une dizaine d’années les centrales électriques françaises auront besoin de la totalité des eaux des grands fleuves. Il en résultera une augmentation moyenne de 7 °C des eaux, ce qui en période estivale et compte tenu des pollutions, entraînera la destruction de presque toute la vie aquatique.
Notons enfin que les effets de la pollution par matières organiques, en réduisant dans une proportion massive la teneur en oxygène dissous, sensibilisent les Poissons à la pollution par substances minérales ; des expériences et des observations dans la nature ont montré qu’en milieu très aéré les Poissons sont capables de résister à des concentrations de produits toxiques qui leur seraient fatales dans des eaux moins riches en oxygène. Or on sait que les pollutions sont le plus souvent très complexes et proviennent de mélanges de substances organiques et minérales.
Les pollutions des eaux douces sont finalement des plus nuisibles à l’homme lui-même et à ses activités. La plupart des grandes collectivités dépendent des rivières pour leur approvisionnement en eau brute ; or le traitement des eaux à haut degré de pollution organique ou minérale est de plus en plus difficile et onéreux, faisant courir des dangers très sérieux à la santé publique. Des traces de certains éléments dont aucune installation d’épuration ne permet de débarrasser les eaux peuvent à la longue devenir préjudiciables à l’homme. Les sels de métaux lourds se concentrent le long des chaînes alimentaires et atteignent des taux alarmants chez les Poissons dont la chair est dorénavant toxique pour l’homme. Ce fut le cas de Poissons des Grands Lacs américains, devenus impropres à la consommation humaine du fait de leur teneur en mercure.
Elles causent par ailleurs de graves dommages aux industries elles-mêmes. De fortes concentrations des eaux en produits chimiques sont incompatibles avec certaines utilisations déterminées, aussi bien dans les installations de refroidissement (dépôts de tartres, de sels ferreux, corrosion par acides) que dans des utilisations plus directes, par exemple les industries chimiques, la papeterie, les industries alimentaires. Beaucoup d’installations industrielles sont ainsi forcées de traiter au préalable les eaux pour les débarrasser des produits rejetés en amont, quitte à les déverser à nouveau à la rivière, chargées de nouvelles pollutions dont elles ne se seront pas souciées. L’industriel, qui contribue si largement à la pollution des eaux douces, se retrouve parmi les premières victimes.
Les pollutions des eaux douces constituent donc dans leur ensemble un problème très sérieux dans le monde moderne. Les cours d’eau des régions fortement industrialisées sont devenus de véritables cloaques qui charrient tous les résidus des activités humaines. Il convient de faire cesser ce regrettable état de choses, qui porte préjudice à la nature sauvage autant qu’à l’homme lui-même. Les rivières ne sont pas faites pour servir de moyen de transport à toutes les immondices de la vie moderne.
Sans doute la plupart des pays ont pris conscience de l’urgence et de la gravité de ces problèmes. Les mesures adoptées concernent aussi bien l’action juridique (interdiction des déversements, réglementation du rejet des eaux usées, responsabilité civile) que l’action technique (mise au point de procédés d’épuration, aménagement d’installations bien adaptées). Il convient bien entendu d’étudier chaque cas particulier, en fonction de la nature des pollutions, de leur volume et des possibilités d’autoépuration des cours d’eau. De plus ces mesures doivent s’intégrer au sein d’une planification d’ensemble s’adressant à tout le bassin fluvial, bien commun de grandes communautés humaines.
Quelques états ont adopté une classification des rivières, interdisant tout déversement dans certaines, les autorisant dans d’autres devenues ainsi des égouts naturels (par exemple aux États-Unis et en Belgique). D’autres s’efforcent au contraire de limiter partout les dégâts par des mesures techniques adéquates (notamment en Grande-Bretagne où le rejet de toutes les eaux résiduelles est interdit avant prétraitement et déversement aux égouts communaux ; des dispositions similaires existent en Allemagne, où des associations mixtes groupent depuis le début de ce siècle les collectivités, les industries et les particuliers).
Les procédés techniques, que nous n’envisagerons pas ici, sont variés à l’infini. Dans le cas des installations industrielles, la solution idéale consiste bien entendu en un « recyclage » des eaux en circuit fermé, les résidus étant évacués ailleurs qu’en rivière. Dans l’ensemble les procédés d’épuration mis au point donnent satisfaction sur le plan technique. Il convient de les mettre en œuvre sans tarder pour le bien même de l’humanité.
2. Pollutions des mers
Les mers ne sont pas plus à l’abri des pollutions, car elles ont depuis fort longtemps déjà servi de dépotoir141. Certes leurs eaux ont un volume considérable par rapport à celui des matières et des liquides rejetés, et on peut espérer que les courants et les marées seront capables de les brasser et de les diluer avec une vitesse suffisante. Le rejet d’eaux usées et de déchets de toutes sortes, y compris les déchets industriels, revêt néanmoins une grande importance. Les effets de ces décharges sont parfois imprévisibles, car les courants marins, loin de toujours les entraîner au large, les ramènent parfois vers les côtes à grande distance du point de déversement. Aussi bien en Amérique du Nord qu’en Europe, des plages renommées et très fréquentées ont été ainsi polluées par les égouts des villes côtières, et envahies par les déchets les plus inattendus.
En plus de ces effets dont l’homme est le premier à pâtir, la contamination des mers par les eaux usées, domestiques ou industrielles, est susceptible de modifier l’équilibre des organismes marins, en particulier du Plancton, y déterminant la prolifération de nombreuses Algues (Algues vertes, Diatomées), dont la mort rend les eaux putrides. Une relation existe à coup sûr entre la composition des associations animales et le degré de pollution, certaines espèces plus résistantes pouvant proliférer142, sauf dans un certain rayon autour du point d’épandage, où la faune et la flore marines sont complètement stérilisées.
Des effets semblables sont également connus quant aux Poissons, notamment au Portugal et en Scandinavie où la pollution des fjords a des répercussions sur le rendement des pêcheries. Beaucoup d’estuaires, par où s’écoulent les eaux rejetées tout au long des bassins fluviaux et au bord desquels sont souvent édifiées de grandes villes, présentent un degré de pollution très alarmant. Dès l’embouchure des rivières il existe de ce fait une « barrière empoisonnée » qui empêche la remontée de certains poissons anadromes, tels les Saumons.
En fait les mers reçoivent maintenant un volume d’affluents considérable, où l’on retrouve tous les polluants des eaux douces et de l’atmosphère. Les communautés marines sont gravement perturbées et la vie aurait diminué de 30 à 50 % jusqu’à une profondeur d’au moins 500 m (commandant Cousteau). L’homme risque ainsi de se priver de ressources essentielles et de compromettre quelques-uns des mécanismes fondamentaux de la biosphère dont dépend le maintien de la vie sur la terre.
Il serait trop long d’établir la liste des polluants que l’on retrouve dans la mer. Parmi eux figurent tous ceux qui sont charriés par les fleuves, même les sels de métaux lourds (la teneur en plomb des eaux a augmenté de 5 fois depuis 50 ans en Méditerranée, mer particulièrement fragile comme tous les bassins fermés ; l’affaire des « boues rouges » au large de la Corse en 1972 l’illustre tragiquement). Ces sels se concentrent le long des chaînes alimentaires marines. Aux États-Unis, 23 % des conserves de Thon analysées contenaient un taux de mercure supérieur à la limite admise. Des millions de boîtes ont dû être retirées du marché (le mercure agit comme un dangereux poison sur le cerveau, le foie et les reins).
Une pollution presque spécifiquement marine est celle que provoquent les hydrocarbures rejetés à la mer en quantités croissantes, parallèlement au développement de l’industrie et du transport des produits pétroliers (voir Hawkes, 1961 ; Tendron, 1962 ; Zobell, 1962). Ces substances non miscibles à l’eau flottent en surface, y formant un film d’épaisseur variable tendant vers une couche monomoléculaire. Les courants marins les emportent au loin, en particulier vers les plages. Ces pollutions sont d’autant plus graves que les hydrocarbures sont pour la plupart remarquablement stables et ne sont attaqués que très lentement par un petit nombre d’organismes microbiens. Ils sont donc assurés d’une longue durée d’existence qui en rend les effets très pernicieux.
On s’émeut de cette menace depuis une trentaine d’années déjà. Les armateurs de Grande-Bretagne, d’ailleurs suivis par ceux d’autres pays d’Europe, avaient alors volontairement décidé de ne rejeter aucun produit pétrolier à moins de 50 milles marins de leurs côtes. En 1936, les États-Unis avaient appliqué la même interdiction à une zone de 100 milles.
Ces mesures se révélèrent cependant inefficaces du fait que les courants marins ramènent vers les côtes les produits déversés loin au large et surtout en raison de l’importance grandissante du trafic pétrolier. Après la Seconde Guerre mondiale, la pollution des mers par hydrocarbures avait ainsi atteint une ampleur dont s’alarmèrent les plus hautes instances internationales (voir rapport ONU, 1956).
Les hydrocarbures répandus dans les mers proviennent avant tout des pétroliers qui transportent les huiles brutes des centres d’extraction vers les lieux de transformation et d’utilisation. On sait qu’après déchargement de leur contenu, les réservoirs sont emplis par de l’eau servant de ballast et assurant l’assiette au bateau. Les citernes renferment cependant encore des produits pétroliers relativement légers qui se mélangent à l’eau et sont rejetés à la mer à chacune des rotations du navire lors de la purge des réservoirs.
Par ailleurs les soutes à mazout et les citernes des pétroliers contiennent toujours une masse pâteuse de produits lourds qui se sédimentent et ne peuvent être ni utilisés par les moteurs ni vidés lors du déchargement de la cargaison. Ce résidu en partie solide qui encombre les réservoirs et obstrue les canalisations ne peut être expulsé qu’après traitement à la vapeur ou à l’eau chaude sous pression qui liquéfie le dépôt, émulsionne les huiles et les entraîne ensuite.
À ces causes de pollution – dont les navires pétroliers sont donc les principaux responsables – il faut ajouter les eaux de fuites diverses et se chargeant de graisses, d’huiles et de mazout, avant d’être rejetées à la mer. Dans les temps récents l’exploitation du pétrole sur le plateau continental par forage sous-marin a considérablement accru les risques de pollutions (15 % du pétrole est actuellement extrait des fonds marins). Les fuites se produisent au niveau des puits et entraînent le déversement de volumes considérables de produits pétroliers au moindre accident. Le plus spectaculaire arriva au large de Santa Barbara, Californie, en 1969, et entraîna une véritable « marée noire » le long des côtes de cette partie de l’Amérique du Nord. De telles catastrophes risquent de se multiplier du fait de l’ampleur que prend l’exploitation du pétrole en mer, et l’on ne peut manquer d’être inquiet de ce qui se passerait en Méditerranée si l’on donnait suite aux projets de forages à 2 000 m de profondeur (voir M. Roubault, Courrier de la nature, no 25, 1973).
On ne peut à première vue imaginer l’ampleur des pollutions des mers par les hydrocarbures et le volume des produits rejetés. Au courant de 1966, 1 160 millions de tonnes de produits pétroliers ont été transportés à travers le monde. En supposant que seul 1 ‰143 de ces produits forme des déchets rejetés à la mer, on arrive donc à la quantité phénoménale d’un million de tonnes d’hydrocarbures répandus à la surface des océans, principalement dans les zones les plus fréquentées, le long des côtes américaines et européennes. Ces valeurs, simple ordre de grandeur, sont néanmoins parfaitement vraisemblables quand on se rappelle qu’un grand pétrolier moderne expulse, en purgeant ses citernes, de 3 000 à 5 000 t d’eau chargée de 100 à 200 t d’hydrocarbures. Il suffit de multiplier ces chiffres par le nombre de pétroliers circulant à travers le monde et la fréquence des rotations annuelles pour en être convaincu. Les effets de ces pollutions sont considérables, en raison de la stabilité chimique de ces déchets que les courants et les marées emportent au loin.
Parmi les zones marines les plus gravement polluées se rangent la Méditerranée, empruntée par tous les pétroliers venus du Proche-Orient, l’Atlantique oriental (par exemple les côtes bretonnes exposées aux vents du N.O.), la Manche et la mer du Nord. Il semble que les mers froides aient atteint un degré de pollution nettement plus alarmant que les mers chaudes (probablement en rapport avec le rayonnement solaire et les conditions d’émulsionnement) et que les mers peu profondes soient plus polluées que les autres, les hydrocarbures s’y « diluant » apparemment avec moins de facilité.
Les premiers à pâtir sont les oiseaux. Lorsqu’ils se posent à la surface ou traversent le film superficiel de pollution, leurs plumes se chargent de produits pétroliers qui les souillent d’une manière indélébile. Le plumage perd ainsi ses propriétés calorifuges et hydrofuges (par modification des phénomènes de tension superficielle). L’oiseau ne tarde pas à mourir de congestion et de troubles consécutifs à la mauvaise thermorégulation, n’étant plus isolé du milieu liquide par le matelas d’air compris entre ses plumes (Portier et Raffy, C. R. Acad. Sci., 1934). Mais il existe en plus une véritable intoxication consécutive à l’ingestion du mazout par l’oiseau qui l’absorbe en plongeant ou en tentant de nettoyer son plumage. La dissection de sujets morts des suites de mazoutage a montré de graves lésions des organes internes : foie congestionné, surrénales hypertrophiées, imperméabilisation de la muqueuse, destruction de la flore intestinale. Notons que l’action des détergents employés en vue de nettoyer les mers au moment des pollutions accidentelles est au moins aussi néfaste que celle des hydrocarbures eux-mêmes.
Il est évidemment difficile d’estimer numériquement les pertes dues aux pollutions par hydrocarbures, car la plupart des oiseaux meurent en haute mer, et seul le dénombrement des cadavres échoués sur les plages permet de juger de leur importance. On citera à ce point de vue les observations faites à Terre-Neuve (péninsule d’Avalon) où, sur une portion de la côte occidentale, 464 cadavres de Guillemots de Brünnich Uria lomvia par mille de côte ont été dénombrés en mars 1956, sans compter d’autres oiseaux appartenant à 11 espèces. Cette situation est particulièrement grave, cette partie de l’Atlantique constituant le lieu d’hivernage de nombreux oiseaux marins, et le trafic y devenant de plus en plus intense du fait des aménagements du Saint-Laurent. Cela explique également qu’une colonie de Pingouins ne comptant pas moins de 250 000 individus a été décimée en 2 ans dans ces parages. On a estimé par ailleurs que de 20 000 à 50 000 oiseaux de mer – appartenant à une cinquantaine d’espèces dont 14 espèces de Canards – sont annuellement victimes des pollutions par hydrocarbures le long des côtes néerlandaises. Ce nombre s’élève vraisemblablement à 250 000 en Grande-Bretagne (surtout Pingouins, Macreuses, Goélands et Plongeons). Il en est de même dans les autres secteurs marins d’Europe et notamment de la mer du Nord, ce qui est particulièrement regrettable, cette mer constituant les quartiers d’hiver de nombreux Canards venus de l’Arctique, et notamment de la Harelde de Miquelon Clangula hyemalis, extrêmement raréfiée à l’heure actuelle.
On ne peut manquer d’évoquer brièvement la catastrophe survenue aux oiseaux du sud de l’Angleterre et de la Bretagne lors du naufrage du Torrey Canyon, le 18 mars 1967 (voir J. E. Smith (dir.), « Torrey Canyon » Pollution and Marine Life, Cambridge, 1968). Quelque 50 000 t de pétrole brut se répandirent sur la mer ; emporté par les courants, celui-ci atteignit les côtes britanniques et françaises en une « marée noire » tristement célèbre. À l’action des hydrocarbures vint se joindre celle des détergents employés pour émulsionner les graisses et nettoyer les plages. Les oiseaux pâtirent dans une proportion considérable, et en particulier ceux de la réserve des Sept-Îles au large des Côtes d’Armor : le 10 avril 1967 vit la ruine des efforts de ceux qui depuis 60 ans avaient permis à des colonies prospères de se constituer. Les Macareux eurent leurs effectifs réduits de 5 000 à 600, les Pingouins de 700 à 100, de même que les Guillemots. Cette catastrophe est d’autant plus regrettable que beaucoup d’espèces d’Alcidés manifestaient déjà depuis plusieurs années une diminution continue de leurs effectifs.
Le désastre biologique entraîné par le naufrage du Torrey Canyon est certes un accident, une « maladie aiguë » des mers, aux conséquences spectaculaires. Mais bien plus grave est la « maladie chronique » des mers due au rejet régulier des hydrocarbures. Car on déverse délibérément chaque année le contenu de 50 Torrey Canyon à la surface des océans.
Mais les oiseaux ne sont pas les seuls à pâtir des hydrocarbures et de leur action physique (ils modifient localement la tension superficielle dont le rôle est si grand dans la vie des animaux planctoniques) et chimique (certains de leurs composants se comportent comme de véritables poisons à l’égard des Invertébrés marins, notamment des Crustacés, et même des Poissons). Les plages souillées de mazout deviennent azoïques ; Annélides, Crustacés et Mollusques meurent en même temps que les micro-organismes intercotidaux (voir notamment O’Sullivan et Richardson, Nature, 214, 5 087, 1967). Des pertes sérieuses ont été signalées sur des lieux de pêche renommés144. Ceci s’applique particulièrement aux poissons microphages (par exemple les Mulets, qui se nourrissent de proies de petite taille et de débris organiques, chargés d’hydrocarbures). Le frai, surtout les œufs flottant en surface, est également touché.
Un danger très sérieux menace l’homme dans le cas des coquillages comestibles, qui se chargent de certains composants cancérigènes des produits pétroliers. On a notamment trouvé du benzopyrène chez des Coques, des Huîtres, des Moules et des Couteaux (Solen). Ce danger ne doit pas être minimisé, bien que l’on ignore comment se métabolisent ces corps éminemment cancérigènes. Il n’est pas impossible qu’il y ait, comme dans le cas des insecticides, une sorte de concentration le long des chaînes alimentaires, l’homme risquant d’en devenir l’ultime victime. Les boues contiennent des proportions notables de certains corps provenant des hydrocarbures rejetés à la mer (Vasserot, 1962 ; Mallet, Tendron et Plessis, 1960) d’où ces substances passeraient dans le corps des microphages, d’abord les Mollusques consommés par l’homme.
Les déchets pétroliers, poussés par les vents et les courants, viennent par ailleurs s’échouer sur les plages et s’accumulent dans la zone intercotidale en longues traînées ou en concrétions roulées par les flots. Ces amas ont une influence profonde sur les organismes littoraux, et constituent également une gêne sérieuse pour tous les usagers des plages. Il est devenu impossible de fréquenter les rivages d’Europe occidentale et de Méditerranée, pour ne citer que ceux-ci, sans en revenir maculé. D’innombrables plaintes émanent des touristes et de tous ceux qui vivent directement ou indirectement de l’exploitation balnéaire.
Ces diverses menaces vont s’aggraver dans le proche avenir. Seulement pour l’Europe, on prévoit que la consommation de produits pétroliers n’atteignant que 134 millions de tonnes en 1957, a passé au minimum à 340 millions en 1975, doublant donc les dangers de pollution des mers par hydrocarbures. Cette situation avait provoqué dès 1926 la convocation à Washington d’une conférence réunie à l’instigation des États-Unis (conférence préliminaire sur la pollution des eaux navigables par le pétrole), puis en 1935 d’une autre à celle de la Société des Nations. Ce n’est cependant qu’en 1953 qu’une nouvelle conférence fut tenue à Londres sous l’égide de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OICNM, la 12e institution spécialisée des Nations unies chargée des problèmes de navigation commerciale internationale). Cette réunion aboutit en 1954 à la signature d’une convention qui définissait un certain nombre de zones à l’intérieur desquelles il était interdit aux bateaux de purger ou de vidanger ballasts ou citernes, les déchets devant être soit rejetés en dehors des périmètres définis, soit éliminés dans les ports en utilisant des séparateurs.
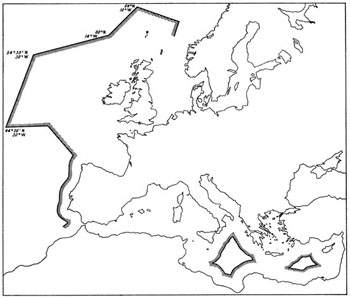
Fig. 40. Carte des zones d’interdiction de déversement de produits pétroliers au large de côtes d’Europe occidentale et en Méditerranée. D’après les documents de la conférence int. Pollution des eaux de mer par hydrocarbures, 1962.
Dix-neuf nations ratifièrent cette convention145 en dehors de laquelle demeurèrent néanmoins plusieurs nations sous le pavillon desquelles navigue une importante flotte pétrolière. Les effets ne furent cependant pas pleinement satisfaisants, car le jeu des courants fausse les données du problème en ramenant vers les côtes les produits rejetés au large. Et la pollution des mers continuait ses ravages…
En mars-avril 1962 se réunissait en conséquence à Londres une nouvelle conférence à laquelle participaient 55 nations. Cette conférence aboutit à l’adoption d’un certain nombre d’amendements qui complètent le texte de 1954 et constituent en fait une nouvelle convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de mer par les hydrocarbures, applicable à tous les bâtiments d’un tonnage supérieur à 150 t (à l’exception des navires de guerre). L’interdiction de tout rejet à la mer de produits pétroliers est admise en principe par les nations contractantes, bien qu’encore impossible à appliquer à l’heure actuelle (sauf pour les navires d’une jauge brute supérieure à 20 000 tonneaux déjà soumis à cette réglementation). La mesure pratique la plus importante est d’étendre considérablement les périmètres d’interdiction, particulièrement dans les eaux pacifiques du Canada, le nord-ouest de l’Atlantique, les mers bordant l’Islande et la totalité de la mer du Nord et de la Baltique (fig. 40). De nouvelles zones interdites sont créées dans la Méditerranée, la mer Rouge et le golfe Persique, de même qu’autour de l’Inde et de Madagascar, en prévision de l’utilisation de nouvelles routes maritimes quand le tonnage des pétroliers aura dépassé la capacité du canal de Suez.
Cette nouvelle convention entrera en vigueur lorsque les deux tiers des gouvernements qui ont ratifié la première convention auront également ratifié la deuxième. Mais il est à souhaiter que les mesures prévues soient appliquées au plus vite au moment où l’homme lui-même risque d’être la victime de ces pollutions dangereuses.
Les navires n’auront donc plus le droit de déverser des produits pétroliers dans de vastes zones à travers les mers et devront de ce fait posséder des installations à bord ou profiter de celles qui existent dans les ports où ils chargent ou déchargent leurs cargaisons. Ces appareils qualifiés de séparateurs ont pour but de séparer les hydrocarbures en suspension dans l’eau qui a servi au nettoyage des citernes, de les conduire dans des cuves spéciales d’où ils seront vidangés à terre et de rejeter à la mer des eaux ne contenant plus que des traces de produits pétroliers.
Il est indispensable que les armateurs puissent se débarrasser des déchets pétroliers à bon compte et sans délai, car pour être rentable la rotation des bateaux, et spécialement des pétroliers, doit être rapide, et comporter le minimum de temps mort. Aussi les installations permettant ces opérations doivent être bien placées dans les circuits empruntés par le fret pétrolier et en état de fonctionner rapidement.
La nouvelle convention représente donc un progrès très sensible, à condition qu’elle soit appliquée après avoir été ratifiée par toutes les nations armant des flottes importantes, surtout des flottes pétrolières. Aux yeux des ornithologues, elle a le grand mérite de protéger efficacement les plateaux continentaux qui bordent les terres et les mers intérieures (mer du Nord, Baltique, Méditerranée) où se tient la majeure partie des oiseaux (sauf bien entendu les plus pélagiques d’entre eux, tels les Procellariiformes).
Mais il faut cependant reconnaître qu’elle doit être considérée comme menant à une interdiction totale du rejet de produits pétroliers à la mer. En consultant par exemple les cartes des zones interdites, on constate que la partie de l’Atlantique comprise entre le continent européen et les Açores est largement ouverte au déversement de produits pétroliers. En raison de la direction des courants marins, tous les déchets s’amasseront aux approches de ces îles et la pollution peut y avoir de graves conséquences.
La seule solution pleinement satisfaisante est sans conteste une interdiction totale du rejet de tout produit pétrolier à la mer. La convention de Londres représente une première étape importante, car elle a permis une prise de conscience du public et des divers spécialistes ; elle a été l’occasion d’une libre discussion entre armateurs et compagnies pétrolières d’une part, biologistes, experts en tourisme, administrateurs et politiciens d’autre part. Elle a montré qu’une entente est possible en dépit des difficultés de droit international rencontrées chaque fois qu’il s’agit de la haute mer.
Cela permet d’espérer que les océans cesseront un jour, peut-être proche, d’être considérés comme les champs d’épandage de produits dont la toxicité et la malfaisance ne font plus de doute pour personne.
3. Pollutions de l’atmosphère
La terre et l’eau n’ont pas été les seuls éléments empoisonnés par l’homme, et l’air n’a pas échappé aux pollutions. Les industries rejettent en effet dans l’atmosphère une quantité insoupçonnée de gaz et de déchets solides sous forme de fines particules, capables de rester en suspension et de passer dans les voies respiratoires de l’homme et des animaux, ou de se déposer après avoir été emportées parfois à des distances considérables.
Comme dans le cas de la pollution des eaux douces, le problème est ancien. Une ordonnance du XVIIe siècle interdisait d’allumer des feux pendant la session du Parlement, et pourtant il n’y avait pas encore d’industrie à Londres. Evelyn, dans un opuscule intitulé Fumifugium (cité par Landsberg, 1956), écrit déjà en 1661 en parlant de Londres : « alors que l’air est pur et serein dans tous autres lieux, il est ici éclipsé par un tel nuage de soufre, que le soleil lui-même, qui éclaire partout ailleurs, est à peine capable de le pénétrer et de le disperser ; et à des milles de distance le voyageur fatigué sent, bien avant de la voir, la Cité vers laquelle il se dirige. » Que dirait le même voyageur en arrivant maintenant dans une de nos grandes métropoles !
Ce problème a pris à l’heure actuelle de telles proportions que même l’opinion publique a été alarmée par cette question d’un grand intérêt pour la santé de l’homme, ainsi que pour la nature tout entière146.
Cette forme de pollution entraîne une modification plus ou moins profonde de l’atmosphère. Les villes sont couvertes d’une véritable calotte grise, flottant jusqu’à des altitudes variant entre 1 500 et 2 500 m, provenant des poussières mises en suspension dans l’air ; elles vivent ainsi « accroupies sous un couvercle de fumées grasses et pestilentielles »147. Cette couche absorbe une partie appréciable du rayonnement solaire, entraînant un déficit notable de l’insolation, qui d’après certains auteurs peut atteindre 20 % en été et 50 % en hiver. Des mesures faites à Vienne entre le niveau du sol et les tours de la cathédrale, à 70 m, montrent que cette simple couche d’air intercepte à elle seule 5,7 % des radiations. La composition spectrale de la lumière se trouve modifiée, les ultra-violets étant en particulier filtrés dans une proportion notable : d’après Maurain (in Landsberg, 1956), les rayons ultraviolets ne comptent plus que pour 0,3 % de l’énergie du rayonnement solaire à Paris, alors que cette proportion est de 3 % aux environs de la ville. Simultanément le nombre de jours pendant lesquels la visibilité est de 6 km dans le centre de Paris a passé de 95 par an pendant la décennie 1901-1910 à 60 au cours des années 1921-1930.
La pollution de l’atmosphère est produite à la fois par des gaz et par des solides en suspension. Les premiers proviennent avant tout de la combustion des multiples foyers domestiques et industriels. Les plus importants sont le gaz carbonique, polluant d’un type très particulier sur lequel nous reviendrons (voir p. 296), et l’oxyde de carbone, oxydé en partie seulement ensuite, véritable poison pour les animaux. L’influence de ce gaz peut être importante sur l’homme dans les villes, vu les quantités produites. Les véhicules circulant dans Paris répandent 50 millions de m3 cubes d’oxyde de carbone. Mille automobiles produisent par jour 3,2 t d’oxyde de carbone, de 400 à 800 livres de vapeurs d’hydrocarbures incomplètement brûlées et de 100 à 300 livres de dérivés nitrés148. Or, en 1967, il existait 204 120 000 véhicules dans le monde, contre 83 140 000 en 1953 ; leur nombre passa de 2 020 000 en 1953 à 11 500 000 en 1967 rien qu’en France (Nations unies, Annuaire statistique, 1968). L’oxyde de carbone devient dangereux quand il atteint une concentration de 10 pour 1 million, un taux atteint fréquemment dans les grandes villes, par exemple pendant un tiers et même la moitié de la journée à Chicago et Philadelphie. À Los Angeles, ce taux est atteint pendant 40 % de la journée du fait de la production de quelque 10 millions de kilos d’oxyde de carbone par les véhicules, ce qui suffit à diminuer de 20 % les facultés d’oxygénation du sang de nombreux habitants particulièrement exposés.
Les produits d’oxydation du carbone ne sont bien entendu pas les seuls, car la combustion plus ou moins incomplète des impuretés des combustibles utilisés en produit beaucoup d’autres, principalement de l’ammoniaque et une série de dérivés chlorés, fluorés, nitrés et soufrés. Si ces derniers ont une grande importance dans les produits rejetés par les foyers domestiques, ils sont encore bien plus importants dans ceux des foyers industriels. On a calculé qu’une seule grande centrale thermique rejette journellement 500 t de substances soufrées, principalement sous forme d’anhydride sulfureux qui s’oxyde et se transforme en acide sulfurique, aux propriétés corrosives bien connues.
À côté de ces produits gazeux, les foyers déversent en grande abondance des produits solides restant un temps plus ou moins long en suspension dans l’air, certains formant de véritables aérosols. La densité des noyaux de condensation, ayant un diamètre de 0,01 à 0,1 µ, est de 5 à 10 fois plus importante en ville qu’à la campagne et la proportion des poussières (d’un diamètre de 0,5 à 10 µ) varie dans le même sens. Des concentrations de 25 à 30 particules par cm3 dans l’air des villes ont été signalées, alors qu’on n’en comptait pas plus de une ou deux dans les campagnes limitrophes. On estime qu’une grande centrale thermique répand journellement 50 t de poussières, qui saturent l’atmosphère et vont ensuite se déposer dans un rayon de l’ordre de 5 km, parfois bien plus loin. Un grand nombre de corps chimiques allant des sels minéraux à la silice et aux dérivés soufrés, certains franchement toxiques, se retrouvent sous cette forme. La complexité de ces suspensions mêlées aux gaz naturels est encore accrue par les diverses réactions chimiques ayant leur siège dans l’atmosphère sous l’action de l’oxygène, de l’ozone et des radiations solaires.
La quantité globale de poussières répandues par les grandes agglomérations est en fait très importante. Des mesures faites aux États-Unis, à Pittsburgh, Pennsylvanie, qui a longtemps passé pour la ville la plus polluée du monde, ont permis de calculer qu’en moyenne 235 t de poussières se déposent chaque année sur 1 km2 149. Ce dépôt est de 276 t/km2/an en Lorraine, de 345 t en Sarre, de 372 t dans la Ruhr et de 390 t à Osaka, Japon. Ces quelques chiffres traduisent l’ampleur de la pollution de l’atmosphère par produits solides, dont le dépôt a presque l’importance d’un phénomène géologique150.
De telles situations ont des conséquences graves sur la santé de l’homme. Indépendamment de l’action indirecte par l’intermédiaire des modifications du climat des villes et d’une sensible diminution de l’insolation (les polluants en suspension dans l’atmosphère provoquent des nuages artificiels en déterminant la condensation de la vapeur d’eau), les produits déversés dans l’atmosphère – en particulier les dérivés soufrés, les divers aldéhydes et les suies – occasionnent des irritations graves des voies respiratoires.
On ne peut pas toujours incriminer directement les pollutions de la mort des citadins ; mais elles viennent conjuguer leurs effets à ceux d’autres maux, et « achèvent » en quelque sorte des patients souffrant par ailleurs de déficiences physiologiques. Elles tuent les sujets se trouvant dans un état de moindre résistance, les plus atteints étant ceux qui témoignent d’une sensibilité particulière au niveau des voies respiratoires151 ou de l’appareil circulatoire. On remarquera également que la grande quantité d’oxyde de carbone déversée dans les atmosphères urbaines est peu favorable aux citadins, pouvant déterminer des anémies qui les sensibilisent à d’autres atteintes.
Les produits déversés dans l’atmosphère comprennent enfin un certain nombre de substances connues pour leurs propriétés cancérigènes, notamment des carbures polycycliques (le benzopyrène par exemple a été mis en évidence dans l’atmosphère des villes à des concentrations jusqu’à 100 fois plus fortes qu’à la campagne). Il est à peu près prouvé que certains cancers, et notamment des cancers pulmonaires, sont dus à l’inhalation de ces produits, qui sont éminemment favorisants même s’ils ne sont pas déterminants.
L’action des pollutions sur l’homme est particulièrement pernicieuse quand, par suite de circonstances météorologiques, l’air stagne au-dessus des villes152. Il se produit un mélange intime de brouillard et de particules solides en suspension, phénomène qualifié de smog153, qui a fait la triste réputation de beaucoup de villes fortement industrialisées. À Londres, célèbre à ce point de vue en raison d’un concours de circonstances climatiques et des multiples industries établies dans cette ville gigantesque, une « crise » d’une gravité exceptionnelle et devenue classique fut observée du 5 au 8 décembre 1952. D’après les mesures faites à cette époque, la teneur de l’air en anhydride sulfureux passa brusquement de 0,07-0,23 à 1,34 partie pour un million, ce taux pouvant même être localement bien supérieur. La teneur en matières solides en suspension passait simultanément à 4,46 mg par m3, soit de 3 à 10 fois la teneur normale. On estima alors à 4 000 le nombre de décès imputables au smog dans l’agglomération londonienne, le nombre de personnes atteintes étant par ailleurs très élevé (les admissions dans les hôpitaux londoniens furent 4 fois plus nombreuses en ce qui concerne les maladies affectant les voies respiratoires et l’appareil circulatoire). Des accidents de ce genre se renouvellent fréquemment à Londres comme dans diverses régions d’Angleterre. On a estimé que les pollutions atmosphériques coûtaient 700 millions de dollars par an au pays. En Belgique, dans la vallée de la Meuse, du 1er au 5 décembre 1930 un smog persistant entraîna de nombreuses affections cardio-vasculaires et respiratoires et une mortalité 10 fois supérieure à la normale (une soixantaine de morts dans un district d’une vingtaine de kilomètres le long de la rivière).
Dans le Nouveau Monde, si une longue série de villes est sujette au smog, l’exemple de l’« accident » de Donora, près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, est resté tristement célèbre. En octobre 1948, un smog très dense s’abattit sur cette ville de quelque 12 000 habitants et occasionna des troubles cardiaques et respiratoires chez environ 42 % des habitants (10 % de cas sérieux). On déplora une vingtaine de décès dont la pollution atmosphérique est directement responsable.
En août 1967, le U.S. Public Health Service a publié une liste de 65 villes atteintes gravement par ces maux. Les trois premières sont, dans l’ordre, New York, Chicago et Philadelphie ; 7 300 centres urbains ont à faire face à des problèmes de ce genre. La cité qui dans le passé avait le plus souffert est Los Angeles. Des inversions thermiques fréquentes dans cette zone, jointes à un rayonnement solaire intense, activant les réactions, y produisent une stagnation de l’air au niveau du sol. La pollution atmosphérique y était tristement célèbre, de même que les accidents de santé des habitants. Une vigoureuse campagne eut raison de ces pollutions, ce qui prouve que l’homme peut les éliminer quand il en a la volonté.
Tous ces cas attestent le degré atteint par la pollution atmosphérique au-dessus des villes et particulièrement des centres industriels. La santé de l’homme en est gravement atteinte et on ne fait encore que mesurer d’une manière très imparfaite les conséquences de l’empoisonnement de l’atmosphère sur l’hygiène publique. Rappelons que dans les villes les bâtiments eux-mêmes sont affectés par les substances répandues dans l’air, qui viennent les souiller, voire les attaquer (en particulier les acides). On a pu dire à ce sujet que l’obélisque de Louxor, qui orne la place de la Concorde à Paris, a été plus usé depuis qu’il a été érigé à son emplacement actuel en 1836 que dans son site primitif depuis Ramsès II. Et pendant ce temps, les Parisiens ont respiré l’air qui attaquait la pierre.
Si les hommes pâtissent des pollutions atmosphériques, la nature subit elle aussi de graves atteintes. Les communautés sauvages souffrent dans leur ensemble d’être recouvertes d’un dépôt de produits corrosifs, affectant principalement les végétaux. Des travaux récents ont montré que, plongés dans l’air pollué, les jeunes plants présentent des malformations structurales et la différenciation de couches superficielles anormales, notamment de liège ; puis au cours de stades ultérieurs, les tissus sont profondément modifiés, principalement au niveau de l’appareil chlorophyllien. Les tissus présentent rapidement des nécroses, se traduisant par un brunissement des organes végétatifs, entraînant souvent la mort. Des cas fréquents ont été signalés aux États-Unis, concernant aussi bien les plantes herbacées que les Conifères. Un exemple particulièrement démonstratif se rencontre dans les Alpes françaises, dont plusieurs vallées ont été défigurées par l’industrie. En Maurienne, dans l’étroit couloir que forme la vallée entre Modane et Aiguebelle, où sont implantés des complexes métallurgiques produisant de l’aluminium, une pollution fluorée154 très grave est responsable de la dégénérescence d’une partie des forêts de Conifères. Le fluor produit une nécrose des aiguilles, qui brunissent, puis tombent, entraînant la mort des arbres ou du moins un ralentissement de la croissance et une réduction de la fructification. Sur 700 ha ayant fait l’objet d’investigations, les forestiers ont rencontré 16 565 arbres morts. Les Pins sylvestres sont particulièrement sensibles (jusqu’à 80 % d’entre eux sont détruits), de même que les Épicéas, alors que les Sapins et les Mélèzes paraissent plus résistants.
Des cas semblables ont été signalés dans bien d’autres régions fortement industrialisées, notamment aux États-Unis, où les gaz de fonderie sont responsables de la destruction de forêts sur de vastes espaces.
Ces menaces planant sur les habitats naturels ne sont pas à minimiser à l’heure actuelle. Des milliers de tonnes de substances diverses, dont les effets se combinent de la manière la plus détestable, se déversent sur les champs155, les forêts et les étendues demeurées sauvages, contribuant à les « empoisonner » au sens littéral du terme. La situation est d’autant plus grave que pour lutter contre le gigantisme des grandes agglomérations, beaucoup d’États, notamment en Europe occidentale, appliquent actuellement une politique de décentralisation et par des mesures économiques provoquent un véritable éclatement des centres industriels en encourageant l’implantation d’usines dans des zones jusqu’alors demeurées rurales. Ces mesures, aussi bénéfiques soient-elles au point de vue social, risquent d’étendre le mal en créant et en multipliant les foyers de pollutions à travers tout le pays. C’est ce qui se passe en France, entre autres en Normandie dont diverses vallées (avant tout la basse vallée de la Seine) voient se développer des industries ayant fui la capitale surpeuplée.
Certes l’étendue du péril a provoqué une réaction de la part de l’opinion publique. Les autorités officielles, à l’instigation des services sanitaires et de nombreux groupements de particuliers, ont commencé à prendre des mesures pour contrôler, sinon supprimer, les pollutions atmosphériques. Les moyens de prévention et de lutte consistent avant tout en un bon conditionnement des appareils de combustion, aussi bien domestiques qu’industriels ; en l’installation d’appareils de récupération des substances nocives (avant tout des hydrocarbures incomplètement brûlés et des produits soufrés) ; et en un dépoussiérage massif des fumées et autres déchets que l’on rejette à l’état brut dans l’atmosphère.
Nous disposons des moyens techniques pour diminuer les pollutions atmosphériques, comme en témoignent les résultats satisfaisants obtenus dans certains pays. En Grande-Bretagne, les mesures prises à la suite du Clean Air Act de 1956 ont produit leurs effets. À Londres, 80 % des 156 000 t de poussières projetées annuellement dans l’atmosphère ont été éliminés et l’on estime qu’en hiver la ville reçoit 50 % de rayons solaires en plus. Ces mesures coûtent bien entendu cher, mais c’est le prix que nous devons payer pour bénéficier de la civilisation industrielle.
Il en est de même de la pollution due aux automobiles. Divers procédés sont actuellement en cours d’étude ou de réalisation, notamment aux États-Unis où des lois très strictes vont être mises en application au cours des prochaines années. On parle même d’une interdiction du classique moteur à explosion et de l’emploi d’essence contenant du plomb. On ne peut qu’insister sur les effets déplorables d’une politique des transports favorisant l’automobile, ce qui est de plus ridicule en pleine crise du pétrole. À côté du bruit et de l’emprise au sol exagérée des routes et garages, ce véhicule est source de pollutions variées et graves, notamment dans les villes. L’abus de l’automobile est un problème politique auquel il convient de trouver sans tarder une solution.
Une autre série de mesures de la plus haute importance consiste en l’aménagement dans toutes les zones urbaines d’espaces verts aussi vastes que possible. Des arbres et des plantes judicieusement choisis y protègent les citadins contre la pollution de l’air que ceux-ci respirent. Les feuillages, capables de retenir les particules en suspension dans l’air, sont également en état de « régénérer » à proprement parler l’atmosphère. Tous les plans d’urbanisation et d’aménagement des zones résidentielles doivent donc comporter des espaces réservés à la végétation ; si ceux-ci sont destinés à la « récréation » des citadins, à leur bien-être moral, ils sont également indispensables sur le plan strictement matériel pour garder un peu d’air pur au sein des villes.
Mais la pollution de l’atmosphère n’intéresse pas seulement l’hygiéniste, car l’empoisonnement de l’air a de graves répercussions sur l’équilibre naturel en viciant le milieu aérien et en déversant dans les habitats des quantités considérables de substances toxiques. À ce titre ce problème intéresse tout autant le conservateur de la nature qui doit liguer ses efforts avec le médecin pour que cesse ce fléau des temps modernes.
Le milieu gazeux n’a pas pour fonction de servir de lieu de décharge pour des déchets que l’homme a le moyen technique d’éliminer.
4. Perturbations de l’équilibre de l’atmosphère
Certaines formes de pollutions peuvent avoir des conséquences à l’échelle de la planète tout entière et menacer l’équilibre de l’ensemble de la biosphère. C’est le cas de la production de gaz carbonique (CO2) provenant de l’utilisation de combustibles fossiles, charbons, pétroles et gaz naturels. Le carbone stocké dans ces produits et mis hors circuit au cours des périodes géologiques antérieures a été libéré sous forme de CO2 dont la teneur augmente dans l’atmosphère depuis le début de l’ère industrielle. Il ne faut pas oublier qu’une automobile consomme en parcourant 1 000 km autant qu’un homme en un an. Un avion quadriréacteur allant de Paris à New York brûle autant d’oxygène que n’en produit un hectare de forêt de feuillus en un an. Le taux, normalement de 0,03 %, se serait accru d’environ 15 % depuis le début de ce siècle, comme en témoignent notamment les mesures faites au cours des dernières Années géophysiques internationales. Cette tendance va encore s’accentuer au cours des prochaines décennies. Ce phénomène de proportions « géologiques » peut avoir des effets très profonds sur l’équilibre global de la biosphère, d’une importance telle qu’on se propose de l’étudier à l’aide de satellites.
Jusqu’en des temps récents, la production et la consommation de CO2 s’équilibraient. Bien qu’une partie de ce gaz se dissolve dans l’eau et s’y précipite sous forme de carbonate de calcium, il est surtout utilisé par les végétaux chlorophylliens pour lesquels il est la seule source de carbone. Ces végétaux fixent ce corps, étant ainsi à l’origine de toute matière organique, et libèrent de l’oxygène. La synthèse chlorophyllienne est à la fois le maillon essentiel du cycle du carbone et le seul producteur de l’oxygène essentiel à la vie sur terre. Il s’est ainsi établi un équilibre stable au cours de l’évolution, favorisant le fonctionnement de la biosphère tout entière156.
Malheureusement, en même temps que la production de CO2 augmentait du fait des combustions provoquées par l’homme, la production d’oxygène diminuait consécutivement à la réduction de la végétation à travers le monde. Les forêts ont régressé, tout comme beaucoup d’autres associations végétales.
Actuellement les Diatomées et les Algues microscopiques du plancton marin produisent 70 % de l’oxygène qui passe dans l’atmosphère (elles sont ainsi à l’origine des chaînes alimentaires si prospères des biocénoses marines). Ces organismes sont particulièrement sensibles aux effets de certaines pollutions très répandues en mer. Les hydrocarbures pétroliers leur sont néfastes, de même que les insecticides ; or on sait l’étendue des pollutions par ces substances, notamment le DDT dont on a retrouvé des traces jusque dans les mers antarctiques. Il en est de même des herbicides qui se déversent en provenance des terres et auxquels le phytoplancton est très sensible (on a pu dire que si le Torrey Canyon avait été chargé d’herbicides au lieu de pétrole, son naufrage aurait pu entraîner la destruction de tout le phytoplancton des mers du nord-ouest de l’Europe).
Nous courons donc le risque de perturber gravement un système fondamental de la biosphère. Les combustions « artificielles » jointes aux effets de la destruction de la végétation naturelle et des pollutions stérilisatrices déplacent un équilibre dont dépend le maintien de conditions optimales pour la vie.
L’augmentation du taux du CO2 peut également entraîner un réchauffement notable de l’atmosphère terrestre. Un milieu gazeux plus riche en CO2 laisse plus facilement passer les radiations de courte longueur d’onde, venues du soleil, aux effets calorifiques, et en revanche, peut retenir les radiations thermiques d’origine terrestre, comme nous l’apprennent les géophysiciens. Cet effet vient s’ajouter à celui des diverses formes de pollution thermique due aux diverses activités humaines, et la terre risque de se réchauffer sensiblement. Cela pourrait provoquer la fonte des glaces polaires et une élévation du niveau des mers entraînant la submersion d’une partie des terres émergées, y compris les grandes villes qui y sont établies. Par ailleurs le réchauffement des mers perturberait la fixation du CO2, d’où accélération du phénomène, et stériliserait des communautés marines essentielles au fonctionnement de la biosphère et à l’approvisionnement en aliments d’une partie de l’humanité.
Il ne semble toutefois pas y avoir de danger immédiat, certaines mesures récentes ayant montré que le taux de l’oxygène n’a pas changé d’une manière significative par rapport à des mesures dignes de foi effectuées depuis 1910 (Broecker ; Matcha et Hughes, Science, 168, 1970).
Les diverses pollutions dont l’homme est responsable sont également susceptibles de provoquer des perturbations profondes des conditions climatiques157. Les modifications du climat, maintenant bien connues dans les villes, peuvent affecter de bien plus vastes surfaces. En surchargeant l’atmosphère de poussières, l’homme modifie fondamentalement la composition du rayonnement incident, les échanges thermiques et les courants aériens. C’est notamment ce qui a été avancé pour expliquer la désertification du nord-ouest de l’Inde et du Pakistan occidental (Bryson et Baerreis, 1967). L’atmosphère y est chargée d’une telle quantité de poussière que le sol n’est plus visible d’une altitude de 3 000 m. On y a mesuré jusqu’à 800 μg/m3 de particules solides, alors que leur teneur ne dépasse pas 200 μg au-dessus de Chicago, où l’air ne passe cependant pas pour limpide. Le désert du Rajputana, qui est probablement le désert le plus poussiéreux du monde, est cependant surmonté d’une atmosphère d’une humidité comparable à celle que l’on trouve au-dessus de la forêt tropicale humide. Et pourtant les précipitations y sont extrêmement faibles. En fait ce désert devrait être couvert de savanes. Mais le couvert végétal a été détruit par le surpâturage, surtout par les chèvres, et par de mauvaises pratiques culturales, qui ont déclenché une érosion éolienne et une charge de l’air en poussières. Ces conditions atmosphériques ont entraîné une diminution des condensations, donc une nouvelle désertification et une érosion encore accélérée par suite d’un surpâturage accru. La teneur de l’air en poussières a augmenté à nouveau de ce fait, et le cycle infernal recommence. La civilisation de l’Indus, jadis si florissante, comme l’attestent les puissantes cités enfouies sous les sables, ne pourrait plus s’épanouir de nos jours. L’homme est ainsi responsable de la désertification de ces régions encore densément peuplées, avec son cortège de problèmes économiques et sociaux. Un processus analogue aurait bien pu avoir lieu sur les pourtours du Sahara, accentuant une tendance naturelle à l’assèchement dans une zone d’équilibre instable.
On ne saurait également passer sous silence la grave menace que fait peser la multiplication des avions à vitesse supersonique volant à haute altitude. Leur passage détruit la couche d’ozone qui filtre les radiations nocives du soleil, couche à l’existence de laquelle on doit sans doute l’apparition et le maintien de la vie sur la terre. Il y a une bonne probabilité de voir cette couche protectrice détruite par une flotte d’environ 500 avions supersoniques en exploitation commerciale normale. On ne peut encore avancer de chiffres, mais le danger de voir la surface de la terre en partie stérilisée est réel, même s’il n’est pas une certitude.
Ces diverses perturbations revêtent donc une échelle planétaire. Elles n’appartiennent malheureusement pas au domaine de la « science-fiction », mais reposent sur des observations déjà substantielles. Leurs conséquences pourraient être tragiques et signifier la fin de la vie sur la planète. Nous n’avons aucune certitude scientifique à leur sujet ; mais nous n’avons pas le droit de courir ce risque avant d’avoir procédé à de méticuleuses vérifications précédant la mise en œuvre de processus aussi potentiellement destructeurs.
5. Pollutions radioactives
Depuis la dernière guerre mondiale, l’homme a découvert un nouveau moyen de polluer la terre entière en y répandant les produits de fissions nucléaires artificielles. Les conséquences de cette forme de pollution dans la nature risquent d’être énormes. Même en dehors d’un conflit atomique généralisé, qui sonnerait sans aucun doute le glas de notre espèce, de multiples dangers pour l’homme et pour les êtres vivants peuvent résulter de la multiplication des substances radioactives et de la généralisation inéluctable de leur emploi pacifique.
La plupart des savants atomistes nous assurent que toutes les précautions sont prises et que la radioactivité n’a jamais dépassé le seuil critique, même si localement elle a subi une augmentation. Nous sommes bien forcés de leur faire confiance, et d’ailleurs il convient d’être objectif et de ne pas tomber dans le travers de certains « alarmistes » emportés par des passions sans grands fondements scientifiques.
Le problème nucléaire dans ses rapports avec la conservation de la nature ne sera évoqué ici que dans ses grandes lignes. Si de nombreuses études ont été consacrées à son aspect médical, peu de choses sont connues quant à l’influence de la radioactivité sur la nature sauvage158. Il faut d’ailleurs signaler que la documentation à la disposition du public, même des scientifiques, est dans l’ensemble relativement peu abondante. Beaucoup de secrets militaires ou industriels protègent certains aspects des actions des pollutions nucléaires. Les dangers atomiques sont volontairement minimisés par certains et au contraire considérablement amplifiés par d’autres. L’opinion publique mériterait sans doute d’être mieux informée et mieux rassurée qu’elle ne l’est à l’heure actuelle sur des questions au demeurant fort inquiétantes, ne serait-ce que par le mystère qui entoure tout ce qui y a trait.
Trois sources sont responsables des pollutions par produits radioactifs, qui affectent aussi bien l’air et le sol que les eaux douces et salées. La première est à chercher dans les explosions atomiques : celles qui ont lieu dans l’atmosphère entraînent des pollutions consécutives à la formation du « champignon » atomique bien connu et à la libération d’une grande quantité de gaz et de produits solides radioactifs ; leurs retombées peuvent polluer de grandes superficies après avoir été emportées par les vents159. La deuxième provient de l’utilisation des eaux dans les usines atomiques notamment pour le refroidissement des réacteurs ; elles peuvent devenir radioactives et transporter des corps dangereux après avoir été rejetées dans les rivières. La troisième provient des déchets atomiques. Les usines qui produisent, transforment ou utilisent des produits radioactifs sont encombrées d’un volume croissant de déchets dont il convient de se débarrasser dans les meilleures conditions. Les produits fortement radioactifs sont stockés dans des réservoirs spéciaux construits à grands frais, mais devenant rapidement insuffisants, parfois enterrés dans des galeries de mines désaffectées. Une autre solution adoptée par divers pays consiste à placer les déchets dans des récipients scellés, entourés de couches absorbant les radiations, et noyés dans des masses de béton, avant d’être immergés dans les fosses océaniques les plus profondes. Les « fossoyeurs atomiques » estiment que ce procédé est le mieux adapté pour se débarrasser de ces produits dangereux, car les récipients sont solides, à l’abri de toute atteinte et même si l’un d’eux était éventré pour une raison fortuite, la profondeur des abysses, comme retranchés du monde des vivants, mettrait l’homme à l’abri de toute atteinte.
Cela n’est que très partiellement vrai, comme l’a fait remarquer le professeur Fontaine dès 1956. La durée de vie du récipient est très nettement inférieure à celle de quelques-uns des corps radioactifs qu’il contient. L’iode 129 a une période de 20 millions, le césium 135 de 3 millions et le zirconium D3 de 1 million d’années. Ces corps représentent plus de 10 % des produits de fission des éléments lourds, uranium 235 et plutonium 239 en particulier. On est donc en droit de se demander si les récipients, aussi résistants soient-ils, sont réellement capables de résister un million d’années à l’eau de mer. Les océanographes ont mis en évidence dans les temps récents des courants marins qui, en dépit de leur lenteur extrême, sont capables de brasser les eaux même dans les abysses. Certains pensent qu’une circulation d’eau existe entre les fonds marins et la surface. De plus les êtres vivants sont capables de transporter les substances le long des chaînes alimentaires. Ces corps dangereux sont donc éventuellement capables de revenir en surface, d’où l’homme avait cru les exclure définitivement. Si, à moins d’accident, notre génération se trouve à l’abri de ces déchets, on ne peut être aussi affirmatif pour celles à venir.
Les substances de déchet ayant une moindre radioactivité sont directement évacuées dans la mer ou dans les rivières, sous le contrôle des savants atomistes, de manière à éviter de dépasser les seuils dangereux. D’après diverses constatations, la radioactivité des eaux qui ont servi au refroidissement des réacteurs ou qui charrient de tels déchets reste très faible, bien inférieure aux seuils dangereux pour l’homme, et incapable d’apporter un trouble quelconque à la vie aquatique.
On peut admettre que dans l’état actuel des choses, à moins d’un conflit atomique généralisé ou d’un accident grave survenant à une usine atomique – circonstance dont la probabilité est, hélas, beaucoup plus grande –, le monde se trouve à l’abri des effets directs des pollutions atomiques, le risque ne dépassant pas au pire celui qui résulte d’autres formes de l’activité humaine.
Même dans les conditions actuelles les faits sont cependant plus compliqués à cause de la concentration biologique des corps radioactifs le long des chaînes alimentaires. Comme dans le cas des pesticides (voir p. 253), ces corps passent dans la matière vivante des organismes les plus simples, qui les concentrent, et les transmettent à leurs prédateurs, avec des taux dangereux.
Ce phénomène apparaît avec une particulière netteté dans le milieu marin. On sait depuis longtemps que les animaux aquatiques sont capables de concentrer des substances très diluées dans le milieu qui les baigne. Certains Mollusques concentrent 4 300 fois le cuivre, 6 900 fois le fluor ; certains Crustacés (Copépodes) 13 000 fois la silice ; certains Poissons 2 500 000 fois le phosphore dissous dans l’eau de mer. Les corps radioactifs ne font pas exception, surtout les éléments rares, normalement présents à des doses infinitésimales dans la nature ; répandus avec une plus grande abondance comme déchets atomiques, ils peuvent entraîner une contamination grave des milieux naturels et s’accumuler dans les êtres vivants. C’est entre autres le cas du strontium 90 dont l’origine ne résulte que des fissions nucléaires artificielles ; sa durée de demi-vie de 25 ans est suffisante pour permettre son accumulation dans les êtres vivants et sa concentration le long des chaînes alimentaires, d’autant plus que les sols jouissent de facultés de rétention considérables. Cet élément, se métabolisant comme le calcium, se fixe dans les os et n’est mobilisé que très lentement. Il en est de même de certains isotopes de l’iode (par exemple iode 129) qui se fixent au niveau de la glande thyroïde.
Des concentrations importantes ont été mises en évidence dans diverses plantes aquatiques. En Angleterre, des mesures faites à Plymouth ont montré que des Algues marines concentrent de 20 (Ascophyllum nodosum) à 40 fois (Fucus serratus) le strontium 90 de l’eau de mer. Aux États-Unis, dans la rivière Columbia (qui reçoit les effluents de l’usine atomique d’Hanford), les Algues présentent une radioactivité 1 000 fois plus forte que l’eau. Dans la rivière Clinch (qui reçoit les effluents de l’usine d’Oak Ridge), le plancton est 10 000 fois plus radioactif que l’eau dans lequel il vit. Des Mollusques bivalves d’eau douce concentrent 100 fois l’iode radioactif. Des Poissons dulçaquicoles se trouvant à un niveau élevé dans les chaînes alimentaires sont de 20 000 à 30 000 fois plus radioactifs que l’eau dans laquelle ils vivent. Il en est de même des Poissons marins, dont les migrations peuvent de plus disperser au loin les produits radioactifs160. Cela explique que l’on ne peut déverser de grandes quantités de produits radioactifs au niveau des zones de pêche intensive.
Des phénomènes de concentration de ce type existent également le long des chaînes alimentaires dont les oiseaux aquatiques représentent le sommet, notamment en ce qui concerne le phosphore. Dans la rivière Columbia, un isotope de cet élément (phosphore 32161) a passé d’une concentration de 1 dans l’eau à 35 chez des Invertébrés aquatiques (Crustacés, Insectes), à 7 500 chez des Canards et 200 000 dans les œufs de ces derniers (la jaune est très riche en phosphore, qui en contient 2 millions de fois plus que l’eau de la rivière)162.
Les Procellariiformes – Albatros, Pétrels et Puffins – seraient éventuellement eux aussi très sensibles aux pollutions des mers par retombées radioactives ou déchets déversés imprudemment. Ces oiseaux sont en effet essentiellement planctonophages, et nous avons vu que le plancton est capable de concentrer d’une manière massive divers corps radioactifs. Les ornithologues se sont émus des explosions atomiques qui ont eu le Pacifique pour théâtre, toutes se trouvant sur les voies de migration du Puffin à bec grêle Puffinus tenuirostris qui décrit une boucle immense à travers tout cet océan, de la Tasmanie au détroit de Béring et à la Californie.
Bien que les chaînes alimentaires terrestres soient moins sensibles que celles qui déroulent leurs maillons dans les eaux, on peut néanmoins y observer des concentrations de ce type. C’est le cas de divers isotopes de l’iode, que leur faible durée de vie rend heureusement moins dangereux. Des troubles importants peuvent survenir par suite de la contamination d’herbages sur lesquels paissent des Vaches laitières, entraînant, dans le lait, une concentration importante des corps radioactifs, en particulier du strontium 90, menace très sérieuse pour l’alimentation humaine et spécialement celle des enfants. D’après des observations faites notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis, une partie des corps radioactifs retombés sur le sol est absorbée par les plantes fourragères au niveau des racines ; une autre tombe sur les plantes elles-mêmes et est ingérée directement par les herbivores. Plusieurs accidents graves ont été signalés et justifient les mesures de contrôle mises en vigueur depuis.
Nous n’évoquerons pas ici les effets des substances radioactives sur les animaux et sur l’homme. La peau, les yeux, les tissus hématopoïétiques (rate, moelle osseuse), les glandes génitales, sont particulièrement sensibles. Les radiations affectent à la fois la physiologie des individus exposés et leur hérédité (mutations subléthales et léthales par altérations des chromosomes et du code génétique). En provoquant la diminution des mécanismes immunitaires, elles augmentent la vulnérabilité aux affections cancéreuses. Des observations ont montré que l’augmentation de la radioactivité de certains lacs nord-américains entraînait une modification de l’équilibre de la faune aquatique (par suite d’une sensibilité différente des espèces), une croissance ralentie et une réduction de la longévité des poissons. À Hiroshima, lieu de sinistre mémoire, de graves répercussions ont été observées parmi la faune marine et notamment parmi les Mollusques (mortalité élevée, destruction des tissus, régression des glandes génitales transformées en parenchyme indifférencié).
Il faut également signaler les dangers d’une radioactivité accrue sur l’avenir génétique des populations végétales et animales. Bien que des opinions sans aucun doute excessives aient été émises à ce sujet, la menace est néanmoins très réelle, car les chances de mutations augmentent avec la radioactivité et celles-ci risquent de modifier le patrimoine héréditaire du monde vivant dans un sens probablement défavorable.
Des anomalies dans la mue de certains petits échassiers nichant dans les régions arctiques ont été « expliquées » par les effets des irradiations. Les animaux eux-mêmes peuvent devenir radioactifs. On a constaté que des Bernaches nonnettes Branta leucopsis nichant en Nouvelle-Zemble et de passage à Gotland, Suède, avaient un plumage radioactif. Une telle contamination a été mise en évidence chez les Caribous au Canada et en Alaska, et chez des Rennes de Suède, par l’intermédiaire des lichens dont les animaux font le principal de leur nourriture. Ces végétaux fixent pratiquement la totalité des retombées radioactives provenant des explosions nucléaires (strontium 90 et césium 137 entre autres).
Il faut cependant remarquer que jusqu’à présent les dangers dus aux pollutions radioactives ont surtout été potentiels. À part un certain nombre d’accidents malheureusement tragiques, ni l’homme ni la nature n’ont eu à pâtir d’une manière généralisée des fissions atomiques, en dépit de ce qui a été avancé par beaucoup de ceux qui rendent les expériences atomiques responsables de la raréfaction de certains animaux comme… du mauvais temps qu’ils déplorent pendant leurs vacances.
Les radiobiologistes sont cependant beaucoup moins optimistes quant aux effets nucléaires qu’il y a peu de temps. L’augmentation de la radioactivité est déjà plus élevée que prévu à travers le monde, particulièrement dans l’hémisphère Nord. Les retombées de produits radioactifs, notamment de strontium 90, ont entraîné une concentration dans divers aliments tel le lait. La teneur de certains organes humains, surtout les os, en radio-isotopes artificiels, a tendance à augmenter, comme l’ont montré les mesures faites sur les dents de lait des enfants aux États-Unis (« Baby Tooth Survey » organisé par le Saint Louis Committee for Nuclear Information).
Telles sont donc très brièvement esquissées les menaces de la pollution atomique, celle qui comporte les plus grands risques pour la survie de l’espèce humaine.
Nous espérons que l’homme saura éviter la catastrophe d’une utilisation guerrière de l’énergie formidable à sa disposition depuis que la première bombe atomique – un « pétard » à côté des engins actuels – a explosé le 6 août 1945. Car alors le problème de la place de l’homme dans la nature ne se poserait vraisemblablement plus…
Le danger cependant change d’échelle au moment où se généralise l’utilisation industrielle de l’énergie nucléaire. La fission atomique constitue le plus sérieux espoir de l’humanité, au moins à court et moyen terme, alors que les autres ressources d’énergie s’épuisent d’une manière alarmante, situation encore aggravée par les effets de facteurs politiques. Si les programmes de développement nucléaire des divers pays devaient se poursuivre au rythme actuel, ce qui est probable étant donné les circonstances et l’inertie de nos économies, les dangers de la pollution atomique augmenteront d’une manière accélérée.
Mettons à part les accidents possibles, consécutifs à une explosion nucléaire ou à des fuites dans les réacteurs de divers types en usage. L’industrie atomique est une des plus fiables. Au moment même où l’homme a commencé à maîtriser la puissance de l’atome, à la libérer d’une manière contrôlée, il a pris conscience des dangers de cette nouvelle forme d’activité. Mais des accidents sont toujours possibles, comme dans toute industrie, et leurs conséquences seraient infiniment plus graves que dans une raffinerie ou une usine sidérurgique.
Le problème le plus sérieux pour l’environnement reste le devenir des déchets radioactifs, produits en quantités croissantes à mesure que les centrales se multiplient. La saturation sera rapidement atteinte et l’optimisme de commande des atomistes ne peut en aucun cas nous rassurer. Sans écouter de trop les contestataires systématiques, nous devrions quand même exiger d’être renseignés autrement que par de belles paroles et quelques propos lénifiants.
À supposer même que les pollutions nucléaires puissent être contrôlées, et que les doses admissibles soient respectées (on aimerait savoir comment on les calcule dans un milieu biologique complexe), deux menaces subsistent. La première est la pollution thermique. Les centrales nucléaires rejettent d’énormes quantités de chaleur dans l’atmosphère ou dans les eaux de refroidissement, près de 70 % de l’énergie libérée se dissipant sous forme thermique. L’emploi de l’eau de mer permettrait peut-être d’éliminer cette énergie sans dégâts trop graves aux écosystèmes côtiers. En revanche si l’eau des fleuves devait être utilisée, comme il est prévu, les conséquences pourraient être dramatiques, car l’élévation de la température des milieux aquatiques tournerait rapidement au désastre écologique.
La seconde conséquence du développement nucléaire sera inévitablement une nouvelle consommation de l’espace. Les centrales, dont les villes ne veulent pas à leur voisinage, seront implantées dans des sites encore demeurés sauvages. Un simple coup d’œil sur la carte de répartition des projets en France suffit à s’en convaincre. L’emprise au sol est notable si l’on prend en considération les voies d’accès et les lignes de transport de l’énergie électrique. Cela signifie de nouvelles destructions apportées à des milieux jusqu’ici protégés et des ruptures d’équilibre écologique s’ajoutant à tant d’autres.
Tout cela doit être pris en considération au moment où l’on développe l’énergie nucléaire. Renoncer à celle-ci serait dans la situation présente renoncer à la civilisation industrielle. Les bienfaits que nous pouvons en attendre valent la peine de veiller à ne pas « empoisonner » la nature d’une manière telle que les autres formes de pollutions paraîtraient des enfantillages et qu’enfin la planification tienne compte d’impératifs écologiques à une époque où s’opère une mutation de l’économie et de la technologie.