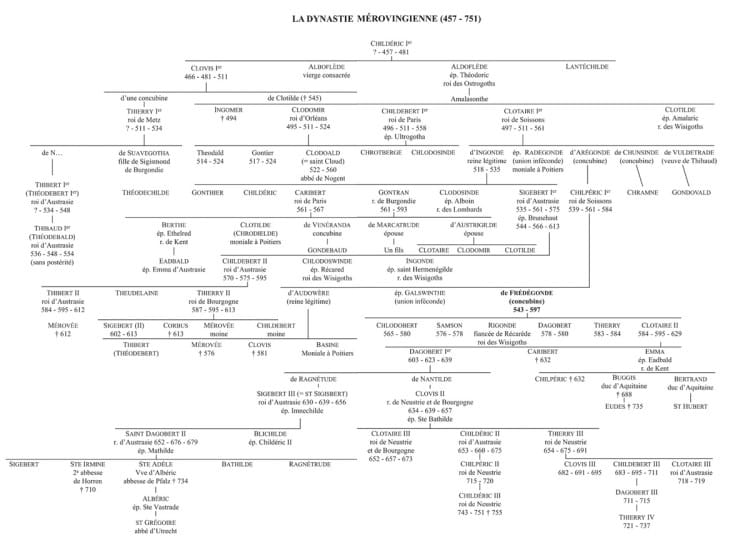VIII
La régente
Le premier soin de Frédégonde, en ce printemps 586, fut d’exercer cette justice régalienne que les leudes avaient revendiquée en son nom. L’opinion publique réclamait un coupable dans l’affaire Prétextat ; il convenait d’en découvrir un et de le châtier.
On arrêta peu après un esclave1 du défunt prélat, prisonnier de guerre, donc capable de se servir d’une arme, connu pour avoir nourri envers son maître une profonde inimitié et qui avoua sous les coups être le tueur de la cathédrale.
Ces aveux obtenus par la contrainte et la violence étaient-ils plus crédibles que ceux produits à temps et contretemps par Brunehilde chaque fois qu’elle cherchait à nuire à sa belle-sœur ? Non, mais le misérable faisait un assassin plausible et c’était l’essentiel.
Si l’on n’avait pas déjà découvert le vrai meurtrier, il fallait supposer que Frédégonde, avisée, avait pourvu à sa sauvegarde sitôt le coup accompli, ainsi qu’elle l’avait fait lors de l’assassinat de Sigebert dont on n’avait jamais retrouvé les coupables. À moins qu’elle eût jugé préférable d’éliminer un auxiliaire peu sûr ; elle n’avait pas apprécié l’initiative fâcheuse de perpétrer le crime dans la cathédrale et en plein office2.
Simple esclave, l’homme ne méritait pas la réunion d’un tribunal et un jugement dans les formes. La reine se contenta de le livrer au neveu de Prétextat, plus proche parent du défunt, lequel exerça son droit de justice privée en faisant torturer à mort le meurtrier présumé de son oncle.
Manifestement, Frédégonde n’avait rien à voir avec cette victime propitiatoire et elle n’en redoutait pas de confidences déplacées. Il y en eut pourtant. Dans les affres de ses tourments, le malheureux, sollicité pour lui faire dire ce que le clan Prétextat voulait entendre, chargea la reine, l’évêque Mélaine et l’archidiacre de Rouen, les accusant pêle-mêle de lui avoir mis l’épée à la main contre promesse d’affranchissement pour sa femme et lui-même. Les conjurés lui avaient, jura-t-il, donné deux cents sous d’or pour commettre le forfait.
Le neveu ne s’étonna pas de n’avoir pas retrouvé cette somme conséquente, mais imaginaire ; il ne se demanda pas non plus pourquoi l’assassin, en possession de ce trésor, n’en avait pas profité pour s’enfuir et se mettre à l’abri des poursuites.
Tout, une fois de plus, était incohérent dans cette affaire mais cela ne changea rien au dénouement prévisible : l’esclave mourut dans les tourments3.
L’incident n’était point pour affecter Frédégonde ; elle conservait les façons de penser d’avant la christianisation, quand il était admis qu’un esclave n’appartenait pas à l’espèce humaine et qu’il était permis d’en user avec lui à sa guise du moment que l’on était son maître…
Ces aveux ridicules ne changeraient rien à l’opinion, bonne ou mauvaise, que l’Austrasie et la Burgondie se faisaient d’elle. On l’avait depuis trente ans insultée de tant de manières, on avait colporté sur son compte tant de calomnies, on l’avait rendue responsable de tant de crimes que cela ne l’atteignait plus ; elle se plaçait maintenant au-dessus de tout cela, et en avait le droit : elle était la reine.
Elle le rappela magistralement en se débarrassant du duc Beppolène, un incapable en charge de la défense du front de Bretagne, Marche chaque été en butte aux attaques des chefs de clans voisins. Beppolène n’avait jamais réussi à endiguer ces pillages estivaux systématiques et même il les avait aggravés en dévastant le Vannetais, représailles ineptes qui avaient fait basculer définitivement cet évêché, resté attaché à ses racines gallo-romaines, du côté des Tierned bretons.
Frédégonde méditait de longue date un rapprochement entre la Bretagne et la Neustrie, qu’elle pensait à terme profitable aux uns et aux autres. Malgré le goût des Bretons pour le vin du pays nantais, qui les incitait à piller le vignoble chaque automne, et leurs visées expansionnistes manifestes vers la région rennaise, elle pensait avoir beaucoup à gagner d’un accord avec eux. Et pour commencer la possibilité de détourner leurs ardeurs belliqueuses en direction des possessions austrasiennes du Cotentin. Cela apprendrait à l’évêque de Coutances à venir lui donner des leçons.
Le cas échéant, les chefs de clans feraient des alliés redoutables, et fiables, contre Childebert et Gontran. Son fils et elle ne disposaient point de tant de soutiens qu’il fallût négliger celui-là.
À ces considérations politiques et stratégiques argumentées s’ajoutaient des sympathies personnelles ; la Gauloise Frédégonde se sentait des affinités avec ces Celtes d’outre-Manche. Peut-être même tenait-elle à eux par quelques liens familiaux et nationaux. Le choix du prénom de son second fils, Samson, celui de l’évêque de Dol, qui avait étonné en son temps parce qu’il n’appartenait pas au patrimoine onomastique de la dynastie mérovingienne et que l’on avait tenté de rattacher acrobatiquement au chef de guerre biblique, tenait peut-être uniquement à cela, et à la nécessité tôt éprouvée de se rapprocher des gens de la Petite Bretagne.
La reine n’avait pas su persuader Chilpéric, jadis, de la suivre dans cette voie. Fidèle aux ambitions de son grand-père Clovis, le roi de Neustrie espérait rattacher à la Gaule cette Armorique qui lui échappait depuis plus de deux siècles. Frédégonde, qui possédait une meilleure connaissance de ces peuples et de ces régions, savait que cette conquête ne se ferait point, ou à un prix que la Francia n’avait pas, pour l’heure, les moyens de payer. Maintenant qu’elle était libre de ses choix et de ses alliances, elle décida de faire prévaloir la paix bretonne.
Beppolène, qui tirait de substantiels revenus de ses pillages annuels dans la Marche de Bretagne, tantôt côté breton tantôt côté franc car il n’était pas regardant, prit mal ces nouvelles directives. Plus mal encore d’entendre une femme lui donner des conseils et des ordres à propos de questions militaires. Près d’être relevé d’un commandement qu’il exerçait fort mal, il préféra prendre les devants et s’en fut se réfugier près de Gontran auquel il se plaignit d’abondance que Frédégonde « ne le traitait pas avec les honneurs dus à son rang4 ».
Ces nouvelles confortèrent le roi de Burgondie dans son analyse des événements. À l’instar de Brunehilde, qui n’avait pas éprouvé de honte à ceindre le baudrier et le glaive et avait paru sur un champ de bataille au nom de son fils, Frédégonde à son tour s’arrogeait un pouvoir par nature masculin, entendait commander aux armées de Neustrie et décider souverainement de la paix et de la guerre. Décidément, on marchait sur la tête et le monde tournait à l’envers ! Comment s’étonner, quand on voyait cela, de tous les signes apocalyptiques relevés par l’évêque Grégoire, ces comètes, ces lueurs célestes mystérieuses, et, marque probante du dérèglement généralisé de l’univers, ces arbres fruitiers qui refleurissaient en septembre ? ! Il était temps de remettre de l’ordre !
Dans ce but, Gontran reconduisit Beppolène dans ses fonctions de duc de la Marche de Bretagne, fonctions dont Frédégonde venait de le relever, et l’envoya à Rennes en son nom. Mais ni Rennes ni Angers ni aucune autre ville d’Armorique et d’Anjou ne le reconnut et n’accepta de lui ouvrir ses portes. Refus assimilable à une rébellion contre le pouvoir légal, en l’occurrence celui de Gontran, donc passible de représailles. Les évêques de Burgondie n’avaient-ils pas menacé la Neustrie récalcitrante d’être mise à feu et à sang ? Beppolène démontra que ce n’était point paroles en l’air. Avant d’être assassiné par des notables qui ne toléraient plus ces façons de se conduire comme en pays conquis5.
La reprise en main de Gontran s’acheva là. Ne lui restait de sa régence neustrienne qu’une tutelle aussi théorique que celle qu’il avait été censé exercer sur l’Austrasie. Il n’en décolérait pas, vouait aux cent mille diables ses deux belles-sœurs qu’il tenait pareillement pour des créatures démoniaques : elles étaient femmes, c’était tout dire !
Heureusement pour le Burgonde, sa situation militaire s’améliora au cours de l’été 586, lui donnant de l’air et lui rendant un peu les coudées franches.
La mort du roi Léovigild de Tolède et l’accession au trône d’Espagne de son fils, le prince Reccared, mirent un terme prématuré à la campagne de Septimanie et empêchèrent les Wisigoths d’exploiter leurs victoires de 585, fulgurantes, et qui avaient failli restaurer un véritable État wisigothique de ce côté-ci des Pyrénées. Éviter ce désastre qui eût porté atteinte au meilleur de l’œuvre de Clovis et déshonoré son petit-fils était une bonne chose. La cour de Chalon n’accueillit pas, pourtant, avec grande allégresse la nouvelle inattendue de la conversion de Reccared au catholicisme. Le nouveau roi, plus marqué qu’il ne l’avait laissé jusque-là supposer par le souvenir de sa mère et par le martyre de son frère aîné, Hermenégilde, sitôt monté sur le trône, abjura l’arianisme entre les mains de l’évêque Léandre, décision qui entraîna la conversion de son peuple et de sa noblesse. Afin de couper court aux contestations, Reccared fit immédiatement supplicier sa belle-mère, la reine Goïswinthe, soit qu’il craignît les menées de cette arienne fanatique et l’influence dont elle jouissait encore, soit qu’il lui fît payer la mort d’Hermenégilde, dont elle avait été la contemptrice acharnée.
Cette décision ouvrait-elle motif à une nouvelle Faide entre l’Espagne et la Francia, Goïswinthe étant la mère de Brunehilde et la grand-mère de Childebert II ? Ou bien l’Austrasie se souviendrait-elle que la disparue avait ourdi la perte de la princesse Ingonde, drame qui avait considérablement refroidi les rapports entre Metz et Tolède ? Dans l’expectative, Reccared prit hardiment les devants en proposant le mariage à la cadette de sa belle-sœur, Chlodoswinthe, dernière-née de Brunehilde et Sigebert. C’était faire bon marché de ses fiançailles avec Rigonthe de Neustrie, toujours enfermée dans le cloître de Notre-Dame de la Dorade et que tout le monde semblait avoir oubliée, à commencer par son promis. Reccared avait un moment tenu la région toulousaine mais n’avait jamais envisagé d’aller délivrer sa fiancée. L’alliance neustrienne avait perdu son intérêt depuis la mort de Chilpéric.
L’éventualité d’une guerre menée au nom d’une énième vendetta familiale ennuyait Gontran, qui sortait à peine d’un conflit, mal engagé, avec l’Espagne. Il supputait les problèmes que la conversion de Reccared allait causer à la Francia. Travaillée par les querelles religieuses qui opposaient le pouvoir wisigoth, souvent persécuteur, à ses sujets catholiques, l’Espagne ne s’était pas hissée, en Europe, au niveau de puissance de la Francia mérovingienne ; réunifiée, apaisée, elle risquait de gagner en force jusqu’à devenir une menace. Pis encore, le voisin wisigoth, converti, cessait de représenter le commode épouvantail hérétique contre lequel il avait été simple, depuis cent cinquante ans, de fédérer Francs et Gallo-Romains au nom de la défense du catholicisme.
Toutes ces cogitations contrarièrent assez Gontran pour qu’il envoyât désagréablement promener une ambassade espagnole venue lui offrir un traité de paix. Tant qu’il ignorerait les intentions de Brunehilde, imprévisible comme toutes les femelles, il préférait éviter les initiatives malencontreuses. Les espions qu’il entretenait à la cour de son neveu ne l’avaient-ils pas informé de mystérieux accords entre la reine d’Austrasie et l’usurpateur Gondovald ? Ses agents tenaient pour quasi assuré que l’or austrasien avait de longue date pris le relais des fonds byzantins et payait la campagne du prétendant ; ils assuraient aussi que Brunehilde avait offert le mariage à cet aventurier…
Gontran, intelligent, lisait dans le jeu tortueux de l’Austrasienne : Brunehilde avait été très contrariée de le voir défendre Frédégonde et, puisqu’il aimait tant tenir la balance égale entre les deux royaumes, elle lui rendait la monnaie de sa pièce en soutenant le supposé fils de Clotaire, histoire de lui rappeler qu’il n’y avait pas qu’un roi en Francia.
L’offre de mariage lui fit, par contre, hausser les épaules. Pourquoi la reine, qui avait jadis froidement sacrifié le jeune Mérovée à la préservation des droits de Childebert, serait-elle allée s’offrir à Gondovald ? L’hypothèse tenait encore moins debout depuis que Childebert avait des héritiers. La jeune reine Faileuba lui avait donné deux enfants en deux ans, un fils, Théodebert, et une fille, Théodelane. Il y en aurait sûrement encore beaucoup d’autres. En assurant l’avenir de la dynastie austrasienne, Brunehilde s’était aussi assurée de ne point perdre le pouvoir, qu’elle continuerait d’exercer à travers sa descendance.
Gondovald, trop sûr des succès obtenus l’année précédente, et ignorant de ces péripéties, ne sentit pas le vent tourner. L’argent, les soutiens et la chance lui manquèrent en même temps. Assiégé dans Comminges, il accepta de négocier avec les envoyés de Gontran, qui l’attirèrent dans un piège et le tuèrent.
À l’automne 586, le roi de Burgondie, liquidée la double crise militaire qui l’avait affaibli et mis dans l’impossibilité d’agir à sa guise dans ses tentatives de contrôle de la Francia, repassa aux choses sérieuses : le rétablissement de son pouvoir en Neustrie. En avait-il les moyens ? Cela restait à démontrer car les quelques opérations de maintien de l’ordre qu’il lança en Anjou et en Armorique sous prétexte d’enquêter sur les circonstances du meurtre de Beppolène n’aboutirent qu’à des vexations gratuites à l’encontre de partisans déclarés de Clotaire II ; mais Frédégonde, qui ne voulait sous aucun prétexte d’une rupture ouverte avec Gontran, préféra lui envoyer, au printemps 587, des ambassadeurs afin de renégocier leurs relations sur des bases neuves, et plus équilibrées pour les Neustriens.
Ces diplomates arrivèrent à peu près dans le même temps qu’une autre délégation, austrasienne, celle-là, en charge de régler le vieux différend opposant Austrasie et Burgondie pour le contrôle de la région marseillaise.
Il y avait sûrement, dans cette concomitance de pourparlers, plus qu’une coïncidence, une volonté très nette de Brunehilde d’empêcher la signature d’un accord entre Gontran et Frédégonde, accord qui entérinerait définitivement la reconnaissance de la légitimité et des droits du petit Clotaire II. Les buts austrasiens ne variaient pas depuis la mort de Chilpéric : Childebert II devait être seul et unique héritier de son oncle de Neustrie, au détriment d’un cousin qu’il s’obstinait à proclamer bâtard. Or, Gontran s’y refusait, parce que maintenir le statu quo entre ses deux neveux, et laisser planer le doute sur une éventuelle adoption de Clotaire, ouvrant à celui-ci des droits sur la couronne burgonde, lui assurait une position de force.
C’est à ce jeu que Brunehilde entendait mettre fin une fois pour toutes. Comment ? En accusant Frédégonde d’être une meurtrière. Refrain lassant et répétitif mais dont elle espérait qu’à force de le chanter, on finirait par le croire.
Donc, les deux ambassades, l’austrasienne et la neustrienne, s’étaient, fin mars 587, croisées à la cour de Gontran. Circonstance un peu contrariante, qui témoignait de l’ordinaire double jeu du Burgonde. Celui-ci avait préféré couper court et renvoyer les Neustriens avec une réponse dilatoire6, si peu satisfaisante que les diplomates s’attardèrent en Burgondie, dans l’attente d’un revirement du roi, ou d’informations supplémentaires.
Survint alors un incident invraisemblable. Une nuit de la Semaine sainte, Gontran se rendant à matines découvrit, dans un corridor menant de ses appartements à l’église, un homme visiblement pris de boisson affalé contre le mur, ronflant comme un sonneur, l’épée au côté et une lance à portée de la main. Rien d’autre, à l’évidence, qu’un ivrogne trop saoul pour savoir où il cuvait son vin mais sa présence à proximité des appartements royaux, en armes, avait de quoi inquiéter. Cette sécurité à laquelle Gontran tenait tant depuis que ses frères avaient été assassinés n’était pas garantie comme elle aurait dû l’être ; il en fit la remarque.
Quel rapport entre ce soûlard et Frédégonde ? Aucun, bien entendu, mais les agents austrasiens ne manquèrent pas de faire un rapprochement et, jouant sur les compréhensibles angoisses du roi de Burgondie, ils transformèrent le poivrot en meurtrier. Torturé, le soldat fit les réponses que ses tourmenteurs attendaient : il avait été placé là par les ambassadeurs neustriens et, feignant le sommeil, devait attendre le passage du roi puis, se jetant sur lui, le tuer.
Version non moins absurde que toutes celles déjà inventées par le passé afin de nuire à Frédégonde ; peut-être même plus absurde encore que les précédentes, mais Gontran, cet homme fin et plein de bon sens, avait eu très peur et cette peur le rendit complètement idiot : il goba ces aveux. Il fit arrêter les ambassadeurs, les pressa de questions, accompagnées de quelques attentions moins diplomatiques. Un peu de raison aurait pourtant dû suffire à lui faire disculper les Neustriens. Pourquoi, si ces hommes avaient aposté un meurtrier à la porte de sa chambre, avaient-ils pris le risque de rester en territoire burgonde ? Afin de connaître le résultat de leurs complots7 ? Choix pour le moins imprudent ! Il eût été plus sûr d’attendre les nouvelles de l’autre côté de la frontière !
Cette évidence ne calma point Gontran, pas plus que les dénégations désespérées des diplomates qui assuraient « n’être pas venus le trouver pour autre chose que la mission qu’ils lui avaient exposée ». Leur sincérité manifeste leur épargna le pire ; il conclut que Frédégonde les avait utilisés comme couverture, qu’ils ignoraient tout de ses véritables desseins et se borna à les frapper d’ordres de bannissement aux quatre coins du territoire8.
À examiner plus raisonnablement l’événement, l’innocence de la reine de Neustrie ne fait guère de doute. Elle n’avait aucune raison de supprimer Gontran qui, désormais écarté des affaires intérieures de Neustrie, ne représentait plus une gêne mais, tout au contraire, un allié ; sans lui, dernier représentant adulte de la lignée royale, qui reconnaîtrait la légitimité de Clotaire ? Qui ferait valoir ses droits ? N’était-ce pas d’ailleurs le motif des atermoiements de Gontran qui s’amusait d’année en année à repousser l’investiture officielle de son neveu, quitte à suspendre aussi un baptême point culminant des festivités prévues ?
Il ne fallait pas non plus croire la reine de Neustrie sotte, maladroite et imprévoyante, ce que laissaient supposer ces tentatives de meurtres à répétition tantôt contre les uns tantôt contre les autres mais toutes également bâclées et ahurissantes de stupidité. Lorsqu’il arrivait à Frédégonde, parce qu’elle ne voyait plus d’autre échappatoire, parce qu’elle jugeait sa vie, ou celle de ses fils, en grave danger, de se résoudre à tuer un ennemi, qu’il s’agît de Sigebert ou de Prétextat, elle ne manquait pas son coup, sachant s’entourer d’hommes sûrs et résolus, non d’amateurs. Eût-elle voulu le trépas de Gontran, de Brunehilde ou de Childebert, ils seraient morts. Penser le contraire n’était pas lui rendre justice.
Non, ce plan lamentable et grotesque portait, comme d’habitude, la signature de Brunehilde, non qu’elle voulût la disparition de Gontran, mais parce qu’elle tenait à faire échouer le rapprochement entre la Burgondie et la Neustrie qu’elle voyait se profiler.
En quoi elle réussit au-delà de tous ses espoirs. L’arrestation de l’ambassade neustrienne, contraire à tous les usages diplomatiques, équivalait à une rupture entre les deux États et même à un casus belli si Frédégonde s’était trouvée en position de force. Elle ne l’était pas et dut avaler l’insulte, puis assister, impuissante, au renouvellement de l’amitié burgondo-austrasienne. La naissance, dans le courant de l’été, d’un second prince héritier à Metz, prénommé Thierry, fut l’occasion pour Gontran de manifester la grande affection qu’il portait à ses neveux en les comblant de cadeaux de prix, et en restituant à l’Austrasie les territoires qu’il avait annexés en Provence et en Albigeois. Des dispositions furent prises en vue d’une rencontre au sommet qui réactiverait l’adoption de Childebert par son oncle et officialiserait définitivement sa place d’héritier de la couronne burgonde.
Gontran, qui n’aimait pas qu’on le pressât et surtout pas qu’on lui forçât la main, tergiversa encore tout le printemps, tout l’été et une partie de l’automne 587, puisque ce n’est que le 29 novembre qu’il se décida à signer à Andelot-Blancheville le pacte tant espéré par l’Austrasie. Dans l’intervalle, comme si on avait voulu le forcer à accélérer le mouvement, le roi de Burgondie avait encore fait l’objet de plusieurs tentatives plus ou moins boiteuses d’assassinat que la rumeur ne manquait pas d’attribuer à Frédégonde.
Attentats fictifs, à l’exception de celui du 4 septembre 587, fête de saint Marcel, patron de la capitale burgonde, au cours de laquelle, à la cathédrale, un homme porteur de deux poignards réussit à s’approcher du roi qui revenait de communier. L’individu avait-il l’intention de se servir de ses armes ? On n’eut pas l’occasion de s’en assurer puisqu’il fut démasqué avant de passer à l’acte et d’ailleurs relâché, car Gontran choisit de faire grâce, par égard envers le bienheureux saint Marcel. Attention délicate assez peu dans les manières habituelles du roi, que chacun s’entendait à trouver implacablement rancunier. Cette magnanimité accréditait la thèse d’une vengeance personnelle, et justifiée ; Gontran avait un jour causé quelque tort grave à son agresseur et il s’en souvenait.
Frédégonde n’y était pour rien, mais la tentative de meurtre dans la cathédrale rappelait trop l’attentat contre l’évêque Prétextat pour n’être pas exploitée à fond par la propagande austrasienne. Gontran laissa dire et laissa faire. Il était fatigué de ce qui-vive perpétuel, de ces angoisses, d’avoir à se défier de toute ombre suspecte.
En cédant aux pressions de Brunehilde, il s’assurait une période de tranquillité, quitte à en passer par les exigences outrancières de sa belle-sœur.
Que pensa Frédégonde lorsqu’elle prit connaissance à son tour des termes du pacte d’Andelot-Blancheville ? Mesura-t-elle l’habileté de Gontran qui, en échange de beaucoup de promesses mirifiques mais fort vagues, avait conforté son pouvoir et son rang sans rien céder de très concret ? Femme de tête, rompue aux jeux politiques, elle dut retirer du document les dispositions qui les concernaient, indirectement, son fils et elle, et, paradoxalement, trouva motif à s’en réjouir.
Certes, Gontran confirmait l’adoption de Childebert et lui assurait sa succession, mais il n’était écrit nulle part, et c’était l’essentiel aux yeux de Frédégonde, que cette adoption du jeune roi d’Austrasie excluait l’éventualité d’une seconde adoption, plus tard : celle de Clotaire. Sur ce point-là qui lui importait tant, Brunehilde n’avait pas obtenu gain de cause. Mieux encore, en bon juriste, Gontran avait usé des termes les plus flous pour parler de son héritage, de sorte que l’on pouvait comprendre qu’il léguait à Childebert simplement la Burgondie stricto sensu, c’est-à-dire réduite à ses frontières historiques, sans les cités neustriennes annexées à la mort de Chilpéric, nuance énorme ; il avait aussi explicitement exclu la Neustrie de l’héritage à venir, ce qui protégeait les droits de Clotaire. Gontran avait eu beau éviter de prononcer les noms du petit souverain et de sa mère, il les avait cependant défendus. Parce qu’il y trouvait son intérêt, ce qui laissait la porte ouverte à de nouveaux arrangements, dans un futur proche.
Frédégonde soupira de soulagement, et s’étonna que Brunehilde se fût contentée de cet arrangement, beaucoup moins avantageux pour elle qu’elle ne l’avait espéré. La raison en était sans doute à chercher en d’autres clauses, en apparence annexes mais qui, du point de vue des reines, avaient une importance colossale.
Fait sans précédent, Brunehilde avait obtenu d’être nommée et considérée dans les dispositions du pacte sur le même pied que son beau-frère et son fils, et se voyait décernée dans les actes le titre de reine, accompagné de toutes les prérogatives d’ordinaire réservées au souverain. Traitée à l’égal d’un homme, la reine avait veillé, en cas de disparition de son fils et de ses petits-fils, à se voir garantis les avantages prévus par son Morgengabe, enrichis de quelques autres, qui la mettraient définitivement à l’abri du besoin et hors la dépendance masculine. Sa fille, la princesse Chlodoswinthe, et la princesse Clotilde, la fille survivante de Gontran, s’étaient pareillement précautionnées, se faisant reconnaître, quoique célibataires, des biens propres qui ne leur seraient jamais enlevés, ainsi que la promesse de ne jamais les contraindre à se cloîtrer.
Cette reconnaissance de libertés féminines, ces concessions arrachées au misogyne Gontran concernant le pouvoir de la reine mère valaient leur pesant d’or. Frédégonde ne s’y trompa point et se jura qu’elle saurait s’en servir le moment venu afin d’obtenir les mêmes avantages.
Finalement, le traité d’Andelot-Blancheville qui l’avait tant inquiétée se révélait moins néfaste qu’elle l’avait craint. Il équivalait, ni plus ni moins, au maintien du statu quo ante, que l’on continuerait à contester, tous bords confondus. Les déplorables incidents qui avaient marqué le décès de la reine Radegonde l’été précédent étaient un triste révélateur des tensions ambiantes.
Usée par les privations, les macérations, les pénitences, la veuve de Clotaire Ier s’était éteinte le 13 août 587 au monastère Sainte-Croix de Poitiers, sa fondation, âgée d’une soixantaine d’années.
Sans enfant, la reine moniale avait reporté son affection maternelle sur le petit Sigebert, encore au berceau lors du décès de sa mère, la reine Ingonde. Elle l’avait élevé. Entre eux, l’affection ne s’était jamais démentie. Tout naturellement, lors des partages de 561 et 568, Radegonde avait privilégié les intérêts de Sigebert ; elle s’était réjouie de voir le Poitou tomber dans la part du roi d’Austrasie, n’avait pas accepté l’annexion de Poitiers à la Neustrie par Chilpéric et avait manifesté derechef sa satisfaction lorsque la ville était revenue à Childebert II après l’assassinat du Neustrien.
Opinions feutrées, qui s’exprimaient dans la discrétion du parloir de Sainte-Croix, plus rarement par le biais de la correspondance que Radegonde entretenait avec Brunehilde, mais, toutes feutrées qu’elles fussent, ces opinions, en raison de la réputation de sainteté de la vieille reine, pesaient très lourd et n’étaient pas dépourvues de conséquences politiques et diplomatiques. Nuisibles à la Neustrie. Et cela, l’évêque de Poitiers, Marovée, un homme de Chilpéric, ne l’avait jamais admis.
Misogynie, antipathie personnelle incontrôlable, différends politiques irréconciliables, il n’avait jamais réussi à cacher qu’il détestait la reine Radegonde et collectionnait à son encontre une foule de griefs injustifiés. Il n’avait jamais manqué une occasion de l’offenser ou de lui faire du tort, notamment lors de la translation, en 569, des reliques de la vraie Croix offertes, honneur exceptionnel, par le Basileus, de Constantinople à Poitiers. Au lieu de considérer la gloire d’entrer en possession d’une des reliques les plus convoitées de la chrétienté, l’atrabilaire Marovée n’avait vu, ce qui était exact mais accessoire, que le triomphe diplomatique obtenu par Sigebert à cette occasion. Et il avait boudé les cérémonies, obligeant l’évêque de Tours à le suppléer lors des festivités.
Après cela, Radegonde, sans jamais manquer à ce qu’elle devait à l’évêque, avait pris ses distances et veillé à mettre sa fondation à l’abri du contrôle du prélat. Sage précaution d’ailleurs. Marovée avait interprété cette attitude comme une intolérable rébellion, à laquelle il ne pouvait remédier puisque la reine et ses filles étaient sous la protection des souverains austrasiens. À défaut de les mettre au pas, il leur avait livré une petite guerre sournoise, laquelle avait touché son apogée lorsque, le 13 août, apprenant le décès de sa vieille ennemie, Marovée avait quitté Poitiers, prétextant une tournée pastorale urgente, qui le dispensait de célébrer les obsèques de Radegonde. L’abbesse Agnès l’avait vainement attendu quarante-huit heures, puis cédé aux objurgations de l’évêque Grégoire de Tours, qui la conjurait de procéder aux funérailles avant que la chaleur estivale rendît la décomposition du corps insoutenable9.
Procédés mesquins et inélégants mais qui en disaient long sur la persistance des tensions et rappelaient que rien n’était réglé entre les trois royaumes francs.
Frédégonde en avait pris bonne note, même si elle conservait une certaine reconnaissance envers la reine Radegonde, pour l’avoir défendue en 584 quand les Austrasiens avaient déclenché contre elle la campagne diffamatoire visant à la faire répudier pour adultère. Marovée s’était mal conduit mais son attitude avait le mérite de mettre en évidence quelques fidélités, et nombre de mécontentements locaux qu’il faudrait exploiter le moment venu.
Brunehilde, qui avait paru satisfaite de l’accord de novembre 587, ne tarda pas à en déplorer les restrictions et les non-dits. Elle demeurait obsédée par l’élimination de Clotaire II et de sa mère, n’admettait pas l’attitude de Gontran, voulait à toute force lui arracher des promesses et des engagements que, justement, il se refusait à prendre. Avec l’idée de faire pression sur lui, elle incita Childebert à ne pas respecter certaines clauses annexes du traité d’Andelot-Blancheville, concernant des dédommagements dus par l’Austrasie en échange de l’abandon de la souveraineté burgonde sur Senlis. Elle lui conseilla aussi de maintenir dans ces régions des dignitaires et notables pro-austrasiens dont les Burgondes avaient demandé le déplacement. Tout cela ne plut pas à Gontran.
Il fit courir le bruit, au printemps 588, qu’il mènerait personnellement à l’été une campagne contre les Bretons afin de mettre un terme à leurs perpétuelles attaques sur le pays nantais, et que, ce faisant, il agirait au nom de Clotaire II, son neveu et pupille. Le roi de Burgondie s’amusait fort à la pensée que cette annonce irriterait autant Brunehilde que Frédégonde, mais pour des raisons opposées.
Brunehilde parce qu’elle se refusait à reconnaître l’existence de Clotaire ; Frédégonde parce que cette initiative de son beau-frère, à qui elle n’avait rien demandé, mettrait à mal sa diplomatie propre, l’amorce de rapprochement qu’elle préparait avec la Bretagne, et constituerait une manœuvre pour lui ravir ce pouvoir qu’elle avait réussi à reprendre.
Quelques indiscrétions calculées en direction de la cour de Metz firent aussi savoir que Gontran envisageait de partager ses domaines entre ses deux neveux, Childebert ayant une certaine tendance, ces derniers temps, à le décevoir…
Les intrigues de Brunehilde se retournaient contre elle.
Elle le devina, essaya de prendre les devants, envoya Grégoire de Tours à Chalon avec mission officielle d’informer Gontran du projet de mariage entre Chlodoswinthe et Reccared, mission officieuse de lui indiquer fermement combien l’Austrasie s’offusquait de ses ménagements à l’égard de « l’ennemie de Dieu et des hommes », formule qui sonnait bien et dont elle venait d’affubler Frédégonde.
On était à Pâques 588, et le temps, ce printemps-là, était glacial, gelant sur les branches bourgeons et promesses de fruits. Ces conditions climatiques, spécialement exécrables au sud de la Loire, n’avaient pas empêché une délégation toulousaine d’atteindre Chalon, où elle ramena la princesse Rigonthe. Une autre ambassade, neustrienne celle-là, se trouvait déjà là, qui ramènerait la jeune fille près de sa mère.
Frédégonde s’était beaucoup démenée afin d’obtenir ce retour de son aînée, enfermée trois ans dans le cloître de Notre-Dame de la Dorade. L’avoir obtenu constituait un beau succès.
L’apparition de la princesse, maintenant âgée de dix-neuf ans et passablement aigrie par ses mésaventures, fut un coup porté au moral de la délégation austrasienne ; ce retour affermissait la dynastie neustrienne, car la légitimité de Rigonthe était incontestable et lui ouvrait droit à la couronne en cas de disparition de son petit frère. L’annexion de la Neustrie par Childebert en parut plus problématique que jamais et ce désappointement explique les jérémiades de Grégoire, qui se plaignit d’abondance de n’avoir pas été reçu avec autant d’honneurs que les envoyés neustriens ; puis il fit remarquer qu’en fait, ces gens-là n’eussent pas dû être reçus du tout. Telle n’était pas l’opinion de Gontran, qui remit vertement l’évêque à sa place, non sans l’inviter au préalable à relire les termes exacts du traité d’Andelot-Blancheville, afin de bien s’en imprégner et en souligner les violations devant son roi. L’entretien ne prenait pas une tournure aimable et pacifiée.
Grégoire, prié d’exposer le motif de sa visite, parla du conflit récurrent entre Childebert et les Lombards, conflit résultant d’anciennes alliances avec Byzance, et des prétentions austrasiennes sur certaines régions d’Italie, au nom des droits de la princesse ostrogothe Amalasonthe, la nièce de Clovis. Le Burgonde éluda : pour s’être frotté plusieurs fois aux Lombards, il connaissait leurs remarquables talents militaires et n’entendait pas s’engager contre eux dans une guerre outre-monts. Il prétexta l’épidémie de peste qui désolait la péninsule pour refuser sa participation, faisant valoir qu’il était insensé, quand les Gaules se remettaient mal d’une accumulation de catastrophes, d’aller en plus rapporter la mort noire.
Dépité, Grégoire aborda le sujet des noces espagnoles de Chlodoswinthe, et se heurta à l’incompréhension scandalisée de Gontran. Toujours en guerre avec l’Espagne, puisqu’il avait refusé les offres de paix de Reccared, il s’indignait que Brunehilde, qui l’avait encouragé, voire poussé à déclencher les hostilités, envisageât sérieusement de marier sa cadette à Tolède. Inconvenant lui paraissait le mot le plus approprié pour décrire la chose ; Reccared n’avait-il pas joué un rôle, lui aussi, dans les infortunes d’Ingonde, ces infortunes qui avaient conduit la jeune femme à la fuite, à l’exil, au veuvage, à une mort prématurée ? L’Austrasie n’avait-elle pas incité la Burgondie à entrer en guerre à cause de cette Faide déclenchée pour venger la princesse ? L’avait-on oublié ? En un mot comme en cent, « il n’était pas bon que Chlodoswinthe s’en allât au pays qui avait tué sa sœur, et il était plus mauvais encore que l’assassinat d’Ingonde ne fût pas vengé10 ».
Grégoire objecta que les Espagnols étaient prêts à payer tous les dédommagements exigibles, argument décisif puisque ces affaires d’honneur germaniques se terminaient toujours en histoires de gros sous. Il n’y avait rien à répliquer à cela et Gontran donna, du bout des lèvres, un consentement de principe, assorti d’une condition : il bénissait l’union, si Childebert tenait ses engagements d’Andelot-Blancheville. Grégoire jura la main sur le cœur que le roi d’Austrasie les respecterait au pied de la lettre. Ce ne serait certainement pas le cas, et les deux interlocuteurs le savaient, mais, de toute façon, Gontran ne disposait d’aucun moyen de s’opposer à ce mariage ; mieux valait donc feindre de l’approuver11.
Cela réglé, on passa au fond du dossier : les doléances de Brunehilde au sujet de la Neustrie. Grégoire les résuma avec tant d’acrimonie que Gontran prit le parti d’en rire et s’écria :
— À ce que je constate, vous avez plus que jamais resserré les liens d’amitié entre ma sœur Brunehilde et la reine Frédégonde !
Et l’évêque de rétorquer le plus sérieusement du monde que les liens en question n’avaient jamais été aussi forts. Puis, cri étonnant dans la bouche d’un homme de Dieu, il précisa :
— Sache, ô roi, que la haine qui s’est jadis élevée entre ces deux femmes ne cesse d’augmenter sans jamais se tarir. Plaise au Ciel que tu témoignes moins d’égards à Frédégonde car nous avons eu souvent le déplaisir de constater que tu faisais meilleur accueil à ses envoyés qu’aux nôtres…
C’était beaucoup dire si l’on se souvenait que, l’année précédente, l’ambassade neustrienne avait fini en prison !
Gontran répondit qu’il n’accueillait pas les envoyés de « l’ennemie de Dieu et des hommes », mais ceux de son neveu Clotaire, ce qui ne revenait pas au même et que ces relations ne nuisaient nullement à sa grande affection pour Childebert. Grégoire grinça qu’il était tout de même étonnant de le voir ménager une femme qui avait à maintes reprises tenté de le faire assassiner. Gontran rebondit sur le mot, suggéra qu’Austrasie et Burgondie se missent d’accord afin de former une commission d’enquête qui reprendrait l’étrange dossier de la mort de Prétextat. Cela signifiait, en termes voilés, que, réflexion faite, il ne croyait qu’à demi à l’implication de Frédégonde dans ce crime, et se demandait quel rôle les Austrasiens avaient tenu dans l’histoire. Curieusement, Grégoire, qui avait appelé à venger l’évêque de Rouen tant que les soupçons visaient Frédégonde, éluda toute réouverture du dossier dès lors qu’il était question d’aller au fond des choses et affirma que cette affaire n’intéressait plus personne.
Décidément, il était vrai que la haine ne faisait que grandir entre les reines, et que Brunehilde ne reculait devant rien afin de l’entretenir. Cette constatation, pour n’être pas nouvelle, était inquiétante.
Gontran vieillissait, sort commun, et pensait souvent à sa mort, plus souvent encore à ce qui arriverait ensuite à la Francia. Tomberait-elle au pouvoir de Childebert, c’est-à-dire à celui de sa mère, cette femme redoutable dont l’adolescent, dénué de personnalité, ne parvenait pas à s’émanciper ? Brunehilde possédait d’authentiques qualités de souveraine mais elle était wisigothe et cette origine ne rassurait pas Gontran : qu’attendre de bon de l’ennemi héréditaire ? Il soupçonnait que la reine d’Austrasie poursuivrait sa guerre personnelle contre la Neustrie, au détriment, éventuellement, du bien du royaume et de la dynastie. Analyse exacte.
Fallait-il, alors, lui donner satisfaction sous prétexte de préserver la paix et l’unité du royaume, et sacrifier Clotaire ? L’enfant avait maintenant quatre ans et sa ressemblance avec Chilpéric s’accentuait assez pour ne laisser aucun doute sur sa filiation. Inimaginable, dès lors, de le priver de sa part légitime. À condition, bien entendu, qu’il survécût… Était-il sage de mécontenter l’Austrasie sous prétexte de préserver les droits d’un petit garçon qui n’aurait peut-être jamais l’âge de régner ?
Dilemme dont Gontran se tira avec son entregent ordinaire, en ne tranchant pas entre ses neveux :
— Si mon neveu Childebert se scandalise de me voir recevoir les envoyés de Clotaire, mon autre neveu, c’est parce que je ne suis pas assez fou pour ne pas m’interposer entre eux et tenter d’empêcher que leur discorde s’aggrave. Je préfère y mettre un terme que la laisser se prolonger.
Cela dit à l’intention de Brunehilde, si prompte à se vanter d’entretenir et d’accroître les haines familiales. Puis, pour rééquilibrer la balance, il annonça, nouveauté qui consternerait la reine d’Austrasie, qu’il entendait désormais réserver une part de son héritage, « deux ou trois cités tout au plus », à Clotaire pour que le petit roi ne se sentît pas déshérité par son oncle.
« Deux ou trois cités », qui pouvaient fort bien compter parmi les plus belles de Burgondie, ou se révéler des places stratégiques, c’était beaucoup, surtout retirées d’un héritage jusque-là censé aller tout entier à Childebert. En l’apprenant, Brunehilde suffoqua de fureur, puis, sa colère retombée, elle chercha les moyens de compenser cette perte. Conforter l’annexion du Soissonnais, opérée au lendemain de la mort de Chilpéric, mais jamais admise par la Neustrie, lui parut l’option la plus sûre.
La première partie du plan consista à convoquer à Metz le duc de Soissons, Rauching, puis à le liquider sans autre forme de procès sous une vague accusation de trahison au profit de la Neustrie. Personne n’y crut. Rauching avait choisi son camp en 584 : celui de Childebert II, lâchant sans scrupule le parti neustrien qu’il estimait perdu. Non content d’avoir livré Soissons, capitale du royaume, à l’Austrasie, il avait épousé la cause de Brunehilde jusqu’à l’assister dans ses manigances contre Frédégonde. C’était lui qui avait monté la fausse tentative d’assassinat contre Childebert en 585, fait arrêter deux malheureux clercs et leur avait extorqué sous la torture une effroyable confession qui accablait « la Sorcière de Neustrie ». Un pareil dévouement méritait meilleure récompense…
Mais Brunehilde n’était pas sentimentale, et la gratitude n’était pas sa vertu dominante. Elle se méfiait de Rauching, apparenté à la dynastie, donc dangereusement puissant, soupçonnait un traître de rester un traître, capable, s’il y trouvait son intérêt, de tous les revirements profitables, et convoitait une fortune considérable qui aiderait à renflouer les caisses austrasiennes.
Le duc occis, la reine assura son emprise sur Soissons en l’érigeant en royaume « indépendant », dont elle remit la couronne à son petit-fils, Théodebert, un enfant de cinq ans. Cela n’avait évidemment aucune importance politique mais flattait une aristocratie locale à la loyauté douteuse qui déplorait l’abaissement d’une ville jadis capitale prestigieuse.
Une fois encore, la reine d’Austrasie se livrait à un cavalier seul des plus alarmants qui conduisit Gontran à prendre à l’encontre de la cour de Metz des mesures de rétorsion ; la plus lourde fut la suspension des clauses du traité d’Andelot-Blancheville, assortie de la menace d’annuler l’adoption de Childebert.
Frédégonde eût exulté si, au début de 590, son fils n’était tombé gravement malade. C’était la réédition des drames précédents, des heures de désespoir passées au chevet de ses enfants à l’agonie, de l’angoisse et du chagrin, avec ce poids supplémentaire de savoir que la disparition de Clotaire entraînerait, presque à coup sûr, la chute de sa mère. Plus de mari pour la protéger, plus d’espoir d’enfanter un dernier héritier. Frédégonde ne survivrait pas à son fils, et elle le savait.
Les premiers jours, elle chercha à dissimuler l’état de santé du petit roi ; mais Gontran et Brunehilde gardaient, en dépit des mesures prises afin d’écarter les espions, des oreilles à la cour de Rouen. Ils ne tardèrent pas à être informés, ne songèrent pas à cacher la joie et le soulagement que leur causait la disparition, qu’on leur avait assurée inéluctable, d’un enfant qui leur avait terriblement compliqué la vie. Bientôt, le bruit se répandit, insistant, que Clotaire se trouvait à l’agonie. On parlait même de lui administrer le baptême en urgence.
Qu’à six ans passés, le petit roi n’eût toujours pas été baptisé relevait moins de l’inconséquence et de la légèreté religieuse de Frédégonde que d’une nécessité politique. Chacun comprenait depuis sa naissance que la cérémonie équivaudrait à une reconnaissance de ses droits, acte que Gontran, son tuteur, un homme qui aimait se poser en bon catholique, repoussait par principe. Prétextat lui-même, tout évêque qu’il fût, n’avait jamais soulevé l’aspect moral de cette omission.
Frédégonde, pénétrée de l’importance d’une cérémonie qui déciderait de l’avenir et de la couronne de son fils, devait être véritablement désespérée et folle d’angoisse pour lui faire administrer le sacrement à la sauvette, exclusivement afin d’assurer son salut éternel.
Cette constatation poussa Gontran à se rendre à Rouen. Il fallait doubler Brunehilde qui tenterait de faire main basse sur la Neustrie. Le roi de Burgondie désirait-il aussi mettre la reine Frédégonde à l’abri de la furie austrasienne ? Ce n’était pas impossible, car il éprouvait envers elle une incontestable admiration, non dénuée d’attirance amoureuse. À cinquante ans, « la Sorcière » conservait une grande part de sa beauté et de cette séduction qui avait autrefois exercé tant d’emprise sur tous les hommes qui l’approchaient.
Que fût-il advenu de la reine si Clotaire avait rendu l’âme ? On ne sait car, alors que le cortège du roi de Burgondie atteignait les bords de Seine, un messager envoyé aux nouvelles revint, l’air consterné, annoncer que le petit roi de Neustrie avait surmonté le mal et qu’il se portait à merveille. La reine en rendait grâces au grand saint Martin de Tours auquel elle avait fait vœu sur vœu pour la guérison de son fils, et qui l’avait exaucée12.
Gontran avait perdu de vue un détail : si Frédégonde avait accepté si longtemps d’ajourner le baptême de son fils, c’était que l’enfant jouissait d’une santé robuste et d’une forte constitution.
Il fallut repartir l’oreille basse, ridicule et déçu, passablement irrité contre saint Martin qui donnait l’impression, en cette circonstance, d’avoir appuyé « l’ennemie de Dieu et des hommes ». La reine de Neustrie n’oublierait pas de sitôt l’indécente promptitude de son beau-frère à venir enterrer son fils, attitude qu’aucune mère ne saurait pardonner…
Frédégonde songeait-elle aussi que Gontran avait, en cette situation, fait bon marché des droits de l’autre héritière, sa nièce Rigonthe ? Certainement. La reine n’eût pas manqué, pourtant, de les faire valoir et de les défendre, bec et ongles, comme son ultime chance de survie.
La princesse avait-elle, en ces jours cruels de 590, aspiré au trône de Neustrie ? Le conquérir eût été terriblement difficile mais Rigonthe tenait de ses parents, et surtout de sa mère, un tempérament ardent et batailleur avec lequel son oncle eût été obligé de compter.
Tempérament qui, au demeurant, rendait chaque jour la cohabitation entre Frédégonde et sa fille plus pénible. Le palais de Rouen retentissait de leurs cris, de leurs scènes, de leur fureur mutuelle, de leurs emportements. Les mauvaises langues prétendaient avoir vu les deux femmes se crêper le chignon telles des harengères, détail peut-être quelque peu exagéré.
Rigonthe enrageait. L’échec grotesque du mariage espagnol, le dédain de Reccared, qui avait osé, le misérable, réclamer la main de sa cousine Chlodoswinthe à la place de la sienne, l’avaient privée de toute valeur sur le marché restreint des alliances royales. Elle ne serait pas reine et en tenait, abusivement, sa mère pour responsable. Si, en 584, Frédégonde n’avait pas tant tardé à la laisser partir, si elle n’avait pas eu cent prétextes à la retenir un jour de plus auprès d’elle, la princesse eût atteint la frontière pyrénéenne avant que la nouvelle de l’assassinat de son père se répandît, et elle eût régné sur l’Espagne ! Avenir fantasmé, car rien n’assurait que Léovigild, au courant de la mort de Chilpéric, n’eût pas réexpédié sa fille en Francia, jugeant le mariage sans valeur… Mais c’était là un langage que la princesse se refusait à entendre.
Puisqu’elle ne serait pas reine d’Espagne, au moins voulait-elle un mari, et tout de suite ! Exigence que Frédégonde n’entendait pas satisfaire. Marier Rigonthe était une décision politique qui engageait l’avenir de la dynastie, au cas où son frère viendrait à disparaître ; hors de question de la donner au premier venu et de la laisser s’amouracher d’un dignitaire ou d’un leude sous le pauvre prétexte qu’il avait de beaux yeux ou une fière prestance à cheval.
Langage, là encore, intolérable pour une fille affolée par la crainte de monter en graine et qui voulait un homme. Avait-elle jeté son dévolu sur quelqu’un ? Lui avait-elle fait des avances ? Lui avait-elle cédé ? Les malveillants le murmuraient avec des mines scandalisées, et affirmaient que Frédégonde n’eût pas été tellement en colère si elle n’avait point découvert que sa fille avait un amant…
Bruits vraisemblablement infondés mais d’une certaine gravité. En droit germanique, c’était l’union charnelle qui faisait la légitimité du mariage, non la bénédiction religieuse. Si Rigonthe avait ouvert sa couche à un homme, celui-ci devenait son époux selon la coutume franque et cette éventualité avait de quoi contrarier Frédégonde.
Rien ne confirma ces médisances mais le calme ne revint pas pour autant au palais. Mère et fille s’étaient installées dans une relation tissée d’amour et de haine, violente et passionnelle, qui leur était devenue nécessaire13.
Si la guérison de Clotaire avait accablé Gontran, elle ranima de plus belle la haine de Brunehilde qui reprit comme devant ses menées et inventa d’extravagants complots dont elle accusait Frédégonde.
La reine Faileuba, la jeune épouse de Childebert, avait, courant 590, fait une fausse couche, accident qui mit sa vie en danger et la contraignit à garder longuement le lit, dévorée de fièvre et presque comateuse. Délirait-elle, ou bien, la croyant inconsciente et hors d’état de comprendre ce qui se disait autour d’elle, ceux qui la veillaient omirent-ils toute prudence et parlèrent-ils vraiment à son chevet d’assassiner Childebert et Brunehilde, puis de porter les petits Théodebert et Thierry au pouvoir, s’arrogeant la régence au nom des deux enfants ? Il est malaisé de trancher, mais, quand Faileuba fut en état de parler, elle informa sa belle-mère du projet qui impliquait plusieurs hauts dignitaires, et la nourrice des jeunes princes. Le scénario, plausible, entraîna une purge expéditive au sein du personnel palatial austrasien, dans laquelle la reine inclut sans barguigner un certain nombre de dignitaires dont sa bru n’avait point prononcé les noms mais qui gênaient sa politique. La plupart de ces épurés avaient, à un moment ou un autre, eu des liens avec la Neustrie. Les retombées de cette affaire, qui n’était peut-être que le fruit du délire d’une malade, se manifestèrent jusqu’au mois de novembre, date à laquelle un concile réuni à Metz déposa l’évêque de Reims, Ægidius, accusé d’avoir toute sa vie servi la cause neustrienne.
Bien que rien ne permît d’impliquer Frédégonde dans ce règlement de comptes interne à la politique austrasienne, et que personne n’eût prononcé son nom, Brunehilde s’ingénia d’un bout à l’autre de l’affaire à laisser planer le soupçon sur sa belle-sœur.
Puis, quand elle eut bien préparé les esprits à de nouvelles et plus terribles révélations, on arrêta, à la porte de l’oratoire de la villa royale de Marlenheim, un individu suspect qui, sous les coups, avoua avoir été payé pour assassiner le roi Childebert quand il se rendrait à l’église. À l’entendre, il appartenait à un groupe de douze hommes, divisé en deux équipes de six, envoyés par Frédégonde et qui se relaieraient dans ce projet tant que le roi d’Austrasie serait en vie…
On interpella quelques-uns des tueurs présumés qui subirent les supplices et les mutilations réservés aux régicides ; d’autres suspects préférèrent se suicider. Tout cela était bien commode puisque cela évitait des contre-interrogatoires et des vérifications ultérieures14 mais ne démontrait en rien l’implication de Frédégonde. Seul le recours, déplorablement maladroit, à un unique modus operandi répétitif à en devenir stupide était censé démontrer sa culpabilité. À moins d’admettre que la reine de Neustrie était la femme la plus sotte qui fût, reproche que nul ne lui avait jamais adressé, et qu’elle recourait aux services des tueurs les plus maladroits de la profession, ce qui était faux, il fallait chercher, encore et toujours, les responsables de ces mises en scène de plus en plus ridicules dans l’entourage immédiat de Brunehilde.
L’épuration du personnel austrasien avait aussi entraîné la déchéance de quelques fidèles de Gontran, ce qui signifiait la volonté de la reine d’Austrasie d’en finir avec la tutelle théorique de son beau-frère. Le Burgonde apprécia peu cet acte d’hostilité indirect ; il ne s’était résolu à l’adoption de Childebert qu’en désespoir de cause, comme à un moindre mal et tenait au moins, en échange, à ce qu’on lui accordât l’apparence du pouvoir unique. Il était maintenant un vieil homme sexagénaire qui n’irait plus très loin et qui s’en consolait en se figurant sous les traits du roi de la Francia, rôle qu’à la différence de son père il avait réussi à occuper sans guerre ni bains de sang, en se servant de l’impuissance de ses belles-sœurs et de leurs rejetons. Il tenait à ce qu’on préservât cette illusion jusqu’à sa mort. Or, Brunehilde ne se prêtait plus à la comédie depuis que son fils avait atteint l’âge d’homme.
Décidément, il devenait urgent de rogner les crocs de cette ambitieuse. Gontran fit savoir à la fin de l’année qu’il célébrerait lors des fêtes de Pâques15 591 le baptême de son neveu Clotaire et serait le parrain du jeune roi.
Le programme des festivités, à Paris, laissait supposer une cérémonie grandiose, royale, qui rappelait par plus d’un point celle de l’adoption de Childebert. En tenant le petit roi de Neustrie sur les fonts baptismaux, Gontran procédait d’ailleurs à une autre forme d’adoption, d’ordre spirituel, qui ferait de Clotaire son fils devant Dieu. Ce choix assumé et public ressemblait à une remise en cause des accords antérieurs entre la Burgondie et l’Austrasie, une remise en cause, surtout, des clauses du traité d’Andelot-Blancheville qui instituaient Childebert unique héritier de son oncle.
Folle de rage, Brunehilde lui envoya une nouvelle ambassade chargée d’exposer les doléances austrasiennes : à l’entendre, parrainer Clotaire revenait à renier et déshériter Childebert.
Gontran joua la surprise, la tristesse et plaça sa décision sur un plan strictement religieux : la grave maladie de son neveu au début de l’année lui avait fait prendre conscience de ses devoirs ; il ne se fût point pardonné que le malheureux enfant eût rendu l’âme sans avoir reçu le sacrement dans des conditions dignes de son rang et de sa naissance. En tant que souverain catholique et chef de la dynastie, il lui revenait de réparer au plus vite cette coupable et trop longue négligence.
Les Austrasiens ne crurent pas une seconde à cette soudaine crise de scrupules mais se retirèrent sans avoir rien obtenu de Gontran sinon l’assurance de l’immense tendresse qu’il portait à Childebert et à sa chère maman…
Informée, Frédégonde resta d’abord dans une prudente expectative. Deux fois déjà par le passé, Gontran avait fixé une date pour le baptême de Clotaire, posé des conditions passablement humiliantes, avant de trouver un prétexte à repousser la cérémonie sine die. Ces reports avaient servi la propagande austrasienne : tantôt le roi de Burgondie éprouvait des doutes au sujet de la légitimité de l’enfant, tantôt la cour de Neustrie n’osait pas le montrer en public de peur que sa bâtardise ne fût trop visible, ou parce qu’on avait substitué un fils de serfs à l’héritier du trône. Ces calembredaines, hélas, trouvaient toujours un public.
La reine craignait de voir la comédie se reproduire, et un nouvel affront. S’y mêlait l’inquiétude maternelle à la pensée de laisser l’enfant s’éloigner d’elle plusieurs jours ou plusieurs semaines. Sa crainte panique de l’attentat, de l’empoisonnement, de la maladie brutale, ne l’avait pas lâchée ; tout lui semblait péril autour de son fils. Elle le quittait le moins possible. Or, Gontran refusait la présence de sa belle-sœur aux cérémonies parisiennes.
Au vrai, il ne s’agissait pas de faire insulte à Frédégonde mais de réaffirmer la puissance intacte de la lignée masculine et de fixer un terme à ce pouvoir des femmes qui, à travers les deux régentes, s’était déjà trop exercé au goût du roi de Burgondie. Il avait pareillement écarté Brunehilde jadis des cérémonies d’adoption de Childebert, et n’avait pas manqué, en cette occasion, de mettre son neveu en garde contre l’influence maternelle, leçon qui n’avait guère frappé l’enfant de sept ans. Les remontrances identiques qu’il croirait bon d’adresser à Clotaire n’auraient évidemment pas plus de poids. Les deux cousins avaient trop besoin de leurs mères.
Brunehilde ne désarmait pas encore, dans l’espoir d’obtenir l’annulation ou le report des festivités. Pour ce faire, elle n’hésita pas à essayer de compromettre Frédégonde dans le scandale qui secouait alors le royaume et que l’on avait appelé « la révolte des nonnes ».
La mort de la reine Radegonde, en août 587, avait été pour la communauté du monastère Sainte-Croix de Poitiers un choc et une douleur considérables, ravivés l’année suivante par le décès prématuré de l’abbesse Agnès, sa fille d’élection et sa continuatrice. La nouvelle abbesse, Leubovère, avait fait aussitôt l’unanimité contre elle. Sous sa direction maladroite, la vie conventuelle, supportable et digne du vivant de la sainte et de Mère Agnès, était devenue odieuse à nombre de religieuses cloîtrées non par vocation mais par la volonté de leur famille, ou pour raisons politiques, cas des princesses Clotilde, fille du roi Caribert, et Basine, fille de Chilpéric.
Clotilde, surnommée la Superbe car la religion n’avait pas courbé son orgueil de race, prit la tête d’une mutinerie dans laquelle elle entraîna, outre sa cousine, plus de quatre-vingt-dix jeunes moniales. Au début, elles réclamaient simplement la déposition de leur abbesse, jugée de trop modeste naissance pour commander à des femmes de leur rang. L’Église ne leur donnant pas raison, elles accablèrent la malheureuse de calomnies insanes, l’accusant d’avoir de nombreux amants qu’elle accueillait en clôture, entre autres des ouvriers qui achevaient les travaux du monastère et qu’elle autorisait à fréquenter les thermes des religieuses. Une enquête démontra l’inanité de ces accusations.
Alors, faute d’obtenir raison, Clotilde s’exclaustra en compagnie de Basine et des autres, sous prétexte d’aller elle-même plaider leur cause devant son oncle Gontran et son cousin Childebert.
Pitoyable équipée, à laquelle s’étaient associés des hommes sans foi ni loi, épaves des conflits successifs qui avaient ensanglanté le Poitou, qui prêtèrent volontiers leur appui à des nonnettes jeunes, jolies et bien nées. Les moniales évadées étaient encore loin de Chalon ou de Metz que nombre d’entre elles arboraient déjà les signes de grossesses manifestes. En cours de route, leurs gardes du corps trop attentionnés avaient assassiné un certain nombre de personnes qui tentaient de les raisonner et profané plusieurs sanctuaires en s’y livrant à de véritables orgies.
Scandale épouvantable auquel il serait long et difficile de mettre un terme. Si Basine et quelques-unes de ses compagnes finiraient par réintégrer Poitiers, apparemment contrites et repentantes, une majorité resterait dans le monde, s’y marierait, y élèverait les enfants conçus pendant leur extravagante expédition. Clotilde elle-même obtiendrait de sa famille sa liberté, assortie des droits et garanties qui avaient été à Andelot-Blancheville consentis à ses cousines Chlodoswinthe d’Austrasie et Clotilde de Burgondie, leur permettant de vivre indépendantes et sans souci16.
Au printemps 591, cette conclusion était loin de se dessiner et l’on s’interrogeait sur les causes exactes qui avaient conduit à cette rébellion sans exemple. Clotilde la Superbe, qui avait besoin à la fois d’obtenir la levée de l’excommunication qui l’avait frappée d’office, et l’appui de sa tante Brunehilde, lui rendit le signalé service de mêler le nom de Frédégonde à cette sale histoire. Elle prétendit que Leubovère et ses partisanes, amies de l’évêque Marovée, appartenaient au parti neustrien, en défendaient ardemment les intérêts à Poitiers, conspiraient jour et nuit contre l’Austrasie. Ces crimes s’assortissaient évidemment de mauvais traitements répétés à l’encontre des religieuses fidèles à la couronne austrasienne. Autrement dit, c’était pour ne pas se ranger dans le camp de « l’ennemie de Dieu et des hommes » que les édifiantes consacrées avaient brisé la clôture et violé leurs vœux.
Argument pour le moins spécieux qui avait le mérite d’éclabousser une fois de plus la réputation déjà tellement entachée de la reine de Neustrie.
Gontran ne s’y laissa pas prendre ; tout au plus cela l’incita-t-il à maintenir le refus opposé à Frédégonde d’assister au baptême de son fils. Elle s’inclina d’autant plus volontiers que son beau-frère, exaspéré par les provocations austrasiennes, semblait décidé à célébrer tout de bon la cérémonie prévue.
Le roi de Burgondie n’accorda qu’une concession à l’Austrasie : le baptême ne serait point célébré à Paris, comme initialement prévu, mais à Nanterre. Lui-même ferait certes une entrée solennelle dans la capitale mais n’y résiderait pas, afin de respecter les termes du partage de 568 qui interdisait aux rois de s’installer à Paris sans le consentement de leurs parents et cohéritiers. Anxieux et superstitieux, Gontran se souvenait que Sigebert et Chilpéric avaient tous deux bizarrement trouvé une mort violente peu après avoir violé ce pacte juré sur de très saintes reliques. Il préférait de pas encourir pour si peu le courroux du Ciel et se contenta de loger dans la villa royale de Rueil.
Le choix de Nanterre, s’il semblait moins prestigieux, revêtait pourtant une certaine importance, car Gontran avait tenu à ce que Clotaire fût baptisé sur les fonts qui avaient servi, disait la tradition locale, lors du baptême de sainte Geneviève, l’amie de Clovis et Clotilde, l’une des patronnes de la dynastie mérovingienne. Le destin de la diaconesse héroïque était trop intimement mêlé à l’histoire de Paris pour qu’il n’y eût pas là un symbole fort propre à compenser ce changement de sanctuaire.
Gontran hésitait-il encore, cependant ? Une crise de goutte, qui sentait un peu la maladie diplomatique, le retint quelques jours au lit, repoussant les célébrations, comme s’il attendait quelqu’un ou quelque chose ; sans doute une ultime ambassade austrasienne, qui n’apporta aucune promesse de la part de Brunehilde et Childebert, mais accusa le roi de Burgondie de s’apprêter à faire reconnaître la souveraineté de Clotaire et de la Neustrie sur Paris. Telle n’était pas son intention, mais cette intervention l’agaça davantage encore et l’incita à donner au petit roi des gages qu’il n’avait pas l’intention de lui accorder avant l’irruption des envoyés austrasiens.
Quand les évêques de Lyon, d’Autun et de Chalon, qui avaient procédé au baptême, lui remirent son filleul, Gontran confirma qu’il lui donnait le prénom de Clotaire, ce qui le rattachait solennellement et définitivement à la dynastie, faisant taire toute rumeur sur sa légitimité, et, montrant le petit garçon, il s’écria :
— Puisse cet enfant grandir ! Puisse-t-il voir se réaliser tout ce qu’augure son prénom17 ! Puisse-t-il enfin jouir de la même puissance qui fut celle de l’aïeul dont il porte le nom18 !
Ces vœux de longue vie et de prospérité dissimulaient un autre message que Childebert et Brunehilde feraient bien de méditer : si Clotaire réalisait le programme que lui imposait son royal prénom, il deviendrait un jour capable de reconquérir l’épée à la main ce royaume dont ses proches avaient cherché à le spolier. Childebert se voyait déjà roi de la Francia. Ce titre, son jeune cousin le lui ravirait peut-être19. L’avenir n’était pas écrit.
Cet avertissement, faussement ambigu, fut clairement reçu à Metz. Il eut le mérite d’inciter Brunehilde à observer plus de réserve vis-à-vis de la Neustrie. Un temps, les attaques cessèrent ; il ne fut plus question de complots déjoués ni d’assassins démasqués à l’instant de commettre leur infâme forfait.
Frédégonde, satisfaite au centuple des assurances que son fils avait reçues à Nanterre, observa une égale réserve, de sorte qu’un observateur superficiel eût presque conclu à une pacification réelle, acceptée, réciproque. La disparition de Gontran fit voler en éclats cette tranquillité factice.
Après avoir tellement craint de périr assassiné à l’instar de ses frères, le roi de Burgondie s’éteignit paisiblement, d’une maladie banale, en son palais de Chalon, le 28 mars 593. Comme il l’avait promis, la Burgondie alla à Childebert, sans qu’il en fût rien soustrait au profit de son cousin, ainsi que Gontran l’avait laissé entendre autrefois ; mais toutes dispositions avaient été prises afin de préserver les droits de Clotaire et le maintien des frontières neustriennes.
Solution de sagesse et d’équité, que l’Austrasie refusa d’emblée ; ce n’était pas vraiment une surprise. Les souverains de l’Est n’attendaient que d’être délivrés de l’encombrante tutelle burgonde pour chercher l’occasion d’en finir avec le royaume rival. Frédégonde et ses conseillers le prévoyaient, ce qui justifiait les accords discrètement passés au cours des mois écoulés avec la Bretagne, seule alliée potentielle.
La rapidité de l’action austrasienne prit cependant la Neustrie de court. Vers le mois de mai 593, après avoir obtenu des engagements solennels de la part des leudes de Soissons et de Meaux, territoires neustriens dont Gontran avait demandé le retour à leur roi légitime, Brunehilde déclencha une attaque sur Tournai. Tenir Soissons, capitale historique de la Neustrie, ne lui suffisait pas ; elle voulait aussi le berceau de la dynastie. Et un prétexte à légitimer son coup de force.
Frédégonde et Clotaire résidaient alors à Tournai, cité plus prestigieuse que Rouen, plus associée aux fastes mérovingiens, et dont il était plus facile de surveiller la dangereuse frontière austrasienne, voire de chercher l’occasion de reprendre Soissons.
La noblesse locale se déchirait depuis des années pour une Faide rancie qui n’avait pas trouvé de solution, ses protagonistes étant tous morts. L’affaire avait commencé en vaudeville, avec une histoire d’adultère. La stricte monogamie et la fidélité conjugale peinant à entrer dans les mœurs franques, l’entretien d’une concubine ou d’une maîtresse n’entraînait pas d’ordinaire de réactions violentes, mais la famille de l’épouse bafouée prit la mouche, parce que le mari volage fréquentait des prostituées au vu et au su de toute la ville. Comme l’excellent garçon refusait de revenir à une pratique plus honnête du mariage, le clan de sa femme le trucida. Ce fut le début d’une vendetta féroce qui cessa en peu de jours, faute de combattants, les deux familles ayant fini par s’entre-tuer. En toute logique, cette Faide disproportionnée eût dû s’arrêter là ; mais la perspective de gros dommages et intérêts motiva, des deux bords, des parents éloignés à se porter parties au procès. Il y avait dix ou quinze ans que l’affaire traînait, sans que les plaignants parvinssent à s’entendre et à tomber d’accord sur des réparations, puisque chacun se posait en victime au lieu d’admettre les torts partagés.
Frédégonde détestait ce droit germanique, où tout se résumait à des versements en argent ; elle n’avait jamais compris, jamais admis ces réparations qui, selon elle, ne réparaient rien et ne satisfaisaient ni l’honneur ni la vengeance. Dans ce cas précis, toutefois, ce qui l’irritait surtout, c’était la mauvaise foi de ces cousins éloignés, qui n’avaient certainement pas versé une larme sur les défunts et qui s’empoignaient pour quelques sous supplémentaire.
La reine avait usé de tous les moyens de conciliation, tenté de faire admettre l’extinction de l’action du fait de la mort de tous les protagonistes, conjuré les plaideurs de trouver enfin un accord. En vain : les trois représentants des familles campaient sur leurs positions.
Frédégonde tenta une dernière conciliation, au palais, au cours d’un « banquet de réconciliation » ; ni les mets délicats, ni les sauces savoureuses, ni le vin, la bière et l’hydromel qui coulaient à flots n’apaisèrent les rancunes. À la fin du repas, Frédégonde, excédée, mit les plaignants d’accord en les faisant exécuter tous les trois, pour le rétablissement de l’ordre public. Belle démonstration du peu de cas qu’elle faisait de la justice franque, en même temps que d’une certaine sagesse expéditive mais assez féminine.
Évidemment, la noblesse de Tournai n’apprécia pas le procédé et livra la ville à Brunehilde20. Jolie façon de justifier une félonie calculée qui ne devait pas grand-chose à cette étonnante décision de justice.
Qu’y avait-il de vrai au demeurant dans cette histoire que la propagande austrasienne raconta, répandit, exploita ? Rien peut-être mais cela servait à merveille la cause de Childebert et de sa mère, puisque Frédégonde apparut une fois de plus sous les traits d’une adepte systématique de la violence politique, souveraine illégitime prête à détourner et ridiculiser la plus sainte des fonctions régaliennes, la justice, et que ce geste, ce choix soulignaient à quel point cette indigène gauloise restait fondamentalement étrangère aux façons d’être, d’agir et de penser de la race franque.
Ce succès obtenu par trahison se révéla sans lendemain. Certes, Frédégonde et son fils avaient été contraints de fuir Tournai, mais, au début de l’été, ils revinrent en force, la reine exerçant l’autorité militaire, le jeune Clotaire, maintenant âgé de neuf ans, chevauchant à côté d’elle, et parvinrent à reprendre par les armes non seulement Tournai mais Soissons, au terme d’une bataille livrée à Trucy, défaite que les Austrasiens s’ingénièrent à minimiser, jusqu’à la faire passer pour une ridicule escarmouche.
Tout laisse pourtant supposer que le combat fut dur, acharné, et que les troupes de Childebert, rudement étrillées, perdirent un nombre considérable d’hommes dans l’affrontement.
Sans cela, pourquoi l’Austrasie eût-elle lâché deux villes symboliques, deux capitales mérovingiennes convoitées ? Elle craignit même un moment que la Champagne, zone frontalière peu sûre où la Neustrie avait toujours compté des sympathies, basculât à son tour. La perte de Reims eût été un terrible revers, qui fut évité de justesse.
Frédégonde ne disposait pas de forces suffisantes pour continuer une campagne militaire en territoire austrasien. La reconquête de Soissons et de Tournai, légitime, lui suffisait, du moins pour l’instant. Elle nourrissait d’autres ambitions, d’autres projets, notamment la reprise de Paris et de l’Île-de-France, perdus à la mort de Chilpéric, territoires qui restaureraient la Neustrie dans ses frontières historiques, mais comprenait qu’il fallait attendre. Quelques années, le temps que Clotaire fût en âge d’exercer le commandement, ou de paraître l’exercer. Les guerriers suivraient plus volontiers le jeune roi que sa mère. Ainsi raisonnaient les hommes et il fallait s’en accommoder.
Frédégonde les connaissait trop bien pour ne pas ménager leurs préjugés absurdes.
Moins sage, Brunehilde tenta, à l’été 594, de reprendre les hostilités sur le front de l’Ouest, en attaquant l’allié breton de la Neustrie par le Cotentin. Cette expédition ne lui réussit pas mieux que la précédente, car les Austrasiens se heurtèrent à un corps de renfort neustrien venu au secours des Bretons, qui les obligea à retraiter.
Un équilibre précaire s’établit entre les deux monarchies. Nul n’aurait su prédire combien de temps il durerait.
Un événement imprévisible vint le rompre : les morts simultanées du roi Childebert II et de la reine Faileuba, survenues à quelques heures d’intervalle dans le courant de l’hiver 595-596.
Brunehilde, fidèle à elle-même, hurla à l’assassin, accusa la Neustrie, et Frédégonde, d’avoir versé du poison dans les plats servis à la table du couple royal. Peut-être, pour une fois, y avait-il eu empoisonnement véritable21, mais dans ce cas, il s’agissait d’une intoxication alimentaire due à une viande mal fumée entraînant le botulisme, pas d’un crime.
La disparition prématurée de Childebert II, qui n’avait guère dépassé ses vingt-cinq ans, affecta certainement la reine d’Austrasie, privée à l’improviste d’un fils incarnation de tous ses rêves et toutes ses ambitions, mais ne changea pratiquement rien à la politique et à la vie du royaume de l’Est. Personnalité faible et malléable, le jeune roi était demeuré toute sa courte vie un docile pantin entre les mains expérimentées de sa mère. Il n’avait jamais été qu’un commode prête-nom et nul ne sut quel éloge accorder à ce défunt dépourvu d’envergure22.
Il eût fallu le talent et le dévouement dynastique de Grégoire pour donner un peu d’ampleur et de couleurs à ce drame ; mais l’évêque de Tours avait rendu l’âme le 17 novembre 594, laissant inachevée sa chronique historique à la gloire de l’Austrasie23.
La principale conséquence de cette mort n’échappa point à Frédégonde : Childebert II, qui s’était trop tôt imaginé roi unique de la Francia, disparu, ses terres partagées entre ses deux fils, des enfants, Clotaire II, à la veille de la majorité royale, prenait une envergure inespérée. La reine de Neustrie n’avait aucune part dans le trépas de l’Austrasien ; il n’empêche qu’il servait à propos les intérêts de son fils.
Seul acte posé par le défunt, Childebert avait rédigé son testament, par lequel il léguait l’Austrasie à son aîné, Théodebert, la Burgondie à son cadet, Thierry, avec Orléans pour capitale en place de la Chalon de Gontran. Moins de trois ans après la mort de ce dernier, la réunification tant attendue se trouvait déjà caduque. Pis encore, Brunehilde prit apparemment sur elle, sous prétexte de ne pas défavoriser l’un de ses petits-fils par rapport à l’autre, et créer ainsi des tensions, d’agrandir le territoire burgonde de gros morceaux d’Austrasie ; son but était d’affaiblir une noblesse austrasienne qu’elle savait prompte à profiter des régences pour se hausser du col, mais elle perdait de vue qu’elle affaiblissait surtout la marche de l’Est, ce qui représentait toujours, stratégiquement, une faute lourde.
Frédégonde se livra sans peine à cette analyse et jugea le moment enfin venu d’effacer définitivement l’humiliation de 584.
En juin 596, année faste qui marquait le centenaire de la victoire de Clovis à Tolbiac et celui de sa conversion, Clotaire II fêta son douzième anniversaire ; cela faisait de lui, en vertu du droit franc, un prince majeur et un homme adulte, capable de gérer ses biens, son royaume et sa vie par lui-même.
La reine en éprouva sans le dire un immense soulagement. Elle avait maintenant plus de cinquante-cinq ans, un âge avancé et, sentant ses forces diminuer, il lui était souvent arrivé de se demander si elle vivrait assez longtemps pour voir son dernier fils atteindre sa majorité. Elle en avait beaucoup cauchemardé, dans la certitude que, si elle mourait, l’enfant lui survivrait peu. Même majeur, sa position demeurerait fragile, à cause de son extrême jeunesse, de son inexpérience, des ennemis qui l’entouraient.
Ces constatations amenèrent Frédégonde à prendre une fois encore les devants : plus l’Austrasie serait affaiblie, plus les chances de Clotaire de grandir, de s’affirmer et de régner s’accroîtraient.
Profitant des innombrables difficultés qui entouraient l’élévation au trône des deux petits princes austrasiens, et sans cas de conscience, car elle savait pertinemment que Brunhehilde, à sa place, ne se fût point gênée, Frédégonde, soutenue par le maire du palais de Soissons, Landric, que d’aucuns tenaient pour son amant, et qui l’était peut-être finalement devenu, depuis le temps qu’elle était veuve et seule, prépara une campagne éclair dont le but final, qu’elle comptait camoufler en se livrant d’abord à un mouvement vers la frontière austrasienne, n’était autre que la reconquête de Paris.
Certes, la Neustrie disposait de troupes inférieures en nombre à celles de l’Austrasie-Burgondie, mais elles se composaient d’hommes entraînés et la reine misait sur l’effet de surprise. Il joua à plein.
Les Austrasiens marchèrent sous le commandement du duc Wintrio, l’homme qui s’était fait rosser à Trucy et qui s’en excusait en expliquant qu’il dormait au moment de l’attaque ennemie. Clotaire se porta au-devant d’eux et les atteignit à Laffaux, localité à trois lieues et demi de Soissons ; la capitale neustrienne constituait donc l’objectif récurrent du général austrasien, qui n’avait pas su la garder en 593.
Avoir laissé Wintrio pénétrer en Neustrie faisait de lui l’agresseur, manœuvre qui justifierait la suite. Cela l’avait aussi obligé à une longue marche pénible, sous un soleil cuisant, à travers la Champagne qui avait fatigué ses soldats. Les troupes de Clotaire, en revanche, cantonnées à proximité d’une des villas royales de Berny ou de Braine, n’avaient eu que peu de route à parcourir et elles arrivèrent fraîches et disposes sur le champ de bataille.
Plus tard, les Austrasiens qui avaient intérêt à minimiser leurs pertes et l’ampleur de leur défaite, évoqueraient un combat long, difficile, viril mais indécis. Ils s’accrochèrent en effet au terrain avec plus de mordant qu’à Trucy et perdirent en conséquence plus de monde dans l’affaire ; mais, à la fin de la journée, le résultat fut exactement le même que trois ans plus tôt : Wintrio, battu, retraita vers la frontière austrasienne.
Brunehilde aurait beau ensuite tourner en ridicule cette « victoire » neustrienne, qui n’en était pas franchement une et qui n’avait décidé ni du sort du conflit ni de celui des royaumes, ce qui était exact24, les troupes de Clotaire II n’en demeuraient pas moins maîtresses du terrain, et libres de leurs mouvements puisqu’elles en profitèrent, sur la lancée, pour entrer en Île-de-France et reprendre Paris.
Frédégonde qui, en 593, avait tenu à paraître en armes au côté de son fils, sur le champ de bataille de Trucy, ne réitéra pas cet exploit en 596. L’énergie, la santé commençaient à lui manquer, la contraignant à se ménager, dans la nécessité de vivre encore un peu. Et puis, elle ne voulait pas imiter l’erreur de Brunehilde, incapable de s’effacer, et qui avait interdit à Childebert de s’affirmer, de devenir le roi et l’homme qu’il eût été sans cette mère étouffante. La reine de Neustrie sentait dans ses os qu’elle touchait à sa fin, que sa protection, ses conseils, son amour allaient en même temps manquer à son enfant. Mieux valait que Clotaire apprît rapidement à se passer d’elle, à s’affirmer.
À ce prix, et à ce prix seulement, son fils vivrait, il serait roi, et tout ce qu’elle avait entrepris, tout ce qu’elle avait fait, prendrait et conserverait un sens. Dans le cas contraire…
Mais Frédégonde, épuisée, ne voulait pas y penser. Elle n’arrivait pas à croire qu’elle eût tant lutté, tant sacrifié, et tant tué parfois en vain...
Si elle n’avait point paru à Laffaux, Frédégonde se montra, une dernière fois, près de Clotaire, lors de son entrée victorieuse dans Paris.
Ils allèrent loger au vieux palais de Julien, dont les jardins descendaient en terrasses vers les rives de la Seine, demeure historique associée dans les souvenirs de la reine à des moments de grande joie, à d’autres de grandes douleurs ou de grandes angoisses. Le remords, semble-t-il, ne la travaillait pas. Ce qu’elle avait fait, elle l’avait fait conduite par la nécessité, l’instinct de survie, le bien de l’État souvent, celui de ses enfants toujours, et n’éprouvait pas le besoin de se repentir. Il n’y eut pas de conversion spectaculaire.
Dans le courant de l’année 597, à une date exacte que nul chroniqueur ne vint enregistrer, la reine Frédégonde de Neustrie s’éteignit, dans son lit, et, du moins tout le laisse supposer, avec une grande sérénité. Elle avait cinquante-sept ou cinquante-huit ans.
Se conformant à ses vœux, Clotaire fit enterrer sa mère, non, comme on pouvait s’y attendre s’agissant d’une femme qui avait si violemment, si passionnément aimé ses enfants, près de l’un des fils qu’elle avait tant pleurés, à Saint-Denis ou à Soissons, mais à Paris, en l’abbaye Saint-Vincent, dans la même tombe que le roi Chilpéric, son époux.
Ultime volonté de demeurer la reine jusque dans l’éternité.
Ou, plus simplement, plus humainement, désir de rejoindre l’homme qu’elle avait aimé, conquis, gardé : coûte que coûte. Au risque de se perdre.