III
Comme tout serait plus limpide dans notre philosophie si l’on pouvait exorciser ces spectres, en faire des illusions ou des perceptions sans objet, en marge d’un monde sans équivoque ! La Dioptrique de Descartes est cette tentative. C’est le bréviaire d’une pensée qui ne veut plus hanter le visible et décide de le reconstruire selon le modèle qu’elle s’en donne. Il vaut la peine de rappeler ce que fut cet essai, et cet échec.
Nul souci donc de coller à la vision. Il s’agit de savoir « comment elle se fait », mais dans la mesure nécessaire pour inventer en cas de besoin quelques « organes artificiels1 » qui la corrigent. On ne raisonnera pas tant sur la lumière que nous voyons que sur celle qui du dehors entre dans nos yeux et commande la vision ; et l’on se bornera là-dessus à « deux ou trois comparaisons qui aident à la concevoir » d’une manière qui explique ses propriétés connues et permette d’en déduire d’autres2. A prendre les choses ainsi, le mieux est de penser la lumière comme une action par contact, telle que celle des choses sur le bâton de l’aveugle. Les aveugles, dit Descartes, « voient des mains3 ». Le modèle cartésien de la vision, c’est le toucher.
Il nous débarrasse aussitôt de l’action à distance et de cette ubiquité qui fait toute la difficulté de la vision (et aussi toute sa vertu). Pourquoi rêver maintenant sur les reflets, sur les miroirs ? Ces doubles irréels sont une variété de choses, ce sont des effets réels comme le rebondissement d’une balle. Si le reflet ressemble à la chose même, c’est qu’il agit à peu près sur les yeux comme ferait une chose. Il trompe l’œil, il engendre une perception sans objet, mais qui n’affecte pas notre idée du monde. Dans le monde, il y a la chose même, et il y a hors d’elle cette autre chose qui est le rayon réfléchi, et qui se trouve avoir avec la première une correspondance réglée, deux individus donc, liés du dehors par la causalité. La ressemblance de la chose et de son image spéculaire n’est pour elles qu’une dénomination extérieure, elle appartient à la pensée. Le louche rapport de ressemblance est dans les choses un clair rapport de projection. Un cartésien ne se voit pas dans le miroir : il voit un mannequin, un « dehors » dont il a toutes raisons de penser que les autres le voient pareillement, mais qui, pas plus pour lui-même que pour eux, n’est une chair. Son « image » dans le miroir est un effet de la mécanique des choses ; s’il s’y reconnaît, s’il la trouve « ressemblante », c’est sa pensée qui tisse ce lien, l’image spéculaire n’est rien de lui.
Il n’y a plus de puissance des icônes. Si vivement qu’elle « nous représente » les forêts, les villes, les hommes, les batailles, les tempêtes, la taille-douce ne leur ressemble pas : ce n’est qu’un peu d’encre posée çà et là sur le papier. A peine retient-elle des choses leur figure, une figure aplatie sur un seul plan, déformée, et qui doit être déformée — le carré en losange, le cercle en ovale — pour représenter l’objet. Elle n’en est l’« image » qu’à condition de « ne lui pas ressembler4 ». Si ce n’est par ressemblance, comment agit-elle ? Elle « excite notre pensée » à « concevoir », comme font les signes et les paroles « qui ne ressemblent en aucune façon aux choses qu’elles signifient5 ». La gravure nous donne des indices suffisants, des « moyens » sans équivoque pour former une idée de la chose qui ne vient pas de l’icône, qui naît en nous à son « occasion ». La magie des espèces intentionnelles, la vieille idée de la ressemblance efficace, imposée par les miroirs et les tableaux, perd son dernier argument si toute la puissance du tableau est celle d’un texte proposé à notre lecture, sans aucune promiscuité du voyant et du visible. Nous sommes dispensés de comprendre comment la peinture des choses dans le corps pourrait les faire sentir à l’âme, tâche impossible, puisque la ressemblance de cette peinture aux choses aurait à son tour besoin d’être vue, qu’il nous faudrait « d’autres yeux dans notre cerveau avec lesquels nous la puissions apercevoir6 », et que le problème de la vision reste entier quand on s’est donné ces simulacres errants entre les choses et nous. Pas plus que les tailles-douces, ce que la lumière trace dans nos yeux et de là dans notre cerveau ne ressemble au monde visible. Des choses aux yeux et des yeux à la vision il ne passe rien de plus que des choses aux mains de l’aveugle et de ses mains à sa pensée. La vision n’est pas la métamorphose des choses mêmes en leur vision, la double appartenance des choses au grand monde et à un petit monde privé. C’est une pensée qui déchiffre strictement les signes donnés dans le corps. La ressemblance est le résultat de la perception, non son ressort. A plus forte raison l’image mentale, la voyance qui nous rend présent ce qui est absent, n’est-elle rien comme une percée vers le cœur de l’Être : c’est encore une pensée appuyée sur des indices corporels, cette fois insuffisants, auxquels elle fait dire plus qu’ils ne signifient. Il ne reste rien du monde onirique de l’analogie…
Ce qui nous intéresse dans ces célèbres analyses, c’est qu’elles rendent sensible que toute théorie de la peinture est une métaphysique. Descartes n’a pas beaucoup parlé de la peinture, et l’on pourrait trouver abusif de faire état de ce qu’il dit en deux pages des tailles-douces. Pourtant, s’il n’en parle qu’en passant, cela même est significatif : la peinture n’est pas pour lui une opération centrale qui contribue à définir notre accès à l’être ; c’est un mode ou une variante de la pensée canoniquement définie par la possession intellectuelle et l’évidence. Dans le peu qu’il en dit, c’est cette option qui s’exprime, et une étude plus attentive de la peinture dessinerait une autre philosophie. Il est significatif aussi qu’ayant à parler des « tableaux » il prenne pour typique le dessin. Nous verrons que la peinture entière est présente dans chacun de ses moyens d’expression : il y a un dessin, une ligne qui renferment toutes ses hardiesses. Mais ce qui plaît à Descartes dans les tailles-douces, c’est quelles gardent la forme des objets ou du moins nous en offrent des signes suffisants. Elles donnent une présentation de l’objet par son dehors ou son enveloppe. S’il avait examiné cette autre et plus profonde ouverture aux choses que nous donnent les qualités secondes, notamment la couleur, comme il n’y a pas de rapport réglé ou projectif entre elles et les propriétés vraies des choses, et comme pourtant leur message est compris de nous, il se serait trouvé devant le problème d’une universalité et d’une ouverture aux choses sans concept, obligé de chercher comment le murmure indécis des couleurs peut nous présenter des choses, des forêts, des tempêtes, enfin le monde, et peut-être d’intégrer la perspective comme cas particulier à un pouvoir ontologique plus ample. Mais il va de soi pour lui que la couleur est ornement, coloriage, que toute la puissance de la peinture repose sur celle du dessin, et celle du dessin sur le rapport réglé qui existe entre lui et l’espace en soi tel que l’enseigne la projection perspective. Le fameux mot de Pascal sur la frivolité de la peinture qui nous attache à des images dont l’original ne nous toucherait pas, c’est un mot cartésien. C’est pour Descartes une évidence qu’on ne peut peindre que des choses existantes, que leur existence est d’être étendues, et que le dessin rend possible la peinture en rendant possible la représentation de l’étendue. La peinture n’est alors qu’un artifice qui présente à nos yeux une projection semblable à celle que les choses y inscriraient et y inscrivent dans la perception commune, nous fait voir en l’absence de l’objet vrai comme on voit l’objet vrai dans la vie et notamment nous fait voir de l’espace là où il n’y en a pas7. Le tableau est une chose plate qui nous donne artificieusement ce que nous verrions en présence de choses « diversement relevées » parce qu’il nous donne selon la hauteur et la largeur des signes diacritiques suffisants de la dimension qui lui manque. La profondeur est une troisième dimension dérivée des deux autres.
Arrêtons-nous sur elle, cela en vaut la peine. Elle a d’abord quelque chose de paradoxal : je vois des objets qui se cachent l’un l’autre, et que donc je ne vois pas, puisqu’ils sont l’un derrière l’autre. Je la vois et elle n’est pas visible, puisqu’elle se compte de notre corps aux choses, et que nous sommes collés à lui… Ce mystère est un faux mystère, je ne la vois pas vraiment, ou si je la vois, c’est une autre largeur. Sur la ligne qui joint mes yeux à l’horizon, le premier plan cache à jamais les autres, et, si latéralement je crois voir les objets échelonnés, c’est qu’ils ne se masquent pas tout à fait : je les vois donc l’un hors de l’autre, selon une largeur autrement comptée. On est toujours en deçà de la profondeur, ou au-delà. Jamais les choses ne sont l’une derrière l’autre. L’empiétement et la latence des choses n’entrent pas dans leur définition, n’expriment que mon incompréhensible solidarité avec l’une d’elles, mon corps, et, dans tout ce qu’ils ont de positif, ce sont des pensées que je forme et non des attributs des choses : je sais qu’en ce même moment un autre homme autrement placé — encore mieux : Dieu, qui est partout — pourrait pénétrer leur cachette et les verrait déployées. Ce que j’appelle profondeur n’est rien ou c’est ma participation à un Être sans restriction, et d’abord à l’être de l’espace par-delà tout point de vue. Les choses empiètent les unes sur les autres parce qu’elles sont l’une hors de l’autre. La preuve en est que je puis voir de la profondeur en regardant un tableau qui, tout le monde l’accordera, n’en a pas, et qui organise pour moi l’illusion d’une illusion… Cet être à deux dimensions, qui m’en fait voir une autre, c’est un être troué, comme disaient les hommes de la Renaissance, une fenêtre… Mais la fenêtre n’ouvre en fin de compte que sur le partes extra partes, sur la hauteur et la largeur qui sont seulement vues d’un autre biais, sur l’absolue positivité de l’Être.
C’est cet espace sans cachette, qui en chacun de ses points est, ni plus ni moins, ce qu’il est, c’est cette identité de l’Être qui soutient l’analyse des tailles-douces. L’espace est en soi, ou plutôt il est l’en soi par excellence, sa définition est d’être en soi. Chaque point de l’espace est et est pensé là où il est, l’un ici, l’autre là, l’espace est l’évidence du où. Orientation, polarité, enveloppement sont en lui des phénomènes dérivés, liés à ma présence. Lui repose absolument en soi, est partout égal à soi, homogène, et ses dimensions par exemple sont par définition substituables.
Comme toutes les ontologies classiques, celle-ci érige en structure de l’Être certaines propriétés des êtres, et en cela elle est vraie et fausse, on pourrait dire, en renversant le mot de Liebniz : vraie dans ce qu’elle nie et fausse dans ce qu’elle affirme. L’espace de Descartes est vrai contre une pensée assujettie à l’empirique et qui n’ose pas construire. Il fallait d’abord idéaliser l’espace, concevoir cet être parfait en son genre, clair, maniable et homogène, que la pensée survole sans point de vue, et qu’elle reporte en entier sur trois axes rectangulaires, pour qu’on pût un jour trouver les limites de la construction, comprendre que l’espace n’a pas trois dimensions, ni plus ni moins, comme un animal a quatre ou deux pattes, que les dimensions sont prélevées par les diverses métriques sur une dimensionnalité, un Être polymorphe, qui les justifie toutes sans être complètement exprimé par aucune. Descartes avait raison de délivrer l’espace. Son tort était de l’ériger en un être tout positif, au-delà de tout point de vue, de toute latence, de toute profondeur, sans aucune épaisseur vraie.
Il avait raison aussi de s’inspirer des techniques perspectives de la Renaissance : elles ont encouragé la peinture à produire librement des expériences de profondeur, et en général des présentations de l’Être. Elles n’étaient fausses que si elles prétendaient clore la recherche et l’histoire de la peinture, fonder une peinture exacte et infaillible. Panofsky l’a montré à propos des hommes de la Renaissance8, cet enthousiasme n’était pas sans mauvaise foi. Les théoriciens tentaient d’oublier le champ visuel sphérique des Anciens, leur perspective angulaire, qui lie la grandeur apparente, non à la distance, mais à l’angle sous lequel nous voyons l’objet, ce qu’ils appelaient dédaigneusement la perspectiva naturalis ou communis, au profit d’une perspectiva artificialis capable en principe de fonder une construction exacte, et ils allaient, pour accréditer ce mythe, jusqu’à expurger Euclide, omettant de leurs traductions le théorème VIII qui les gênait. Les peintres, eux, savaient d’expérience qu’aucune des techniques de la perspective n’est une solution exacte, qu’il n’y a pas de projection du monde existant qui le respecte à tous égards et mérite de devenir la loi fondamentale de la peinture, et que la perspective linéaire est si peu un point d’arrivée qu’elle ouvre au contraire à la peinture plusieurs chemins : avec les Italiens celui de la représentation de l’objet, mais avec les peintres du Nord celui du Hochraum, du Nahraum, du Schrägraum… Ainsi la projection plane n’excite pas toujours notre pensée à retrouver la forme vraie des choses, comme le croyait Descartes : passé un certain degré de déformation, c’est au contraire à notre point de vue qu’elle renvoie : quant aux choses, elles fuient dans un éloignement que nulle pensée ne franchit. Quelque chose dans l’espace échappe à nos tentatives de survol. La vérité est que nul moyen d’expression acquis ne résout les problèmes de la peinture, ne la transforme en technique, parce que nulle forme symbolique ne fonctionne jamais comme un stimulus : là où elle a opéré et agi, c’est conjointement avec tout le contexte de l’œuvre, et nullement par les moyens du trompe-l’œil. Le Stilmoment ne dispense jamais du Wermoment9. Le langage de la peinture n’est pas, lui, « institué de la Nature » : il est à faire et à refaire. La perspective de la Renaissance n’est pas un « truc » infaillible : ce n’est qu’un cas particulier, une date, un moment dans une information poétique du monde qui continue après elle.

Nicolas de Staël : Coin d’Atelier, 1954.
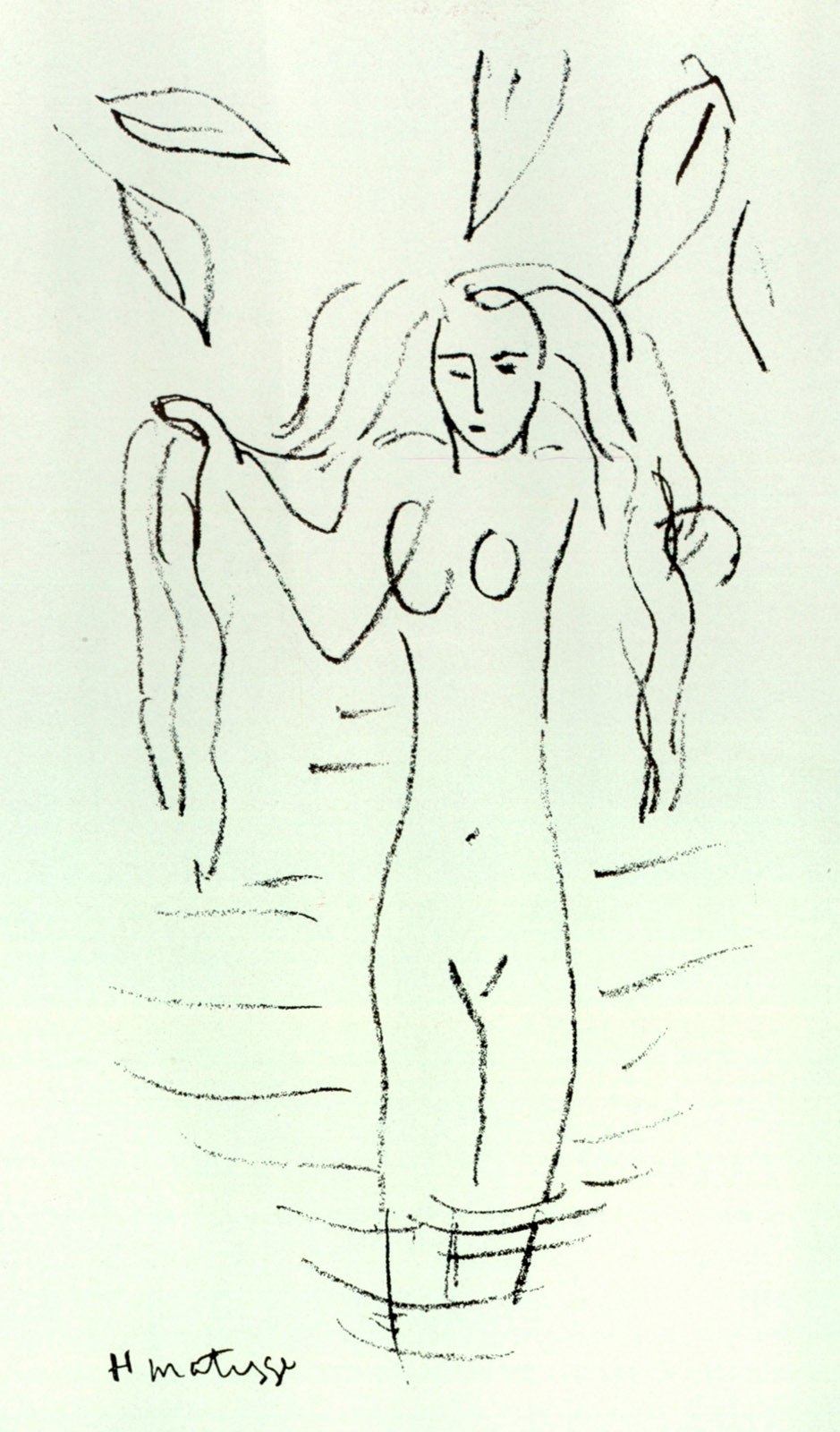
Henri Matisse : Dessin.
Descartes cependant ne serait par Descartes s’il avait pensé éliminer l’énigme de la vision. Il n’y a pas de vision sans pensée. Mais il ne suffit pas de penser pour voir : la vision est une pensée conditionnée, elle naît « à l’occasion » de ce qui arrive dans le corps, elle est « excitée » à penser par lui. Elle ne choisit ni d’être ou de n’être pas, ni de penser ceci ou cela. Elle doit porter en son cœur cette pesanteur, cette dépendance qui ne peuvent lui advenir par une intrusion de dehors. Tels événements du corps sont « institués de la nature » pour nous donner à voir ceci ou cela. La pensée de la vision fonctionne selon un programme et une loi qu’elle ne s’est pas donnés, elle n’est pas en possession de ses propres prémisses, elle n’est pas pensée toute présente, toute actuelle, il y a en son centre un mystère de passivité. La situation est donc celle-ci : tout ce qu’on dit et pense de la vision fait d’elle une pensée. Quand par exemple on veut comprendre comment nous voyons la situation des objets, il n’y a pas d’autre ressource que de supposer l’âme capable, sachant où sont les parties de son corps, de « transférer de là son attention » à tous les points de l’espace qui sont dans le prolongement des membres10. Mais ceci n’est encore qu’un « modèle » de l’événement. Car cet espace de son corps qu’elle étend aux choses, ce premier ici d’où viendront tous les là, comment le sait-elle ? Il n’est pas comme eux un mode quelconque, un échantillon de l’étendue, c’est le lieu du corps qu’elle appelle « sien », c’est un lieu qu’elle habite. Le corps qu’elle anime n’est pas pour elle un objet entre les objets, et elle n’en tire pas tout le reste de l’espace à titre de prémisse impliquée. Elle pense selon lui, non selon soi, et dans le pacte naturel qui l’unit à lui sont stipulés aussi l’espace, la distance extérieure. Si, pour tel degré d’accommodation et de convergence de l’œil, l’âme aperçoit telle distance, la pensée qui tire le second rapport du premier est comme une pensée immémoriale inscrite dans notre fabrique interne : « Et ceci nous arrive ordinairement sans que nous y fassions de réflexion tout de même que lorsque nous serrons quelque chose de notre main, nous la conformons à la grosseur et à la figure de ce corps et le sentons par son moyen, sans qu’il soit besoin pour cela que nous pensions à ses mouvements11. » Le corps est pour l’âme son espace natal et la matrice de tout autre espace existant. Ainsi la vision se dédouble : il y a la vision sur laquelle je réfléchis, je ne puis la penser autrement que comme pensée, inspection de l’Esprit, jugement, lecture de signes. Et il y a la vision qui a lieu, pensée honoraire ou instituée, écrasée dans un corps sien, dont on ne peut avoir idée qu’en l’exerçant, et qui introduit, entre l’espace et la pensée, l’ordre autonome du composé d’âme et de corps. L’énigme de la vision n’est pas éliminée : elle est renvoyée de la « pensée de voir » à la vision en acte.
Cette vision de fait, et le « il y a » qu’elle contient, ne bouleversent pourtant pas la philosophie de Descartes. Étant pensée unie à un corps, elle ne peut par définition être vraiment pensée. On peut la pratiquer, l’exercer et pour ainsi dire l’exister, on ne peut rien en tirer qui mérite d’être dit vrai. Si, comme la reine Elizabeth, on veut à toute force en penser quelque chose, il n’y a qu’à reprendre Aristote et la Scolastique, concevoir la pensée comme corporelle, ce qui ne se conçoit pas, mais est la seule manière de formuler devant l’entendement l’union de l’âme et du corps. En vérité il est absurde de soumettre à l’entendement pur le mélange de l’entendement et du corps. Ces prétendues pensées sont les emblèmes de l’« usage de la vie », les armes parlantes de l’union, légitimes à condition qu’on ne les prenne pas pour des pensées. Ce sont les indices d’un ordre de l’existence — de l’homme existant, du monde existant — que nous ne sommes pas chargés de penser. Il ne marque sur notre carte de l’Être aucune terra incognita, il ne restreint pas la portée de nos pensées, parce qu’il est aussi bien qu’elle soutenu par une Vérité qui fonde son obscurité comme nos lumières. C’est jusqu’ici qu’il faut pousser pour trouver chez Descartes quelque chose comme une métaphysique de la profondeur : car cette Vérité, nous n’assistons pas à sa naissance, l’être de Dieu est pour nous abîme… Tremblement vite surmonté : il est pour Descartes aussi vain de sonder cet abîme-là que de penser l’espace de l’âme et la profondeur du visible. Sur tous ces sujets, nous sommes disqualifiés par position. Tel est ce secret d’équilibre cartésien : une métaphysique qui nous donne des raisons décisives de ne plus faire de métaphysique, valide nos évidences en les limitant, ouvre notre pensée sans la déchirer.
Secret perdu, et, semble-t-il, à jamais : si nous retrouvons un équilibre entre la science et la philosophie, entre nos modèles et l’obscurité du « il y a », il faudra que ce soit un nouvel équilibre. Notre science a rejeté aussi bien les justifications que les restrictions de champ que lui imposait Descartes. Les modèles qu’elle invente, elle ne prétend plus les déduire des attributs de Dieu. La profondeur du monde existant et celle du Dieu insondable ne viennent plus doubler la platitude de la pensée « technicisée ». Le détour par la métaphysique, que Descartes avait tout de même fait une fois dans sa vie, la science s’en dispense : elle part de ce qui fut son point d’arrivée. La pensée opérationnelle revendique sous le nom de psychologie le domaine du contact avec soi-même et avec le monde existant que Descartes réservait à une expérience aveugle, mais irréductible. Elle est fondamentalement hostile à la philosophie comme pensée au contact, et, si elle en retrouve le sens, ce sera par l’excès même de sa désinvolture, quand, ayant introduit toutes sortes de notions qui pour Descartes relèveraient de la pensée confuse — qualité, structure scalaire, solidarité de l’observateur et de l’observé — elle s’avisera soudain qu’on ne peut sommairement parler de tous ces êtres comme de constructa. En attendant, c’est contre elle que la philosophie se maintient, s’enfonçant dans cette dimension du composé d’âme et de corps, du monde existant, de l’Être abyssal que Descartes a ouverte et aussitôt refermée. Notre science et notre philosophie sont deux suites fidèles et infidèles du cartésianisme, deux monstres nés de son démembrement.
Il ne reste à notre philosophie que d’entreprendre la prospection du monde actuel. Nous sommes le composé d’âme et de corps, il faut donc qu’il y en ait une pensée : c’est à ce savoir de position ou de situation que Descartes doit ce qu’il en dit, ou ce qu’il dit quelquefois de la présence du corps « contre l’âme », ou de celle du monde extérieur « au bout » de nos mains. Ici le corps n’est plus moyen de la vision et du toucher, mais leur dépositaire. Loin que nos organes soient des instruments, ce sont nos instruments au contraire qui sont des organes rapportés. L’espace n’est plus celui dont parle la Dioptrique, réseau de relations entre objets, tel que le verrait un tiers témoin de ma vision, ou un géomètre qui la reconstruit et la survole, c’est un espace compté à partir de moi comme point ou degré zéro de la spatialité. Je ne le vois pas selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans, j’y suis englobé. Après tout, le monde est autour de moi, non devant moi. La lumière est retrouvée comme action à distance, et non plus réduite à l’action de contact, en d’autres termes conçue comme elle peut l’être par ceux qui n’y voient pas. La vision reprend son pouvoir fondamental de manifester, de montrer plus qu’elle-même. Et puisqu’il nous est dit qu’un peu d’encre suffit à faire voir des forêts et des tempêtes, il faut qu’elle ait son imaginaire. Sa transcendance n’est plus déléguée à un esprit lecteur qui déchiffre les impacts de la lumière-chose sur le cerveau, et qui le ferait aussi bien s’il n’avait jamais habité un corps. Il ne s’agit plus de parler de l’espace et de la lumière, mais de faire parler l’espace et la lumière qui sont là. Question interminable, puisque la vision à laquelle elle s’adresse est elle-même question. Toutes les recherches que l’on croyait closes se rouvrent. Qu’est-ce que la profondeur, qu’est-ce que la lumière, τί το ὄν — que sont-ils, non pas pour l’esprit qui se retranche du corps, mais pour celui dont Descartes a dit qu’il y était répandu — et enfin non seulement pour l’esprit, mais pour eux-mêmes, puisqu’ils nous traversent, nous englobent ?
Or, cette philosophie qui est à faire, c’est elle qui anime le peintre, non quand pas il exprime des opinions sur le monde, mais à l’instant où sa vision se fait geste, quand, dira Cézanne, il « pense en peinture12 ».
1. Dioptrique, Discours VII, édition Adam et Tannery, VI, p. 165.
2. DESCARTES, Discours I, éd. cit. p. 83.
3. Ibid., p. 84.
4. Ibid., IV, pp. 112-114.
5. Ibid., pp. 112-114.
6. Ibid., VI, p. 130.
7. Le système des moyens par lesquels elle nous fait voir est objet de science. Pouquoi donc ne produirions-nous pas méthodiquement de parfaites images du monde, une peinture universelle délivrée de l’art personnel, comme la langue universelle nous délivrerait de tous les rapports confus qui traînent dans les langues existantes ?
8. E. PANOFSKY, Die Perspektive als symbolische Form, dans Vorträge der Bibliotek Warburg, IV (1924-1925).
9. Ibid.
10. DESCARTES, op. cit., VI, p. 135.
11. Ibid., p. 137.
12. B. DORIVAL, Paul Cézanne, éd. P. Tisné, Paris, 1948 : Cézanne par ses lettres et ses témoins, pp. 103 et s.