Chapitre 3
Le film signifie :
cinéma et langage
1. Bref historique de la théorie classique
Le film fait voir et entendre, il raconte, il signifie et vise un spectateur. Il « signifie » veut dire qu’il produit un sens, ou plutôt un ensemble de sens, au moyen d’images mouvantes et de sons. Il offre au spectateur des significations. La signification est étudiée par une science, la « sémiologie », définie au départ par le linguiste suisse francophone Ferdinand de Saussure, et qui s’est surtout développée dans les années 1960. Mais le processus de production du sens propre au cinéma se retrouve dès les origines l’objet des réflexions sur le cinéma, dès la fin des années 1910, et dans plusieurs pays simultanément, depuis les États-Unis jusqu’à l’Allemagne, en passant par la France, la Russie et l’Italie, malgré la rareté des traductions d’un pays à l’autre. Le retard de ces traductions, surtout en langue française, est à l’origine de nombreux décalages dans l’influence de certains courants et de certains concepts. Ce chapitre est consacré à une présentation historique du problème de la signification au cinéma depuis les premières théories. Nous avons particulièrement développé la présentation des théoriciens antérieurs aux années 1980, sans doute plus oubliés que les auteurs récents. Un livre de Francesco Casetti, Les Théories du cinéma depuis 1945 (1993), apporte des développements plus conséquents sur les principaux courants de pensée qui ont marqué cette histoire déjà longue d’un siècle.
1.1 Deux précurseurs : Vachel Lindsay et Hugo Münsterberg
1.1.1 Vachel Lindsay
L’un des premiers auteurs à définir le pouvoir de certaines formes cinématographiques de produire un sens, par exemple le « gros plan de visage », est le poète américain Vachel Lindsay (1879-1931) qui publia dès 1914 un livre de critiques de cinéma, The Art of the Moving Picture – traduit en français sous le titre De la caverne à la pyramide en 2000, soit 86 ans plus tard1 ! Ce livre pionnier est sans conteste le tout premier à défendre l’idée d’un cinéma comme partie intégrante des Beaux-Arts, et non comme théâtre filmé. Pour cela, Lindsay se sert essentiellement de comparaisons entre cinéma et sculpture, peinture, architecture, danse. « Edison est le nouveau Gutenberg. Il a inventé la nouvelle imprimerie », écrit Lindsay. Son livre témoigne de sa conviction militante : du mythe platonicien et des tâtonnements de la peinture pariétale aux beautés iconiques et verbales des hiéroglyphes égyptiens, « de la caverne à la pyramide » donc, tout invite l’homme moderne à « penser en images » et l’Amérique à reconnaître dans le cinéma la seule grammaire possible pour le lexique de son imaginaire national. Assurément, pour Lindsay, le cinéma signifie et il le fait d’une manière très personnelle, encore inédite dans l’histoire des représentations visuelles. Par exemple, il s’émerveille qu’au cinéma un personnage peut en signifier toute une catégorie, une jeune fille pour « toutes celles qui vont au bal », et de ce qu’un gros plan peut avoir une dimension symbolique, grâce à la capacité signifiante des images. La comparaison entre le cinéma et les autres arts va connaître une fortune considérable tout au long des développements de la théorie, comme nous allons le vérifier au cours de ce trajet historique.
Le livre précurseur de Lindsay sera remarqué par D.W. Griffith. Celui-ci le fera même distribuer dans ses studios, d’où la renommée du texte dans la tradition culturelle nord-américaine et sa méconnaissance en France2.
1.1.2 Hugo Münsterberg
Le profil professionnel de Hugo Münsterberg (1863-1916) est bien différent. Il est l’auteur du premier ouvrage de théorie systématique sur le cinéma jamais écrit : The Photoplay, A Psychological Study (1916)3. Münsterberg était un psychologue allemand qui fut invité à Harvard en 1892. À partir de 1897, il dirige le département de philosophie de cette université prestigieuse. Ce n’est qu’en 1915 qu’il découvre le cinéma un peu par hasard, et il va alors voir durant des mois de très nombreux films pour en tirer son essai sur le cinéma, qui est son dernier livre, publié l’année même de sa disparition.
Malgré son sous-titre, ce livre n’est pas seulement un traité psychologique. La première partie étudie, dans une perspective quasi « cognitiviste » avant la lettre, les traits essentiels de l’activité spectatorielle durant la projection : construction d’une profondeur imaginaire, perception d’un mouvement apparent ; variabilité de l’attention, et moyens pour le film de la diriger ; mise en jeu de la mémoire et de l’imagination ; émotions. C’est comme cela que le film signifie. Il faut souligner que Münsterberg prend alors parti pour le long métrage de fiction, par opposition à ce qu’il nomme la « photoconnaissance ». Pour lui, le cinéma est un art lorsqu’il traite de fiction. La signification vient de la capacité du cinéma à mimer des opérations psychiques, comme l’attention, la mémoire, la prévision et à aiguiller l’attention du spectateur par le gros plan, la composition de l’image, les oppositions fixe vs mobile, proche vs lointain. Il note également que le spectateur a la faculté de porter un jugement sur des actions (un enfant en danger au bord d’une falaise, déjà évoqué au chap. 2.4 § 4.5.1) ou des personnages (un cuistre), une fois qu’il a identifié cette situation et ce personnage.
La seconde partie de l’ouvrage esquisse une esthétique du cinéma, de type formaliste. L’art est défini, selon Münsterberg, non par l’imitation mais par la transformation du monde en beauté, selon un idéal assez classique.
Dans cette perspective, le cinéma « nous montre un conflit significatif d’actions humaines dans des images mouvantes qui, délivrées des formes physiques de l’espace, du temps et de la causalité, sont ajustées au libre jeu de nos expériences mentales, et parviennent à une séparation totale du monde pratique par l’unité parfaite de l’histoire racontée et de son apparence picturale » : c’est sa définition esthétique ; elle amène Münsterberg à adopter une attitude assez méfiante envers l’utilisation de sous-titres et autres mentions écrites, ainsi que de la musique d’accompagnement, qui nuisent à la pureté des moyens artistiques ; symétriquement, il se fait de la fonction de ce nouvel art une très haute idée : « Le monde extérieur a perdu son poids, il a été libéré de l’espace, du temps et de la causalité, et vêtu dans les formes de notre conscience. L’esprit a triomphé de la matière, et les images se succèdent avec l’aisance des sons musicaux. C’est un plaisir suprême qu’aucun autre art ne peut procurer. »

3.1 La Vie d’Adèle, chapitres 1 et 2 (Abdellatif Kéchiche, 2013).
Une esthétique fondée sur les très gros plans de visages, filmés caméra à la main. Un retour à la force expressive des origines du cinéma pour filmer l’itinéraire sentimental d’une adolescente des années 2010 avec ses chapitres successifs.
Cette approche idéaliste – universellement ignorée jusqu’à la réédition du livre en 1970 aux États-Unis – est proche de celle, notamment, de Jean Epstein, et plus tard de Christian Metz dans Le Signifiant imaginaire.
Vachel Lindsay et Hugo Münsterberg sont assurément des précurseurs et il importait de les évoquer à ce titre, même si leurs livres sont longtemps restés oubliés après leur publication initiale, et particulièrement en France.
1.2 La contribution française aux débuts de la théorie : Louis Delluc et Jean Epstein
C’est un poète italien, Ricciotto Canudo (1877-1923), également romancier, philosophe et essayiste, fixé à Paris dès 1901 qui lance les premières réflexions esthétiques sur le cinéma. Il y fonde trois revues, dont la Gazette des Sept Arts (1922). Canudo voyait le début du xxe siècle comme voué à une synthèse de l’art et des arts. Il reste surtout connu aujourd’hui pour sa prise de parti extrêmement précoce en faveur du cinéma, dès 1908 avec son article « Triomphe du Cinématographe », d’abord publié en italien, puis traduit en français, avant même que celui-ci pût vraiment apparaître comme un art. Canudo est l’inventeur et le promoteur zélé de la formule du cinéma comme « septième art » (non sans quelque hésitation : en 1911, il était le « sixième art » et en 1908, le « cinquième art »), qu’il définit et défendit systématiquement après la guerre, notamment dans une célèbre conférence de 1921 qui imposa la formule. Cette même année, il fonda le CASA (Club des Amis du Septième Art), deuxième ciné-club de France après celui de Delluc fondé en 1920, et promis à une longue postérité. Il tenta de donner, dans ses critiques et essais, les bases d’une esthétique du cinéma et de préciser la métaphore du « langage cinématographique ».
« Le cinéma, multipliant le sens humain de l’expression par l’image, ce sens que la Peinture et la Sculpture avaient seules gardé jusqu’à nous, formera une langue vraiment universelle aux caractères encore insoupçonnables. Pour ce, il lui est nécessaire de ramener toute la “figuration” de la vie, c’est-à-dire l’art, vers les sources de toute émotion, cherchant la vie elle-même en elle-même, par le mouvement […] Neuf, jeune, tâtonnant, il cherche ses voix et ses mots. Et il nous ramène, avec toute notre complexité psychologique acquise, au grand langage vrai, primordial, synthétique, le langage visuel, hors l’analyse des sons. »
Il prit parti, comme toute l’avant-garde, pour l’image et contre l’adaptation littéraire, pour la couleur et pour la musique (mais à condition qu’elles se soucient d’être réellement expressives). Il esquissa également des catégories stylistiques, qui restent logiques et indicatives.
Il fut sans doute l’un des premiers, avec Vachel Lindsay, à avoir tenté d’intégrer le cinéma dans un système général des arts. Partant d’une bipartition des arts qui sera souvent reprise, notamment par Étienne Souriau – d’un côté les arts de l’espace avec l’architecture, la peinture et la sculpture qui en découlent, de l’autre les arts du temps avec la musique, complétée par la poésie et la danse –, le cinéma vient à ses yeux « combler le fossé entre les arts du temps et les arts de l’espace », occupant alors la position de septième art. Ses positions sur le cinéma sont toutefois souvent plus lyriques ou programmatiques que véritablement systématiques. Il s’en dégage néanmoins de façon très nette une conception artistique du film : les metteurs en scène, qu’il baptise avant Delluc « écranistes », sont les égaux des grands créateurs des autres disciplines, ce qui a pour conséquence de fréquentes condamnations du commerce et de l’industrie du cinéma, et son effort pour créer des lieux de diffusion pour les œuvres de qualité, des salles spécialisées. À la recherche d’une spécificité du film, cet « art plastique se développant selon les normes de l’art rythmique », Canudo nuance l’impression de réalité attachée au cinéma pour insister sur sa valeur d’expression et de signification et sur l’évocation des états d’âme ou des sentiments qu’il peut produire. Il condamne surtout l’influence du théâtre pour défendre l’idée d’une musicalité des images.
1.2.1 Louis Delluc
Inventeur de l’usage des mots « cinéaste » et « cinéphile », Louis Delluc a donné à l’exercice critique « des vertus d’indépendance, de virulence, de style et une audience jusque-là inédites ». D’abord romancier et chroniqueur théâtral, la révélation cinématographique advint lors de la vision de Forfaiture de Cecil B. DeMille (1915). Dès lors, Delluc sera un ardent promoteur du cinéma dans ses ouvrages et au sein des revues, telles Cinéa et Le Journal du ciné-club, associées à des ciné-clubs militants. Dans le contexte de l’époque qui demandait une défense du septième art, souvent dévalorisé, il rechercha une juste définition de ce qui en fait la spécificité.
« Le hasard d’une soirée au cinéma, dans une salle du boulevard, m’a donné une joie artistique si extraordinaire qu’elle semble ne plus dépendre de l’art. Je sais depuis peu que le cinéma est destiné à nous donner des impressions de beauté fugace et éternelle, comme seul nous en donne le spectacle de la nature ou, parfois, de l’activité des hommes. Ces impressions, vous savez, de grandeur, de simplicité, de netteté, qui brusquement vous font trouver l’art inutile. Tout à fait inutile, évidemment, l’art le serait, si chacun était capable de goûter consciemment la beauté profonde de la minute qui passe. Mais l’éducation des foules sensibles est trop lente pour que nous puissions la priver avant de nombreux siècles des œuvres d’art, qui sont la confidence élevée de l’âme des autres. Le cinéma est justement un acheminement vers cette suppression de l’art qui dépasse l’art, étant la vie. Ce ne sera d’ailleurs qu’un moyen terme entre la stylisation et la réalité animée. Et il a, pour atteindre son propre summum, tant de progrès à conquérir que nous sommes loin de fixer le temps où la perfection de l’écran apprendra – et ce sera admirable – à voir dans la nature et dans le cœur humain. » (La Beauté du cinéma, 1917)
Dans ses ouvrages, il s’attache aux notions de « photogénie », qui n’est pas seulement une capacité à prendre la lumière, mais surtout un art de voir et de savoir « asservir les ressources de la photo […] à la fièvre, la sagacité, au rythme du cinéma […] Le goût du metteur en scène est la seule loi dans l’emploi des matières, si intéressantes soient-elles », aux notions de cadence, de décor, de costume. Il défend le scénario original contre les producteurs qui préfèrent s’en tenir aux adaptations littéraires. La question du jeu de l’acteur lui fera déployer toute sa vision moderne du cinéma en lui faisant préférer à « l’esprit de mots » de la comédie française « l’esprit intérieur » de la comédie américaine, dégagé de la mauvaise emprise théâtrale hexagonale du début du siècle :
« Nous assistons à la naissance d’un art extraordinaire. Le seul art moderne peut-être, avec déjà sa place à part et un jour sa gloire étonnante, car il est en même temps, lui seul, je vous le dis, fils de la mécanique et de l’idéal des hommes. On s’est peu intéressé à ses premiers appels. Mais savez-vous jusqu’à quel paroxysme ce délaissé nous mènera ? C’est un art puisque sur lui on a accumulé toutes les peines et qu’il se venge dès aujourd’hui par un reflet de beauté. »4
1.2.2 Jean Epstein
Cependant, le théoricien le plus original et le plus fécond de cette génération qualifiée d’« impressionniste » est sans conteste le jeune cinéaste Jean Epstein (1897-1953)5. Appartenant à l’avant-garde française des années 1920, proche de Delluc et Canudo, Epstein en fut l’un des principaux hérauts, « le premier théoricien du film dans le monde », dira même son ami Jean Mitry, non sans grandiloquence nationaliste. Auteur de nombreux articles et de quelques brefs essais dans les années 1920, ce n’est que dans les années 1930 et surtout après la guerre – alors qu’il avait été par force éloigné de la production de films – qu’il donna ses grandes synthèses théoriques. Dès son premier ouvrage, Bonjour cinéma, qui est aussi un hommage à l’art nouveau, il sera l’un des rares à sortir des considérations littéraires sur le sujet pour tenter d’en définir la spécificité formelle du cinéma (gros plan, rythme, caméra subjective, etc.).
Epstein partit d’un concept, la photogénie, qui était de l’ordre de l’ineffable ou de l’inanalysable, et qui était au fond la qualité propre, mystérieuse, du cinéma : la transfiguration de la réalité. « Sa vision ésotérique du cinéma comme moyen d’accès crypté à l’invisible (“Le cinéma est surnaturel par essence”, “La philosophie du cinéma est tout à faire”, in Bonjour cinéma) le conduira à théoriser cette notion de “photogénie” reprise à Delluc : “J’appellerai photogénique tout aspect des choses, des êtres et des âmes qui accroît sa qualité morale par la reproduction cinématographique” (in La Photogénie de l’impondérable). Dans La Lyrosophie, il tente, en 1922, d’établir des passerelles entre le monde sensible et le monde intelligible et de définir le cinéma comme nouveau moyen de connaissance poétique du monde. » À la fin de sa vie, il théorisa le cinéma comme « machine intelligente » (sensible), voire comme « machine animiste » ; corrélativement, l’intelligence est conçue par lui comme une machine, dont des machines peuvent donner l’approximation. Le travail du cinéma sur le temps n’a donc rien à voir avec une simple indicialité : le cinéma suggère un monde autre que le monde phénoménal, et même que le monde réel (ou alors, il suggère que le monde réel n’est pas ce que nous croyons), parce qu’il déconnecte l’espace de son temps-support.
« Ses trois principaux ouvrages, L’Intelligence d’une machine, Le Cinéma du diable, Esprit de cinéma, développent une théorie du cinéma autour du paramètre du temps qui en constitue la quatrième dimension, ce qui le conduira à se pencher sur tous les procédés formels qui travaillent la durée : ralentis, accélérés, etc.
Ces procédés permettant d’approfondir la perception simplifiée du monde sensible à l’œil nu, lui feront privilégier les techniques formelles insolites et révélatrices d’une réalité méconnue, qu’il utilisera par ailleurs dans ses films. Il avait pour ambition, dans un cadre strictement figuratif, de démultiplier les potentialités du cinéma pour en déployer tous les pouvoirs subtils, et de saisir le monde sensible dans son mouvement, afin d’en restituer la vivacité, proche en cela des questions qui travaillaient les arts picturaux et littéraires de son époque. »6
Entre ces deux périodes de sa pensée, celles des années 1920 et 1940, Epstein développe donc une réflexion sur le temps en général, à partir de l’existence du cinéma. Le cinéma permet de dire la vérité sur le temps, parce qu’il traite ensemble les quatre dimensions. Ainsi, non seulement le cinéma produit du temps (il a ses propres procédures temporelles : ralenti et accéléré, inversion), mais il repense le temps : en en faisant la première des quatre dimensions de l’univers physique, en le ramenant au pour-moi (il n’y a pas d’en-soi du temps), « par conséquent » en posant que si mon aperception change, le temps (donc l’espace) va changer réellement.
Cette réflexion prend parfois des allures un peu fantastiques, mais elle n’est, au fond, qu’une prise au sérieux de ce fait anthropologique, que le temps – non seulement les instruments qui le mesurent, mais le temps lui-même comme notion – est une invention et un outil humains. Il est clair qu’Epstein a posé autrement que la plupart de ses contemporains la question du sens, de ce que le cinéma signifie et comment il s’y prend pour produire un sens qui n’appartient qu’à lui.
Delluc et Epstein étaient tous les deux cinéastes. Leurs œuvres cinématographiques ont contribué à populariser leurs textes théoriques et à les faire connaître à l’étranger. Avec le recul du temps, ce sont les réflexions théoriques de Jean Epstein qui se sont révélées les plus fécondes. Elles irriguent la totalité des classifications des images que Gilles Deleuze proposent dans les années 1980 dans les deux tomes de son Cinéma.
C’est toutefois le critique, poète, dramaturge hungaro-allemand Béla Balázs dont le premier livre L’Homme visible est publié en 1924, et rapidement traduit en anglais, russe, italien, et diffusé internationalement, qui peut être considéré comme le fondateur de la théorie du cinéma. La fortune critique de cet essai que l’auteur réédite en 1930 (L’Esprit du cinéma) dans une version amplifiée sera considérable et ses propositions théoriques reprises et commentées par les théoriciens soviétiques du cinéma, tels Lev Koulechov, S. M. Eisenstein et V. Poudovkine.

3.2 Cœur fidèle (Jean Epstein, 1923).
Photogénie du visage et décomposition des gestes dans les premières minutes du film : « J’appellerai photogénique tout aspect des choses, des êtres et des âmes qui accroît sa qualité morale par la reproduction cinématographique. »
1.3 Le premier théoricien à l’influence internationale : Béla Balázs et L’Homme visible
Bilingue et biculturel en hongrois et en allemand, Balázs est par excellence le théoricien classique du cinéma, à mi-distance des conceptions de Kracauer et de celles d’Arnheim que nous évoquons plus loin. Surtout, ses théories, rassemblées sous leur forme la plus nette et la plus originale dans son premier livre, Der sichtbare Mensch (L’Homme visible, 1924)7, proviennent directement de sa riche expérience de critique de cinéma pour le journal viennois Der Tag, de 1919 à 1924.
Les thèses principales de ce livre qui ne se présente pas comme un traité mais comme une suite de notations brèves, peuvent être décrites selon quatre axes :
1° Le cinéma comme art du visible : thèse d’époque, mais portée et renforcée par la double culture de Balázs, autour de la spécificité artistique du cinéma. Il cherche en particulier, systématiquement, à distinguer le cinéma des arts du verbe, littérature et théâtre. Il note en particulier que le cinéma n’est pas illustration de contenus préexistants ; le récit filmique n’a de commun avec le récit littéraire que la notion de construction (le « squelette ») : leur chair (et leur « moelle ») est différente. La spécificité du cinéma, c’est donc la pure visibilité, la surface, la sensorialité, avant tout accès à un « contenu ».
2° Le réalisme particulier du cinéma : le cinéma rend visible, il fait voir à neuf la réalité et en même temps, il rend compréhensible ce que nous voyons. L’important est que Balázs ne se limite pas à l’argument mimétique : le cinéma est une mise en forme symbolique de ce qu’il représente ; s’il nous fait comprendre le monde, c’est qu’il a pour cela des formules visuelles et immédiates, nouvelles, et qui ménagent parfaitement l’apparence des choses. Mais plus profondément, le cinéma est un art de la présence : un film ne raconte pas, il ne commente pas un événement ; il le montre, il le fait voir, en lui laissant son caractère d’expérience sans concept. Par cela, il signifie.
3° L’image n’est pas pure représentation du monde : ce qu’elle rend présent, c’est la réalité, certes, mais c’est aussi elle-même. Le cinéma selon Balázs est donc un art du visuel, et pas seulement du visible. Les gestes filmiques, par exemple, n’ont pas à charge de véhiculer un discours verbal, mais constituent une espèce de langage. Dans un autre domaine, il observe que le film, s’il est réellement un événement visuel, a besoin d’un temps propre, plus lent que le temps verbal. À travers ce genre de notation se profile l’idée d’un monde des images auquel ressortit le film. Pour lui, dans l’image, tout signifie, personnage humain comme objets ou paysages, parce que tout a la même force expressive, contrairement au théâtre où le primat du dialogue relègue décor et accessoires au statut de cadre fabriqué et muet.
4° À tous ses stades, le cinéma est donc production d’un sens, il signifie : la caméra, pour Balázs, est « productive », les ciseaux sont « inventifs », l’œil « flaire », etc. Cette idée culmine, dès son ouvrage de 1924, avec la notion d’une physionomie que le cinéma donnerait à ce qu’il filme – animé ou inanimé.
« Balázs envisage donc le cinéma en esthéticien, comme l’expression de la naissance d’une nouvelle civilisation : ayant le pouvoir de rendre l’homme visible, les images mobiles ouvrent de nouvelles perspectives sur la réalité au moyen de procédés qui permettent d’apporter des éléments de subjectivité à l’objectivité photographique. L’élément technique privilégié de cette « subjectivation » est pour lui le gros plan, comme chez Lindsay, dont il propose une des premières théorisations systématiques comme puissance d’expression et de révélation en situant le motif choisi, notamment le visage, hors de l’espace. Les gros plans sont liés à la notion de cadrage et ne sont rien non plus sans leur inscription dans la totalité du film, d’où l’importance accordée au montage comme pour la plupart des théoriciens du cinéma de son temps. Cette articulation entre gros plan, cadrage et montage est formalisée plus précisément dans L’Esprit du cinéma (1930) qui se présente comme une sorte d’équivalent d’une « grammaire du cinéma ». Mais celle-ci n’a de sens qu’aux mains de créateurs qui articulent un discours offrant ainsi aux spectateurs un point de vue renouvelé sur le monde. De la sorte, Balázs, à côté des aspects formalistes de son esthétique générale du cinéma, a toujours été très attentif au phénomène de masse que constituait la réception du film. »8

3.3 Les Finances du grand duc (F. W. Murnau, 1924).
Un scénario convenu, mais une recherche de la plasticité de l’image opposant les extérieurs naturels et les intérieurs reconstitués en studio.
1.4 L’École soviétique et le montage, les formalistes russes
Pendant la même période, celle des premières années 1920, l’Union soviétique naissante est un lieu d’effervescence dans le domaine de la réflexion sur le cinéma. Celle-ci se développe d’abord au sein du GTK (devenu VGIK à Moscou), première école de réalisation cinématographique en 1920, créée par Lev Koulechov (1899-1970) alors qu’il n’avait que 21 ans. Il eut comme élève Vsevolod Poudovkine (1893-1953), auteur d’un essai théorique, La Technique du film, dont la version anglaise aura une postérité exceptionnelle. Tous les théoriciens travaillant dans cette constellation professionnelle consacrent le montage comme le concept cardinal de la création cinématographique, de Koulechov jusqu’à S. M. Eisenstein, Poudovkine et Dziga Vertov.
1.4.1 Lev Koulechov
L’enseignement théorique de Koulechov, constitué pour l’essentiel dans les années 1920, consiste en une recherche des lois spécifiques du cinéma. « La création en 1922 au sein de l’Institut technique du cinéma du “Laboratoire expérimental”, sorte de collectif composé entre autres de Poudovkine, Barnet, Komarov, lui permettra de jouer un rôle de pédagogue éclairé et de mener une série d’expériences fructueuses. Le groupe fait des “films sans pellicule”, au moyen de tableaux vivants entrecoupés de levers de rideaux, et met ainsi au point la “méthode répétitive”. »9 Sa théorie est donc le résultat d’une expérimentation, mais moins sur la relation du cinéma, comme outil du voir, à la réalité sociale, que sur l’expressivité cinématographique propre, ou comment le film signifie. Pour lui, en effet, il est possible d’expérimenter sur le cinéma en général, indépendamment de tout contenu, un projet que reprend la filmologie après 1945, puis le cognitivisme. Cette phase expérimentale a pris concrètement la forme de très nombreux exercices de jeu d’acteur, de geste, de cadrage, de mise en scène dans l’« atelier » du GIK. Koulechov y a mis en application une conception analytique, presque mécanique, du jeu de l’acteur, empruntée pour l’essentiel à Delsarte10 pour qui il existe une correspondance bi-univoque entre un geste et un état d’esprit, dans la filiation de la vieille tradition physiognomonique. Le montage influencera aussi sa théorie du jeu de l’acteur. En réaction aux théories de Stanislavski, il établit que le comédien devait s’adapter au nouvel art mécanique, introduisant en quelque sorte le montage au sein du jeu de l’acteur, décomposé et analytique, modèle vivant qui ne doit pas s’exprimer, mais qui doit être soumis aux indications très précises du metteur en scène. C’est dans cette perspective qu’il réalisa ses fameuses expériences sur l’expressivité que confère, à un visage maintenu neutre, le jeu du montage (le mythique « effet Koulechov »). « Cette expérience ne visait pas tant à relativiser le jeu de l’acteur ou la sensibilité du public qu’à démontrer la toute-puissance du montage apte, avec un même matériau, à susciter des effets totalement différents, et à établir la toute-puissance de l’auteur réalisateur. Sous l’influence du formalisme, il sera tenté d’assimiler la syntaxe du film à celle du langage :
“Avec des plans de fenêtres s’ouvrant largement, des gens qui s’y installent, d’un détachement de cavalerie, d’enfants qui courent, d’eaux qui brisent une digue, des pas cadencés de fantassins, on peut monter aussi bien la fête pour l’inauguration d’une centrale électrique que l’occupation par une armée ennemie d’une ville paisible” (L’Art du cinéma) » (Répertoire des critiques, historiens et théoriciens)
Chez Koulechov, cette « anthropologie de l’acteur » va dans le sens d’un fondement en nature de la gestualité expressive et de la mimique de l’acteur, et en même temps, d’une formalisation géométrique de cette gestuelle-mimique. Koulechov défendra ainsi une conception du cinéma comme calcul de tous les paramètres (du cadrage, et du montage surtout) dans le sens d’une mise en valeur de cette expressivité de l’acteur, par simplification et soulignement de la composition et du rythme : « Un cadre doit avant tout être clair, limpide et compréhensible. » Il ira donc jusqu’à quantifier les gestes – leur nombre, leur amplitude, leur extension dans le temps, voire leur « poids » ; d’ailleurs, le réalisateur devra accumuler les prises, chacune représentant une variante différente, afin de multiplier les solutions possibles au montage. Quant au montage, il doit être sans cesse accéléré, toujours en vue de maintenir l’intérêt du spectateur. Le montage, notion faisant l’objet à l’époque d’études dans tous les arts, était défini dès 1918 par Koulechov, qui l’avait découvert en partie dans les films de Griffith, comme faisant la spécificité du cinéma :
« Le moyen d’expression spécifique du cinéma est la succession rythmique de plans, ou de courts fragments immobiles, qui donne l’expression du mouvement, ce qui, techniquement, se nomme montage. Le montage au cinéma correspond à l’organisation des couleurs dans la peinture ou à la succession harmonique des sons dans la musique. »
Par ailleurs, Koulechov reconnaît que le matériau du cinéma est d’essence indicielle11, mais cette qualité propre de l’image de film reste soumise, chez lui, au calcul et au souci quantitatif de la mesure de chaque élément. Au total, il développa une conception du cinéma comme instrument puissant d’action sur son spectateur, à condition de respecter des lois psychologiques essentiellement behaviouristes : conditionnement et calcul de la réaction, une conception que reprendra S.M. Eisenstein.
1.4.2 Vsevolod Poudovkine
Vsevolod Poudovkine, élève de Koulechov au sein du VTK, va devenir rapidement l’un des réalisateurs soviétiques les plus en vue. Il est l’auteur de nombreux essais théoriques, mais son ouvrage le plus important est la version anglaise, Film Technique (1929), d’un texte panoramique écrit en russe sur le cinéma datant de 1926, ouvrage dans lequel il a élaboré une théorie complète du cinéma centrée sur le montage ; en effet, cette version anglaise, diffusée sans cesse depuis sa parution (mais toujours inédite en français), a été considérée comme une véritable Bible par de nombreux réalisateurs, surtout américains, et elle a longtemps représenté une version consensuelle de la théorie classique, dans son état le plus empirique.
Les maîtres concepts du livre, comme chez Koulechov et Eisenstein, sont l’image et le montage : le matériau cinématographique, ce sont des images du « réel », et non le réel lui-même, qui peuvent être raccourcies, modifiées et surtout montées. Chaque image est le résultat d’une série de choix significatifs, à commencer par le choix des objets représentés, qui doivent être expressifs. Le montage, « force créatrice fondamentale » du cinéma, est l’organisation de ces significations en vue d’un discours global compréhensible par un spectateur, dont l’attention est entièrement entre les mains du cinéaste.
L’esthétique défendue par Poudovkine se rapproche donc de l’idéal classique de la « transparence », et la notion, proposée dans son livre, d’« observateur extérieur », en est l’une des variantes.
« Poudovkine a tenté de réconcilier l’avant-garde avec son goût plus nuancé pour le respect de l’intégrité du “réel” et un cinéma narratif. La conception dialectique de la fabrication d’un film, du choix des plans (“Un cinéaste ne cherche jamais un fleuve ou une forêt, il cherche toujours le plan dont il a besoin. Ces plans peuvent emprunter à une douzaine de fleuves ; opportunément montés, ils constituent un tout organique. Le cinéma ne filme pas la nature, il l’utilise aux fins de son montage.”) au montage final, construit un rapport dynamique entre l’analyse et la synthèse, le découpage et le montage ayant des valeurs, au finale, unificatrices. Poudovkine élabore cinq formules d’assemblage pour la recomposition finale : le leitmotiv, la simultanéité, l’analogie, l’antithèse, le parallélisme. Ces formules de composition seront reprises par Raymond Spottiswoode en 1935 avec sa Grammaire du film, puis dans les ouvrages qui en découlent jusqu’à la “syntagmatique” de Metz qui en est une sorte d’aboutissement.
Le gros plan permet d’analyser un détail dans l’espace, le ralenti est “un gros plan dans le temps”, comme l’avait dit Epstein. Même s’il s’éloigne, pour ce qui est de la question du jeu de l’acteur, du modèle vivant de Koulechov, celui-ci doit rester soumis au montage, être “fractionné” durant le tournage :
“Le montage du jeu de l’acteur, c’est-à-dire la composition sur l’écran des fragments filmés séparément et en des lieux différents, ne se présente nullement comme un truc de réalisateur pour évacuer l’interprétation, mais comme une méthode nouvelle et puissante, propre au cinéma, de transmettre cette interprétation.” »12
1.4.3 Dziga Vertov
Dziga Vertov défend des positions radicales et plus personnelles. Il refuse toute collusion du cinéma avec la fiction, au bénéfice d’une croyance en un pouvoir de véridicité dont il serait doté. Absolument convaincu par la révolution soviétique, Vertov propose de repenser le cinéma comme outil de compréhension et d’analyse, comme un outil de monstration ; mais montrer (qui suppose de monter) ne peut se faire que sur la base d’une vision correcte : on n’organise pas le réel visible s’il n’est pas vu réellement. Cette vision, c’est l’affaire de la caméra cinématographique, décrite par Vertov comme un « super-œil ». C’est la notion de kinoglaz (cinœil ou ciné-œil), comprise comme combinaison de la caméra-œil et du cerveau, et celle de kinok (opérateur du kinoglaz).
« Vertov déploie une conception entière du cinéma, fondée sur une mission assignée au cinéma qui doit donc, à toutes ses étapes, participer au “déchiffrement communiste du monde”, centrée autour de la notion de “ciné-œil” (la fabrique des faits), et développée dans ses propres films et ses textes. “Je suis un œil / Un œil mécanique / Moi, c’est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir / Désormais je serai libéré de l’immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement” (“Manifeste Ciné-œil”). En préambule, il déclare la mort de l’art (“Le terme même d’art est substantiellement contre-révolutionnaire” in Kino no 43) et du cinéma de fiction : “Le drame cinématographique est l’opium du peuple. À bas les fables bourgeoises et vive la vie telle qu’elle est.” Le cinéma doit, suivant le mot d’ordre de Lénine, être “un journalisme artistique dans la ligne et l’esprit des meilleurs quotidiens soviétiques”. Le film sera donc discours, parole en images et en mots. L’organisation des Kinoki en cercles de ciné-travail sur le modèle ouvrier doit faire du cinéma un artisanat accessible à tous. »13
Les films « laisseront à découvert l’édifice des procédés », et la tâche du cinéma est de « fixer les documents et les faits, de fixer la vie et les processus historiques », « de donner aux travailleurs une conscience claire des phénomènes qui les concernent ». Le cinéma, servant de conducteur entre les travailleurs grâce à la « circulation sanguine » du « ciné-œil » et à la « ciné-sensation du monde » qu’il véhicule, fera que « les millions de travailleurs ayant recouvré la vue mettront en doute la nécessité de soutenir les structures bourgeoises du monde ».
Ces thèses seront systématiquement reprises par Godard et Gorin après 1970 dans le cadre du « groupe Dziga Vertov ».
Sur cette base pratico-éthique (foncièrement classique : l’art est au service de la République), Vertov invente une notion formelle et sémiotique, l’« intervalle ». Le montage est le principe du film, construit à l’aide des intervalles : « La matière première de l’art du mouvement n’est nullement le mouvement en lui-même mais dans les intervalles, le passage d’un mouvement à un autre » (« Nous »). Selon la célèbre formule « Le montage précède le tournage », toute la chaîne de fabrication du film est fondée sur le principe du montage ininterrompu.
Le mot « intervalle », en général, peut s’entendre selon trois dimensions : spatiale (distance qui sépare deux points), temporelle (durée qui s’étend entre deux moments), musicale (rapport entre deux hauteurs de tons), donc comme lacune, comme lien ou comme relation. L’entreprise de Vertov consiste à échapper autant que possible à la spatialisation (qui amène à réduire le concept d’intervalle à celui de mesure) au profit d’une définition temporelle-visuelle. Le cinœil, en tant qu’il voit, voit depuis les choses mêmes (il n’adopte pas un point de vue extérieur), et son mouvement est libre (non asservi à une conscience) ; le kinok, s’il montre, montre de l’invu (il peut virtuellement être partout).
L’intervalle est ainsi conçu comme pure différence, produite d’un mouvement à un autre mouvement. Le cinéma, corrélativement, n’est pas un mouvement dans l’espace (extensif), mais une pure qualité de mouvement (intensive). D’où la formule de Vertov, proposant de « monter tout le film d’un coup », non pas dans le sens d’un geste de maîtrise supérieure et sur le modèle spatial du puzzle (modèle prégnant chez S. M. Eisenstein ou chez Alain Resnais), mais au contraire comme assertion d’une circulation infinie des éléments, qui ne se définissent que comme puissance d’échange.
1.4.4 S. M. Eisenstein
Sans doute le plus prolixe des cinéastes-théoriciens, d’autant qu’en outre il fut durant plus de quinze ans enseignant à l’école professionnelle de cinéma de Moscou (le VGIK), S. M. Eisenstein (1898-1948) a accompagné constamment son activité de réalisateur de films d’une activité théorique importante ; ses références ont quelque peu évolué au fil des années, mais il demeure fidèle à des problèmes et à des notions qui, par-delà les formulations différentes, permettent de parler chez lui d’un véritable système théorique, autour de trois questions principales :
– des concepts relatifs au matériau filmique : le fragment, conduisant à développer une conception du montage qui ne repose pas sur le primat du narratif, mais sur la recherche d’effets de sens plus ou moins complexes (théorie du « montage harmonique ») ; le monologue intérieur, tel qu’il est étudié par la psychologie cognitive, et tel que la littérature d’avant-garde le symbolise – et qui conduit à l’intuition du « montage intellectuel » ; enfin le contrepoint orchestral du son et de l’image, base du montage « vertical » ;
– des principes sémantiques et formels : la notion de conflit, directement issue de la dialectique hégélienne et marxiste, et suggérant l’idée que, de deux éléments (deux plans, par exemple) peut surgir un troisième (une idée) ; un intérêt passager pour la pensée « prélogique », dans laquelle au milieu des années 1930 Eisenstein pensa trouver un modèle possible pour un discours filmique affranchi de la logique causale et narrative ; enfin, la notion d’obraznost’, ou production d’images conceptuelles au sein des images figuratives et avec elles ;
– une réflexion sur la visée spectatorielle, commençant avec la notion d’attraction, se développant autour d’un thème d’époque, celui du pathétique, dans les années 1930 et débouchant peu après sur l’idée que la forme filmique doit avoir une nature « extatique », seule à même de lui permettre de provoquer chez son spectateur une adhésion émotionnelle forte.
« En référence au marxisme, S. M. Eisenstein place la dialectique au cœur du montage, dialectique qui doit créer la dynamique d’un conflit et doit apporter au final la résolution de ce même conflit. La notion de “choc” est au centre du montage : il consiste à créer une opposition soit au sein même du plan au moyen des différentes composantes de ce même plan, soit entre les plans par le biais du montage (voir Le Film, sa forme, son sens). Le “choc” intellectuel issu de cette opposition, qui force à penser et qui met en branle l’esprit, se double d’un choc pathétique. Le “choc” se divise in fine en trois moments : de l’image au concept, puis du concept à l’image, et enfin de l’identité des deux, qui pose l’unité de la Nature et de l’homme, de l’individu et de la masse (voir La Non Indifférente Nature). Cette dialectique au sein du film s’établit notamment au moyen de l’alternance entre plans d’échelles différentes. À partir des travaux de Koulechov sur le montage, Eisenstein élabora sa théorie du “montage des attractions” :
“Dans notre conception du théâtre, l’attraction est le moment particulier durant lequel tous les éléments concourent à déterminer dans la conscience du spectateur l’idée qu’on a voulu lui communiquer en mettant celui-ci dans l’état d’esprit ou dans la situation psychologique qui a suscité cette idée même […] Au lieu du reflet statique d’un événement – où toutes les possibilités d’expression sont maintenues dans les limites du déroulement logique de l’action – nous proposons une nouvelle forme : le montage libre d’attractions arbitrairement choisies, indépendantes de l’action proprement dite (choisies toutefois selon la continuité logique de cette action), le tout concourant à établir un effet thématique final – tel est le montage des attractions.”
Ce type de montage, où il s’agit d’associer deux plans au contenu très éloigné, sera progressivement abandonné au profit d’un montage associant des plans appartenant à la même continuité dramatique, et non plus strictement étrangers. À la fin de sa vie, Eisenstein élaborera la théorie du film comme “opéra cinéplastique” : l’unité du langage cinématographique ne sera pas seulement le plan, mais aussi les composantes mêmes de l’image, telles le noir vs le blanc, les verticales vs les horizontales, le son vs l’image. Le film devra alors faire appel aux autres arts (opéra, poésie, musique, littérature, etc.) au nom d’un syncrétisme artistique dont le seul le cinéma serait capable. »14
Les théoriciens et cinéastes soviétiques ont donc systématisé la fonction du montage décrite ainsi par Poudovkine : « Par l’assemblage de morceaux séparés le réalisateur bâtit un espace filmique idéal qui est entièrement sa création. Il unit et soude des éléments séparés qui ont peut-être été enregistrés par lui en différents points de l’espace réel, de façon à créer un espace filmique. » Certes, il y a de fortes divergences d’analyse et même des contradictions antagoniques entre Poudovkine, Eisenstein, Vertov mais ils restent unanimes pour reconnaître au montage le rôle prépondérant car « montrer quelque chose comme chacun le voit, c’est n’avoir accompli strictement rien ».
Mais c’est dans Poetika Kino, recueil de cinq essais publié en 1927 par six membres de l’OPOIAZ (société d’étude de la langue poétique), que l’hypothèse du « ciné-langage » est le plus explicitement formulée.
1.4.5 Les formalistes russes et Poetika Kino
Fondé sous le nom de « Cercle linguistique de Moscou » à l’hiver 1915, connu à partir de 1917 sous le nom d’O.PO.IAZ (abréviation de « groupe d’études du langage poétique »), ce groupe de chercheurs et critiques russes, actif jusqu’au début des années 1930, fut surnommé « Formaliste » par ses détracteurs ; c’est ce surnom qui est resté. Ce groupe n’eut jamais de vraie théorie d’ensemble, et les travaux de ses membres, quoique ressortissant à une inspiration commune, ne sont pas absolument systématiques, et ont plutôt visé à définir un projet d’étude de la littérature et de la poésie, sur les grandes lignes suivantes : 1° L’étude d’une œuvre est – dialectiquement – son étude comme singularité : en quoi mobilise-t-elle de façon neuve des procédés poétiques ou littéraires ? et comme œuvre d’art ? En quoi manifeste-t-elle son artisticité ? En quoi, donc, ressortit-elle à l’exercice de régularités ? 2° Il existe, de l’artisticité, des critères purement esthétiques : les Formalistes n’adoptent pas les définitions créatorielle ni institutionnelle de l’art, ni en général une définition conventionnelle. Ces critères sont souvent assimilés à des « procédés formels », visant à produire une sensation neuve ; cette nouveauté met le spectateur en position d’éprouver l’œuvre comme étrange, d’où le concept d’ostraniéniyé (parfois rendu par « distanciation », ou plus justement par « estrangement »). 3° Les procédés littéraires, ou en général artistiques, ont une existence plus ou moins autonome ; ils ont une « signification » ou une valeur propres, transhistoriques. L’histoire des œuvres n’est donc pas celle des contenus mais celle des formes : « La nouvelle forme n’apparaît pas pour exprimer un contenu nouveau, mais pour remplacer l’ancienne forme qui a perdu son caractère esthétique » (Chklovski). 4° Conséquence pour l’analyse des œuvres : choix de la motivation « horizontale » contre la motivation « verticale » (ou mise en évidence de procédés purement formels, comme l’allitération, la répétition en général) ; postulat de la « mise à nu du procédé » : l’œuvre exhibe son propre système formel, le désigne à l’attention.
Les Formalistes se sont intéressés au cinéma, comme en témoigne le recueil Poetika kino (Poétique du cinéma, 1927) avec les textes de Tynianov et Eichenbaum que nous citons ci-dessous :
Dans son article « Des fondements du cinéma », Youri Tynianov précise que « dans le cinéma, le monde visible est donné non en tant que tel, mais dans sa corrélation sémantique, sinon le cinéma ne serait qu’une photographie vivante. L’homme visible, la chose visible ne sont un élément du ciné-art que lorsqu’ils sont donnés en qualité de signe sémantique ». Cette « corrélation sémantique » est donnée au moyen d’une transfiguration stylistique : « la corrélation des personnages et des choses dans l’image, la corrélation des personnages entre eux, du tout et de la partie, ce qu’il est convenu d’appeler la “composition de l’image”, l’angle de prise de vue et la perspective dans lesquels ils sont pris, et enfin l’éclairage, ont une importance colossale. » C’est par la mobilisation de ces paramètres formels que le cinéma transforme son matériau de base, l’image du monde visible, en élément sémantique de son langage propre. On voit ici combien ces thèses sont proches de celles de Béla Balázs.
Tynianov annonce également la conception pasolinienne du ciné-langage lorsqu’il écrit qu’« aussi étrange que cela soit, si l’on établit une analogie entre le cinéma et les arts du verbe, la seule légitime sera non pas celle entre le cinéma et la prose, mais entre le cinéma et la poésie ».
Dans « Problèmes de ciné-stylistique », Boris Eichenbaum indique qu’il est « impossible de considérer le cinéma comme un art totalement non verbal. Ceux qui veulent défendre le cinéma contre la littérature oublient souvent qu’au cinéma, c’est le mot audible qui est exclu et non la pensée, c’est-à-dire le langage intérieur ». Selon cette hypothèse, la lecture du film nécessite un travail contemporain de la perception, ce travail étant la mise en fonction du langage intérieur qui caractérise toute pensée : « La perception cinématographique est un processus qui va de l’objet, du mouvement visible à son interprétation, à la construction du langage intérieur […] Le spectateur doit effectuer un travail complexe pour lier les plans (construction des ciné-phrases et des ciné-périodes). » Cela l’amène à la définition suivante : « en fin de compte, le cinéma comme tous les autres arts est un système particulier de langage figuré » (puisqu’en général il est utilisé comme « langue »). Cela suppose que le fait pour le cinéma d’être ou non un système significatif dépend des intentions de l’utilisateur.
Toutefois, pour les formalistes russes, il n’y a art et par conséquent « langue cinématographique » que lorsqu’il y a transformation stylistique du monde réel. Cette transformation ne peut intervenir qu’en liaison avec l’emploi de certains procédés expressifs qui résulte d’une intention de communiquer une signification. « Ciné-phrase », « ciné-sémantique », « ciné-stylistique », « ciné-métaphore », tous ces termes indiquent le mouvement général d’extrapolation qui caractérise la démarche de ces théoriciens.
Ce mouvement va s’amplifier avec les tentatives d’élaboration des « grammaires du cinéma » à la suite du traité de Poudovkine sur les techniques du cinéma, résumé en 1935 par Raymond Spottiswoode comme nous l’avons indiqué plus haut.
Ces idées directrices ont influencé, à la fin des années 1960, l’analyse des récits cinématographiques, et aussi la conception de l’idéologie transmise par les films. Elles ont surtout été reprises, très délibérément, par l’école « néo-formaliste » (D. Bordwell et ses élèves, voir chap. 3.2 § 2.2.2).
L’ensemble des approches théoriques que nous venons de présenter ont été développées alors que le cinéma était principalement muet. Tous les théoriciens insistent sur l’image et sa visualité, comme sur le montage. Deux décennies après Münsterberg, un autre psychologue allemand va alors proposer une synthèse de la théorie du film de conception gestaltiste, Rudolf Arnheim, écrivant au moment où le cinéma bascule vers le parlant (Film als Kunst, 1932).
1.5 Le bilan des théories du muet : Rudolf Arnheim
Psychologue, philosophe, historien d’art, critique de cinéma et plus généralement des médias, Arnheim est l’auteur de nombreux articles, et d’un livre (Film als Kunst, 1932) qui offrait, à l’époque de l’apparition du parlant, une esthétique et une psychologie du cinéma.
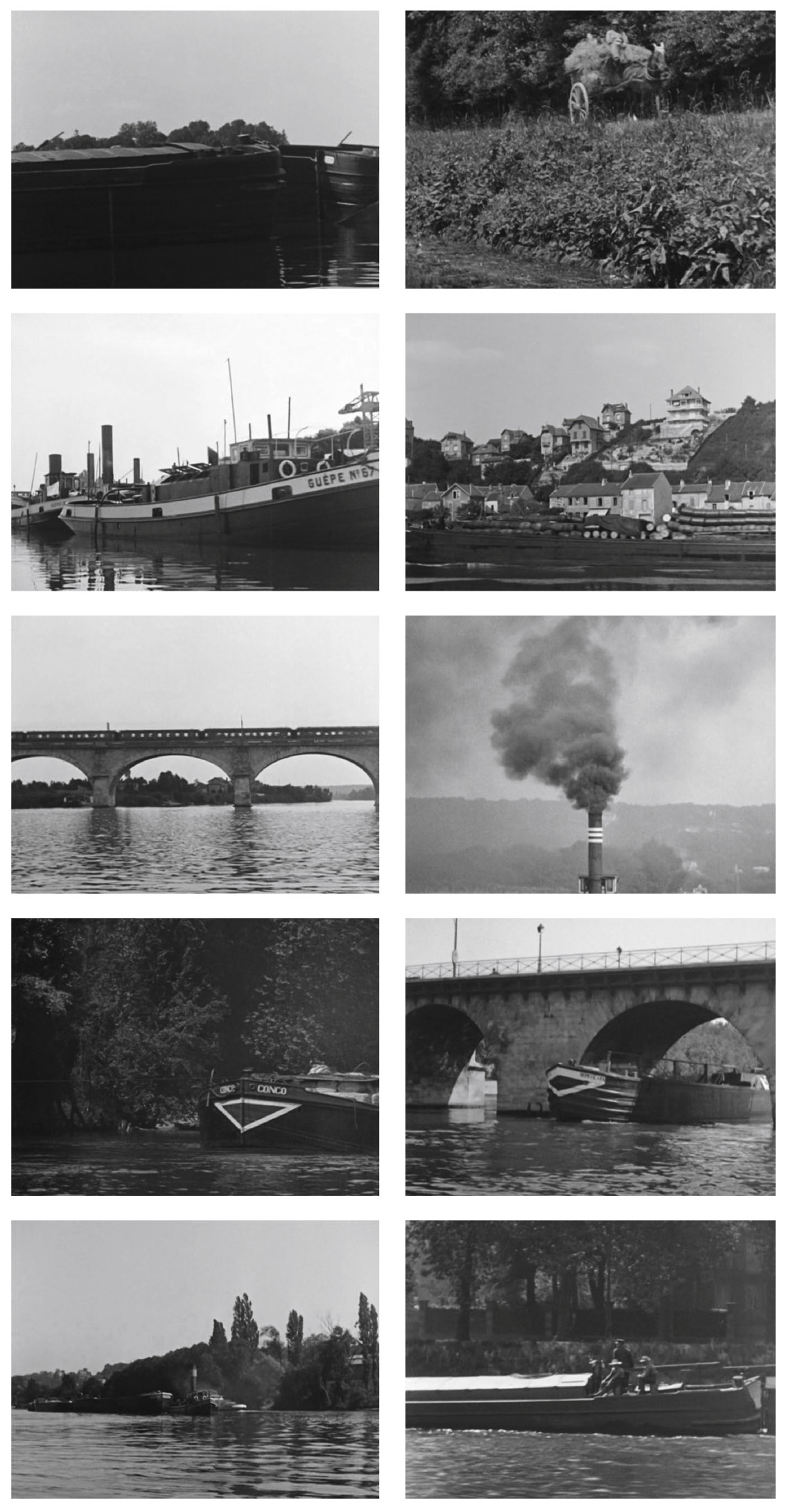
3.4 Dix images d’Études sur Paris (André Sauvage, 1928), toutes en mouvement, lors d’un montage très fluide fondé sur la circulation de l’eau du fleuve et des canaux : photogénie du « réel » documentaire.
« Théoricien de l’art, Rudolf Arnheim a développé une conception du cinéma en tant qu’art, davantage axée sur les qualités propres du médium que sur ce qui est représenté à l’écran. Fortement inspiré de la psychologie de la forme, la Gestalttheorie15, et de ses découvertes dans le domaine de la perception – le visible, tel que perçu par nos yeux, est déformé par le prisme de nos processus mentaux –, Arnheim part de l’idée qu’un sujet identique capté par un autre médium que le cinéma – photographie, peinture, littérature, etc. – aboutirait à une représentation différente – c’est la Materialtheorie. Dès lors, si le cinéma – à l’instar de la photographie – est considéré comme un instrument capable de reproduire fidèlement le réel, sa théorie ne peut plus fonctionner. Arnheim va donc porter son attention sur tout ce qui différencie les images cinématographiques d’une stricte reproduction du réel, qu’il s’agisse, par exemple, des distorsions optiques, des limites imposées par le cadre de l’écran, de la taille de l’image, de l’angle de prise de vue, de l’absence de son, de couleur ou encore de continuité spatio-temporelle. Ces “facteurs de différenciation” représentent, de ce fait, les limites propres au cinéma, mais aussi ses “moyens formateurs” spécifiques, ce qui rapproche beaucoup ces thèses d’Arnheim de celles de Münsterberg. Ainsi le cinéma, par sa capacité à transformer le réel brut, est-il un art. Dans cette perspective, toute innovation technique – le son, et bientôt la couleur – permettant de rapprocher l’image cinématographique d’une représentation analogique du réel va à l’encontre de cet art :
“La tentation d’élargir la surface de l’écran s’accompagne du désir de films en couleurs, en relief et sonores. C’est là ce que désirent ceux qui ignorent combien l’effet artistique est lié aux limites du médium […] Ils s’obstinent à vouloir s’approcher toujours plus près de la nature sans comprendre que, ce faisant, ils rendent toujours plus difficile au cinéma sa tâche d’être un art.” »16
Il faut donc retenir cette thèse des « facteurs de différenciation » : si le cinéma peut être un art, ce n’est qu’à condition de surmonter le handicap initial que constitue sa capacité de reproduction photographique, c’est-à-dire « automatique », du « réel ». Tout illusionnisme et tout naturalisme sont à éviter absolument, et les moyens artistiques du cinéma sont au contraire à chercher dans ce qui le différencie d’une simple reproduction du monde visible. Absence de couleur, absence de son, absence de continuité spatio-temporelle, limitation physique de l’image, etc. : toutes ces limitations sont les facteurs mêmes qui permettent au cinéma de devenir un art, voire l’y obligent.
Logiquement, Arnheim fut opposé, violemment, au cinéma parlant, apparu peu de temps avant la sortie de son livre, et qui avait pour lui le défaut rédhibitoire de tirer le cinéma dans le sens de l’analogie plate. Émigré aux États-Unis en 1938, Arnheim y poursuivit une carrière universitaire d’historien d’art et de psychologue de l’art, mais n’écrivit plus sur le cinéma. Il traduisit en revanche son ouvrage en anglais, dans une version révisée qui en édulcore considérablement les thèses, et perd par là beaucoup de son intérêt.
Dans tous ses travaux, Arnheim défend donc une conception gestaltiste des phénomènes perceptifs et psychologiques : si le film peut produire des sensations analogues à celles qui affectent notre vue, il le fait sans le correctif des processus mentaux, parce qu’il a affaire, à l’état brut, à ce qui est matériellement visible, et non pas à la sphère proprement humaine du visuel.
1.6 Les années d’après-guerre et les théories réalistes
Après 1945, les approches théoriques sont dominées par la notion de réalisme. Cette thèse triomphe dans les textes de Siegfried Kracauer et d’André Bazin. Elle sera discutée par Jean Mitry.
1.6.1 Siegfried Kracauer
Journaliste, sociologue et historien allemand, Siegfried Kracauer collabora à divers journaux, tant en Allemagne (avant 1933) qu’aux États-Unis, où il s’exila par la suite, et contribua à la réflexion sur le cinéma par deux ouvrages d’inspiration et de visée très différentes : De Caligari à Hitler (1947) et Theory of Film (1960)17.
Sous-titré « Histoire psychologique du cinéma allemand », De Caligari à Hitler, le premier de ces livres a proposé une thèse célèbre : le cinéma de l’époque de Weimar, en particulier le courant « expressionniste », aurait représenté une aspiration souterraine du peuple allemand à l’autorité ; il aurait, en quelque sorte, préfiguré de manière obscure mais exacte l’avènement du nazisme. Il envisage ainsi le personnage de Caligari comme une préfiguration, à l’instar du docteur Mabuse de Fritz Lang, de la folie meurtrière de Hitler. Le développement se consacre en fait assez largement à l’étude des scénarios de films au détriment de leur iconographie ; le travail singulier de certains auteurs (Lang, Murnau, par exemple) se trouve également diminué au nom de la conception du film comme travail collectif. L’ouvrage fit date en mettant en évidence à quel point le cinéma s’insérait dans un contexte social et politique.
Son livre de théorie (Theory of Film) est l’un des plus extrémistes imaginables : pour lui, le cinéma, extension de la photographie, a vocation à enregistrer et à révéler la réalité physique. Un véritable film doit donc nous mettre face au monde dans lequel nous vivons, le « pénétrer » sous nos yeux. Le cinéma est une sorte de lecture du « livre du monde » (voire de la nature), le cinéaste, un « explorateur ». Le matériau privilégié du cinéma, c’est donc tout ce que le monde offre de transitoire et d’éphémère ; en revanche, le tragique, en tant qu’expérience purement mentale, n’a pas d’équivalent dans le monde filmique.
Le cinéma est défini comme un art essentiellement réaliste, en raison de son origine photographique : le cinéaste se doit de rester fidèle à la reproduction de la réalité physique en privilégiant une esthétique réaliste plutôt que sa propre créativité – Kracauer évoque une véritable rédemption de la réalité physique opérée par le cinéma. Cette exploration de la réalité, héritière directe des premiers films Lumière, doit autant qu’il est possible conserver à la réalité son aspect mouvant, indéterminé, en étant attentif aux hasards ou aux événements fortuits.
Les thèses de Kracauer recoupent par de nombreux aspects celles qu’André Bazin développe à la même époque.
1.6.2 André Bazin
Critique français, André Bazin a collaboré à des quotidiens (Le Parisien libéré), des hebdomadaires (L’Écran français, France-Observateur) et à des mensuels, dont les Cahiers du cinéma, qu’il contribua à fonder en 1951. Il n’est l’auteur d’aucun livre systématique, mais de plusieurs recueils d’articles, dont l’anthologie Qu’est-ce que le cinéma ? est la plus représentative, et la plus intéressante pour les idées théoriques qui y sont proposées.
« Si le verbe de Louis Delluc fut l’âme du cinéma français, l’âme d’André Bazin a fait de lui le Delluc de demain, la conscience d’une génération : non pas celle à qui nous devons le cinéma d’aujourd’hui, mais celle qui va faire le cinéma, demain. » (Henri Langlois)
André Bazin est en quelque sorte le père fondateur de la critique moderne de cinéma en France, du moins pour la génération d’après-guerre, à partir de 1945. Il fut influencé par la lecture de Bergson (sur le continu, la durée, la force), Sartre (L’Imaginaire : la problématique de la liberté et les implications métaphysiques du style), Malraux (Esquisse d’une psychologie du cinéma), et des essayistes catholiques (Mounier, Teilhard de Chardin). À la fois théoricien et critique au jour le jour, ses textes associent pédagogie, patience scrupuleuse, et sens du paradoxe, innervés par ce souci premier : « Il est grand temps d’inventer une critique cinématographique en relief » (« Pour une critique cinématographique »).
Influencé par le Sartre de L’Imaginaire, Bazin pose l’art comme moment crucial dans l’effort psychologique de l’homme pour dépasser ses conditions réelles d’existence. Liant ontologie et histoire des arts figuratifs, il lit dans la photographie un moment essentiel de cette histoire, libérant « les arts plastiques de leur obsession de la ressemblance » en assurant automatiquement celle-ci, et répondant par là à un profond besoin psychologique d’« embaumer le temps ». Empreinte littérale du réel, l’image photographique « emporte notre croyance » ; prenant la relève, le cinéma réalise de mieux en mieux, au fil de son évolution, l’idéal du « cinéma total », empreinte non seulement de l’espace mais de la durée. La photographie, et le cinéma à sa suite, « rendent hommage au monde tel qu’il paraît », et nous mettent en présence de la « chose même ».
Aussi Bazin condamne-t-il, comme contraire à la nature du cinéma, toute intervention excessive, toute manipulation, toute « tricherie », qui attenterait à l’intégrité du réel représenté ; cela l’amène notamment à « interdire » le montage dans tous les cas où son utilisation produirait un sens trop univoque, imposé par l’arbitraire du cinéaste, au détriment de l’« ambiguïté immanente au réel ». Corrélativement, le film doit se garder d’imposer au spectateur une interprétation de ce qui lui est montré ; cette « liberté psychologique » du spectateur amène Bazin à privilégier des styles fondés sur le plan-séquence et la profondeur de champ (voir ses commentaires sur les films d’Orson Welles, dans le recueil consacré à ce cinéaste).
« Dans sa série Qu’est-ce que le cinéma ?, il a posé quelques-uns des fondements de sa pensée sur le cinéma qui ont eu une très riche et longue postérité. L’origine photographique du film (voir “Ontologie de l’image photographique”), constitue le fondement ontologique du cinéma, à la fois vitaliste et mortifère, qu’il appelle le “réalisme ontologique” : “Pour la première fois [avec le cinéma], l’image des choses est aussi celle de leur durée et comme la momie du changement.” Le réalisme ontologique qui constitue le cinéma et lui confère une plénitude (“la robe sans couture de la réalité”) quasi sacrée induit quelques principes esthético-éthiques, dont le fameux “montage interdit” qui ordonne le respect de la continuité et de l’indétermination du réel contre le morcellement truqué par le montage, et conduit à privilégier le plan-séquence (à travers la défense de William Wyler) et la profondeur de champ. Ce devoir de respect de l’insécabilité de la réalité, noué au pouvoir révélateur du cinéma (l’écran de cinéma comme cache et non comme cadre), ne provoque pas pour autant le rejet des fractures stylistiques. André Bazin a inventé la formule célèbre du “cinéma impur”, à propos de la question des adaptations littéraires (voir “Pour un cinéma impur. Défense de l’adaptation”) posée par lui de manière totalement inédite : on retrouve une essence cinématographique dans un texte littéraire non pas en cherchant des équivalences pour produire des effets de cinéma, mais en en décuplant justement la matière littéraire de départ, le surcroît de théâtralité étant ainsi une manière d’atteindre le cinéma… »18
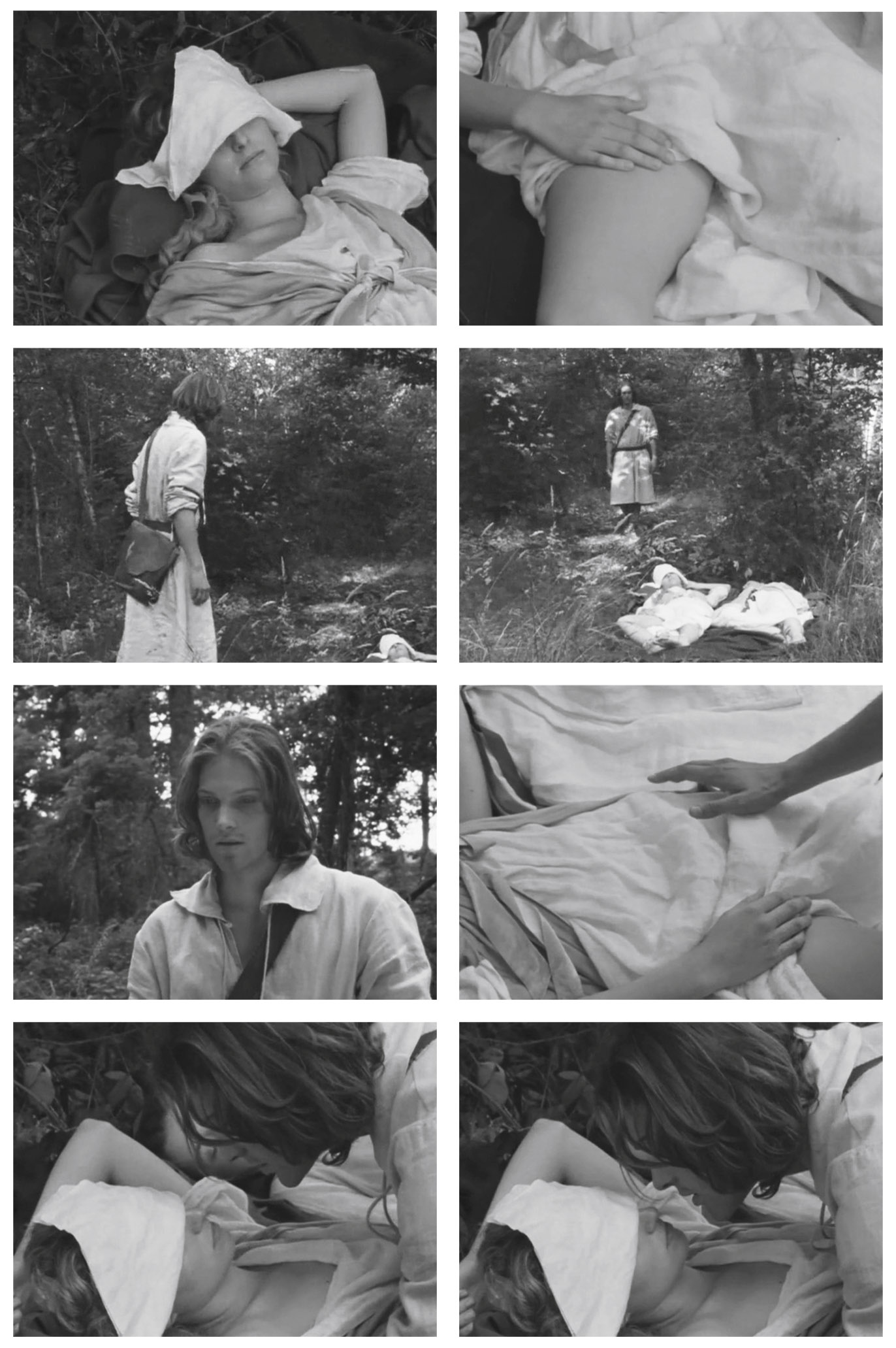
3.5 Les Amours d’Astrée et de Céladon (Éric Rohmer, 2007).
Un surcroît de « littérarité » dans une adaptation d’Honoré d’Urfé par un cinéaste d’une liberté de création exceptionnelle dont c’est l’œuvre ultime.
Les thèses réalistes défendues par Kracauer et Bazin ont eu une grande influence sur les courants principaux de la théorie du cinéma, elles ont été également vigoureusement discutées et contestées par d’autres théoriciens et historiens au premier rang desquels figure Jean Mitry. Toutefois, avant d’en venir aux thèses de Mitry concernant la signification au cinéma, il importe de mentionner les recherches de l’Institut de filmologie qui se sont développés entre 1946 et 1953.
1.6.3 La filmologie
Le terme « filmologie » a été forgé en 1946, lors de la création de l’Institut de filmologie à la Sorbonne. Ce dernier a existé de 1947 à 1959, et ses travaux ont été publiés par la Revue internationale de filmologie19. La filmologie se voulut étude générale du fait filmique, sans considération d’œuvres ou d’auteurs particuliers. Elle s’opposa ainsi radicalement à l’approche critique, de même qu’à l’analyse de films (au sens où celle-ci analyse des œuvres particulières). Elle s’est développée autour de trois corps de disciplines préexistantes (Cohen-Séat, 1946) et s’est directement posé le problème de la signification au cinéma :
1° La psycho-physiologie de la perception s’est principalement attachée à étudier la perception de film en tant que perception visuelle. L’objet central de son étude fut « l’impression de réalité » et les phénomènes de croyance provoqués par les images mouvantes. L’image de film fut comparée aux autres images artificielles, comme par exemple l’image du radar et l’image électronique. Cette « impression de réalité » sera reprise et commentée par Metz dans ses premiers articles.
2° À la croisée de la sociologie et de la psychologie de l’éducation, la filmologie a étudié l’effet produit par la projection cinématographique sur des publics scientifiquement sélectionnés. Il s’agissait la plupart du temps d’un public d’enfants dont on testait le niveau de compréhension des suites imagées. Le psychologue René Zazzo s’interrogea sur le rôle du niveau mental dans la compréhension du film, l’anthropologue anglais J. Maddison étudia l’information mentale des peuples « primitifs » par le moyen du cinéma. La filmologie sur son versant médical analysa les réactions des enfants inadaptés, leur processus de mémorisation des images filmiques, notamment. Les recherches cognitivistes se situent dans cet héritage.
3° La filmologie s’est également efforcé de jeter les bases d’une approche esthétique générale du fait filmique, notamment en définissant les « grands caractères de l’univers filmique » (Souriau), dans la perspective d’une esthétique comparée. L’univers filmique est appréhendé à partir du corps de notions de la phénoménologie ; il est fondé sur la dissociation entre perception écranique (platitude de l’écran, dimension constante, durée objective : les jeux de luminosité et d’obscurité, les formes, ce qui est visible) et perception diégétique, purement imaginaire, reconstruite par la pensée du spectateur, espace dans lequel sont censés se passer tous les événements que le film présente, dans lequel les personnages paraissent se mouvoir.
Ces recherches ont été reprises et prolongées par la sémiologie après 1960. Elles sont également commentées en détails par Jean Mitry (1963, 1965).
1.6.4 Jean Mitry
Jean Mitry a été critique dès 1923 dans Ciné pour tous et Cinéa-Ciné ; c’est en commençant à enseigner l’histoire et l’esthétique du cinéma dans les premières années de l’IDHEC, en 1944-1945, qu’il systématise ses réflexions théoriques à propos du septième art. Ce travail aboutit à la monumentale synthèse en deux volumes d’Esthétique et psychologie du cinéma (1963-1965).
Mitry avait à coup sûr lu pratiquement tout ce qui s’était publié d’intéressant sur le cinéma depuis les années 1920, y compris hors de France. Il fut ainsi l’un des tout premiers à commenter Balázs ou Arnheim, et sa curiosité universelle l’amena à utiliser, pour réfléchir sur le cinéma, des auteurs aussi divers que Worringer, Wittgenstein, Carnap, Russell, Poincaré. Il est difficile toutefois de discerner, dans ses œuvres de synthèse, une véritable ligne directrice, à l’exception peut-être d’une utilisation récurrente des thèses de la Gestalttheorie, notamment à propos de la question du rythme dans les films (les chapitres correspondants de son livre de 1963 constituent toujours une mise au point judicieuse sur le sujet).
Car l’œuvre clé de Mitry reste les deux tomes de son Esthétique et psychologie du cinéma. Reprenant tous les problèmes théoriques fondamentaux – le cinéma en tant que langage, la psychologie des mouvements de caméra et de la profondeur de champ, les notions de temps, d’espace, de réalité, les structures de l’image, etc. – développés par ses prédécesseurs – dont Arnheim, Balász, Cohen-Séat et Morin –, Mitry apporte un nouvel éclairage en développant une thèse anti-bazinienne qui écarte tout présupposé philosophique au profit d’une logique scientifique. Car « les conditions de l’expression filmique sont fondées, de toute évidence, sur la psychologie des perceptions et les phénomènes de conscience » (Esthétique, tome 2). Polémiste jusqu’à la fin de sa vie, Mitry effectue, plus de vingt ans après, une relecture critique d’Esthétique et, refusant d’être dépassé par une nouvelle génération de théoriciens qui travaille à moderniser la réflexion cinématographique, se réfère aux travaux de Metz – pourtant analyste révérencieux de Mitry – afin de démontrer les limites de la sémiologie appliquée au film et de proclamer « son échec entendu au sens large » (La Sémiologie en question). Mitry y critique véhémentement la sémiologie d’inspiration linguistique et tente de lui opposer une science de la signification fondée sur un modèle phénoménologique, au nom d’une « théorie de l’image et du réel perçu ».
Il appartient en particulier à Mitry dans le troisième chapitre de son Esthétique et psychologie du cinéma d’avoir réaffirmé l’existence du langage cinématographique en en élargissant les bases.
Mitry part d’abord de la conception traditionnelle du cinéma comme moyen d’expression pour ajouter aussitôt qu’un moyen d’expression, comme l’est le cinéma « susceptible d’organiser, de construire et de communiquer des pensées, pouvant développer des idées qui se modifient, se forment et se transforment, devient alors un langage, est ce qu’on appelle un langage ». Ce qui l’amène à définir le cinéma comme étant une forme esthétique (tout comme la littérature), utilisant l’image qui est (en elle-même et par elle-même) un moyen d’expression dont la suite (c’est-à-dire l’organisation logique et dialectique) est un langage.
Cette définition a le mérite de mettre l’accent sur la matière signifiante du cinéma (l’image au sens large) ainsi que sur la mise en séquence, deux traits qui caractérisent un langage.
Le langage, pour Mitry, c’est un système de signes ou de symboles (définition très saussurienne) qui permet de désigner les choses en les nommant, de signifier des idées, de traduire des pensées. Il précise plus loin qu’il ne faut pas réduire le langage au seul moyen permettant les échanges de la conversation, c’est-à-dire au langage verbal, que ce dernier n’est qu’une forme particulière d’un phénomène plus général. Il y a bien langage cinématographique, même si celui-ci élabore ses significations non pas à partir de figures abstraites plus ou moins conventionnelles, mais au moyen de « la reproduction du réel concret », c’est-à-dire de la reproduction analogique du « réel visuel et sonore ».
Mitry a bien vu que l’erreur des théoriciens antérieurs, celle qui sous-tend la conception dominante du langage cinématographique, réside dans le fait que ceux-ci posent a priori le langage verbal comme étant la forme exclusive du langage, et puisque le langage filmique est nécessairement différent, ils en concluent que celui-ci n’est pas un langage.
Un passage de l’auteur résume avec clarté la dialectique propre à l’élaboration du langage filmique à partir de la représentation, de l’image des choses :
« Il est évident qu’un film est tout autre chose qu’un système de signes et de symboles. Du moins ne se présente-t-il pas comme étant cela seulement. Un film, ce sont d’abord des images et des images de quelque chose. C’est un système d’images ayant pour objet de décrire, de développer, de narrer un événement ou une suite d’événements quelconques. Mais ces images, selon la narration choisie, s’organisent en un système de signes et de symboles ; elles deviennent symboles ou peuvent le devenir de surcroît. Elles ne sont pas uniquement signes comme les mots, mais d’abord objets, réalité concrète : un objet qui se charge (ou que l’on charge) d’une signification déterminée. C’est en cela que le cinéma est un langage ; il devient langage dans la mesure où il est d’abord représentation et à la faveur de cette représentation ; c’est, si l’on veut, un langage au second degré. »
Les perspectives théoriques de Mitry permettent ainsi d’éviter un double écueil. Elles manifestent clairement le niveau d’existence du langage cinématographique en insistant sur le fait que le cinéma, tout en étant une « représentation du réel » n’en est pas un simple décalque ; la liberté du cinéaste, la création d’un pseudo-monde, d’un univers semblable à celui de la réalité ne s’opposent pas à l’instance du langage ; c’est au contraire celui-ci qui permet l’exercice de la création filmique.
Tout film suppose également une composition et un agencement ; ces deux activités n’impliquent aucunement l’alignement sur des structures conventionnelles. L’importance du cinéma provient précisément de ce qu’il suggère avec insistance l’idée d’un langage de type nouveau, différent du langage verbal. Le langage cinématographique s’écarte notablement du langage articulé. L’entreprise sémiologique inaugurée par Christian Metz s’est efforcée de mesurer ces écarts et les zones de recouvrement possible, et cela avec un niveau de précision encore inusité dans le champ de la théorie du cinéma.
1.7 La sémiologie et les sémiologies
À partir du milieu des années 1960, la théorie du cinéma subit l’influence de la sémiologie naissante, au moment des travaux de Roland Barthes sur la sémiologie générale20. C’est Christian Metz qui va s’inspirer le plus directement de ce courant de réflexion pour rependre autrement la question du supposé « langage cinématographique ». Ses travaux vont susciter de nombreux commentaires proposant d’autres modèles sémiologiques. C’est le cas notamment des propositions de Peter Wollen et de Pier Paolo Pasolini que nous aborderons ensuite.
1.7.1 Christian Metz
Agrégé de lettres classiques, amateur de jazz et cinéphile, c’est comme linguiste que Metz commence une carrière de chercheur. C’est à ce titre qu’il publie, en 1964, le premier d’une longue suite d’articles destinés à examiner la pertinence d’une comparaison entre le cinéma et le langage, et à esquisser le projet d’une sémiologie du cinéma, selon la définition de cette discipline qu’avait donnée Saussure, « Le cinéma, langue ou langage ? ».
On peut distinguer dans sa recherche trois moments principaux. Le premier s’inscrit dans un mouvement général d’élaboration d’une sémiologie des systèmes de signes non linguistiques où il rencontre notamment les travaux de Barthes (théorie générale de la sémiologie ou théories plus particulières, entre autres sur la photographie), de Greimas puis de Genette, et, en Italie, de Garroni et de Pasolini. Cette période culmine avec Langage et cinéma (1971) qui en représente l’aboutissement, et développe la thèse fondamentale du cinéma « langage sans langue », dans lequel jouent des « codes » dont l’ensemble, conçu comme relativement systématique, tient lieu de la langue introuvable, et explique que, malgré tout, les films puissent être compris, communiquer du sens et signifier.
Une seconde période interroge autrement le signifiant filmique (les images mouvantes et les sons), dont il s’agit de comprendre le rapport à la « réalité » reproduite, non plus en termes de sens, mais en termes de relation imaginaire entre un sujet-spectateur et le spectacle en images auquel il est confronté (Le Signifiant imaginaire, 1977). C’est alors principalement la théorie freudienne du sujet qui est mise à contribution, et qui nourrit des études « métapsychologiques » de la position spectatorielle (comparée, par exemple, à celle du rêveur ou à l’hallucination) ; le signifiant filmique est interrogé à partir de cette appropriation par un sujet-spectateur qui croit et en même temps ne croit pas à ce qu’il voit. Metz insiste en outre sur la dimension intrinsèquement figurale de ce signifiant – au sens de la rhétorique mais aussi au sens plastique – dépassant ainsi ce qu’avait à ses propres yeux de trop rigide le modèle saussurien.
Enfin, une troisième période voit Metz tenter une synthèse de la sémio-linguistique et de la sémio-psychanalyse, en analysant la notion d’énonciation appliquée au film – une énonciation « impersonnelle », car non liée à un sujet mais à un site abstrait (1991). Metz rejoint alors les travaux de nombreux chercheurs, dont son livre est une sorte de panorama synthétique.
Les deux premiers livres de Metz, portés par un mouvement général de curiosité pour les sciences humaines et par la vague structuraliste, ont eu une influence internationale exceptionnelle. En France, ses travaux, ouvertement déclarés scientifiques, auront permis aux études cinématographiques d’acquérir un statut disciplinaire dans l’Université, ce que n’avait pas réussi l’Institut de filmologie de la Sorbonne dans les années 1950.
L’aspect le plus singulier de la démarche théorique de Metz est son principe de réflexion par différenciation négative : il s’agit d’abord de démontrer, en s’appuyant sur la linguistique structurale, que le cinéma n’est pas une langue, quoiqu’il soit une sorte de langage. De même, il s’agira ensuite de souligner que, quoique le spectateur de film perçoive les images selon un flux qui présente de nombreuses analogies avec la perception onirique, il ne rêve pas vraiment. Quant à l’énonciation filmique, elle se distingue de son statut linguistique, car elle ne fait pas intervenir l’alternance entre des personnes (« je » et « tu »).
La période initiale est consacrée à l’analyse rigoureuse des différences entre le langage cinématographique et la langue proprement dite. Ce qui caractérise la langue, ou les langues naturelles, c’est qu’elles sont multiples, ce qui n’est pas le cas du cinéma. La langue permet à tout instant la permutation des rôles entre locuteur et interlocuteur. Malgré le développement des caméras sur les téléphones portables, cette permutation des rôles ne se retrouvent pas avec les images enregistrées. Mais la différence fondamentale concerne le statut des images du film, fondé sur une relation d’analogie alors que les productions sonores des langues relèvent toutes de l’arbitraire. Enfin, les unités significatives et distinctives de la langue ne se retrouvent pas du tout dans les éléments du langage cinématographique, qui possède des unités spécifiques.
Un autre apport des propositions metziennes repose sur la mise en évidence de « codes » propres au cinéma, mais plus encore sur la distinction entre les codes qui lui sont spécifiques et ceux qui ne le sont pas. Seuls les « codes spécifiques » constituent le langage propre au cinéma et ils sont liés à la nature visuelle et mouvante de l’image et des sons qui l’accompagnent. Un code très particulier est par exemple celui des mouvements de caméra, alors que celui des échelles des plans se retrouve en photographie, comme en arts plastiques.
Cette distinction met en évidence le rôle des codes dits « non spécifiques », de loin les plus nombreux. Ce qui veut dire qu’étudier un film, ce sera étudier un très grand nombre de configurations signifiantes qui n’ont rien de spécifiquement cinématographique.
C’est dans Langage et cinéma que Metz approfondit l’opposition entre film et langage cinématographique. Ce que l’on retrouve dans un film, c’est un « système textuel » fondé sur des codes spécifiques et bien d’autres qui ne le sont pas. Cette hypothèse est illustrée par l’analyse du système textuel d’Intolerance (1916), de Griffith que nous présentons ici brièvement à titre d’exemple.
Intolerance est composé de quatre récits différents présentés d’abord séparément, puis les uns à la suite des autres selon un rythme de plus en plus rapide : il s’agit de la chute de Babylone, de la Passion du Christ en Palestine, de la Saint-Barthélémy en France au xvie siècle et d’un épisode « moderne » se déroulant dans l’Amérique contemporaine de la réalisation du film. Le film est donc structuré d’une manière originale : par un montage parallèle généralisé à sa construction d’ensemble. Ce montage parallèle est un type particulier de construction séquentielle qui appartient à un code spécifiquement cinématographique, celui du montage au sens d’agencement syntagmatique des segments de films. Certes, cette construction peut également intervenir dans un récit littéraire, théâtral, mais elle est ici spécifiquement cinématographique dans la mesure où elle nécessite, pour produire un effet visuel et émotionnel aussi particulier et intense, la mobilisation du signifiant cinématographique : une succession dynamique d’images en mouvement. Le montage parallèle est l’une des figures de montage possible, il s’oppose à d’autres types d’agencement séquentiel : le montage alterné qui instaure une relation de simultanéité entre les séries, le montage simplement linéaire où les séquences s’enchaînent selon une progression chronologique. Le montage alterné, figure de montage précisément « mise au point » par Griffith dans ses courts métrages de la Biograph, intervient également dans Intolerance, mais à l’intérieur des épisodes, notamment dans la dernière partie du récit moderne lors de la poursuite entre l’automobile et le train, poursuite dont dépend la vie d’un innocent, celle du héros injustement condamné à la pendaison.
Le langage cinématographique, système relationnel abstrait constitué par l’ensemble de la production cinématographique antérieure à Intolerance, offre donc à Griffith une configuration signifiante, le montage parallèle, que le système textuel du film va utiliser, travailler, transformer. Il va l’étendre à la totalité du film puis l’accélérer en passant d’un parallélisme entre groupes de séquences (début du film) à un parallélisme entre séquences (centre du film) pour enfin aboutir à un parallélisme entre fragments de séquence, entre plans où l’unité séquentielle est totalement pulvérisée, passée au « hachoir » du montage. L’accélération finale n’est produite que par ce jeu du parallélisme sur lui-même, mouvement qui transforme totalement la configuration initiale de cette forme de montage jusqu’à la détruire : le système filmique est un travail du film sur le langage.
Ce montage parallèle généralisé est inséparable de la thématique propre au film, thématique fondée sur des configurations signifiantes extra-cinématographiques, ici une configuration idéologique qui oppose radicalement l’intolérance, comme son titre l’indique, à travers la diversité de ses manifestations historiques, à l’image allégorique de la bonté et de la tolérance incarnée par une figure toujours semblable : celle d’une mère berçant son enfant. La dynamique textuelle du film est fondée sur une séparation nettement affirmée au départ de chacun des épisodes consacrés au fanatisme, séparation niée puis transformée en fusion chargée de matérialiser visuellement l’identité de l’intolérance au-delà de la diversité de ses visages contingents. Cette mise en relation antagonique provoque un nouveau palier dans le parallélisme, palier qui, cette fois, est fondé non plus sur un rapport d’identité mais sur un rapport de contradiction. La thématique idéologique mobilisée dans Intolerance est à mettre en relation avec des déterminations extérieures au film. Elle s’intègre au phénomène général concrétisé par l’idéologie réconciliatrice qui caractérise la société américaine d’après la guerre de Sécession ; mais celle-ci informe une figure spécifiquement cinématographique (qui à son tour lui donne une forme, la matérialise) : le montage parallèle. Le système filmique est par conséquent profondément mixte ; c’est le lieu de rencontre entre le cinématographique et l’extra-cinématographique, entre le langage et le texte, rencontre conflictuelle qui métamorphose le « métabolisme » initial de chacun des deux partenaires. Intolerance est un point d’aboutissement dans les recherches expressives de Griffith. Celui-ci expérimente le montage alterné depuis La Villa solitaire (1909) et L’Opératrice de Lonedale (1911) et il le magnifie dans le finale de Naissance d’une nation (1915) lors de l’assaut de la cabane et le sauvetage par le Ku Klux Klan, alors que dans Intolerance, l’échec du sauvetage dans les épisodes antérieurs (la fille de la montagne pour Babylone, le garçon pour Brown Eyes lors de la Saint-Barthélémy) prépare et appelle le succès de la tentative moderne à la dernière seconde, le héros innocent ne sera pas pendu.
L’apport de Metz aux recherches sur la signification au cinéma aura été fondamental, par le prolongement des travaux filmologiques qu’il a entrepris, l’élaboration de concepts précis, l’attention portée au cinéma en tant que tel, au-delà des œuvres singulières, le travail sur les formes cinématographiques dans leur matérialité. Il aura permis l’institutionnalisation de la recherche sur le cinéma au niveau international et son intégration dans les cursus universitaires.
Dans sa première période, Metz s’appuyait essentiellement sur la linguistique structurale et la sémiotique peircienne . Dans le même sillage, en Grande-Bretagne et en Italie, d’autres chercheurs développent un approche de la signification au cinéma sur des bases un peu différentes. C’est le cas de Peter Wollen en Grande-Bretagne, d’Emilo Garroni, Gian Franco Bettitini et du cinéaste Pier Paolo Pasolini en Italie, parmi beaucoup d’autres. Mais comme nous l’avons précédemment évoqué, la réflexion théorique sur le phénomène cinématographique en tant que tel a également engendré par contrecoup une nouvelle pratique, celle de l’analyse de film. Cette pratique a été principalement inaugurée par Raymond Bellour à la fin des années 1960.
1.7.2 Raymond Bellour et l’analyse de film
L’analyse de film est partiellement issue de la critique, mais elle s’en distingue radicalement par plusieurs aspects. La critique, à de rares exceptions près, s’intéresse à la perception d’ensemble d’un film, à sa description comme œuvre globale, d’après la vision continue en salles. Certes, ces conditions ont changé au cours des vingt dernières années et nous y revenons dans le chapitre 4 portant sur le spectateur. Raymond Bellour rompt radicalement ces conditions en inaugurant, trente ans après S. M. Eisenstein (Aumont et Marie, 2015), la « dissection minutieuse » des films, inventant l’analyse du fragment à partir de l’arrêt sur image. Cette pratique aujourd’hui devenue banale avec la numérisation des supports était considérée comme iconoclaste dans les années 1970, car elle se différenciait radicalement de la vision continue des films que privilégiait la critique. Les travaux de Bellour sont alors parallèles à ceux de Metz, celui-ci s’intéressant aux configurations cinématographiques abstraites en général et Bellour aux configurations internes aux films, en tant qu’œuvres singulières. On ajoutera toutefois que cette démarche est très marquée par celle du structuralisme de Lévi Strauss et de la linguistique de Jakobson. Le texte de Bellour disséquant un court fragment des Oiseaux de Hitchcock (Bellour, 1969), la traversée de Bodega Bay par Mélanie Daniels (Tippi Hedren), est méthodologiquement proche de l’analyse d’un poème de Baudelaire, Les Chats, par l’anthropologue et le linguiste. Mais la démarche de Bellour s’appuyant sur l’analyse des séquences et des plans successifs qui les constituent repose aussi sur deux postulats revendiqués explicitement par le chercheur, celui d’un rapport dialectique entre la partie et le tout (hypothèse structuraliste par excellence), la partie mise en abyme, plan singulier ou séquence, vaut pour le film en son entier, et parallèlement sur l’existence d’un « sous-texte » qui se dévoilerait par la micro-analyse, révélant un sens caché de l’œuvre. Prenant appui sur quelques films de Hitchcock (Les Oiseaux, La Mort aux trousses), Bellour qualifie ce rapport dialectique entre fragment et totalité de « blocage symbolique », ainsi défini : « impression de clôture qu’éprouve le spectateur à la sortie d’un film, impression qu’un résultat a été produit, ici la symbolisation de l’accès au couple, à la résolution de l’Œdipe, et qui indique que cette symbolisation pouvait se lire aussi bien dans le rapport le plus minimal entre ses plans ». Ce blocage symbolique est alors considéré comme l’un des fondements du cinéma « classique ». Par ailleurs, Bellour est également l’un des initiateurs de la notion de « figure » avec celle de « suprasegmental », qui désigne le fait que le sens puisse venir du rapprochement de motifs disséminés dans le film mais comparés par le spectateur.
Les travaux de Bellour épousent par la suite le mouvement de la sémio-psychanalyse et développent un parallèle entre la perception filmique et l’hypnose. Mais dans la dernière période, Bellour s’est attaché à analyser les connexions entre films et régimes mixtes d’images, les autres images telles la peinture, la photographie, la vidéo et les installations d’artistes. Ces connexions sont nommées « entre-images ». Il a cependant affirmé avec beaucoup de conviction la spécificité du dispositif cinématographique, et celle de la perception d’un film en continuité dans une salle obscure (voir le chapitre 4 sur le spectateur).
1.7.3 Peter Wollen et la sémiotique peircienne
« Pour sa part le critique, cinéaste et chercheur anglais Peter Wollen a contribué à élargir le champ de la sémiotique en l’éloignant du modèle du langage verbal, comme l’avait proposé Mitry. Le but clairement énoncé de son livre le plus connu, Signs and Meanings, est de sortir les études filmiques de l’univers fermé du discours, hermétique à tout concept étranger. Wollen reproche à la notion de signe telle que conçue par Saussure – un Signifiant (les sons) et un Signifié (le concept) – de donner trop d’importance au verbal, et lui oppose le modèle pluriel du sémioticien américain Peirce – un Signifiant (la face perceptible du signe), un Référent (ce qu’il représente) et un Signifié (ce qu’il signifie) –, qui a l’avantage de s’intéresser à tous les systèmes de signes, réintégrant ainsi le modèle linguistique dans une perspective plus large. » En effet, une image peut avoir un sens, autre que l’appartenance au monde qu’elle représente, comme l’ont bien compris tous les premiers théoriciens du cinéma, de Lindsay et Münsterberg jusqu’à Balázs et Epstein. « Wollen reprend alors la classification tripartite – effectuée selon le type de relations qu’entretiennent le Signifiant et le Référent – chère à Peirce, qu’il utilise pour distinguer les trois courants dominants de l’histoire du cinéma : l’“indice” – la relation causale de contiguïté physique – est relié aux cinéastes qui tendent à une prise directe de la réalité (tels Flaherty ou Rossellini) ; le “symbole” – la relation de convention, de type arbitraire – à un cinéma illustré par Eisenstein, qui traduit une réalité de manière indirecte en jouant sur les conventions (notamment par le recours à la métaphore) ; l’“icône” – la relation d’analogie – à une tendance dominée par Sternberg selon Wollen, qui s’éloigne de la réalité directe ou symbolique pour proposer une réalité réinventée et fantasmée. Ainsi, cette distinction permet de souligner de manière plus précise la complexité du cinéma, qui réside donc dans sa capacité à combiner ces trois types de signes. » Cette triple distinction va être réactivée par de nombreux chercheurs et occupe une place centrale de la démarche de Deleuze, qui s’appuie comme Wollen sur la sémiotique peircienne. « D’un côté, cela va permettre à Wollen de justifier le recours, par la suite, à d’autres domaines que le langage verbal pour étudier le cinéma (dans son livre Paris Hollywood) et d’élargir sa démarche à ses écrits sur la culture contemporaine (Raiding the Icebox, Paris Manhattan). De l’autre, Wollen va pouvoir classer les réalisateurs en deux catégories – ceux qui utilisent un seul type de signes parmi les trois (la notion de “cohésion”) et ceux qui mélangent les trois (la notion de “dispersion”) – et valoriser la démarche des seconds en défendant le cinéma expérimental. »21
On voit donc comment dès les années 1960 et 1970, l’inspiration sémiologique ou l’interrogation sur les mécanismes de signification au cinéma se développe selon des voies multiples. En Italie, la sémiotique plus directement issue de la linguistique se prolonge avec les recherches d’Umberto Eco, Gianfranco Bettitini, Emilio Garroni22. Mais l’inspiration sémiotique est reprise également de manière très provocante et personnelle par le poète et cinéaste Pier Paolo Pasolini.
1.7.4 Pier Paolo Pasolini, le cinéma de poésie
Tout à la fois écrivain, dramaturge, poète, essayiste, critique, cinéaste, Pasolini en tant que sémiologue et philosophe se définit lui-même comme « hérétique » : d’abord parce que ses idées sont difficilement acceptables par les dogmes dominants, de la tradition universitaire au marxisme, ensuite parce que le discours qu’il tient n’appartient à aucun genre reconnu. Mêlant intervention critique, parfois politique et théorie, il accepte et même souligne le caractère actuel, daté et situé de sa réflexion. D’abord idéologue marxiste, il développe dans les années 1960 une approche stylistique, centrée autour de la défense du « discours indirect libre » en littérature et bientôt, de ses équivalents en cinéma. Cet aspect de son œuvre sera commenté en détails par Gilles Deleuze.
Son œuvre théorique s’étend principalement de 1965 à 1971, partant de la définition du « cinéma de poésie » en 1965, de « la langue écrite de la réalité » en 1966, et des « observations sur le plan-séquence » en 1967, et s’achevant avec L’Expérience hérétique (1972). Dans sa période « sémiologique » de la fin des années 1960, il développe une idée fondamentale : la réalité s’exprime par elle-même et ne parle qu’à elle-même. Par conséquent, seul le cinéma, qui reproduit la réalité sans avoir besoin de l’évoquer (comme la littérature et la poésie), ni de la copier (comme la peinture), ni de la mimer (comme le théâtre), peut exprimer la réalité par la réalité. D’où la définition du cinéma comme « langue écrite de la réalité comme langage ». Il existe un « code des codes », le « code cognitif de la réalité », auquel seul a accès le cinéma, et sur lequel sont nécessairement fondés tous les autres codes, culturels par définition. Ainsi, la langue du cinéma est à peu près universelle, sans lexique, sans arrière-plan historique ni culturel ; Pasolini reconnaît toutefois que le cinéma ne peut utiliser des objets vierges de connotations, lesquelles sont culturellement variables ; le cinéma n’a donc de lexique qu’à l’intérieur d’une pragmatique, c’est un lexique sans cesse redéfini par ses usages. La langue du cinéma est donc sans grammaire vraie, mais elle possède quatre grands « codes » ou « opérations » ou « modes » (la terminologie varie quelque peu d’article en article) :
– la reproduction : le cinéma est une langue qui n’existe qu’à l’état écrit, c’est à dire filmé ; il n’a donc ni orthographe, ni grammaire, mais une stylistique, manifestée par exemple, par le souci de la composition (qu’il emprunte à la peinture) ou de la prosodie (que le cinéma muet a empruntée à la poésie) ;
– la substantivation, qui opère en deux temps : réduction tendancielle de la polysémie, puis assertion d’existence (ou d’action existentielle) de ce qui est reproduit ;
Le cinéma échappe à l’homologie avec les structures sociales qui caractérise la littérature (parce que les contenus littéraires, et la langue verbale elle-même, sont homologues à la société) ; le cinéma est, mieux qu’international, transnational (transcendant aux nationalités) et aussi, de la même façon, « transclassiste » (il échappe aux déterminations de classe). Il ne peut acquérir de caractéristiques d’ordre social ou psychologique qu’au prix d’une opération stylistique – contrairement encore à la littérature, qui est d’emblée caractérisée socialement. Pasolini défend ainsi un style particulier de cinéma, le « cinéma de poésie », fondé sur le « discours indirect libre », c’est-à-dire « l’immersion de l’auteur dans le personnage », qui permet de présenter la réalité à travers le système expressif déterminé par la caractérisation psychologique et sociale de ce personnage.
Dans « le cinéma de poésie », Pasolini élabore le concept de l’« imsegno » (image-signe) et du « cinèma » (cinème) : le premier est la première version du « langage de l’action », suivant l’affirmation qu’il y a des signes dans le réel, avant l’enregistrement par le cinéma, analysables par la sémiotique ; le deuxième désigne les « objets, formes ou actes de la réalité qui se trouvent à l’intérieur de l’image cinématographique ». Dans les derniers textes, Pasolini développe une tension entre « le cinéma » et les « films », entre la « psyché » qu’est la « langue spatio-temporelle » et le « soma » de la « langue audiovisuelle ». Il élabore ainsi comme nous l’avons vu plus haut la notion de « discours indirect libre » au cinéma, équivalent de la forme mixte littéraire où le narrateur tantôt parle en son nom, tantôt avec la parole d’un des personnages.
2. Le langage et après
Les développements qui précèdent concernent pour l’essentiel la période des origines des théories du cinéma jusqu’au début des années 1980. Depuis, le modèle sémiologique qui a marqué la période précédente s’est progressivement transformé en intégrant de nouvelles dimensions, notamment le point de vue du spectateur. Il a perdu la position hégémonique qui était la sienne dans les années 1960-1975. Il a été contesté par les approches formalistes et cognitives. La sémiologie structurale était fondée sur la notion d’immanence. Elle restait par principe enfermée dans les frontières du texte, excluant toute référence à la genèse de l’œuvre, comme à la réception de celle-ci par un spectateur. De nouvelles inspirations disciplinaires vont déplacer cette perspective en la renversant. C’est pourtant une notion linguistique qui est à l’origine de ce mouvement, celle d’« énonciation ».
2.1 Énonciation, sémio-pragmatique et rhétorique
2.1.1 L’énonciation
Dans un récit littéraire, il existe un certain nombre de signes de ce qu’on appelle depuis Émile Benveniste (1970) l’énonciation. Des mots comme « je », « ici », « maintenant » peuvent renvoyer à cette instance imaginaire qui n’est pas l’auteur réel d’un texte, mais un personnage théorique qui « énonce » le récit. Le terme est donc d’origine linguistique : l’énonciation suppose un discours avec un locuteur et un auditeur. Cependant, par l’intermédiaire de la narratologie qui oppose « l’histoire » au « discours », la théorie du cinéma a repris le terme et s’est attachée à rechercher les marques d’énonciation dans les « énoncés » filmiques. Il s’agissait d’une sorte de retour du refoulé après des années d’affirmation concernant l’effacement des marques d’énonciation dans le film de fiction et d’interdiction du regard à la caméra. Il est admis aujourd’hui que le spectateur consomme à la fois l’histoire et le discours en les goûtant tous deux. Or, si dans un texte écrit les marques d’énonciation sont assez simples à repérer, il n’en va pas de même dans un film.
Dans le domaine du cinéma, l’énonciation est ce qui permet à un film, à partir des potentialités inhérentes au cinéma, de prendre corps et de se manifester. Mais l’idée d’énonciation en linguistique repose sur le fait qu’un texte est toujours le texte de quelqu’un pour quelqu’un, à un moment et un lieu donnés, tandis que ces caractéristiques sont loin d’être évidentes pour l’énonciation filmique.
Ce sont les adresses directes des personnages au spectateur, courantes dans le cinéma burlesque, dans les films des Marx Brothers, dans ceux issus du music-hall, dans les documentaires de propagande ou les dessins animés de Tex Avery par exemple, ou les regards à la caméra qui ont permis de s’interroger sur le lien entre le film et son spectateur, relativisant l’idée du spectateur passif, floué, fasciné et « opiomisé » (J. P. Simon, 1979, 1983).
2.1.2 La sémio-pragmatique
Le premier ouvrage important de Francesco Casetti, D’un regard l’autre, le film et son spectateur (1986), traite de la question de l’expérience spectatorielle, en se focalisant, non sur le dispositif (la salle obscure, etc.), mais sur la relation entre le film et le spectateur : comment le film s’adresse-t-il à ce sujet, comment le « préfigure »-t-il et jusqu’à quel point le guide-t-il ?
On a pu proposer des modèles généraux de la façon dont un film, en se laissant voir, rappelle et détermine un spectateur, soit les divers rôles prévus pour le destinataire et prédéterminés par l’émetteur, ou locuteur (Casetti, 1986) ; ou cerner la façon dont tout film de fiction met en scène, à côté de l’histoire racontée, une sorte de « théâtre de la communication » où sont représentées les façons dont cette histoire est construite et doit être déchiffrée (Dayan, 1983, 1984). Le film, au lieu de déterminer des modèles de spectateurs idéaux, suggère ainsi des comportements à assumer ou des options à réaliser, à « performer », le film étant analysé comme moyen d’action sur le spectateur.
La prise en compte, dans tout acte de langage, des locuteurs et du contexte relève d’une discipline spécifique issue de la linguistique qui est la pragmatique. Par analogie, une pragmatique du film le relie au contexte social au sein duquel il apparaît, avec ses besoins, ses habitudes, ses attentes, ses façons de faire ; au moment et au lieu où il est produit et projeté ; à l’action de celui qui le réalise et de celui qui le consomme, avec leurs orientations, intentions et capacités respectives. Il est aussi relié à l’ensemble des textes qui l’accompagnent, que ce soit matériellement (organisation de la séance de cinéma) ou virtuellement (citations, hommages, réélaboration). Le texte filmique est donc mis en relation avec son contexte, c’est-à-dire avec le milieu où il se trouve, ou du moins où il entend opérer.
L’orientation pragmatique a été généralisée par Casetti, Dayan puis Roger Odin, dont l’axiome de départ est que le film ne possède pas un sens en soi. Ce sont plutôt l’émetteur et le récepteur, par leur projet et leur attente, qui lui donnent un sens à travers une série de procédures à leur disposition dans l’espace social où ils opèrent. Odin explore alors une série de modes de production du sens en usage dans la société, et même des modes de production de signifiés et de sentiments : un film a besoin d’être compris autant que d’être vécu. Il les caractérise pour les effets que les films cherchent à obtenir : le mode spectaculaire qui vise à distraire par la vision d’un spectacle, le mode fictionnel qui vise à faire vibrer et émouvoir au rythme des événements racontés, et requiert la participation, le mode énergétique qui vise à faire vibrer au rythme des images et des sons sans égard pour les contenus, le mode privé qui vise à faire revenir sur son propre vécu (le film de famille), le mode documentaire qui vise à informer, le mode artistique qui vise à mettre en lumière la production d’un auteur, enfin, le mode esthétique qui vise à créer un intérêt pour le travail des images et des sons (les films expérimentaux). À la question « qu’est-ce qui harmonise ou oppose les modes activés par celui qui fait et par celui qui voit le film ? », Odin répond que c’est l’institution dans laquelle les deux se situent, c’est-à-dire le contexte social auxquels ils se réfèrent.
Les théories de l’énonciation ont permis de prendre en considération la manière dont le texte filmique se dessine, s’enracine et se retourne sur lui-même. La notion sert à mettre l’accent sur trois moments de la production du texte filmique : le moment de sa constitution, celui de sa destination, et son caractère auto-référentiel.
S’intéresser à l’énonciation filmique, c’est s’intéresser au moment où on a cadré une image et au moment où le spectateur perçoit ce cadre, mais c’est aussi s’intéresser au rythme du récit, à la couleur, à la netteté de l’image ou son contraire, comme à l’ensemble de ses relations à la bande sonore. L’énonciation filmique est « impersonnelle » (Metz, 1991) ; elle se manifeste d’abord par toute une série de procédés autoréflexifs : adresses directes au spectateur, regard vers la caméra, commentaire prononcé par un personnage dans le champ ou par un observateur invisible, exhibition du dispositif par la présence de la caméra ou des micros dans le champ, citations d’autres films, etc., et, bien entendu, les inscriptions avec des informations supplémentaires, les titres de début et de fin. « Dans tous ces procédés, le film se replie sur lui-même, met en lumière les instances qui l’organisent et fait de sa présentation un élément de comparaison » (Metz). Ces procédés autoréflexifs présents chez Godard dès son premier film (« Si vous n’aimez pas la mer… », interpelle Poiccard au début d’À bout de souffle) se développent et prolifèrent tout au long de sa carrière jusqu’à ses dernières œuvres, comme cela avait été le cas dans l’histoire du cinéma américain, tant dans les comédies, les films musicaux que les drames.
Ces procédés autoréflexifs semblaient essentiels au moment de ces premières approches de l’énonciation au cinéma. L’énonciation est aujourd’hui conçue plus largement, sans batterie spécifique de « signes spécialisés », mais comme ce que perçoit le spectateur (par exemple en appréciant un mouvement de caméra, un montage, ou l’usage d’une musique) en cours de projection comme relevant du travail d’énonciation.
Parce que la présence de marques d’énonciation dans l’énoncé menace le régime d’adhésion à la fiction, certains théoriciens ont alors opposé le « film narratif classique » qui privilégie l’effet de leurre et la « transparence » en s’efforçant d’effacer les traces de l’énonciation, à toutes les catégories de films modernes, dysnarratifs ou expérimentaux qui, au contraire, exhibent leur dispositif énonciatif (sur la narration, voir chap. 2.3 § 3.5).
2.1.3 La rhétorique
Ce prolongement de la réflexion sémio-linguistique a par la suite intégré un autre type de lecture du film issu de la rhétorique : pour savoir ce que le film signifie, il faut d’abord se demander comment celui-ci s’adresse à nous, « comment le film nous parle », selon la formule proposée par Soulez dans son livre portant sur les rapports entre « rhétorique, cinéma et télévision » (2011).
La rhétorique, à proprement parler, désigne depuis l’Antiquité l’ensemble des procédés de l’art de bien parler et de convaincre son auditoire. Le cinéma est l’un des lieux où s’exerce celle-ci, quand il est conçu comme mise en forme active et surgissement de la signification. Pratiquement, l’étude de la rhétorique filmique a suivi trois directions :
– celle des figures cinématographiques, étude souvent menée par les « grammaires » traditionnelles du « langage cinématographique », mais dont on trouve encore la trace chez des théoriciens et critiques des années 1950 et 1960 ;
– celle des discours et « genres » filmiques, et de la diversité des procédés qu’ils mettent en œuvre. Par exemple, le documentaire a sa rhétorique propre, souvent assimilée à celle d’un discours verbal rationnel, ou bien orienté vers une « vérité du réel » chez Grierson ; le « film de famille » a une rhétorique fondée sur l’émiettement narratif, l’absence de clôture, l’indifférenciation spatiale, l’adresse à la caméra, comme l’a démontré Roger Odin ;
– celle du rhétorique en général, c’est-à-dire du « figural » dans le film. C’est la direction suivie par le courant sémiotique chez Eco, philosophique chez Lyotard et psychanalytique chez Metz et Kuntzel, mais aussi le courant « déconstructionniste » influencé par les théories de Derrida sur l’écriture, voire le courant herméneutique issu de Ricœur. Cette rhétorique s’appuie également sur l’opposition entre le « discours » et la « figure » que propose Lyotard dans un livre qui porte ce titre et qui va être à l’origine de tout un courant d’analyse de film après les années 1980 ; nous y revenons plus loin.
Plaidant plus récemment pour une approche plus strictement rhétorique de la relation au spectateur, Guillaume Soulez se propose d’étudier « le processus par lequel, dans le mouvement même de constitution du film comme texte et comme discours, c’est le spectateur lui-même qui considère que quelque chose dans le film le conduit à penser que le film “lui parle” ». Il faut noter que la conception qu’a Soulez de la rhétorique est très soucieuse de ne pas limiter celle-ci à l’image étroite des « figures de rhétorique » (il ne s’agit nullement pour lui de déceler dans des films de telles figures). Il entend la rhétorique comme « méthode d’analyse générale au même titre que la poétique (ou sa branche narratologique) », comprenant trois branches, qui correspondent à la tripartition canonique entre ethos, pathos et logos : la première centrée sur le responsable du discours, la deuxième sur la réception par le public, la troisième sur les formes argumentatives.
Comme Odin, Soulez considère que la production de sens du film est déterminée par le contexte de lecture ; l’analyse rhétorique ne vise donc pas un sens implicite, plus ou moins caché, immanent (comme le faisait toujours l’approche sémiotique des années 1960-1970), mais elle veut situer les films dans un espace social donné, comme le fait Esquenazi à propos de Godard, de Hitchcock et du film noir ; c’est donc « une théorie du public logée à l’intérieur d’une théorie du discours », reposant sur la conviction que les films ont une capacité de discussion avec leur destinataire. C’est sur cette base que l’on peut en venir à l’analyse des formes filmiques, qui sont lues comme transposant dans les agencements d’images et de sons les dynamiques rhétoriques (telles qu’on les définit à partir du langage verbal).
Dans sa proposition, Soulez annonce d’emblée que celle-ci vise à permettre une lecture rhétorique des films, qu’il voit comme différente des lectures socioculturelles ou des lectures « poétiques » (notamment sur la question du figural), mais se situant sur le même plan général – la différence étant pour lui entre une lecture immanentiste (celle des analyses formelles) et une lecture pragmatique (la sienne et celle d’Odin) : « Le sens n’est pas dans le film, c’est le spectateur qui fabrique le sens à partir de ce qu’il voit et entend. » Soulez remarque d’ailleurs que la lecture rhétorique ne convient pas également à tous les films, certains s’y prêtant mieux que d’autres ; il convoque un certain nombre de fragments de films, qui illustrent son propos : un épisode de Jules et Jim (Truffaut, 1962) permet de mettre en évidence plusieurs instances rhétoriques (voix off, personnage délégué) et trois figures différentes du public ; ailleurs, le point de vue rhétorique sur La Jetée (Marker, 1962), appuyé sur une discussion méticuleuse de ses formes syntagmatiques, permet d’y voir un film qui, allant de la représentation au dispositif (et non, comme d’habitude, l’inverse), a une portée remarquable vis-à-vis de son spectateur. Ces exemples ne sauraient avoir vraiment valeur de démonstration, mais ils sont intégrés à la réflexion de façon étroite, qui en fait quelque chose comme des arguments.
Il analyse par exemple la célèbre première phrase d’Hiroshima mon amour (Resnais, 1959), « Tu n’as rien vu à Hiroshima », comme s’adressant non seulement à l’héroïne (qui répond ensuite) mais aussi au spectateur (qui ne peut répondre) ; il analyse en détail, dans l’élocution, dans la voix (ressentie comme non française, marquée d’un accent), dans l’étrangeté initiale du « tu », dans la position off de cette voix, tout ce qui constitue un effet de « tribune », au moins sous-jacente, proposant une lecture rhétorique du film autour de la question de la représentation. Mais c’est un passage de la scène de ménage d’Une femme est une femme de Godard (1961 – illus. 3.6) qui parcourt tout son livre et illustre ses développements argumentatifs.

3.6 Une femme est une femme (Jean-Luc Godard, 1961).
« À qui parle Angela, ou pour qui parle Angela ? La réceptivité du spectateur que présuppose le dispositif de Godard s’oppose ici à la surdité d’Émile.

En évitant le champ/contrechamp et en soulignant le sentiment de défaite d’Angela, celui qui nous fait voir et entendre cette dispute suggère sa position propre et, surtout, attend de nous une prise de position. »
2.2 Les apports du néo-formalisme et du cognitivisme à l’intelligibilité du film
Le courant sémiologique a été principalement discuté et contesté par des chercheurs nord-américains s’appuyant d’abord sur le néo-formalisme, tel David Bordwell, puis sur la philosophie analytique et le cognitivisme, tel Noël Carroll.
2.2.1 Le néo-formalisme et David Bordwell
Le mouvement « formaliste » russe du début du xxe siècle, que nous avons présenté plus haut (chap. 3.1 § 1.4), a été redécouvert dans les années 1960. Ces textes furent rapidement utilisés par les sémiologues et narratologues, mais assez peu dans le domaine du cinéma. La seule exception notable dans l’immédiat après-coup de la publication du premier recueil en français (Todorov, 1965) est celle de Noël Burch (Praxis du cinéma, 1969), qui proposa un cadre d’analyse et de description des films s’attachant aux phénomènes formels davantage qu’aux contenus.
Dans les années 1980, cette reprise fut prolongée et systématisée par l’école néo-formaliste américaine, celle de David Bordwell, Kristin Thompson et leurs élèves, qui tentèrent d’actualiser l’idée centrale d’une « poétique du film » fondée moins sur la description des éléments formels que sur leurs fonctions. L’analyse de film, pour le néo-formalisme, ne peut se faire selon une méthode générale et universelle, mais plutôt cas par cas, en inventant une méthode adaptée à chaque objet analysé. Dans cette invention, les concepts formalistes initiaux de « système à dominante », de « mise au premier plan », de « sujet » et de « fable », deviennent des instruments destinés à guider l’imagination du chercheur. Analyser un film, ce sera chercher sa dominante stylistique (par exemple, le « recouvrement » dans Les Vacances de monsieur Hulot de Tati [1953], selon K. Thompson, 1977), c’est-à-dire au fond en donner une interprétation, mais en termes formels.
Ce qui, pour les néo-formalistes, préserve ces analyses de l’arbitraire, c’est l’ensemble des concepts formalistes liés à l’histoire des styles. Un film donné « met au premier plan » certains traits stylistiques, par rapport à un « arrière-plan » qui est celui de la norme stylistique. Cette norme, à son tour, ne peut être définie que par l’étude méticuleuse d’un grand nombre d’œuvres, permettant par exemple de définir un « style classique hollywoodien » (Bordwell et al., 1985), ou un « style international européen du muet » (Thompson, 1988). Enfin, le recours à la distinction entre fable (l’histoire) et sujet (l’histoire telle que transformée par le récit) permet de développer une théorie de la narration au cinéma qui se centre sur l’activité du spectateur comme activité cognitive (Bordwell, 1985 – voir chap. 3.2 § 2.2.2). Cependant l’opposition norme/écart est fort délicate à définir car il n’y a pas vraiment de consensus sur la notion de style en théorie du cinéma.
David Bordwell peut être considéré comme le fondateur et le promoteur de cette école « néo-formaliste » de critique et d’analyse de film. Il s’est d’abord intéressé au style de certains cinéastes, ainsi Dreyer (1981), puis Eisenstein et Ozu, puis à des questions théoriques générales, notamment celle de la narration (1985), qu’il propose d’étudier à partir de catégories stylistiques historiquement définies, celle du style (1997), puis celle de la mise en scène (2005). Ses positions, sur ces questions, sont proches de celles de ses modèles formalistes des années 1920 à propos de la littérature – positions qu’il a prolongées avec système, rigueur et encyclopédisme, et sur la base d’analyses de films toujours extrêmement précises et concrètes.
Avec Noël Carroll, Bordwell s’est aussi engagé dans une activité de critique théorique, publiant ou dirigeant plusieurs ouvrages dans lesquels étaient littéralement fustigés certains travaux de théorie du cinéma, essentiellement européens, et surtout français. Certaines de ces critiques notamment sur le flou de certains concepts ou leur inadéquation à l’analyse de film sont parfois recevables ; on peut regretter cependant la tendance excessivement polémique de certains textes et surtout, le fait que les propositions positives ne soient pas toujours à la hauteur des analyses critiques.
2.2.2 Le cognitivisme
Le cognitivisme est au départ un courant de la psychologie pour lequel la pensée peut être décrite comme un processus de traitement de l’information. Il s’est constitué dans les années 1950, de manière transversale à plusieurs disciplines : psychologie, neurologie, anthropologie, et même philosophie dans sa variante « analytique ». On a alors parlé de « sciences cognitives » pour désigner ces approches qui ont en commun surtout leurs refus : elles s’opposent tant à la tradition béhavioriste qu’aux théories historicistes, et généralement à toute approche globale et a priori des phénomènes de pensée et de perception.
Ce courant est inégalement représenté, sur le plan historique et géographique, dans les études cinématographiques, où il est apparu dans les années 1990, comme une solution de rechange après l’impasse supposée de la sémiologie structuraliste et post-structuraliste. Les théories cognitivistes se demandent notamment comment nous reconnaissons les objets représentés sur l’écran ; quelles relations les images écraniques entretiennent avec nos images mentales ; comment le jugement émotionnel interfère avec le jugement proprement cognitif, etc. – bref, elles ont vocation à traiter de tous les problèmes relatifs à la situation de spectateur de film : perception, attention, compréhension, émotion, affect, mémorisation, comme l’avait indiqué dès 1916 Hugo Münsterberg (voir chap. 3.1 § 1.1.2). Dans l’état actuel des recherches, les modèles proposés sont toutefois très largement hypothétiques, et ne reposent encore que sur bien peu d’expériences de type vraiment scientifique (répétables et vérifiables) ; en revanche, le cognitivisme n’a pas été avare de termes nouveaux, retombant souvent dans l’abstraction qu’il reproche au structuralisme.
Noël Carroll s’est auto-proclamé représentant du courant cognitiviste américain et s’est d’abord signalé par son hostilité sans nuances à la théorie telle qu’on la concevait alors en Europe, plus particulièrement en France et en Grande-Bretagne. Carroll publia alors coup sur coup deux ouvrages dénonçant de supposées faiblesses conceptuelles des théories le plus en vue, au nom d’une conception de la philosophie d’obédience assez strictement « analytique ». Cette veine polémique est en grande partie expliquée par l’attachement de Carroll à une version « positive » de la philosophie (dont la philosophie des sciences est pour lui le modèle) : de toute réflexion théorique, il exige qu’elle interroge constamment ses présupposés, et qu’elle questionne la validité de ses résultats – ce qui n’est pas toujours évident dans le domaine esthétique.
Face à la vigueur de ces attaques contre les théories inspirées par la psychanalyse, le marxisme, le structuralisme, le féminisme, les propositions positives de Carroll peuvent sembler décevantes, l’excès de prudence épistémologique auquel il s’oblige l’amenant à donner par exemple une définition peu contestable, mais abstraite et très générale, de l’image mouvante. Aussi son principal apport reste-t-il, paradoxalement, la méfiance qui est la sienne envers toute « grande théorie », susceptible de tout expliquer, mais qui ne peut ni prédire, ni même valablement décrire quoi que ce soit.
Le principal chercheur français qui ait commenté et partiellement eu recours à certains aspects du cognitivisme est Laurent Jullier avec ses ouvrages Cinéma et cognition (2002) et Analyser un film, de l’émotion à l’interprétation (2012). Le premier de ces livres s’affichait comme strictement cognitiviste avec une certaine raideur, le second s’y référait avec plus de souplesse et d’invention. Ses axes de recherche privilégient en effet l’investissement cognitif et affectif des spectateurs dans les films qu’ils apprécient. Différents outils, en provenance de l’esthétique du cinéma, de la psychologie cognitive, de la philosophie morale, de la sociologie mais aussi de la pragmatique sont mis à contribution pour décrire cet investissement. Plus particulièrement, ces travaux ont jusqu’ici concerné : les moyens stylistiques et techniques employés pour faire effet (la bande son et les images de synthèse des blockbusters, les mouvements de caméra « immersifs ») ; la construction et la réception des films (ou des séries télévisées) comme des « leçons de vie » ; la circulation des stéréotypes de genre ; la cinéphilie et les raisons d’aimer certains films plus que d’autres. On notera cependant que cette approche est nettement moins polémique et normative que celles des chercheurs américains dont il s’inspire parfois, bien que l’auteur s’en prenne souvent à une certaine forme de cinéphilie dominante marquée par les choix et les goûts des Cahiers du cinéma (voir Cinéphiles et cinéphilies, 2010, avec Jean-Marc Leveratto).
2.3 Les pensées figurales de l’image
La polysémie du mot « figure » l’a rendu utilisable dans de nombreux contextes, au détriment d’une définition unitaire. La figure, c’est d’abord l’effigie, matériellement produite (le verbe latin fingo, d’où vient le mot, connote l’idée de modelage) ; de là dérive une série de sens qui insistent sur le fait que la figure est un élément visuel autonomisable dans une représentation, même si la notion est déjà présente en narratologie chez Genette, par exemple (les « figures » de la Bible). Ainsi, dans l’opposition entre « figure » et « fond », en Gestalttheorie, la figure se caractérise par les traits suivants : elle a un caractère d’objet (le fond, un caractère de substance) ; elle paraît être devant le fond ; le fond semble se continuer derrière la figure ; le contour appartient à la figure, non au fond.
Ces traits sont généralement avérés dans les représentations figuratives (celles qui produisent et utilisent des figures), même si, spécialement dans les représentations photographiques, il est difficile de distinguer figure et fond ; cette distinction est facilitée, en cinéma, par le mouvement, qui, dans les cas normaux, lève toute ambiguïté perceptive (Michotte, 1948).
De ce sens classique, la portée du mot a été étendue, par certains historiens d’art, jusqu’à désigner potentiellement tout élément de la représentation, pourvu qu’il ait une existence visuelle avérée et individuelle, et même s’il ne comporte pas le trait analogique , et s’il ne se ressort pas sur un fond (Didi-Huberman, 1990).
Certains théoriciens ont en effet considéré la figure en général comme un principe signifiant original, ne passant pas par la langue, mettant en jeu des formes d’expression plus « primaires » – au sens de Freud –, moins « secondarisées », donc plus neuves et potentiellement, plus poétiques. Dans son Discours Figure (1971), qui introduit la notion pour la première fois de façon suivie et développée, Lyotard souligne trois traits caractéristiques (et même potentiellement définitoires, selon lui) du figural : son opacité, car le figural est ce qui, dans l’image, n’est pas « transparent » à un représenté (il ne représente rien) ; son rapport à la vérité (entendue en un sens largement inspiré de Freud, c’est-à-dire comme ce qui ne s’atteint qu’à travers l’interprétation de symptômes) ; il fait événement, s’offrant comme un élément de l’image qui ne peut se réduire à aucun système de sens. Il s’agit ainsi, pour Lyotard, d’un registre d’expression immédiate dans l’image, qui n’appartient pas à l’horizon de la connaissance, mais entre dans un circuit où se joue le « travail » du désir.
En cinéma, cette idée a été développée dans les années 1980 et 1990, et la notion de figure a pu désigner de nombreux éléments, comportant en outre le trait de mouvement et de « poussée du sens » (par exemple – non limitatif – des figures de corps humain en mouvement – voir Vernet, 1988, puis plus tard, Brenez, 1998).
Un second sens, tout aussi classique, fait de la figure un mode de signification qui permet d’ajouter au sens « littéral » d’un texte ; la lecture « figurative » de l’Ancien Testament est un autre nom de l’exégèse biblique, activité qui consiste à lire « en figure » le texte sacré, comme une grande métaphore du Nouveau Testament. En ce sens, la figure se rattache au trope – métaphore, métonymie, synecdoque, etc. – comme l’avaient bien compris Genette et Eco : la figure de rhétorique est une forme signifiante par arrangements d’éléments dans un texte.
Deux registres de sens sont ouverts par cette définition :
– d’une part, la définition de tropes, ou « figures » cinématographiques, équivalant aux tropes littéraires (le lorgnon du médecin de bord du Cuirassé « Potemkine », accroché dans les haubans et signifiant le personnage qu’on a jeté par-dessus bord, par synecdoque). Le film peut produire l’équivalent de beaucoup de tropes, par exemple l’emphase, la litote, l’analepse (retour en arrière), la prolepse (anticipation), l’ellipse, etc. ; pour Deleuze (1983), « les images cinématographiques ont des figures qui leur sont propres, et qui correspondent avec leurs propres moyens aux quatre types de Fontanier [tropes, tropes impropres, figures de substitution, figures de pensée] ».
– d’autre part, un principe d’interprétation des œuvres, considérées comme ressortissant au figural : le film signifie à plusieurs niveaux et de plusieurs façons, entre autres « par figure ». Le plus souvent, cette idée est rabattue sur une interprétation métaphorique assez mécanique (recherche de « symboles sexuels », notamment), qui réduit la recherche du sens à une traduction selon un lexique préformé. Dans son principe, elle revient à valoriser la figure comme principe signifiant sui generis, capable d’actualiser le surgissement permanent de l’expression et du sens (ce qu’on a parfois appelé principe figural – Lyotard, mais aussi Barthes dans S/Z et Kristeva dans sa théorie de la « sémanalyse »).
Ces propositions ont été reprises par plusieurs autres théoriciens ou critiques, notamment Deleuze (1981), pour qui la picturalité fondée sur la Figure (sur le figural) quitte le domaine du représentatif et du narratif pour « capter les forces » et leur donner une forme sensible, et Didi-Huberman (1990), qui décèle un travail de ce genre dans l’œuvre de Fra Angelico, et le rattache à un sous-texte théologique.
Des idées comparables ont été examinées par Metz (1975), dans une perspective également freudienne, mais moins radicalement opposée à l’idée d’une présence du verbal dans l’image. C’est aussi dans cet esprit que se sont situées certaines tentatives analytiques inspirées de Lyotard (Eizykman, 1976) ou de Ricœur, pour qui la métaphore « vive » est la figure par excellence (Andrew, 1984 a&b). Plus récemment, les travaux de Deleuze et de Didi-Huberman ont influencé, directement ou indirectement, de très nombreux travaux d’analyse de film, qui en ont repris les idées directrices, parfois même la terminologie et ont tenté de l’appliquer, ainsi Dudley Andrew, Claudine Eizykman, Jacques Aumont, Nicole Brenez, Philippe Dubois, Luc Vancheri et quelques autres. Ce dernier propose une présentation synthétique de ce courant dans son livre Les Pensées figurales de l’image (2011), tout en l’appliquant lui-même à certains films célèbres tels Psychose ou La Grande Illusion.
2.4 Le film signifie et pense : cinéma et philosophie
2.4.1 Une tradition ancienne mais latérale
Le cinéma a été très tôt objet de réflexion critique de la part de psychologues (Münsternberg) ou de sociologues (Kracauer), comme nous l’avons vu au début de ce chapitre, mais les philosophes n’ont manifesté qu’un intérêt discontinu ou partiel dans leurs travaux pour l’art des images en mouvement jusqu’à ces deux dernières décennies. Il y a bien sûr quelques exceptions, et en particulier Henri Bergson qui a souvent fait honneur au cinématographe comme l’a rappelé Dominique Chateau (2003). Ainsi « de ses leçons au Collège de France sur l’histoire de l’idée de temps » (1902-1903) où, dit-il, « nous y comparions le mécanisme de la pensée conceptuelle à celui du cinématographe », à La Pensée et le mouvant (1934) en passant par L’Évolution créatrice (1907), non seulement Bergson ne se contenta pas de faire allusion épisodiquement au septième art, « mais il l’érigea en modèle cognitif d’une forme de pensée et de relation au mouvement et au temps de laquelle, par ailleurs, toute sa philosophie entendait se démarquer » (Chateau, 2003). Ce que Bergson appelle le plus souvent la méthode cinématographique, mais aussi la tendance cinématographique de la perception et de la pensée, est convoqué, en de multiples occurrences, pour décrire la façon dont la pensée fonctionne dans la pratique, s’agissant de « régler l’allure générale de la connaissance sur celle de l’action », puis de caractériser la science à laquelle elle est également « bien ajustée ». Dans un long passage, Bergson prend l’exemple de la reproduction sur un écran d’une scène animée, celle d’un défilé de régiment pour en conclure :
« Au lieu de nous attacher au devenir intérieur des choses, nous nous plaçons en dehors d’elles pour recomposer leur devenir artificiellement […] Qu’il s’agisse de penser le devenir, ou de l’exprimer, ou même de le percevoir, nous ne faisons guère autre chose qu’actionner une espèce de cinématographe intérieur. On résumerait donc tout ce qui précède en disant que le mécanisme de notre connaissance usuelle est de nature cinématographique. »
On trouve par la suite quelques considérations perspicaces consacrées au cinéma chez Merleau-Ponty (1948), qui met en évidence l’existence d’une composante intellectuelle dans l’image filmique, parfaitement superposée à son caractère iconique et l’assimilant à une sorte de signe. Merleau-Ponty développe ses hypothèses dans une conférence prononcée à l’IDHEC en 1945 « Le cinéma et le nouvelle psychologie ». Celle-ci est non seulement applicable à la perception du film, mais encore elle est cohérente avec la définition même du film. D’où ce postulat : « Disons d’abord qu’un film n’est pas une somme d’images, mais une forme temporelle. »
Quant au philosophe italien Della Volpe, il s’est efforcé de montrer que le film est susceptible d’activer la pensée du spectateur, non point en défendant l’hypothèse d’une spécificité de la pensée visuelle, mais en s’efforçant de mettre la spécificité filmique en relation avec le pouvoir cognitif humain, « avec sa faculté rationnelle œuvrant de la sorte dans l’interface entre l’expérimentation mentale des idées qui est son domaine propre et leur incarnation dans des formes empiriques » (Chateau, 2003).
Mais il fallut attendre les années 1970 et 1980 pour voir des philosophes professionnels tels Cavell, puis Deleuze consacrer des ouvrages de fond à la pensée cinématographique.
La philosophie du cinéma a donc été le plus souvent l’œuvre de francs-tireurs, des cinéastes tels Epstein, Eisenstein ou Pasolini, des critiques tels Bazin, Daney, Barbaro, ou des marginaux comme Gilbert Cohen-Séat, qui est à l’origine de la création de l’Institut de filmologie de la Sorbonne. Au sein de cet Institut, la philosophie fut représentée par un esthéticien, Étienne Souriau, inventeur du vocabulaire de la filmologie. Nous avons précédemment souligné l’importance des travaux de l’école filmologique et leur rôle dans le développement des recherches sémiologiques, puis cognitives (voir chap. 3.1 § 1.6.3).
2.4.2 Stanley Cavell et Gilles Deleuze
À partir des années 1970-1980, les philosophes manifestent un intérêt nouveau et spectaculaire pour le cinéma, comme en témoignent les deux livres de Gilles Deleuze, Cinéma 1, L’Image-mouvement (1983) et Cinéma 2, L’Image-temps (1985). Il avait été précédé aux États-Unis par Stanley Cavell dont les livres ont été traduits tardivement en français (Must We Mean What We Say?, 1969 ; La Projection du monde. Réflexions sur l’ontologie du cinéma, 1971).
Stanley Cavell est un philosophe américain dont on a souligné souvent la filiation avec la pensée d’Emerson ou de Thoreau. Son œuvre se partage entre réflexion philosophique (métaphysique, éthique), critique littéraire (sur Shakespeare, par exemple), et une série d’interventions sur la culture, notamment populaire.
Au cinéma, Cavell a consacré surtout deux ouvrages. Il se pose explicitement la question des rapports entre cinéma et réflexion philosophique. Le premier de ses livres, The World Viewed (1971), reprend frontalement l’interrogation métaphysique et ontologique. Le cinéma démontre un trait important de l’art moderne : les possibilités esthétiques d’un art ne sont pas données a priori, et chaque art n’en finit pas de susciter de nouveaux médias qui le transforment. Le cinéma a d’abord été un médium, celui du Hollywood classique, que Cavell décrit comme fondé sur les mythes baudelairiens de la modernité. Ceux-ci n’étant plus actifs, le cinéma récent constitue un autre média, nouveau, incomparable avec le précédent. D’autre part, les arts sont infiniment spécifiques ; il est donc faux de lire le cinéma, même en ses origines, comme un avatar d’un ou plusieurs des arts traditionnels. La nouveauté radicale du film consiste dans le fait qu’il produit automatiquement les conditions de la vision du monde (ou d’un monde), et notamment la condition essentielle du « voir sans être vu ». Le rapport du film au monde est complexe, puisqu’à la fois, le film dépend du monde, qu’il ne peut que montrer, mais dispose de moyens, comme la couleur, de créer un monde particulier. Le cinéma, avant d’être un médium, c’est-à-dire un instrument pour arriver à percevoir le monde, est « un monde vu », c’est-à-dire la réalité comme elle tombe sous le sens : la « réalité » même, que l’image à l’écran nous restitue dans toute sa plénitude, et que nous percevons à l’écran comme à travers une fenêtre grande ouverte. En somme, d’objet de l’expérience ordinaire, le cinéma devient modalité ordinaire d’expérience des objets. Avec le cinéma, le réel redevient familier et nous semble plus proche : en soi, dans ses contours concrets, dans ses manifestations effectives. Parce que le cinéma est, d’une certaine manière, « la réalité », moment d’expérience quand nous allons le voir, ou pour ce qu’il nous fait voir.
Du point de vue du cinéma, la convergence avec la philosophie est surtout justifiée par la nature autoréflexive du film. Pour Cavell, n’importe quel film contient un motif de spéculation et n’importe quel film répond avec sa propre façon de se présenter et de procéder aux questions dont il est l’origine. Ainsi, un film pense et se propose lui-même comme témoignage.
Le second ouvrage de Cavell, Pursuits of Happiness (À la recherche du bonheur), est moins théorique, mais possiblement plus profond et original. Cavell y examine un sous-genre de la screwball comedy, qu’il baptise « comédie du remariage ». À travers ces histoires de couples qui commencent par se défaire, de l’intérieur, avant de se reformer in fine, il étudie la société américaine, sa conception de l’individu, du couple, du bonheur (le titre anglais fait allusion à l’une des premières phrases de la constitution des États-Unis). Le cinéma n’est pas étudié comme art, mais comme discours produit par une société, et qui l’exprime. L’auteur s’appuie cependant sur un nombre très limité de films (7), mais son livre a le mérite d’attirer l’attention sur la dimension idéologique du cinéma américain dans la défense du couple hétérosexuel et de la fidélité dans le mariage.
Dans son livre co-écrit avec Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie ? (1991), Gilles Deleuze se présente même comme le gardien du domaine : la philosophie a des rivaux, des sciences jusqu’au marketing, rivaux qui prétendent s’approprier ce qui lui revient de droit, à savoir le concept, car « le concept appartient à la philosophie et n’appartient qu’à elle ». Ces revendications portent atteintes à la philosophie, non seulement parce qu’elles rivalisent avec elle, mais encore parce qu’elles la pénètrent :
« Plus la philosophie se heurte à ses rivaux impudents et niais, plus elle les rencontre en son propre sein, plus elle se sent d’entrain pour remplir sa tâche, créer des concepts, qui sont des aérolithes plutôt que des marchandises. Ainsi donc la question de la philosophie est le point singulier où le concept et la création se rapportent l’un à l’autre. »
Mais selon Chateau (2003), Deleuze et Guattari proposent une définition singulière du concept, qui tourne le dos à sa définition plus commune comme forme spécifique de représentation cognitive ; pour eux le concept est une création plutôt qu’une forme ; il n’est même pas une formation puisque, en même temps qu’il est créé, il se crée lui-même, à l’image du vivant ou de l’œuvre d’art : on le reconnaît à son « caractère autopoïétique ». La philosophie n’a d’autre prétention que d’être la seule manière de penser par concepts et d’être la seule attitude de l’esprit capable de rendre compte par le concept des autres formes de pensée. Ainsi, pour Deleuze, la philosophie du cinéma est une théorie fabriquée à partir de concepts sur un objet qui n’en fabrique pas lui-même et qui, pourtant, pense. La philosophie et le cinéma se rencontrent par ce que l’une et l’autre pensent : « Penser, c’est penser par concepts, ou bien par fonctions, ou bien par sensations, et l’une de ces pensées n’est pas meilleure qu’une autre, ou plus pleinement, plus complètement, plus synthétiquement “pensée”. » La philosophie pense avec des concepts ; le cinéma pense avec des affects et des percepts ; l’art en général pense avec des affects et des percepts. Pour Deleuze, l’essence du cinéma, qui n’est pas la généralité des films, a pour objectif plus élevé la pensée, rien d’autre que la pensée et son fonctionnement :
« Les grands auteurs de cinéma nous ont semblé confrontables non seulement à des peintres, des architectes, des musiciens, mais aussi à des penseurs. Ils pensent avec des images-mouvements, et des images-temps, au lieu de concepts. » (Deleuze, 1983)
La philosophie du cinéma n’est pas une théorie du cinéma, mais une théorie avec le cinéma, et « une théorie du cinéma n’est pas “sur” le cinéma, mais sur ce que le cinéma suscite » affirme-t-il (1985). Et il ajoute : « Les concepts ne sont pas donnés dans le cinéma. Et pourtant ce sont les concepts du cinéma, non pas des théories du cinéma ». La philosophie ne surimpose pas ses concepts au cinéma, comme une quelconque théorie, elle rend compte avec des concepts de la spécificité de la pensée cinématographique qui est non conceptuelle : « Aucune détermination technique ni appliquée (psychanalyse, linguistique), ni réflexive, ne suffit à constituer les concepts du cinéma lui-même. » La philosophie est seule habilitée à créer les concepts du cinéma qui sont en même temps les concepts du cinéma même.
Le cinéma est pour Deleuze « une nouvelle pratique des images et des signes, dont la philosophie doit faire la théorie comme pratique conceptuelle » (1985). C’est à cette pratique conceptuelle qu’il se consacre proposant une classification des formes filmiques, une taxonomie vaste et minutieuse des façons dont le cinéma se présente. Le cinéma est un lieu de pensée, mais si le cinéma « pense », ce n’est pas parce qu’il « dit », car Deleuze réfute fermement l’assimilation du film au discours. Le cinéma pense parce qu’il a recours à l’être, ou parce qu’il présente et se présente lui-même comme une forme d’existence. Sous cet aspect, la forme de pensée qu’un film incarne est la même chose que la forme de réalité qu’il montre dans ses images et dans ses sons et à laquelle il s’identifie. « Pour le cinéma, selon Deleuze, penser, présenter et être, c’est la même chose » (Chateau, 2003).

3.7 Damnation (Béla Tarr, 1988).
Un noir et blanc très contrasté dans tous les plans intérieurs s’opposent au gris des extérieurs, mais le paramètre le plus important ici est la longueur et la lenteur des plans eux-mêmes : « Béla Tarr transforme la boue humaine en or filmique par ses travellings aériens et ses obsédants plans séquences. » (Vincent Ostria)
2.4.3 Après Deleuze
Ces deux livres de Deleuze ont connu dès les années 1980 un très grand retentissement tant en France qu’à l’étranger, où ils ont été beaucoup commentés. Plus récemment, Dork Zabunyan publie en 2011 un nouveau livre de synthèse didactique, Les Cinémas de Gilles Deleuze. L’ouvrage s’appuie sur la définition deleuzienne de la philosophie comme activité de création de concepts, qui, au contact du cinéma et des affects et autres percepts qui en forment le tissu, se dote d’une « réelle puissance de métamorphoses ». Le livre procédant par entrées multiples, un peu à la manière d’un rhizome deleuzien, Zabunyan interroge ce que sont des « grands » et des « mauvais » films selon le philosophe. « Un film n’a d’intérêt, en tant qu’œuvre de pensée, que s’il pose un problème et que si les images qui le composent sont chargées d’une idée. »
Mais Deleuze n’est évidemment pas le seul philosophe qui ait travaillé sur le cinéma dans la période récente. Son intervention a été suivie par bien d’autres philosophes qui ont discuté ses thèses ou bien apporté leurs contributions personnelles aux rapports entre leur discipline et le cinéma, depuis Jean-Louis Schéfer jusqu’à Jacques Rancière et Dominique Chateau.