Les animaux s’entraident
La sélection familiale
Des mères hors pair
En m’approchant de ce vanneau huppé, quelque part dans le nord de la France, je n’ai pas tout de suite compris pourquoi il poussait des cris. Non seulement l’oiseau criait, mais il montrait un drôle de comportement. Il marchait bizarrement, une aile pendant vers le sol. En apercevant ses petits – qui ne se mettaient toujours pas à l’abri malgré les appels de l’adulte –, je compris qu’il feignait d’être blessé pour attirer mon attention. C’était la première fois que j’assistais à une telle scène, et je dois avouer que ce petit oiseau vulnérable et courageux jouant la comédie m’a ému. Cette stratégie de détournement de l’attention du prédateur est très classique chez les oiseaux nichant au sol. En Afrique, le vanneau éperonné n’hésite pas à crier et à menacer les éléphants qui s’approchent du nid !
De multiples exemples de comportement héroïque, voire de sacrifice, montrent le dévouement des adultes à leur progéniture. Certaines araignées se laissent mourir et dévorer par leurs petits. La femelle de la pieuvre surveille et ventile ses œufs, défend farouchement sa couvée contre les intrus, ne se nourrit plus et meurt. Mais elle transmet son patrimoine génétique. La transmission des gènes s’opère de plusieurs manières : soit les animaux émettent une grande quantité d’œufs et ne s’en occupent pas ou peu ; soit ils utilisent leur énergie à l’élevage d’un ou quelques jeunes peu nombreux et leur donnent un maximum de chances de survie – c’est le cas des animaux les plus complexes. C’est essentiellement dans la deuxième catégorie que s’observent les comportements altruistes. Le terme même d’altruisme appliqué aux animaux est très discuté, car il décrit des motivations différentes. Globalement, un comportement altruiste coûte quelque chose au donneur sans compensation personnelle mais apporte à l’autre.
Dans L’Origine des espèces, Darwin évoque déjà une sélection familiale. Il énonce que « la sélection s’applique à la famille aussi bien qu’à l’individu1 » pour expliquer un des cas les plus difficiles à faire concorder avec sa théorie : l’entraide des ouvrières stériles chez les abeilles et les fourmis, capables de sacrifier leur vie pour la communauté.
Comme l’homosexualité, la non-sexualité soulève le problème de la propagation des caractères par des individus qui ne les transmettent pas. Darwin propose une ingénieuse comparaison avec les animaux domestiques : on peut très bien sélectionner une race bovine avec des bœufs à longues cornes, alors que les bœufs ne perpétuent pas l’espèce : « C’est grâce à la répétition du même procédé que s’est peu à peu accumulée la prodigieuse différence qui existe entre les femelles stériles et les femelles fécondes de la même espèce2. » Le néodarwinisme avance des explications plus précises.
Darwin piqué au vif par les abeilles
Dès 1964, le biologiste britannique William Donald Hamilton (1936-2000)3 formule le principe de la sélection de parentèle (kin selection), qui explique les comportements altruistes par la parenté entre l’individu qui les exprime et son ou ses bénéficiaires, « parenté » signifiant proximité génétique. La parentèle est aujourd’hui encore la seule théorie qui permette d’expliquer l’évolution des individus stériles. Ceux-ci font partie de groupes sociaux composés de membres proches génétiquement.
La théorie de la parentèle a beaucoup été appliquée aux insectes eusociaux, c’est-à-dire vivant en sociétés comprenant quelques individus reproducteurs et des ouvrières stériles. L’hérédité particulière des abeilles et des fourmis fait qu’une femelle est plus proche de sa sœur que de ses propres petits : 3/4 de patrimoine génétique partagé contre 1/2. Elle explique parfaitement l’altruisme de l’ouvrière. Si l’on comprend qu’une mère humaine peut se sacrifier pour son petit (une moitié de gènes communs), la fourmi a encore plus de « raisons » de se sacrifier pour ses sœurs (trois quarts de gènes communs). En terme de transmission de caractères, il est plus « rentable » pour une ouvrière de nourrir ses sœurs que de se reproduire. L’énigme soulevée par Darwin trouve donc avec la génétique une explication logique4.
Cependant, la proximité génétique des fourmis ouvrières est souvent confondue avec la sélection de parentèle, alors que celle-ci n’implique pas une telle proximité, et peut fonctionner avec un degré de parenté égal ou inférieur à 1/2. D’ailleurs, d’autres insectes eusociaux comme les termites n’ont pas les particularités héréditaires des fourmis, par exemple des pucerons japonais et des coléoptères australiens. Il existe aussi des crustacés eusociaux ! Ces petites crevettes vivent jusqu’à plus de trois cents individus dans les canaux internes d’une éponge. Leur communauté comprend une reine reproductrice, défendue par des individus stériles munis d’une pince démesurée.
Il existe même une espèce de mammifère eusocial : le rat-taupe glabre.
Des rongeurs qui se prennent pour des fourmis
Comme son cousin le rat-taupe de Damara, aux mœurs assez proches, le rat-taupe glabre n’est ni un rat ni une taupe. Nu, fripé, aveugle, affublé de dents de morse, ce rongeur a l’allure d’une saucisse rose avec une tête de pit-bull insomniaque. Le rat-taupe glabre vit uniquement dans des galeries souterraines, dans les régions arides de l’Afrique de l’Est. Il n’a été décrit qu’en 1842, et depuis, les révélations s’accumulent. En 1981, les zoologistes découvrent avec surprise que, dans chaque colonie, une seule femelle se reproduit et assure la descendance : c’est une reine, comme chez les abeilles5 ! Elle est le plus gros individu de la colonie. Elle engendre des portées moyennes de quatorze petits, quatre fois par an. En captivité, une reine a mis bas vingt-sept rejetons en une seule fois, et cent huit la même année, en cinq portées !
Une colonie de rats-taupes compte couramment quatre-vingts individus, mais peut aller jusqu’à trois cents. Comme dans une fourmilière, chaque membre joue un rôle spécialisé suivant sa corpulence. Les plus gros semblent ne pas faire grand-chose, mais si un danger survient (en général un serpent), ce sont eux qui courent l’affronter, de la même manière que les soldats chez les termites. D’autres rats-taupes des deux sexes s’occupent des jeunes. Les plus petits sont des ouvrières ou des ouvriers actifs : ils creusent les galeries et recherchent les énormes tubercules qui nourriront la colonie. Certains individus appelés « dispersants » sont destinés à partir fertiliser d’autres colonies, comme font les fourmis ailées. Cela évite une trop grande consanguinité6. Enfin, la reine règne en dictateur sur tout ce petit monde. Elle passe une partie de son temps à parcourir les galeries en agressant violemment ses sujets. Elle harcèle entre autres les femelles du groupe, dont elle inhibe la sexualité à force de stress, et probablement à l’aide de messages chimiques, afin de préserver son monopole de génitrice. Quand elle tombe malade ou meurt, des femelles libérées du joug se mettent à grossir et s’affrontent dans des combats sanglants pour la remplacer.
En 2000, on découvre que les reines présentent une particularité unique chez les rats-taupes : une vertèbre lombaire plus allongée, qui élargit leur ventre et leur permet une meilleure fécondité. Comme les termites, les abeilles, les guêpes ou les fourmis, la reine rat-taupe est donc physiquement différente des autres membres de sa colonie ; c’est le seul mammifère dont la société est divisée en castes morphologiques. De même que les insectes, c’est un animal à « sang froid », ou poïkilotherme : sa température change en fonction de l’extérieur. Un mammifère décidément bien étrange…
Don du sang sous les tropiques
Dans la chaude nuit amazonienne, on entend les chants flûtés des grenouilles tropicales, des bruits furtifs, des cris de bêtes inconnues. Attaché près du campement, un cheval est assoupi, fatigué de sa journée de labeur. Il dort debout, car il ne se trouve pas dans un lieu où il se sent pleinement en sécurité. Au sol, une petite chauve-souris rampe silencieusement vers lui, à quatre « pattes », s’aidant de ses ailes comme de trop longues béquilles. Puis elle grimpe sur un de ses sabots, et cherche, à l’aide des zones thermosensibles de son nez, les vaisseaux sanguins qui affleurent. Elle lui lèche la peau et la transperce sans qu’il le sente, avec ses deux dents pointues7. L’animal est un vampire commun, ou vampire d’Azara, la plus connue des trois espèces de chauves-souris hématophages d’Amérique, que Buffon a baptisées « vampires » par allusion aux légendaires humains suceurs de sang.
La petite chauve-souris lèche longuement le sang de l’équidé, qui coule grâce à un anti-coagulant contenu dans sa salive. Une ou deux dizaines de minutes plus tard, voire une demi-heure, elle a englouti l’équivalent de deux cuillers à soupe de liquide : plus que son propre poids ! Après un tel festin, le vampire repart le ventre gonflé. Il est parfois si lourd qu’il a du mal à s’envoler, et il doit d’abord faire une sieste pour digérer. Le sang contient beaucoup d’eau, qui s’élimine vite ; après un petit pipi, le vampire délesté peut décoller à nouveau.
Charles Darwin aurait pu décrire cette scène, car il a observé lui-même au Brésil des vampires qui s’attaquaient aux chevaux de l’expédition : « Je sais qu’en Angleterre on a mis en doute la véracité de ce fait ; il est donc fort heureux que j’aie été présent un jour qu’on attrapa un de ces vampires (Desmodus d’Orbignyi, Wat.) sur le dos même d’un cheval. Nous bivouaquions fort tard, un soir, auprès de Coquimbo, dans le Chili, quand mon domestique, remarquant que l’un de nos chevaux était fort agité, alla voir ce qui se passait ; croyant distinguer quelque chose sur le dos du cheval, il y porta vivement la main et saisit un vampire. Le lendemain matin, l’enflure et les caillots de sang permettaient de voir où le cheval avait été mordu ; trois jours après, nous nous servions du cheval, qui ne paraissait plus se ressentir de la morsure8. »
Trop gentils, les vampires !
Les vampires se nourrissent également sur des tapirs, des crapauds, des guanacos et autres animaux sauvages, y compris des otaries, et sur des animaux domestiques : ânes, vaches, chiens ou volaille. Ces chauves-souris peuvent encore se nourrir aux dépens d’un humain assoupi dont le gros orteil dépasserait du hamac, s’appuyant sur une moustiquaire opportunément grillagée…
À l’époque de Darwin, on n’avait que peu d’informations sur la vie familiale des vampires. Le plus extraordinaire de l’histoire restait à venir.
Repue d’hémoglobine, de retour dans sa colonie, notre petite chauve-souris vampire s’accroche près d’une proche parente, la tête en bas comme il se doit. Sa compagne a eu moins de chance, elle est rentrée bredouille de sa collecte de sang. Or, un vampire ne survit pas à deux nuits de jeûne consécutives. Soixante heures sans nourriture suffisent pour qu’il perde jusqu’à un quart de son poids, et sa température corporelle n’est plus régulée. La mort est proche pour la chauve-souris malchanceuse.
Il s’ensuit un étrange cérémonial, digne des films gores qui font frissonner d’horreur et de plaisir les amateurs. L’affamée entreprend une toilette de sa voisine repue. Elle lui lèche le dessous des ailes, puis les lèvres. La compagne rassasiée de sang réagit au rituel ; soudain, elle semble embrasser la visiteuse sur la bouche. En réalité, elle régurgite une partie de son précieux repas, une sorte de boudin tiède prédigéré, et lui sauve la vie.
Quel intérêt a-t-elle de se priver d’une nourriture si indispensable à sa survie ? La réponse est corrélée à une donnée importante : ces dons du sang ne s’observent qu’entre des animaux apparentés ou qui cohabitent depuis longtemps. L’altruisme viendrait donc d’une proximité génétique, mais aussi d’une proximité de groupe. Les récits de vampires ne sont pas tous des histoires d’horreur.
Associations de bienfaiteurs
Une brosse à dents pour la tortue
Vous connaissez certainement ces bestioles qui sautent sur les plages, que l’on appelle des puces de mer ou puces de sable. En réalité, ce ne sont pas des puces, ni même des insectes, mais des crustacés, des cousines des crevettes. En 1964 aux Galápagos, des naturalistes découvrent une espèce de puce de mer restée jusque-là totalement inconnue de la science. Celle-ci est réellement curieuse. Elle ne saute pas, ses pattes ne forment pas des ressorts mais plutôt des crampons et, surtout, on ne trouve ces crustacés que dans la bouche des tortues marines ! Baptisées Hyachelia tortugae, ces bestioles ne se comportent pas comme des parasites, mais comme des crevettes nettoyeuses : lorsqu’une tortue verte se nourrit, Hyachelia doit s’accrocher sur les parois de sa cavité buccale pour éviter d’être broyée avec les aliments. Et quand la mastication s’arrête, elle nettoie les dents de son hôte en consommant ses restes de repas.
Non loin de là, aux Galápagos toujours, vivent les fameux iguanes marins. Ces pauvres reptiles sont décorés de grosses tiques rouges qui leur sucent le sang. Heureusement pour eux, ils sont peut-être les animaux les plus bichonnés au monde. Une équipe de déparasitage complète est à leur service, comprenant les crabes des Galápagos, un oiseau moqueur, trois espèces de géospizes et des poissons du genre Abudefduf, soit en tout six espèces animales nettoyeuses ! Il ne s’agit pas ici de sélection de parentèle, mais d’entraide entre espèces animales très différentes. Les iguanes et leurs alliés soulèvent alors une question : qu’en est-il de la fameuse « lutte » pour la vie ?
Des animaux qui s’aiment
En 1902, Pierre Kropotkine (1842-1921)9 publie L’Entraide, un facteur de l’évolution. Ce biologiste anarcho-communiste juge les idées de Darwin excessivement fondées sur la compétition. Pour lui, les espèces les mieux adaptées ne sont pas les plus agressives, mais les plus solidaires. Sans remettre en cause l’évolution, il s’oppose aux darwinistes sociaux, qui, selon lui, ont caricaturé « la lutte pour la vie » et voulu l’appliquer aux sociétés humaines. Dans sa conclusion, il écrit : « Les espèces animales au sein desquelles la lutte individuelle a été réduite au minimum et où la pratique de l’aide mutuelle a atteint son plus grand développement sont invariablement plus nombreuses, plus prospères et les plus ouvertes au progrès. La protection mutuelle obtenue dans ce cas, la possibilité d’atteindre un âge d’or et d’accumuler de l’expérience, le plus haut développement intellectuel et l’évolution positive des habitudes sociales, assurent le maintien des espèces, leur extension et leur évolution future. Les espèces asociales, au contraire, sont condamnées à s’éteindre. » En fait, Kropotkine rejoint presque Darwin et sa conception des origines de la moralité.
Tout n’est donc pas que compétition dans la nature, la coopération joue aussi un rôle dans l’évolution. Les coraux bâtisseurs d’atolls étudiés par Darwin sont des petits animaux qui renferment des algues, les zooxanthelles, sans lesquels ils ne pourraient pas vivre. Grâce à la photosynthèse, les algues apportent des sucres aux coraux, qui, eux, leur apportent leurs déchets azotés.
Beaucoup d’associations entre espèces animales sont bien connues : celle du poisson-clown et de l’anémone de mer, du pique-bœuf et du buffle africain, ou l’alliance entre les fourmis et les pucerons qu’elles traient, qu’elles déplacent sur des pâtures et qu’elles protègent contre les prédateurs. Les fourmis fondent d’extraordinaires alliances avec une grande quantité d’autres espèces. L’une d’elles (Acropyga) ne peut pas se passer de sa cochenille échangeuse de nourriture. Si bien que, quand une jeune reine fourmi part pour son vol nuptial, elle emporte avec elle une femelle de cochenille ; elles fonderont ensemble chacune sa colonie10 !
Voici, parmi tant d’autres, une histoire d’entraide inattendue. Elle se déroule entre un hibou du continent nord-américain, le petit duc maculé, et le serpent aveugle du Texas, que l’on trouve parfois dans son nid. Comment le reptile est-il arrivé là ? C’est un des hiboux qui l’a volontairement capturé pour le déposer dans son nid douillet ! Le serpent ne dévore ni les œufs ni les oisillons, mais il élimine tous les insectes et les vermines qui infestent la nichée. Le serpent rend aux rapaces un service manifeste, car les petits ducs qui naissent dans un nid nettoyé par ses soins grandissent mieux. Le coup de main est réciproque : le reptile vulnérable bénéficie du gîte, du couvert et de la protection de prédateurs bienveillants. Moralité ? Le serpent aveugle nous susurre qu’on a toujours besoin d’un plus petit que soi.
Une alliance pour la vie
Des alliances se nouent jusqu’au plus profond des organismes. Voici au moins mille millions d’années, une bactérie s’est associée à une cellule munie de noyau. Elle est probablement entrée dans la cellule et aurait évolué jusqu’à devenir une mitochondrie, aujourd’hui partie intégrante de nos cellules, productrice d’énergie et siège de la respiration cellulaire. Les constituants de nos corps reposent donc sur une alliance. Comment un organisme peut-il devenir une partie d’un autre, voire s’y dissoudre ? L’association de la bactérie Buchnera aphidicola et du puceron en est un exemple extraordinaire.
Buchnera est un organisme totalement intégré au puceron : il n’en sort jamais. Il y est arrivé voici environ deux cents millions d’années et il s’y est trouvé bien. Buchnera est abrité par le puceron auquel, en contrepartie, il fournit des acides aminés, substances indispensables. Il s’agit d’un mutualisme et non d’un parasitisme, car le service est réciproque. Au cours de l’évolution, Buchnera a perdu environ 80 % de ses gènes, qui ne lui servent plus à rien. Avec un bagage de moins de cinq cents gènes, il possède le plus petit génome connu. S’il n’existe pas de Buchnera en dehors des pucerons, on ne trouve pas non plus de puceron sans Buchnera. L’organisme fait tellement partie de l’insecte qu’il se transmet au cours de la reproduction, passant directement de l’ovaire maternel aux embryons !
Comme ceux des pucerons, nos corps sont habités par des bactéries symbiotiques, c’est-à-dire vivant en symbiose, ou mutualisme, avec nous. Nous ne pourrions vivre sans celles qui participent à la digestion de nos aliments et qui fabriquent des vitamines essentielles. De fait, notre corps est constitué de beaucoup plus de bactéries que de cellules, une centaine de milliers de milliards, divisés en plus de cinq mille espèces, disséminées sous notre épiderme, notre nez, nos yeux, nos muqueuses, etc. Notre flore intestinale pèse à elle seule plus de un kilo et demi !
Nos alliances ne sont pas qu’intérieures. La domestication du chien peut se lire comme une sorte de symbiose. On sait ce que l’homme a gagné dans l’association. Mais le toutou ? Aux États-Unis, il reste encore quelque dix mille loups contre environ cinquante millions de chiens. D’un point de vue évolutionniste, les canidés ayant accepté la domestication sont nettement gagnants. Leur morphologie a spectaculairement changé, mais aussi leur comportement. Les individus les plus doués pour la communication ont sans doute été sélectionnés. Dès sa naissance, le chiot d’aujourd’hui décode la gestuelle humaine aussi bien qu’un enfant de deux ans et mieux que tous les autres canidés, notamment les loups. Le chien interprète mieux que le chimpanzé, pourtant plus proche de nous génétiquement, le geste de montrer du doigt. Après une longue sélection des animaux les plus sensibles aux signaux sociaux, l’héritage génétique du chien semble donc avoir la capacité de comprendre notre gestuelle humaine.
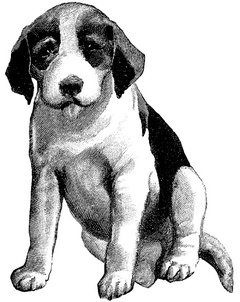
Le chiot interprète parfaitement les gestes des humains
Des plus infimes bactéries jusqu’au toutou de la maison, des organismes de tailles variées ont des choses à nous raconter : tout n’est pas que lutte pour la vie, il existe également des alliances pour la vie.
1. Charles Darwin, L’Origine…, p. 291.
2. Ibid., p. 292.
3. Naturaliste de terrain et féru de modélisations mathématiques, Hamilton a aussi développé une théorie sur l’évolution des parasites. Il fut emporté par le paludisme lors d’une expédition au Congo, où il enquêtait sur les origines de l’épidémie du sida, qu’il attribuait à des campagnes de vaccination expérimentales sur les populations africaines dans les années 1950, à partir de virus prélevés sur des chimpanzés.
4. En 1975, Edward Wilson, grand spécialiste des fourmis, publie Sociobiologie : la nouvelle synthèse. L’ambitieux ouvrage fait référence à la théorie synthétique de l’évolution. La sociobiologie entend unifier des domaines aussi différents que les sciences sociales, l’évolution biologique, l’éthologie, la génétique et l’histoire humaine pour expliquer les comportements sociaux. Elle s’appuie entre autres sur la théorie de parentèle de Hamilton. Autre livre retentissant, Le Gène égoïste de Dawkins pousse encore les explications génétiques. Wilson explique tout, jusqu’à la religion et la morale, par le déterminisme génétique : ce sont nos gènes qui commandent. L’homme est traité de la même manière que les fourmis, et ce déterminisme total provoque de joyeux remous. De plus, des dérives possibles vers le sexisme ou le racisme, dont s’est toujours défendu Wilson, portent de l’ombre à la doctrine. Malgré ces excès, et quelques ennemis farouches, la sociobiologie est une nouvelle façon de comprendre l’évolution. Elle apporte des éclaircissements dans le domaine de l’étude des comportements.
5. Il existe cependant de rares colonies comportant deux reines.
6. En 2007, on a déterminé une forme originale d’« altruisme » chez le rat-taupe de Damara : il existe des paresseux (25 à 40 % de la population) qui ne font quasiment rien. Ils mangent beaucoup et grossissent plus que les autres. Mais durant les périodes humides qui assouplissent la terre, ils creusent en première ligne et parfois s’échappent de la colonie pour en fonder de nouvelles. Cette caste de gros fainéants assure donc la dispersion de l’espèce. En quelque sorte, ils se ménagent pour mieux propager les gènes de la communauté. Une forme de sacrifice somme toute assez douce…
7. D’autres méthodes de chasse existent. Les vampires s’accrochent souvent à la queue ou à la crinière d’un cheval. Les victimes ne sont pas toujours consentantes et cherchent à se débarrasser du parasite en se secouant ou en se frottant contre les arbres, surtout lorsqu’elles sont assaillies par des vampires débutants, qui ne savent pas encore mordre sans faire mal.
8. Charles Darwin, Voyage…, p. 24.
9. Il est fait une allusion inattendue à ce personnage dans le film La Vengeance du serpent à plumes (Gérard Oury, 1984), où Loulou Dupin (joué par Coluche) hérite d’un appartement occupé par deux jolies anarchistes appartenant à un groupuscule baptisé : « Ravachol-Kropotkine »…
10. Lire à ce sujet Alliances animales, de Rémi Gantès et Jean-Pierre Quignard. Voir bibliographie.