330. WITTGENSTEIN À SRAFFA
[18.02.1931]
Cher Sraffa,
Je vous attends dans ma chambre vendredi vers 19 h 45, puisque notre Hall commence à 20 h.
Ludwig Wittgenstein
Je veux parler de vivisection avec vous. Je pense que ce sujet est étroitement lié à ceux dont nous discutons.
— Lettre datée à partir de l’agenda de Wittgenstein : l’invitation était pour le 20 février 1931.
331. NOTE DE SRAFFA POUR WITTGENSTEIN
[Janvier-février 1932]
Si les règles du langage peuvent être construites uniquement par observation, alors aucun non-sens ne peut jamais être proféré. Cela identifie la cause à la signification d’un mot.
Tout comme celui des métaphysiciens, le langage des oiseaux peut être ainsi interprété de façon conséquente.
Il s’agit simplement de découvrir à quelle occasion ils disent quelque chose, à la façon dont on découvre à quelle l’occasion ils éternuent.
Et si le non-sens est « un simple bruit », il peut certainement se produire, comme l’éternuement, là où existe une cause : comment distinguer cela de la signification ?
Il faudrait laisser tomber les généralités et prendre en considération les cas particuliers d’où nous sommes partis. Soit les propositions conditionnelles : quand sont-elles des non-sens, et quand n’en sont-elles pas ?
« Si j’étais roi » est un non-sens. Car en ce cas il faudrait que nous soyons, moi ou la fonction, tout autres. Je connais les raisons précises qui rendent impensable que je sois roi, et je vois que les changements requis pour rendre cela pensable sont si importants que je ne me reconnaîtrais pas ainsi transformé, ou que personne ne dirait qu’appliqué à mon moi actuel la fonction est celle d’un roi.
« Si j’étais enseignant » a un sens. Car je l’étais l’an passé, et je ne crois pas que nous ayons, moi ou la fonction, beaucoup changé depuis. La différence est minime. Ou plutôt je ne peux pas voir de différence : je ne sais pas en quoi exactement j’ai changé depuis l’an passé. Il n’y a, dans cette idée, rien de repoussant.
Mais cela dépend-il seulement de mon savoir ? (Car une différence est importante ou minime selon que je peux ou non la voir clairement.) Si j’en savais suffisamment, tout cela ne serait que non-sens.
Il existe aussi des propositions où « si » tient lieu de « lorsque » : c’est-à-dire que le nom tient lieu d’une classe, et la proposition est vraie (ou pensable, comme supra) au moins pour un membre de cette classe.
— Cette note de Sraffa est conservée à la bibliothèque de Trinity College (dans les papiers de Sraffa : D3/12/71). Elle était manifestement destinée à être montrée à Wittgenstein au cours de leurs discussions.
Elle a été datée par référence au fait que Sraffa dit avoir enseigné l’année précédente (il cessa d’enseigner le 30 septembre 1931) et en fonction de la trace, dans les manuscrits de Wittgenstein, des idées que Sraffa y expose.
332. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Lundi [19.01.1934]
Cher Sraffa,
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, je vous ai dit que je vous appellerai de temps à autre et je veux vous expliquer pourquoi je ne l’ai pas encore fait. En ce moment, il ne me reste que très peu de forces — pratiquement aucune —, car mon travail les absorbe toutes. Et vous n’ignorez pas que les conversations que nous avons eues récemment (je veux dire ces 6 ou 9 derniers mois) m’ont énormément fatigué ; et vous aussi, j’en suis certain. En soi, cela est sans importance, mais il est clair, je crois, que nous nous sommes donné, du moins pour l’instant, tout ce que nous pouvions nous donner. J’ai appris de vous une énorme quantité de choses pendant nos conversations des 2 ou 3 dernières années, mais je ne peux pas dire que j’en ai appris beaucoup dans nos dernières discussions. Ce qui ne veut pas dire que j’ai appris tout ce que vous pouvez enseigner ! Mais que j’ai appris la plupart des choses que je peux assimiler en ce moment. C’est pour cela que nos dernières conversations n’ont pas été profitables. Ce n’est pas une raison pour ne plus nous voir, mais c’est la raison pour laquelle j’éviterai, tant que je ne me sentirai pas de forces supplémentaires, d’avoir une conversation avec vous.
Ludwig Wittgenstein
— Lettre datée au crayon (à peine visible) par Sraffa. À en juger par l’agenda des deux hommes, leurs conversations régulières prirent fin en octobre 1933. Il y eut deux rencontres en décembre 1933 et une tentative de conduire une discussion au moyen de notes pendant le trimestre d’hiver 1934 (voir les lettres 333-338 pour lesquelles la datation n’est pas totalement sûre). Il semble que les rencontres régulières entre les deux hommes n’aient repris qu’au trimestre de printemps 1935.
333. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Mercredi [31.01.1934]
Cher Sraffa,
Voici quelques remarques que j’ai couchées par écrit, sur le sujet abordé dans notre dernière conversation. J’espère qu’elles ne sont pas trop décousues et que vous les lirez jusqu’au bout.
Vous avez dit : « Les Autrichiens peuvent faire la plupart des choses que les Allemands ont faites. » J’ai dit : comment le savez-vous ? Quelles circonstances prenez-vous en compte pour dire qu’ils le peuvent ? « Il peut ôter l’alliance de son doigt. » C’est vrai, et ce n’est pas trop difficile si elle ne lui serre pas trop le doigt. Mais il peut avoir honte de le faire, sa femme peut le lui interdire, etc.
Vous dites : « Tirez la leçon de ce qui s’est passé en Italie. » Mais quelle leçon en tirerai-je ? Je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées en Italie. Aussi la seule leçon que je puisse en tirer, c’est qu’il se produit parfois des choses auxquelles on ne s’attend pas.
Je demande : de quoi cet homme que je ne puis imaginer en colère aura-t-il l’air lorsqu’il sera en colère ? Lui est-il possible de se mettre en colère ? Que dirai-je lorsque je le verrai en colère ? Pas seulement : « Après tout, il peut aussi se mettre en colère », mais : « C’est ainsi qu’il le peut ; c’est donc ainsi que sa colère se rapporte à son apparence antérieure. »
Il est un fait que je peux imaginer sans mal certains traits manifestant la colère (souvenez-vous de ce que j’ai dit des Allemands de Bohême), mais non certains autres. Ce qui ne veut évidemment pas dire que je nie que les seconds soient des manifestations de colère ; mais que le genre de colère qu’ils manifestent me laisse perplexe. Et je conjecturerai peut-être quelque chose sur le genre de colère que j’imagine être la leur.
Vous m’avez dit : « Lorsque quelqu’un est en colère, les muscles a, b, c de son visage se contractent. Cet homme (l’Autrichien) étant pourvu des muscles a, b, c, pourquoi ne se contracteraient-ils pas ? En fait, si vous souhaitez, vous Wittgenstein, savoir de quoi il aura l’air en colère, contentez-vous d’imaginer qu’il contracte ces muscles-là. À quoi l’Autriche ressemblera-t-elle lorsqu’elle deviendra nazie ? Il n’y aura plus de parti socialiste, plus de juges juifs, etc., etc., etc. C’est à cela qu’elle ressemblera. » J’ai répondu : cela ne me donne pas l’image d’un visage. Cela me montre seulement que je connais insuffisamment le fonctionnement de ces choses-là pour savoir si tous les changements que vous indiquez se produiront en même temps. Certes, je comprends ce que l’on veut dire quand on dit que les muscles a, b, c se contractent, mais qu’adviendra-t-il aux différents muscles situés entre ceux-là ? Ne se pourrait-il pas que dans ce visage-là la contraction d’un muscle empêche celle des autres ? Savez-vous, dans ce cas particulier, comment les choses interagissent les unes sur les autres ?
Vous pourriez dire : la seule façon de prédire ce que sera sa physionomie future, c’est certainement d’avoir une connaissance précise des contractions, etc., de tous les muscles (et non des seuls muscles principaux).
Je dis : je ne pense pas que ce soit là la seule façon ; il y en a une autre, qui rejoint celle-là. Je pourrais demander de quoi ce visage aura l’air non seulement à un physiologue, mais aussi à un peintre. Leurs réponses seront différentes (celle du peintre consistera à peindre le visage en colère), mais si elles sont correctes, ces réponses s’accorderont. Bien entendu, je sais qu’un peintre doit apprendre l’anatomie. Je souhaite connaître sa réponse, et je souhaite également savoir ce que le physiologue pourra me dire pour contrôler la réponse du peintre.
Ce qui m’intéresse, c’est de savoir quelles expressions les Autrichiens emploieront lorsqu’ils seront devenus nazis. À supposer que leur patriotisme ne soit que verbal, ce qui m’intéresse n’est que leur discours futur.
Je voudrais vous dire quelque chose d’autre. Je pense que vous commettez une faute dans nos discussions : VOUS N’ÊTES PAS SECOURABLE ! Je me trouve en quelque sorte dans la position de quelqu’un qui vous inviterait à prendre le thé dans son appartement ; mais c’est à peine s’il est meublé ; il faut s’asseoir sur des caisses, les tasses sont posées par terre, elles n’ont pas d’anses, etc., etc. Je m’active pour trouver tout ce que j’estime susceptible de nous permettre de prendre le thé ensemble. Vous, vous êtes planté là, l’air boudeur, disons que vous n’arrivez pas à vous asseoir sur une caisse, à tenir une tasse dépourvue d’anse et que, d’une manière générale, vous rendez les choses difficiles. — C’est du moins ainsi que les choses me semblent être.
Ludwig Wittgenstein
— La date notée au crayon (à peine lisible) par Sraffa est la seule possible. La nazification de l’Autriche menaçait, mais le putsch de février conduisit à l’établissement d’un régime non nazi, mais autoritaire, et à la suppression du parti socialiste (« social démocrate »).
— Notre dernière conversation : Les agendas de poche ne font état d’aucune rencontre antérieure en 1934, mais il ressort de la lettre 336 qu’il y en eut au moins une de prévue.
334. NOTES DE WITTGENSTEIN POUR SRAFFA
[21.02.1934]
Je pense qu’il se pourrait que la seule façon de donner à mes arguments une forme vraiment satisfaisante soit de les noter par écrit. — Car il me semble que la plupart de ces arguments, qu’ils soient corrects ou incorrects, valent la peine d’être entendus et pris en considération ; et le simple fait de savoir que vous n’en tenez pas compte quand je les énonce oralement me remplit de désespoir au moment même où je les établis. C’est comme si l’on essayait obstinément de remplir un tonneau sans fond.
Je ne veux pas dire par là que je suis certain que vous tirerez quelque chose d’un argument de moi s’il est écrit. Mais cela est simplement concevable ; car vous aurez le temps d’en faire ce qui vous plaira, et vous ne l’écarterez pas aussi facilement que si vous l’entendiez simplement.

Dire que les Allemands ne peuvent pas connaître le bonheur et la prospérité dans une république parce qu’ils sont un peuple monarchiste, est-ce un argument correct ? On pourrait le contrer en demandant : « N’auriez-vous pas dit exactement la même chose des Français sous Louis XIV ? » Cet argument me fait penser à quelque chose qui n’a, en apparence, aucun rapport. À la question « pourquoi la mode (disons, vestimentaire) change ? », la plupart répondront : parce que les goûts changent. Ils diront que les gens s’habillent comme ils le font parce que maintenant, ils aiment s’habiller ainsi. Mais, le plus souvent, cela n’est pas vrai ou ne signifie rien. Les gens s’habillent comme ils le font pour quantité de raisons différentes : parce qu’ils voient les autres s’habiller ainsi, parce que leur tailleur fait leur costume ainsi, et ils se seraient habillés différemment s’il le leur avait fait dans un autre modèle. On ne peut même pas dire que les tailleurs qui créent de nouveaux modèles les créent comme ils le font parce qu’ils en aiment le design. Il se peut qu’ils les trouvent plus seyants ou qu’ils les dessinent instinctivement ainsi, etc., etc. Il arrive, bien sûr, que quelqu’un choisisse entre différents modèles, qu’il en aime un plus que les autres et qu’il se fasse faire son costume en fonction de cela. Mais le sophisme que je veux mettre en évidence consiste à croire que toutes les actions faites par quelqu’un sont précédées par un état d’esprit particulier dont l’action en question est le résultat. S’en rendre coupable, c’est dire qu’il y a un état d’esprit, le goût, le penchant, qui change, au lieu de se contenter de dire que les tailleurs dessinent un modèle cette année et un autre, quelque peu différent, l’année suivante, et qu’il y a toutes sortes de raisons à cela. C’est donc considérer comme secondaire l’acte de dessiner le modèle, et comme primaire l’état d’esprit. Comme si une modification de goût ne consistait pas seulement (entre autres choses) à dessiner ce qu’on dessine. Pour décrire ce sophisme, on peut dire qu’il présuppose l’existence d’un réservoir mental où serait contenues les causes véritables de nos actions. Ce qui n’est pas sans rapport avec notre première question, car pour y répondre, on est enclin à invoquer un tel réservoir, À SAVOIR « la mentalité d’un peuple », et lorsqu’on parle des changements possibles du gouvernement d’un pays, on imagine que cette chose-là — la mentalité — ne change pas.
Supposez qu’ait été posée la question suivante : « Un roi sans couronne, est-ce possible ? » On pourrait être tenté d’y répondre : « Non, parce que le fait de n’avoir pas de couronne ne convient pas au caractère d’un roi, ou parce que le fait qu’un roi ne porte pas de couronne ne convient pas à la physionomie de la royauté. » Mais la vraie réponse est : « La physionomie changera, et il y aura des rois sans couronne. »
Si l’on dit : « L’Allemagne ne peut pas changer ni devenir une véritable république parce que cela ne ressemble pas aux Allemands, à leur physionomie telle que je la vois », dans cet argument le sophisme consiste — je crois — à supposer (inconsciemment, en un sens) qu’un certain type de caractéristiques (la mentalité, ou son expression) ne change pas. Sommairement dit, le sophisme consiste à croire que si des choses inattendues venaient à se produire, les gens n’auraient aucun visage, AUCUNE physionomie.
Si j’ai observé un corps en rotation et que son premier mouvement ait été celui-ci :
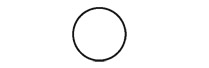
cette image peut m’impressionner si fortement qu’il me paraît impossible que ce corps ne continue pas à suivre le même chemin circulaire. Car, pourrais-je arguer, son mouvement a la physionomie d’un cercle. Mais s’il se meut ensuite ainsi :

il ne possède plus l’ancienne physionomie, mais une nouvelle physionomie très simple ; et aussitôt que je m’en rends compte, je suis à nouveau tenté de penser qu’il doit maintenant se mouvoir selon la figure d’un huit.
Il sera donc correct de dire, comme vous l’avez fait : « Si vous voulez savoir ce qu’il adviendra de l’Allemagne, ne tirez pas argument de sa physionomie ni de choses du même genre. » Non parce que cette physionomie serait trop vague. Certainement pas ! Mais parce que fonder son argumentation sur la physionomie, c’est argumenter sur la base du préjugé selon lequel certaines choses ne changeront pas, alors qu’il n’y a aucune raison de supposer qu’elles ne le feront pas.
Nous emmagasinons dans notre esprit des impressions, certains modèles (tel le roi avec sa couronne), et nous sommes enclins à penser que tout ce que nous pouvons rencontrer doit être conforme à ces standards. Pourtant, si nous tombions sur un royaume où le roi ne possède pas de couronne, nous l’inclurions très vite dans notre collection de modèles.
— Le second de ces documents est une application du premier. Il a été daté au crayon par Sraffa et fut écrit par Francis Skinner, sous la dictée de Wittgenstein.
— Le soulignement en pointillés de « un certain type de caractéristiques » semble indiquer que Wittgenstein doute de la pertinence qu’il y a ici à parler de caractéristiques.
335. NOTES DE SRAFFA POUR WITTGENSTEIN
[23.02.1934]
Voici ce que j’ai à dire sur la méthode de nos discussions (remarques ou arguments). Il me faut, non de brèves, mais de longues histoires ; il me faut essayer de m’en tenir à un certain point, au lieu d’essayer de passer d’un point à un autre en apparence sans rapport avec le premier ; je suis bien trop lent pour effectuer un tel passage, et incapable de trouver la connexion cachée. Je ne me satisfais pas non plus de suggestions ou d’allusions (ni de rien qui ne puisse être posé noir sur blanc). Pour moi, tout cela doit être évité.
Mais il ne sert à rien de poser des conditions auxquelles nous ne pourrions pas nous tenir ; si les choses se passent en pratique de façon intolérable pour l’un de nous, alors nous laisserons tomber.

La mode, le goût, le penchant, le réservoir — excellent (je n’aurais pas pu le présenter aussi bien) pour autant que cela fonctionne. J’ai des objections supplémentaires à la réponse soumise à la critique (pourquoi la mode change ? parce que le goût change). Mais ensuite vous sortez du chemin que vous aviez vous-même tracé. Le roi — l’Allemagne — la physionomie —, le sophisme est de supposer que la physionomie ne change pas. Non, le sophisme est de supposer qu’elle est le réservoir des changements primaires. Nous ne voulons pas un réservoir de choses immuables, mais la chose qui est la première à changer. C’est là le point central. Je pense que le réservoir doit contenir des choses concrètes bien définies, de préférence mesurables et vérifiables avec une certaine certitude, et indépendantes de ce que j’aime et déteste. Les physionomies ne sont certainement pas cela ; elles sont constituées de mes préjugés, de mes sympathies, etc. Et l’expérience m’a appris que j’appréhende toujours les changements de physionomie après — bien après — que les événements que j’ai essayé de prédire se sont produits.
Je veux un réservoir de choses dont les changements soient d’emblée visibles, ou qui soient saisissables de façon plus précise, plus assurée ou plus aisée, et qui (par-dessus tout) soient tels que je puisse les déterminer le plus impartialement possible (qui soient aussi indépendants que possible de mes désirs, préjugés, sympathies, habitudes, etc.). Je veux des choses du même ordre que la quantité de charbon produite par l’Allemagne (si cela est pertinent), et non de l’ordre de l’esprit du peuple allemand. C’est ce que j’essayais de décrire (de façon inadéquate) comme « vague ».
Après avoir critiqué les réponses communes, vous donnez la vôtre. Vous dites : « Les gens s’habillent comme ils le font pour toutes sortes de raisons. »
Mais une telle réponse ne sert à personne ; si je suis tailleur et que je vous je pose la question pour préparer une collection pour la saison prochaine, je veux que vous m’indiquiez une chose qui me soit visible dès maintenant et que vous me donniez une règle qui permette de dire, à partir de l’apparence de la chose en question, le genre de robes que les gens achèteront la saison prochaine.
Un producteur de soie pourrait aussi vous poser cette question pour savoir comment influer sur la mode de façon à augmenter l’usage de la soie ; et vous devriez lui indiquer une chose dont il puisse faire quelque chose. Vous pourriez lui dire par exemple : la mode dépend de la publicité sous tel et tel rapport.
Dans les cas du tailleur ou du producteur de soie, il se peut évidemment que la question reste sans réponse — par exemple, s’il est dans l’incapacité de se rendre à Paris, ou ne dispose pas de fonds pour faire de la publicité.
Mais vos réponses doivent lui donner des indications sur lesquelles il puisse s’appuyer. Si vous disiez au tailleur : « Examinez l’esprit des gens quand il change, les vêtements seront en harmonie avec lui », une telle règle lui serait-elle d’un quelconque usage ? En aurait-elle autant que si vous lui disiez : les journaux n’ont cessé de parler de Toutankhamon, et la mode sera aux copies de vêtements égyptiens, mais elle n’utilisera pas de soie, car la récolte a été mauvaise ; elle adaptera les modèles égyptiens pour qu’ils soient réalisables par des métiers à tisser ; et elle les créera dans des coloris plus sombres pour qu’ils ne se salissent pas trop à Londres, etc.
— Les dates des documents 334 et 335 sont conjecturées, mais ils sont manifestement la réponse aux deux documents supra 334.
Il y a un écho de cet échange dans The Blue and Brown Books, II, § 6, p. 143 (voir aussi infra l’item 337) : « Il y a une sorte de maladie générale de la pensée qui consiste à toujours chercher (et trouver) ce que l’on nommerait un état mental d’où jailliraient tous nos actes comme d’un réservoir. On dit donc : “La mode change parce que le goût des gens change.” Le goût est le réservoir mental. Mais si un tailleur dessine aujourd’hui un modèle de vêtement différent de celui qu’il a dessiné un an auparavant, ce que l’on appelle son changement de goût ne peut-il pas avoir consisté, en partie ou en totalité, à agir simplement ainsi1 ? »
Cet écho suggérerait, si l’on se fonde sur la datation précisée par Sraffa de la seconde partie de l’item 334, que les item 335 et 337 datent de 1935, c’est-à-dire qu’ils sont contemporains de la dictée de la seconde partie du Cahier brun. Mais ils présentent, par ailleurs, une ressemblance thématique avec la lettre 332.
336. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Mardi
27.02 [1934]
Cher Sraffa,
Je vous attendais dimanche. Comme vous n’étiez pas arrivé à 18 heures, j’ai envisagé d’aller jusque chez vous pour voir ce qu’il en était, mais comme je ne me sentais pas très bien moi-même, je suis finalement resté chez moi. — J’ai écrit une longue lettre de 10 pages en réponse à la vôtre que j’ai reçue samedi. Je l’ai écrite au crayon et si mal qu’il se pourrait que vous ne puissiez pas la lire ; en outre, certaines parties ne sont qu’esquissées. Si je peux, je la mettrai au propre (ou la dicterai). Mais ce n’est pas possible en ce moment, car je ne me sens pas bien (les nerfs et la vessie).
Je crains de ne pas pouvoir vous voir dimanche prochain, car j’aurai une visite. Mais le dimanche 11 mars me conviendrait. Pourrai-je venir chez vous ?
Ludwig Wittgenstein
— L’année 1934 est la seule année où le 27 février tombe un mardi et le 11 mars un dimanche. Voir aussi la lettre 338. La longue lettre annoncée fut effectivement écrite (voir la lettre 338), mais elle n’a pas été retrouvée.
337. NOTES DE SRAFFA POUR WITTGENSTEIN
[04.03.1934]
L’erreur est de considérer l’intuition comme un substitut provisoire de la science : « Quand vous produirez une science satisfaisante, je laisserai tomber l’intuition. » — Science et intuition ne peuvent être en concurrence, car elles se situent sur des plans complètement différents. L’intuition est un mode d’action, la science un mode de connaissance (Physicien).
Les actions ne requièrent pas une justification rationnelle — elles font l’objet d’explications.
Vous essayez de rationaliser l’[les] intuition[s] — et dites que c’est un pis-aller par rapport à la science.
— On trouve un écho de cette remarque de Sraffa dans le passage de The Brown Book qui se trouve quelques lignes avant celui cité dans les notes de l’item 335 : « Ce n’est pas un acte de saisie, un acte d’intuition, qui nous fait employer la règle à la manière dont nous le faisons en ce point particulier de la suite. Il serait moins fourvoyant de parler d’un acte de décision, bien que cela soit aussi égarant, car il n’est pas nécessaire que se produise quoi que ce soit qui ressemble à un acte de décision, et il se peut que seul se produise l’acte d’écrire ou de parler. Et l’erreur que nous sommes enclins à faire dans ce cas, et dans des milliers de cas analogues, est indiquée par le mot “faire”, tel que nous l’avons employé dans la phrase : “Ce n’est pas un acte de saisie qui nous fait employer la règle à la manière dont nous le faisons”, parce que ce mot évoque l’idée que “quelque chose doit nous faire” faire ce que nous faisons. Or cela est en rapport avec la confusion de la cause et de la raison. Nous n’avons besoin d’aucune raison pour suivre la règle comme nous le faisons. La chaîne des raisons a un terme2. »
338. WITTGENSTEIN À SRAFFA
11.03.1934
Cher Sraffa,
J’étais trop épuisé ces deux dernières semaines pour mettre au clair la lettre que je vous ai écrite. Je l’ai fait ce matin (en y introduisant quelques modifications).
Par ailleurs, je pense qu’au lieu de venir prendre le thé avec vous je dois prendre l’air cet après-midi, car je dois faire cours demain et j’ai épuisé presque toutes mes forces. Je ne puis donc rien faire qui ne soit pas nécessaire et qui me mette sous tension. Si je ne vous en ai pas informé plus tôt, c’est parce que j’avais ce matin encore l’intention de venir vous voir, mais qu’après avoir écrit la lettre j’ai eu l’impression qu’il ne serait pas sage de le faire.
Je pars samedi prochain, et je voudrais vraiment vous voir avant, si cela est possible. J’essaierai de passer vendredi prochain à l’heure du thé pour bavarder et vous dire au revoir. Si cela ne vous convient pas, faites-le-moi savoir, s’il vous plaît.
Ludwig Wittgenstein
— Lettre datée par Sraffa au crayon. L’agenda de poche de Sraffa fait état d’une rencontre avec Wittgenstein le 11 mars à 16 h 30 (celle qui est ici annulée) et d’une autre le 16 mars (un vendredi), à la même heure. (La lettre réécrite est vraisemblablement la lettre aujourd’hui perdue à laquelle fait référence la lettre 336.)
339. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Dimanche soir
17.03.1935
Cher Sraffa,
Je veux essayer de formuler ce qui vous irrite dans la pensée des gens de Cambridge et dans la mienne en particulier. Peut-être pourrait-on dire que ce que vous ressentez est de cet ordre : ici, il y a des gens qui essaient de parler d’une manière bizarre « impartialement » de choses qu’ils prétendent être capables de tirer de leur propre peau, et ils parlent comme s’ils pouvaient comprendre les sentiments, les souhaits, les tendances, etc., de tout un chacun. À la manière d’acteurs qui auraient oublié qu’ils ne sont pas les hommes pour lesquels ils se font passer. — Ces gens, lorsqu’ils parlent des revendications des différentes nations, essaient de se mettre à la place de Dieu, d’être impartiaux, etc., ou, s’ils prennent parti, ils adoptent une théorie montrant que leur position est la seule possible — et en l’absence de cette théorie, ils n’oseraient pas prendre parti.
C’est cela que je voulais vous dire par ma comparaison des trois religieux. L’application en était : vous êtes comme un Grec orthodoxe qui dit : « Je préfère un protestant véritable — qui est en désaccord total avec moi — à un homme qui se prétend religieux, mais qui est incapable de nous comprendre, le protestant et moi. »
Je ne dirai qu’une seule chose de tout cela : toute manière de penser convient parfaitement, si toutefois elle n’est pas stupide. Ce qui veut dire que le seul problème est de savoir si ma propre manière de penser va suffisamment loin. Si c’est le cas, elle me fera sortir des profondeurs de la forêt. Tout ce que je redoute est de m’arrêter à mi-chemin. Et je le redoute vraiment. Ma manière de penser convient parfaitement, et je remercie Dieu de m’en avoir fait don. Une autre question est de savoir si j’en fais bon usage. Et, en fait, je sais que ce n’est pas le cas…
— Cet extrait est tiré d’une lettre mise en vente le 22 mars 2006, dans le catalogue 683 de la maison de vente aux enchères Stargardt (Berlin). (La lettre a 2 pages et demie ; le texte reproduit ci-dessus est la partie imprimée dans le catalogue. L’acquéreur a souhaité demeurer anonyme.)
— Daté au crayon par Sraffa. La seule rencontre dont fait état l’agenda de chacun des deux hommes pour mars 1935 est le 1er, à 16 h 30.
340. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Mercredi
[13.07.1935]
Cher Sraffa,
Je voulais vous demander le nom de la préparation contre les punaises dont vous m’aviez parlé. Vous m’aviez dit, je crois, l’avoir emportée en Russie. Pouvez-vous aussi, s’il vous plaît, me dire où l’on peut s’en procurer, si vous le savez. —
Je vous ai dit aujourd’hui que je vous écrirai à un moment ou à un autre, mais je pense qu’il ne serait pas tout à fait naturel pour moi de le faire, sauf si un jour je me rends compte que vous avez raison sur les points essentiels de nos conversations, ou si j’arrive à voir clairement que vous avez tort. Tout ce que je peux dire en ce moment est ceci : il y a quelque chose qui ne va fondamentalement pas chez moi — si un profane qui a de bons yeux regarde un mauvais portrait, il verra qu’il est mauvais et pourra souvent dire d’emblée ce qui, à ses yeux, ne va pas en lui ; il remarquera, par exemple, que le nez est trop long. Le peintre pourra en conclure sans risque que son portrait est mauvais ; mais, s’il raccourcissait le nez, il serait mal avisé. Car voir qu’un tableau est mauvais est une chose, et voir où se trouve la faute en est une autre. — Ainsi, lorsque vous regardez en moi, vous voyez qu’il y a quelque chose qui ne va pas — et j’en suis d’accord —, mais quand vous montrez ce qui ne va pas, il est fort douteux que vous montriez ce qui convient — ce qui n’est peut-être pas vraiment important, puisque de toute façon c’est à moi de faire quelque chose pour le rectifier. Espérons que ce soit réellement faisable, et qu’un jour je me sente bien !
Ludwig Wittgenstein
— Datation par Sraffa au crayon, presque effacée.
— Wittgenstein avait une aversion toute moderne à l’égard des punaises. Il aurait même demandé à son ami Hänsel de lui trouver une chambre qui ne soit pas « infectée de punaises » à Innsbruck, en 1922 — ce dont Russell, en victorien, se serait moqué.
341. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Dimanche soir
[19.07].1935
Cher Sraffa,
J’aimerais déplacer la date de notre rencontre à samedi. — Je crois avoir trouvé la solution au problème dont nous avons parlé. La voici : rien de ce que je dis ne vous intéresse vraiment. Si vous y pensez vraiment, vous verrez que c’est la seule solution possible. Vous aimez discuter avec moi parce que je suis opiniâtre et ingénieux (en un sens), mais il manque l’autre élément nécessaire à une bonne discussion — à savoir que chacun soit en mesure d’apprécier ce que l’autre dit (c’est-à-dire que vous n’appréciez pas ce que je dis, mais l’inverse n’est pas vrai).
En un sens, le plaisir est le lubrifiant de la discussion et, à mes yeux, il est peut-être la seule chose qui possède une valeur véritable dans une discussion. À première vue, il peut paraître extraordinaire que l’absence de plaisir introduise une différence aussi énorme, mais pensez à ce qui arrive à une machine, lorsqu’elle n’est pas lubrifiée. Si tout cela n’évoque rien pour vous, ne soyez pas surpris que ce soit à nouveau moi qui vous parle.
Ludwig Wittgenstein
— L’année est notée par Sraffa. Les agendas de poche des deux hommes montrent qu’une rencontre eut lieu le samedi effectivement suggéré.
342. WITTGENSTEIN À SRAFFA
[Avant le 30.09.1936]
Cher Sraffa,
J’ai pensé qu’il se pourrait que vous n’objectiez pas à avoir de mes nouvelles, et je vous écris donc. Je suis heureux d’être venu ici. La vie que j’y mène me fait du bien, quoiqu’elle ne soit pas facile (ou, plutôt, pour cette raison même). Je vis seul dans une petite maison en dehors du village. Vous ne pouvez pas la voir sur cette carte postale. Je dois m’occuper moi-même de tout dans la maison, ce qui prend pas mal de temps. Mais cela aussi est bon. Mon travail avance passablement bien. Lorsque je suis arrivé, j’étais malade et pendant un certain temps je ne me suis pas rétabli, mais maintenant je vais tout à fait bien. Je pense à vous assez souvent et sans aucun sentiment désagréable. Je pense aussi parfois aux dernières conversations sur l’Espagne que nous avons eues le long des Backs3 et à quel point je me suis trompé. Mon adresse est : Skjølden i Sogn, pour le cas où vous auriez envie de me donner de vos nouvelles. J’espère que vous allez bien et que votre travail avance bien. Faites mes amitiés à Keynes, ainsi qu’à Watson. Dites au second de ne pas être paresseux comme un diable et de me donner de ses nouvelles.
Ludwig Wittgenstein
— Cette lettre a été datée sur la base de l’arrivée de Wittgenstein à Skjølden, le 27 août 1936.
— Fin août 1936, au moment où ses fonctions à Cambridge étaient parvenues à leur terme, Wittgenstein partit vivre dans sa maison de bois norvégienne. Il y travailla d’abord à la version allemande de The Brown Book (texte qu’il avait dicté à Alice Ambrose et Francis Skinner en 1934-1935)4. Mais il abandonna rapidement ce projet de réélaboration et prit un nouveau départ, d’où sortit la première version des Recherches philosophiques.
À l’exception de deux voyages à Vienne et Cambridge (l’un autour de Noël 1936, l’autre de trois mois, l’été 1937), il resta là jusqu’en décembre 1937.
— Sur la carte postale, une flèche part du mot « ici » en direction du bord de la photo et le mot « cette », souligné de deux traits, indique le lac.
— Watson : Il s’agit d’Alister Watson (voir la lettre 160), et non de William Heriot Watson.
343. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd
Mardi [14.01.1937]
Cher Sraffa,
Je vous écris sans savoir si vous êtes ou non déjà remis. Je n’ai moi-même pas quitté le lit en raison d’une grippe, et je suis encore trop faible pour sortir. Je souhaite VRAIMENT BEAUCOUP vous voir.
Pouvez-vous venir à l’adresse ci-dessus demain après-midi, à 16 h ? Je ne peux rester ici que quelques jours de plus.
Ludwig Wittgenstein
— Cette lettre a été datée en référence à la grippe et sur la base des agendas. Wittgenstein rencontra Sraffa, en fait, à 11 h. Le motif de sa visite était, sans aucun doute, une « confession ».
344. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Samedi [16.01.1937]
Cher Sraffa,
Ce mot simplement pour vous dire que j’ai été très heureux de parler hier avec vous. Cela m’a fait du bien et aussi plaisir. J’espère que vous avez également l’impression que les choses se sont bien passées. Merci !
Ludwig Wittgenstein
J’ai eu, cet après-midi, une conversation avec Keynes. Elle ne s’est pas aussi bien passée qu’elle l’aurait pu, et cela est en partie de ma faute.
— Wittgenstein s’était aussi « confessé » à Keynes qui, dans une lettre à son épouse Lydia, décrit la confession qu’il reçut en termes d’« objectif excentrique », en soulignant que Wittgenstein ne semblait vraiment pas aller bien du tout.
345. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Skjølden i Sogn, Norvège
Mercredi 03.03.[1937]
Cher Sraffa,
Je pense souvent à vous et aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous lu Lichtenberg ? Je l’espère, et j’espère aussi que vous l’avez apprécié.
Après mon retour ici, mon travail n’a pas bien avancé, mais je ne puis écrire sur ce sujet en ce moment. Actuellement, je travaille un peu mieux.
Si cela vous est possible, j’aimerais vraiment beaucoup que vous voyiez Skinner. Il n’a personne avec qui parler sensément et sérieusement, et je ne peux m’empêcher de penser que vous voir lui ferait grand bien, même si vous n’avez pas de conversation géniale avec lui. Je pense que le simple fait de vous voir lui ferait du bien.
Transmettez mes amitiés à Keynes et à Watson. J’aimerais avoir des nouvelles de Watson.
Ludwig Wittgenstein
— L’année est notée par Sraffa au crayon.
— Watson : Comme dans la lettre 342 supra, il s’agit d’Alister Watson.
346. WITTGENSTEIN À SRAFFA
36 Chelmsford Rd, Ranelagh, Dublin
12.03.1938
Cher Sraffa,
Merci pour votre lettre. — Je crains que celle que j’entame ne soit longue et plutôt confuse, tout aussi confuse que l’état de mon cerveau. Vous savez évidemment plus de choses que moi des événements récents en Autriche. Il est, selon moi, concevable qu’ils constituent les préparatifs immédiats d’une guerre, et si la guerre se trouve déclarée maintenant, Dieu seul sait ce qui se produira. Mais ce n’est pas cette possibilité-là dont je veux parler. Je suppose plutôt que la guerre n’éclatera pas dans les 6 mois à venir. Et, sur la base de cette supposition, je veux savoir ce que je ferai. Au départ, je projetais de me rendre en Autriche en mai ou juin pour l’une de mes visites habituelles, d’y rester un mois environ, puis de revenir à Cambridge ou à Dublin. Mais au vu de la situation actuelle je me demande (a) si je serai autorisé à repartir d’Autriche dans l’hypothèse où je m’y rendrais, (b) si je serai autorisé à rentrer en Angleterre en revenant d’Autriche. Or la possibilité de quitter l’Autriche tout comme celle de revenir en Angleterre sont, pour moi, d’une importance VITALE. Devoir vivre en Autriche me serait intolérable, et j’ai des amis en Angleterre que je ne veux pas abandonner. Actuellement, j’ai environ 300 ou 400 £ en Angleterre (je n’ai pas d’argent en Autriche) et cette somme me permettra de vivre au moins un an sans devoir prendre un emploi, ce qui dans l’ensemble est bon pour mon travail (c’est-à-dire mon livre). Mais maintenant je pense qu’il est peut-être important que j’essaie d’obtenir un emploi du type charge d’enseignement à Cambridge (je ne veux pas dire un poste d’enseignant, puisqu’il n’y en a pas de libre, mais un ensemble de cours qui me serait payé comme d’habitude). Voici donc l’objet de ma lettre :
1) Si je suis en mesure de dire que j’ai un emploi en Angleterre, ils ne peuvent pas me retenir aussi facilement en Autriche ;
2) Si j’ai un emploi à Cambridge, ils (je veux dire les services de l’immigration britannique) me laisseront revenir en Angleterre ;
3) Si je ne suis pas sans emploi, je pourrai plus aisément trouver un emploi ailleurs et peut-être acquérir une autre nationalité.
Inutile de dire qu’étant d’ascendance juive je ne pourrai pas obtenir de travail en Autriche. (Mais même si j’avais quelque chance d’en obtenir un, je préférerais faire n’importe quoi plutôt que de l’accepter.)
Pour les raisons que je viens de mentionner, je penche pour revenir à Cambridge le trimestre prochain (ou pendant les vacances) afin d’y donner quelques discussions comme je l’ai toujours fait et d’essayer d’obtenir une sorte de charge de cours. J’aurais préféré travailler ici, en Irlande, mais je pense n’avoir à présent aucune chance (peut-être plus tard). D’ailleurs, quand je dis que je pourrais essayer d’obtenir une autre nationalité, c’est à l’irlandaise que je pense. Je ne sais pas si je peux vraiment en expliquer les raisons, mais elles tiennent principalement à ce qu’ici je pourrais être considéré comme un simple réfugié alors qu’en Angleterre, avec un passeport britannique, je serais une sorte d’Anglais de pacotille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et il se peut, de toute façon, que je me trompe. — J’aimerais avoir votre opinion sur mon raisonnement et sur le point de savoir s’il est judicieux et opportun d’essayer d’obtenir un travail à Cambridge*. Je suis désolé de vous déranger avec ce problème ; mais, en fait, j’avais même envisagé de venir en Angleterre spécialement pour vous voir et connaître votre point de vue. Si vous le pouvez, écrivez-moi, s’il vous plaît. J’espère que vous serez encore à Cambridge quand ma lettre arrivera, et j’espère de toute façon vous voir à Pâques, ou après Pâques. Le plus tôt sera le mieux.
Ludwig Wittgenstein
* Ou bien s’il y a là quelque chose de louche.
— Les troupes allemandes entrèrent le 12 mars 1938 en Autriche, et l’Anschluss fut déclaré le 13.
347. SRAFFA À WITTGENSTEIN
King’s College, Cambridge
14.03.1938
Cher Wittgenstein,
Avant d’essayer de discuter, probablement d’une façon confuse, je veux répondre clairement à votre question. Si, comme vous le dites, il est d’une « importance vitale » pour vous de pouvoir quitter l’Autriche et de retourner en Angleterre, il n’y a pas de doute, il ne faut pas que vous alliez à Vienne. Que vous ayez ou non une charge d’enseignement à Cambridge, on ne vous laissera plus en repartir, car la frontière autrichienne est fermée aux Autrichiens voulant quitter le pays. Sans doute cette interdiction sera-t-elle quelque peu assouplie d’ici un mois. Mais il n’y aura aucune assurance, pendant longtemps, que vous soyez autorisé à sortir et, pour ma part, je crois qu’il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas pendant un certain temps. Vous savez très certainement que vous êtes désormais citoyen allemand. Votre passeport autrichien vous sera donc sûrement retiré, après quoi il vous faudra demander un passeport allemand, qui ne vous sera accordé que si la Gestapo juge que vous le méritez, et quand elle le voudra.
Quant à la possibilité d’une guerre, je ne sais pas. Elle peut éclater à tout moment, ou bien nous pouvons avoir encore un an ou deux de « paix ». Je n’en ai réellement pas la moindre idée. Mais je ne parierais pas sur la probabilité de six mois de paix.
Si vous décidez malgré tout de rentrer à Vienne, je pense que : (a) le fait d’avoir une charge d’enseignement à Cambridge augmenterait certainement vos chances d’être autorisé à sortir d’Autriche, (b) il n’y aura pas de difficulté à entrer en Angleterre une fois que vous aurez quitté l’Autriche (l’Allemagne, devrais-je dire), (c) il faudrait que vous fassiez transformer votre passeport en passeport allemand (par les soins d’un consulat allemand) avant de quitter l’Irlande ou l’Angleterre. Je présume qu’ils procéderont à cette transformation sous peu. Vous avez plus de chances d’obtenir un passeport allemand ici qu’à Vienne, et si vous l’avez quand vous partirez pour Vienne, il est plus vraisemblable (ce qui ne veut nullement dire certain) qu’on vous laissera quitter à nouveau l’Autriche.
Il faut que vous preniez garde, à mon avis, à plusieurs choses :
1) si vous allez en Autriche, il faut que vous soyez attentif à ne pas dire que vous êtes d’ascendance juive, sinon ils vous refuseront à coup sûr un passeport ; 2) vous ne devez pas dire non plus que vous avez de l’argent en Angleterre, sinon, une fois que vous serez là-bas, ils pourraient vous obliger à le transférer sur la Reichsbank ; 3) si vous êtes contacté, à Dublin ou à Cambridge, par le consulat allemand, soit pour vous enregistrer, soit pour transformer votre passeport, prenez garde à la façon dont vous répondrez. Un mot imprudent peut vous empêcher pour toujours de revenir à Vienne ; 4) faites bien attention à la façon dont vous écrivez à votre famille, bornez-vous à ce qui est d’ordre purement personnel, car les lettres sont certainement censurées.
Si vous avez pris votre décision, il faut que vous demandiez immédiatement la citoyenneté irlandaise (peut-être votre période de résidence en Angleterre jouera-t-elle en ce sens). Faites-le avant que votre passeport autrichien ne vous soit retiré. Ce sera sans doute plus facile en tant qu’Autrichien qu’en tant qu’Allemand.
Dans les circonstances actuelles, je n’aurais pas de scrupules à demander la citoyenneté britannique si c’est la seule que vous puissiez obtenir sans devoir attendre dix ans de résidence supplémentaires. En outre, vous avez des amis en Angleterre qui pourraient vous aider à l’obtenir, et il est certain qu’un emploi à Cambridge vous permettrait de l’obtenir rapidement.
Je serai à Cambridge jusqu’à vendredi, après quoi mon courrier sera réexpédié en Italie. Il vous faut donc faire attention à ce que vous me dites. Peut-être serez-vous en train d’écrire à un censeur italien.
Mon numéro de téléphone est le 3675. Vous pouvez me joindre avant midi ou le soir après 10 heures.
Piero Sraffa
Veuillez excuser la confusion de cette lettre.
348. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd, Cambridge
30.03.1938
Cher Sraffa,
La situation est en gros la suivante : j’ai, à ce jour, reçu pas mal de lettres de la maison dont aucune ne contient de nouvelles alarmantes concernant mes amis et relations de là-bas. Je pense donc qu’il n’est pas nécessaire que je vous dérange pour aller les voir. L’une de mes sœurs qui est maintenant à New York reviendra à Vienne dans une ou deux semaines, et je me suis arrangé pour la rencontrer à Southampton ou Paris, sur son chemin de retour.
Pour ce qui est de ma naturalisation, rien de défini n’a été fait jusqu’ici pour des raisons trop longues à expliquer dans une lettre. Je n’ai pourtant aucune raison de penser que je n’ai pas de chance véritable. Je n’ai pas encore été contacté par le consulat.
J’ai l’intention de rester ici pendant les vacances et d’attendre une invitation à donner des cours, le trimestre prochain.
Faites-moi savoir quand vous revenez.
Merci pour toute la peine que vous vous donnez pour mon affaire.
Ludwig Wittgenstein
— Cette lettre a été envoyée à Sraffa en Italie, où il s’apprêtait, également pour des raisons politiques, à fermer la maison familiale et à emmener sa mère en Angleterre avec lui.
349. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd, Cambridge
01.04.1938
Cher Sraffa,
Je vous ai écrit il y a 2 jours pour vous dire que vous n’aviez pas besoin de vous déranger pour aller voir les miens, car les nouvelles que j’ai reçues semblent indiquer que tout va bien. Mais si vous allez de toute façon à Vienne, je vous serais reconnaissant de passez chez eux, et de tout leur expliquer à mon sujet.
À bientôt !
L. W.
350. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd
Samedi [20.04].1938
Cher Sraffa,
Ce mot simplement pour vous dire que (a) j’ai eu un mot de Keynes me disant que son avocat l’a prévenu qu’il avait écrit à un officiel du Home Office à mon sujet (ce qui devrait à l’évidence m’aider considérablement) ; (b) j’ai reçu une lettre de ma sœur de Vienne me disant qu’elle était très contente de vous avoir rencontré et d’avoir parlé avec vous.
L. Wittgenstein
Notez donc la dorure autour de cette carte postale. C’est le genre de choses auquel je m’apprête à accéder !
— Cette lettre datée est par Sraffa, qui la trouva à son retour d’Italie, le 17 avril 1938.
351. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd, Cambridge
25.06.1938
Cher Sraffa,
Je vous fais suivre une lettre très décourageante de mon avocat qui m’est parvenue ce matin. Pensez-vous que je doive lui demander s’il y a un quelconque moyen de hâter la procédure ? Je ne le crois pas : probablement est-ce impossible, et dois-je lui être reconnaissant pour tout ce qui a été déjà fait — c’est, je suppose, ce qu’il souhaite me faire savoir. Dans la lettre que je lui ai envoyée, j’ai entièrement laissé tomber le passage indiquant que j’avais de « sérieuses raisons », etc., suite à vos critiques. Je me demande maintenant s’il était judicieux de l’avoir écarté.
J’ai reçu hier une lettre de Pattison qui me dit qu’il a toujours environ 300 £ à moi. Il m’a écrit pour m’informer qu’il a eu bien des soucis personnels ces derniers temps et qu’il n’était pas en état d’écrire.
À bientôt, donc !
Ludwig Wittgenstein
Je me demande si je dois écrire une autre lettre à l’avocat pour lui indiquer les raisons pour lesquelles je souhaite que l’affaire soit réglée aussi vite que possible.
— Voir infra la lettre 533.
352. WITTGENSTEIN À SRAFFA
29.09.1938
Cher Sraffa,
Je ne sais évidemment rien de vos plans — mais j’aimerais savoir si, par chance, vous projetez d’aller apporter votre aide en Tchécoslovaquie, d’une manière ou d’une autre, et si cela ne vous dérangerait pas — à supposer que telle soit votre intention — de me prendre avec vous pour que j’y fasse moi-même quelque chose.
Vous pourriez demander : (a) « Pourquoi diable pensez-vous que je puisse, moi Sraffa, aider la Tchécoslovaquie ? » ; (b) « Pourquoi diable voudrais-je que vous veniez avec moi ? » À ces deux questions je répondrai : je ne sais pas, mais cela ne me paraît pas IMPOSSIBLE.
Je suis en chemin vers l’Irlande. Voici mon adresse là-bas :
Chez Drury
36 Chelmsford Rd
Ranelagh, Dublin
Au CAS où je pourrais vous être utile à quelque chose, j’en serais ravi, et si c’est effectivement le cas, envoyez-moi un télégramme à l’adresse ci-dessus, ou bien à la fois à cette adresse et au 81 East Rd. Je peux vous rejoindre, disons, en Suisse.
Si mon idée n’est qu’un fantasme, c’est sans importance.
Mes bons vœux !
Ludwig Wittgenstein
353. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd
Jeudi [01.12.1938]
Cher Sraffa,
Un nouveau point m’est apparu dont il se peut qu’il soit plutôt important. Si vous acceptez le poste de Trinity — bien que vous ignoriez s’il se révélera bon ou mauvais pour vous sous les rapports dont nous avons parlé —, vous n’ignorez pas qu’il représentera un changement de position qui peut contribuer à vous arracher à vos racines, c’est-à-dire que vous devrez quitter la chaise sur laquelle vous êtes assis pour vous asseoir sur une autre. Cela vous apprendra donc de nouvelles choses, ce qui est un argument pour l’accepter.
En un sens, vous perdrez votre travail et en obtiendrez un autre ; ce qui représente au moins un mouvement. Et, comme je l’ai dit, cela vous apprendra de nouvelles choses, vous fera faire une expérience qu’il vous faut peut-être faire. (Je ne pense pas un instant qu’accepter sur de telles bases soit une erreur. Et il n’y a là rien de désinvolte.) (Je sais ce que l’on peut dire à l’encontre de cela.)
Ludwig Wittgenstein
Maintenant, relisez cette lettre da capo al fine !
— Lettre datée au crayon par Sraffa qui devint fellow de Trinity College le jour même où Wittgenstein fut élu professeur.
— Au sujet des conseils que Wittgenstein lui avait donnés, Sraffa confia ceci à Joan Robinson, le 15 février 1939 : « Wittgenstein m’a conseillé d’accepter, mais il a développé une argumentation compliquée expliquant que s’il me le conseillait, c’était peut-être parce que, ayant lui-même accepté le professorat, il voulait inconsciemment m’entraîner dans une ignominie analogue5. » (Sur l’« ignominie », voir infra la lettre 369 où Wittgenstein exprime sa crainte que Sraffa soit « devenu un Don de Trinity : guindé, distant et inamical ».)
354. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd, Cambridge
12.02.1939
Cher Sraffa,
J’ai été nommé prof[esseur]. J’espère que l’avenir montrera que je n’ai pas eu TORT de me présenter à ce poste ; car ce qui m’y a poussé est pour une grande part (si ce n’est exclusivement) la vanité. — À mes yeux, l’un des désavantages manifestes de cette nomination tient à ce qu’elle vérifie votre prévision et que vous serez donc plus sûr de vous que jamais dans nos discussions à venir. Mais cela m’arrange aussi. Sauf contrordre de votre part, je viendrai vous voir mardi, à l’heure habituelle.
À bientôt !
Professeur Wittgenstein
— D’ordinaire, les rencontres avaient lieu à 13 h 15, mais ce jour-là ce fut à 16 h 30. De façon générale, les deux hommes se rencontraient hebdomadairement pendant la durée des trimestres académiques, à l’heure du déjeuner en 1938-1939 et à l’heure du thé en 1939-1940.
355. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd, Cambridge
15.03.[1939]
Cher Sraffa,
Vous trouverez ci-joint la note de mon neveu et la citation de Spengler.
Ce n’est pas pour cela que je vous écris, mais parce que hier, au moment où je vous ai demandé votre adresse de vacances (de façon à pouvoir vous écrire s’il m’arrivait quoi que ce soit présentant un intérêt), vous avez répondu d’une manière telle que j’ai eu l’impression que vous préféreriez n’avoir pas de mes nouvelles. Si mon impression est correcte (ou presque), j’aimerais que vous me le confirmiez.
S’agissant de la citation de Spengler, je souhaite dire qu’il me paraît sans importance que vous n’en ayez rien tiré, mais qu’en revanche il me paraît vraiment important qu’au moment où je vous l’ai donnée vous ayez réagi en souriant, par un sourire bien particulier. Je dois avouer une fois de plus que je n’aime pas du tout ce phénomène. Il dénote manifestement une attitude dédaigneuse à l’égard de ce que vous ne comprenez pas (attitude que vous-même avez dénoncée plus d’une fois dans nos conversations). Je crois que je n’ignore pas combien votre compréhension est excellente et fiable, mais je pense que son champ d’application est très étroitement circonscrit, et je ne peux pas m’empêcher de croire que vous n’avez pas la moindre idée de cette étroitesse.
Cela, je dois vous le dire, ne porte aucunement atteinte au respect (etc.) que j’ai pour vous. Et si je ne ressentais pas si fortement de tels sentiments à votre égard, je ne prendrais pas l’affaire tant au sérieux. J’espère que ce que je vous dis là ne sonne pas comme un conseil donné par un homme sage à un autre moins sage. (Vous n’ignorez pas ce que je pense de moi.)
Je vous souhaite bonne chance sous tous rapports !
Ludwig Wittgenstein
P. S. Ce matin, mon avocat m’a écrit pour me dire que le sous-secrétaire d’État lui a notifié qu’il est maintenant prêt à me délivrer un certificat de naturalisation s’il reçoit 9 £. Conservez, s’il vous plaît, la note de mon neveu ; je veux dire : ne la détruisez pas.
— John Stonborough avait envoyé non une note au sens propre, mais une carte postale à Sraffa depuis Vienne, pour informer discrètement Wittgenstein que tout allait bien (probablement au sujet de l’affaire des faux passeports auxquels la note de la lettre 114 fait référence). Sraffa l’a conservée. La citation de Spengler qui était adjointe à la carte n’a vraisemblablement aucun rapport avec elle.
— L’idée de « ressemblance de famille » est la contribution la plus évidente de Spengler à la pensée wittgensteinienne. (Ainsi Wittgenstein dit-il à Drury : « Vous ne pouvez pas faire entrer l’histoire dans des moules. Mais Spengler a mis en évidence un certain nombre de comparaisons très intéressantes » (Recollections of Wittgenstein, Rhees éd., p. 113). Mais elle n’est pas la seule. Sur l’influence générale de Spengler sur Wittgenstein, voir A. Janik, Assembling Reminders, The Genesis of Wittgenstein’s Concept of Philosophy, ainsi que la lettre 456.
— Pendant les vacances : Pour Pâques (16 mars-18 avril), quatre rencontres sont indiquées dans les agendas de poche des deux hommes.
356. WITTGENSTEIN À SRAFFA
81 East Rd, Cambridge
01.04.1939
Cher Sraffa,
J’ai reçu ce matin une lettre de mon ami professeur auquel j’avais demandé des informations. Il me dit que la décision sera prise le 5 avril et qu’il semble qu’elle sera favorable. Cette lettre est écrite dans une sorte de code, mais il semble que, dans l’ensemble, les choses pourraient être pires qu’elles ne sont. — J’avais écrit à Adrian la nuit dernière, et il aura donc reçu ma lettre ce matin, s’il est à Cambridge. Je lui ai demandé de me répondre dès que possible. Si je viens vous voir lundi vers 14 h 30, cela vous convient-il ? À bientôt !
Wittgenstein
— Mon ami professeur : Sans aucun doute Ludwig Hänsel.
— Wittgenstein évoque ici les poursuites dont deux de ses sœurs firent l’objet pour avoir accepté des documents contrefaits afin d’essayer d’obtenir la nationalité yougoslave. Dans une lettre du 8 avril que B. McGuinness n’a pas incluse dans Wittgenstein in Cambridge, Wittgenstein dit à Sraffa avoir reçu une carte postale lui confirmant tout cela. (Un appel contre l’acquittement des membres de sa famille inculpés avait été déposé, puis retiré, mais ces deux faits n’étaient pas connus de lui.)
— Adrian : Le dernier directeur de Trinity College, consulté à propos du choix d’un médecin pour le diabète (voir la lettre 366).
357. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Carte postale (envoyée de Vienne) [Cachet de la poste 03.07.1939]
Cher Sraffa,
Jusqu’ici, tout va bien pour moi, mais je m’inquiète énormément pour mes sœurs. Je vous serais très reconnaissant de me transmettre toutes les nouvelles que je dois, selon vous, connaître et que je ne connais pas, si nécessaire par télégramme. Transmettez, s’il vous plaît, mon meilleur souvenir à votre mère.
Ludwig Wittgenstein
358. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Vienne IV, Argentinierstrasse 16
03.07.[1939]
Cher Sraffa,
Il se peut que je doive partir d’ici dans deux ou trois jours et que j’arrive à Londres le 7 pour prendre l’Aquitania qui part de Southampton pour New York le 8. En ce cas, je n’aurai pas le temps de passer prendre de l’argent à Cambridge pour payer le billet, et je crains de devoir vous demander de m’expédier 60 £ (par chèque ou autrement) quelque part à Londres. Je suppose que le mieux serait que vous me les envoyiez poste restante et que vous me télégraphiiez le lieu où je peux les retirer. Il n’est pas encore certain que j’aille à New York, mais il faut que l’argent soit prêt, au cas où j’y partirais.
Je vais vraiment bien. Si je dois partir, je vous télégraphierai, et soit je pourrais venir pour quelques heures à Cambridge, soit nous pourrions nous rencontrer à Londres, si cela vous convient.
Tous mes meilleurs vœux. Transmettez, s’il vous plaît, mon meilleur souvenir à votre mère.
Ludwig Wittgenstein
— En fait, Wittgenstein se rendit à Berlin le 5 juillet, sans aucun doute pour des négociations imprévues avec la Reichsbank. Il revint à Vienne le 7, d’où il repartit le 9, pour arriver à Cambridge le 10. Et ce n’est que le 12 qu’il s’embarqua pour New York, sur le Queen Mary.
359. SRAFFA À WITTGENSTEIN
[05.07.1939]
Envoie ce qui est requis aux bons soins de M. Wintach, Swiss Bank, 99 Gresham St, Londres EC2. Sraffa [au] professeur Ludwig Wittgenstein, Neuwaldeggerstr. 38, Vienne 17.
— Brouillon du télégramme expédié en réponse à la lettre 358, qui était initialement codé : « Pour le billet, appeler Marcel [Wintach, etc.] »
360. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Carte postale 24.07.1939
Cher Sraffa,
Simplement pour vous dire que les choses se passent très mal là-bas. Je pars demain pour Zurich où se poursuivent les conférences. Ici, il fait une chaleur d’enfer, et tout évoque pour moi l’enfer de bien d’autres manières encore.
Ludwig Wittgenstein
Mon adresse : Poste restante, Zurich.
— La carte est une représentation de l’hôtel Shelton de New York qui donne vraiment des frissons !
— Wittgenstein se rendit à New York pour tenter une médiation entre son frère Paul et ses sœurs qui n’étaient pas du tout d’accord sur les concessions qu’il était possible de faire à la Reichsbank pour bénéficier d’une immunité relative eu égard aux lois raciales (et autres) qui s’appliquaient à l’Autriche annexée. (Pour plus de précisions, cf. D. Edmonds et J. Eidinow, Wittgenstein’s Poker, Londres, Faber, 2001.) Voir aussi « Rediscovered Score Pianist’s Last Legacy », Chicago Tribune (11 août 2002), compte rendu spécial de Howard Reich, qui contient bien des informations intéressantes tirées des papiers de Paul Wittgenstein (la seule source d’information disponible en attendant l’étude à laquelle travaille M. Alexander Waugh).
361. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Hôtel New Inn, Pontypridd, pays de Galles
Dimanche matin
[Cachet de la poste 03.09.1939]
Cher Sraffa,
Je suppose que vous êtes maintenant de retour à Cambridge. Je suis venu ici pour voir Drury. Mais ce ne sont pas des vacances, car je ne vais pas très bien, et ce qui se passe en ce moment suffirait à rendre malade un homme bien portant. Ci-joint une photo que je souhaite que vous conserviez. Je n’ai presque aucun espoir que le pire ne se produise pas. Si la paix est déclarée en Pologne, je ne sais pas ce que je ferai. J’espère en tout cas vous voir prochainement.
Ludwig Wittgenstein
— L’Allemagne avait envahi la Pologne le 1er septembre, et la Pologne lui déclara la guerre le 3, avant l’heure indiquée sur le cachet de l’enveloppe (8 h 15).
— La photo (retrouvée dans les papiers de Sraffa) est tirée du quotidien du jour et accompagnée de la mention : « Le roi se rend à Downing St. » Elle montre le Premier ministre faisant la revérence en prenant la main du roi Georges VI, jeune et souriant.
362. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Trinity College
Mercredi [Janvier 1940]
Cher Sraffa,
a) Je pense qu’il vaut mieux que je ne vienne plus chez vous le mercredi. La raison en est qu’à présent nous ne disposons pas de matériaux suffisants dont nous pourrions discuter avec succès.
b) Au lieu de ces rencontres, je préférerais que nous nous voyions à l’occasion après le Hall, le risque étant que vous pourriez ne pas y venir, ou être occupé, etc.
c) Le désavantage de cette solution, c’est que je ne verrai pas votre mère. Or je souhaite vraiment la voir. Je me demande si elle aurait la gentillesse d’accepter que je la voie parfois, disons, pour le thé. Pourriez-vous le lui demander ?
d) Si je n’ai pas de réponse de vous, je considérerai que tout est OK de votre côté.
À bientôt !
Votre Ludwig Wittgenstein
Je vous ferai passer le livre de Hardy quand je le récupérerai, dans quelques jours.
— Les rencontres régulières du mercredi ont cessé après le trimestre d’automne 1939. Il y en eut les 7 et 28 février, et les 17 et 24 avril. Six autres sont aussi notées dans l’agenda de Sraffa, pour le trimestre de printemps.
— Le livre de Hardy : A Mathematician’s Apology, publié en 1940 par Cambridge University Press. L’annonce de ce livre par l’éditeur fait partie de la collection de non-sens de Wittgenstein, qui dit par ailleurs, en 1944 (dans le MS 124), que les remarques sur la philosophie des mathématiques contenues dans le livre lamentable (elenden) de Hardy ne sont pas de la philosophie, mais pourraient et devraient constituer, au même titre que les effusions (Ergüsse) de ce genre, des matériaux bruts pour philosopher.
363. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Trinity College, Cambridge
26.07.1940
Cher Sraffa,
Je vous ai fait envoyer par un libraire The Thin Man [L’homme maigre], une histoire de détective dont je vous ai parlé il y a quelques mois. Lisez-la et n’ayez pas honte de l’aimer, même si vous savez que je l’ai aimée. J’ai vu votre mère à plusieurs reprises. Elle semble aller bien et n’être pas du tout dépressive.
Hutt a été mobilisé.
J’ai d’excellentes nouvelles de ma sœur qui est à New York.
Je suis et me sens comme à l’ordinaire.
Ludwig Wittgenstein
— Sraffa reçut cette lettre et le livre de Dashiell Hammett sur l’île de Man où il fut interné (en tant qu’étranger ennemi) de juillet à octobre 1940. (À la différence de Wittgenstein, il ne chercha jamais à se faire naturaliser.)
— Rowland Hutt était un ami proche de Francis Skinner.
364. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Trin. Coll., Cambridge
08.01.1941
Cher Sraffa,
Je crains que cette lettre ne traîne en longueur, mais plutôt que de ne pas l’écrire du tout, je crois préférable de l’écrire maladroitement et longuement. Hier soir, quand nous étions chez vous, j’ai fait une remarque dont je ne crois pas que vous l’ayez comprise, car je m’exprimais mal, mais dont je souhaite que vous la compreniez. J’ai dit que mon cerveau s’était détérioré, et j’ai ajouté que vous non plus, vous ne pensiez pas vraiment — tout comme si je pensais que ces deux choses se trouvaient sur le même plan. — Mais je ne le pense pas. La détériorisation de mon pouvoir de penser me paraît être quelque chose de permanent, comme si elle avait des causes physiologiques. En revanche, le déclin de votre capacité de penser que j’ai cru observer est quelque chose à quoi l’on peut remédier et sur quoi il faut donc attirer votre attention. Ce n’est qu’assez récemment que j’ai cru l’apercevoir. Son symptôme est qu’actuellement vous n’êtes pas capable de faire décemment face à une contradiction forte, je veux dire à la contradiction de quelqu’un qui se méfie de votre raisonnement — lequel me paraît être très fréquemment confus et superficiel. Certes, nous avons tous tendance à aller dans cette direction, mais vous, vous avez l’habitude de considérer la contradiction comme un remède — par contradiction, je n’entends pas l’expression d’un désaccord courtois, mais un défi ! Bien que vous n’ayez pas toujours pris les choses de bonne grâce (mais qui le ferait ?), vous n’aviez pas l’habitude, face à la contradiction, de vous débattre et de porter des coups à la manière de certains animaux. La première fois où j’ai remarqué ces coups — votre façon de parler d’une manière EXTRÊMEMENT offensive —, je n’ai pas été en mesure de les interpréter correctement (je ne le fais peut-être pas maintenant non plus, mais je pense que oui). On pourrait m’adresser l’objection suivante : « Comment W. peut-il juger de la réaction de Sraffa à la contradiction, étant donné qu’il a vu comment il réagissait à son égard, et non à l’égard de qui que ce soit d’autre ? » — Ma réponse est que, de mon point de vue, quiconque n’est pas en mesure de soutenir une discussion ardue avec moi, à 1 000 contre 1, est incapable de soutenir aucune discussion ardue. Je ne nie certes ni que ma façon de discuter soit fréquemment désagréable et exaspérante, ni qu’elle soit répréhensible, mais l’expérience m’a montré que ceux qui souhaitent aller au fond des choses me supportent avec mes mauvaises qualités, parce qu’ils me trouvent très utile.
Je crois donc que ce ne sont pas seulement ces qualités-là qui vous exaspèrent dans nos discussions — au point de rendre aujourd’hui impossible toute discussion profonde. Pour le dire brutalement : la cause de votre exaspération est que vous êtes devenu, d’une certaine manière, mou. — Je ne sais pas pourquoi il en est ainsi ; mais j’ai pensé que c’était peut-être parce que aujourd’hui beaucoup plus de gens vous admirent qu’il y a quelques années ; et lorsque nous avons parlé des mauvais effets de l’admiration sur le professeur Hardy, je n’ai pas seulement pensé à moi comme autre exemple, mais aussi à vous.
Il se peut, évidemment, que je me TROMPE TOTALEMENT. Si c’est le cas — il n’y a aucun mal à ce que je vous aie dit ce que je pensais. Si ce n’est pas le cas, il n’y a pas non plus de mal, et il s’ensuit donc logiquement qu’il n’y a de toute façon aucun mal.
Je suis dans de bonnes dispositions
Ludwig Wittgenstein
— Smythies se souvient d’avoir entendu Sraffa dire : « Je ne me laisserai pas persécuter par vous, Wittgenstein6. »
365. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Nuffield House, Guy’s Hospital
Londres S.E.I.
Mardi [04.11].1941
Cher Sraffa,
Jusqu’à présent, j’ai eu beaucoup de chance ici. Le travail que je fais est exactement celui que je souhaitais. Je crois que je le fais vraiment bien. Je travaille de 8 h 30 à 16 h 30 ou 17 h et, quand j’ai fini, je me sens extrêmement fatigué. J’ai trouvé un excellent professeur : un garçon (de 20 ans) qui s’occupe de moi et qui me montre ce qu’il y a à faire. Ma tâche consiste à transporter ici et là des médicaments, des bandages, etc., et à préparer des onguents et autres choses de ce genre. Lorsque je m’en suis acquitté, je n’ai presque plus aucune force pour penser à quoi que ce soit. Si je suis en bonne santé et que je reprends quelques forces physiques, il se peut que cela change. Je loge avec les médecins (voir l’adresse ci-dessus), dans un appartement confortable, mais modérément calme. — Ryle est très gentil avec moi. Les autres médecins que j’ai rencontrés paraissent guindés et peu attrayants. J’ai aimé tous les travailleurs que j’ai rencontrés.
Le seul problème sérieux et désagréable est que je fais de mauvaises nuits. En dépit (ou peut-être à cause) de ma grande fatigue, je dors mal, ce qui a un mauvais effet cumulatif. Je dois prendre du Phanodorm, ce que je déteste.
Vous m’avez dit un jour que je pouvais vous écrire si je souhaitais que vous m’envoyiez quelque chose. Je fais aujourd’hui usage de votre offre. Allez, s’il vous plaît, chez Couson, le pharmacien, et achetez-moi un flacon de Sedin (si possible le grand, qui coûte 6,6 [shillings]). Il en a probablement mis un de côté à mon intention, il faut donc que vous lui disiez qu’il est pour moi. Je vous rembourserai quand je viendrai à Cambridge.
Transmettez mes meilleurs vœux à votre mère. Je serai à Cambridge le week-end de la semaine prochaine, et j’essaierai de vous voir.
Ludwig Wittgenstein
— Lettre datée sur la base de la lettre suivante de Wittgenstein.
— Le garçon qui s’occupe de moi : Roy Fouracre, voir la lettre 390.
— Ryle : John Ryle (1889-1950) qui fut d’abord professeur de physique (c’est-à-dire médecin) à Cambridge, puis professeur de médecine sociale à Oxford. Il dirigeait alors le service d’urgences médicales (principalement dans le cadre des attaques aériennes) du Borough (Southwark) et logeait au Guy’s Hospital.
— Phanodorm… Sedin : Les somnifères qui étaient encore disponibles.
366. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Nuffield House, Guy’s Hospital, S.E.I.
Mercredi [20.05.]1942
Cher Sraffa,
Je vous saurais gré de déposer la lettre ci-jointe dans la boîte aux lettres du Dr Nourse. C’est une lettre importante, et je ne connais ni le numéro de sa maison ni son prénom. Je me lève maintenant assez longuement pendant la journée, mais je suis épouvantablement faible, en outre ma tête et mon dos me causent toujours des tracas qui me rendent passablement misérable. Je suis à nouveau dans ma chambre à Nuffield House. Il faudra probablement que j’y reste au moins une semaine avant de pouvoir bouger, monter les escaliers, etc. Transmettez mes meilleurs vœux à votre mère.
À bientôt !
Ludwig Wittgenstein
— Cette lettre a été datée sur la base du fait que Wittgenstein a regagné Nuffield House le 16 mai.
— Le Dr Nourse (médecin à Cambridge) avait été préféré au Dr Bevan lorsque Adrian (voir supra lettre 356) avait recommandé un praticien local pour la surveillance du diabète présumé de Wittgenstein (dont il ne semble pas avoir souffert).
367. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Trinity College, Cambridge
Mercredi [20.12.1944]
Cher Sraffa,
Je souhaiterais faire certaines remarques au sujet de notre conversation de l’autre nuit.
1) Je suis orgueilleux et il m’est difficile d’admettre que je me trompe, ou qu’un argument me désarçonne ;
2) Je suis très peu clair sur bien des choses, et estime qu’il est difficile de faire des remarques utiles ;
3) Je pense que l’on doit dire en ma faveur que j’aspire à une discussion plus sérieuse et plus profonde et que, lorsque je m’effondre, j’essaie du mieux que je peux de me relever et de me remettre à marcher.
II. À votre sujet.
1) Vous m’êtes supérieur, car vous êtes beaucoup moins orgueilleux ;
2) Vous êtes moins maladroit que moi et ne trébuchez pas aussi facilement ;
3) Contrairement à moi, vous semblez moins vous soucier de savoir si vous avez raison ou tort que de rester sur vos positions. Et cela vous est possible parce qu’il vous est très facile de contrer l’attaquant. Sous ce rapport, votre habileté constitue un danger pour vous, et j’ai tendance à penser que ce danger est grave. En pareil cas, il n’y a qu’un remède. Vous devez aider votre interlocuteur (à supposer qu’il ait quelque répondant) à vous attaquer s’il ne le fait pas correctement. Il vous faut le secourir s’il trébuche, au lieu d’essayer de le faire trébucher. Et cela, non par égard pour lui, mais pour vous donner la chance de voir s’il n’y a pas, en définitive, quelque chose d’erroné dans vos propres idées.
En vous redisant tous mes meilleurs vœux, toujours
Ludwig Wittgenstein
— Des étiquettes de « Meilleurs vœux » sur des thèmes de Noël ont été collées sur cette lettre.
— Sraffa a noté au crayon sur cette lettre l’année et le mois ; et son agenda de poche montre qu’il a rencontré Wittgenstein les mardis 12 et 19 décembre. La présence des étiquettes de Noël semble indiquer que cette lettre fait référence à la seconde rencontre.
368. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Trinity Coll.
01.11.[1945]
Cher Sraffa,
Diverses pensées qui m’ont récemment traversé l’esprit me conduisent à vous écrire cette note. Comme vous le savez, les chemins que nous avons pris chacun ces dernières années font qu’il nous est impossible d’entretenir des conversations profitables (ou agréables). Mais nous n’avons pas la moindre rancœur à l’encontre l’un de l’autre (en fait, c’est tout le contraire). Aussi veux-je vous faire savoir que, s’il y a quoi que ce soit dont vous souhaitez que vous parlions ou que je puisse faire pour vous, je serai toujours très heureux de vous rendre service. Je sais, bien sûr, qu’il est peu probable que cela se produise, mais sait-on jamais.
Transmettez, s’il vous plaît, mes sincères salutations à votre mère.
Ludwig Wittgenstein
— L’année où a été écrite cette lettre est incertaine, mais il est probable que ce soit après 1942.
369. WITTGENSTEIN À SRAFFA
10.10.1947
Cher Sraffa,
Lorsque je vous ai quitté ce matin, j’ai eu une forte impression extrêmement bizarre. — Comme vous savez, il y a quelques années, nous étions ce que je nommerai des « amis ». Il est inutile que je vous reparle de nos multiples conversations, de leurs difficultés et de leurs bons effets. Tout cela, vous le savez. Vint ensuite un moment où je vous ai de plus en plus tapé sur les nerfs et où nos conversations sont devenues moins fructueuses. Vous avez alors très naturellement réagi par une certaine violence, qui, ajoutée aux circonstances extérieures, a eu pour conséquence que nous nous sommes rencontrés de moins en moins souvent. Puis, il y a eu vos débordements vraiment durs (aux alentours de 1940, je crois) qui m’ont considérablement blessé et mis en colère. Au bout d’un certain temps, mon sentiment a peu à peu changé. J’ai commencé à m’attendre à une certaine inimitié de votre part, et à ressentir moins d’amitié pour vous, particulièrement quand il m’est apparu que vous ne désiriez plus être secourable, lorsque je m’adressais à vous pour avoir votre avis, etc. De proche en proche, il m’a semblé que vous deveniez un Don de Trinity, rigide, distant et inamical. Pendant longtemps, je n’ai pas pu croire à ce changement. Je me disais sans cesse que ce qui arrivait était simplement que je vous tapais de plus en plus sur les nerfs. Mais cela ne semblait pas expliquer entièrement votre comportement. Car les gens — si toutefois on ne les déteste pas ouvertement — ne sont pas nerveusement ébranlés, lorsqu’on ne les voit que quelques minutes, de temps à autre. — Je me souviens, par exemple, de vous avoir croisé une fois dans la pièce des catalogues de la bibliothèque de l’Université. Vous regardiez la petite carte qui se trouve au milieu du sol, et je me suis approché de vous en vous disant quelques mots (je ne sais plus à quel sujet). Vous m’avez signifié verbalement et par le regard que vous ne souhaitiez pas être dérangé à ce moment-là (j’ai supposé qu’il y avait quelque chose que vous redoutiez d’oublier). Mais tout le problème est que vos gestes, votre ton et votre regard étaient EXACTEMENT ceux d’un maître d’école irritable qui essaie de faire savoir au garçon qui l’agace de ne pas le déranger. Et cela me paraît vraiment extraordinaire, car vous êtes un homme qui a de bonnes manières et qui est bien élevé. Or, ce matin-là, votre comportement était d’une grossièreté terrible — que je ne puis m’expliquer. Il ne m’a pas blessé, bien qu’il ait été évidemment très désagréable. Et j’ai pensé que je pouvais aussi vous en parler, d’autant que je quitte Cambridge. J’espère que vous ne me comprendrez pas de travers et n’irez pas croire que je viens me plaindre. Ce que je veux dire est ceci : si, pour une quelconque raison, vous avez maintenant de l’aversion pour moi (ce que je comprendrais), votre comportement est certes déplaisant, mais compréhensible et il n’a rien d’alarmant ; mais si vous ne m’aimez pas particulièrement et que vous n’avez pas non plus d’aversion à mon égard, alors votre comportement me paraît très alarmant. En ce cas, je vous dirais : veillez, je vous en prie, à ne pas devenir complètement inhumain ! — Cette lettre repose peut-être sur une méprise, mais elle n’est certainement pas écrite sur un mode vindicatif. J’ai eu comme l’impression de voir quelque chose de sinistre, et je voulais vous le dire.
Ludwig Wittgenstein
370. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Mercredi [05.11.1947]
Cher Sraffa,
Ce mot simplement pour vous dire qu’il est inutile que vous alliez à la banque retirer les paquets contenant mes manuscrits, etc. Je les ai remis hier à ma sœur qui passait par Londres sur son chemin vers l’Amérique. Elle vous adresse, à vous-même et à votre mère, ses meilleures salutations.
L. Wittgenstein
— Lettre datée au crayon par Sraffa.
371. WITTGENSTEIN À SRAFFA
Strathaird, Lady M[ar]g[are]t Rd, Cambridge
Lundi [11.07.1949]
Cher Sraffa,
Presque aussitôt après vous avoir téléphoné, j’ai eu quelque raison de penser que vous aviez peut-être mal compris ce que j’avais dit.
Voici ce qui s’est passé : j’ai dit à von Wright (qui était à côté de moi pendant que je vous téléphonais) que vous m’aviez fait une réponse plutôt bizarre, et je lui ai expliqué le motif de mon appel. Il m’a dit : il n’y a là rien de surprenant, puisque vous lui avez dit que vous n’aviez pas écrit parce que ce qui est arrivé n’avait aucun sens pour vous. Von Wright avait compris que je vous avais dit : « Je n’ai pas écrit parce que ce qui est arrivé n’a aucun sens pour moi » alors que je vous disais, au téléphone, très maladroitement : « Ce n’est pas parce que ce qui est arrivé n’a aucun sens pour moi que je n’ai pas écrit. » — Si je vous dis tout cela, c’est que je ne veux pas vous offenser par une expression maladroite comprise de travers. À supposer que vous ayez vraiment mal compris ce que j’ai dit.
Je veux ajouter que j’ai commencé à répondre à votre lettre aussitôt que je l’ai reçue, mais que j’ai déchiré ce que j’avais écrit, car j’ai découvert que je ne parvenais à dire que des banalités et que vous saviez exactement comment je me sentais. Je ne veux pas dire que quiconque n’aurait pas pu faire mieux, ni peut-être moi-même, dans des circonstances différentes, par exemple, si nos langages (le vôtre et le mien) étaient plus proches, si nous en savions plus l’un sur l’autre, et si je n’avais pas été malade et déprimé au moment où cela est arrivé. — Si je vous ai téléphoné aujourd’hui, c’est parce que j’ai senti que je devais vous dire maintenant quelque chose, si nous décidions de nous rencontrer. Mais ce n’est pas sorti.
Si cette lettre n’a pas lieu d’être, je ne regretterai pas de l’avoir écrite.
L. Wittgenstein
— Lettre datée au crayon peu lisible par Sraffa. Wittgenstein était alors installé chez von Wright, et le 11 est le seul lundi possible, d’autant que la mère de Sraffa est morte le 25 juin, date à laquelle Wittgenstein était encore en Irlande. (Il semble, du reste, avoir éprouvé de la répugnance à écrire une lettre de condoléances, tout comme lors de l’assassinat de Schlick, où il transmit ses condoléances par l’intermédiaire de Waismann.)
— Il est peu probable que la conversation téléphonique ait été mécomprise par Sraffa, mais une autre caractéristique de Wittgenstein était de considérer toute inexactitude minime comme une faute. Il lui est même arrivé, par exemple, de s’excuser d’avoir menti parce qu’il avait dit avoir vu quelqu’un à qui il avait en fait téléphoné (lettre à Mme Stewart de novembre 1938).
372. WITTGENSTEIN À SRAFFA
1107 Hanshaw Rd
Ithaca N.Y., U.S.A.
23.08.1949
Cher Sraffa,
J’ai reçu votre lettre à Londres quelques jours avant mon départ. J’étais occupé et en mauvaise santé, aussi n’ai-je pas pu y répondre. Certes, votre lettre n’appelle pas vraiment une réponse, mais il y a quelque chose que je souhaite vous dire. J’en suis venu très lentement dans ma vie à la conviction que certaines personnes ne peuvent pas se comprendre ou, du moins, qu’elles ne le peuvent que dans un champ très étroitement circonscrit. En ce cas, chacune tend à penser que l’autre ne veut pas comprendre, ce qui provoque des malentendus SANS FIN. Évidemment, cela n’améliore pas le caractère amical de leurs échanges. Je pourrais entrer dans le détail en ce qui nous concerne, mais je ne le veux pas. La situation générale est cependant telle que l’un estime que l’autre pourrait le comprendre s’il le voulait, qu’il devient brutal ou méchant (en fonction de son caractère), et qu’il croit ne faire que rendre des coups. C’est ainsi que les choses commencent. —
Pour comprendre pourquoi il est impossible ou presque à certaines personnes de se comprendre, il faut penser, non aux rares occasions dans lesquelles elles se rencontrent, mais aux différences existant entre leurs vies considérées dans leur ensemble ; or, rien ne peut être plus différent que vos intérêts et les miens, vos mouvements de pensée et les miens. C’est en vérité un véritable tour de force qui nous a permis de discuter ensemble, il y a des années, quand nous étions plus jeunes. Et si je vous comparais à une mine d’où j’ai extrait des pépites, je dirais que mon labeur a été extrêmement pénible, mais que ce que j’en ai extrait en valait la peine. Mais il est naturel qu’ensuite, quand nous n’avons plus été à même de nous donner quoi que ce soit (ce qui ne veut pas dire que chacun ait bénéficié de tout ce que l’autre possédait), il n’y ait plus eu, entre nous, qu’une absence presque totale de compréhension ; à quoi s’est ajouté pendant longtemps, du moins de mon côté, le désir que la compréhension soit à nouveau possible.
Je pense que ces difficultés sont à imputer, en partie, au fait que j’ai été très lent à reconnaître un certain changement et à en prendre la mesure. Je me dis souvent à moi-même, mais aussi aux autres : « Les choses ont changé », mais en même temps je continue à agir (peut-être par faiblesse) comme si elles n’avaient aucunement changé. Ce qui suscite bien des difficultés.
Cette lettre a une résonance plutôt professorale !
Ludwig Wittgenstein
Plus je vieillis, plus je me rends compte à quel point il est difficile aux gens de se comprendre, et plus je pense que le fait qu’ils se ressemblent tant les induit en erreur. Si certains ressemblaient à des éléphants, et d’autres à des chats ou des poissons, nous n’escompterions pas qu’ils se comprennent, et les choses apparaîtraient bien plus comme elles sont en réalité.
373. WITTGENSTEIN À SRAFFA
27 St John Street, Oxford
Lundi [10.07.1950]
Cher Sraffa,
Je vous remercie vivement pour les « Antiphones » ! Il ne m’a pas encore été possible de les essayer, car j’ai dû aller à Londres ce week-end. Ici, à Oxford, l’agression est presque insupportable ! Je souhaite aller à Cambridge dans une dizaine de jours, notamment parce que je veux voir mon médecin avant mon départ pour la Norvège. Vous m’aviez indiqué le jour où vous quittez Cambridge, mais je crains de l’avoir oublié. J’espère que vous y serez encore à mon arrivée. — Je n’ai pas lu les journaux depuis longtemps, si ce n’est les titres, mais aux yeux d’un profane les choses semblent considérablement dangereuses, comme si une guerre pouvait éclater prochainement.
Excusez mon écriture. Parfois mes mains ne m’obéissent pas.
Ludwig Wittgenstein
374. WITTGENSTEIN À SRAFFA
27 St John Street, Oxford
Mardi [24.10.1950]
Cher Sraffa,
Merci à vous pour The Listener. Rhine est l’un de ceux qui me rendraient sceptique sur la loi de la gravitation, s’il m’en disait quelque chose. Mais il n’est pas suffisamment concentré pour être très amusant. Si vous le rencontrez, dites-lui, s’il vous plaît, que, s’il veut rentrer dans ma collection de non-sens, il lui faudra comprimer un peu plus ses sottises. Néanmoins, il ne faut pas être ingrat.
Je voulais vous voir à nouveau avant de quitter Cambridge, mais cela ne m’a pas été possible. J’espère vous revoir.
Ludwig Wittgenstein
— The Listener : Hebdomadaire de la BBC qui publia, dans son numéro 43 de 1950, un article de J. B. Rhine sur la science et la recherche psychique intitulé « Can The Mind Span Space and Time ? [L’esprit peut-il traverser l’espace et le temps] ». Cette lettre a vraisemblablement été écrite le mardi suivant la parution de ce numéro.
— Joseph Banks Rhine (1895-1980), professeur à Duke University, Durham (Caroline du Nord), est l’inventeur de la parapsychologie et de l’expression « perception extra-sensorielle ». (La collection de non-sens de Wittgenstein contient de nombreux éléments relatifs au spiritisme et à la recherche psychique.)
1. Cf. « Le Cahier brun », in Le Cahier bleu, le Cahier brun, p. 225-226 (trad. mod.).
2. Le Cahier brun, op. cit., p. 225 (trad. mod.).
3. À Cambridge, on nomme « Backs » la zone de promenade située à l’arrière des Collèges, le long de la rivière Cam. (N.d.T.)
4. La partie traduite par Wittgenstein et une traduction du reste du texte sont aujourd’hui publiées in Eine philosophische Betrachtung (Schriften, vol. 5). (É. R.).
5. Cette lettre, tout comme la plupart des éléments relatifs à Sraffa, a été communiquée à B. McGuinness par le Dr Gary Montgiovi. (É. R.)
6. Communication de Frank Cioffi à B. McGuinness. (Éd.)